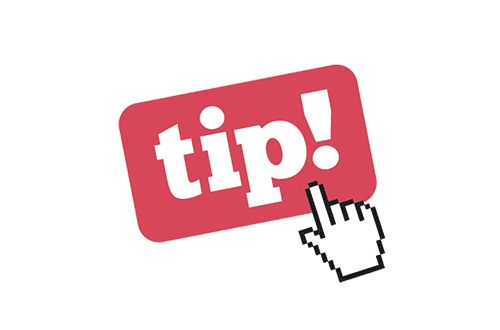-
Par fab75du31 le 31 Janvier 2020 à 13:46
Le lendemain, vendredi, je me réveille avec une gueule de bois, l’humeur maussade. Je n’ai aucune raison de me sentir à ce point au fond du trou, mais c’est pourtant le cas. Je n’arrive pas à me débarrasser de ce sentiment de mal-être.
Je passe la matinée à écouter les deux cd de Starmania. Je retrouve le bonheur de la première écoute à la radio. Je découvre d’autres chansons que je ne connaissais pas. Pour la première fois, j’écoute toute l’histoire en continu, et je suis frappé par son intense beauté. Par les mélodies, les arrangements, les voix. Et les textes, surtout les textes. Prémonitoires, parodiant et critiquant avec finesse et acuité notre monde moderne.
Entre deux chansons, je pense à Jérém.
Entre deux autres, je pense à Thibault. Toujours pas de coup de fil. J’ai toujours du mal à accepter d’avoir perdu son amitié. Quel gâchis !
L’après-midi, je vais courir sur le canal. Ça me fait du bien. En quelque sorte, je le retrouve, après l’avoir pas mal lâché depuis quelques semaines. Et je lui dis également au revoir, car je sais que je ne le reverrais pas de sitôt.
Le soir, je vois ma cousine dans un bar en ville.
Elle veut tout savoir de mon week-end à Campan. Elle est vraiment heureuse pour moi. J’adore ma cousine Elodie.
« Alors, qu’est-ce que tu avais à m’annoncer de si mystérieux ? » je finis par lui demander, alors qu’elle semble tourner autour du pot.
Elle sourit, elle prend une grande inspiration, et elle me balance :
« Je suis enceinte ».
« Quoi ? »
« Tu es la première personne à qui je le dis ».
Je suis assommé. Je n’arrive pas à réaliser que ma cousine va être maman.
« Mais de combien ? ».
« Mais non, je blague ».
« Conasse ! Alors, crache le morceaux ».
« Regarde » fait-elle, en me montrant une bague avec un petit diamant.
« Elle est belle. Tu voulais me voir juste pour m’annoncer que tu as une nouvelle bague ? ».
« Mais qu’il est con ! Philippe a fait sa demande le week-end dernier ! ».
« En mariage ? ».
« Non, en divorce ! ».
« Déjà, après deux mois à peine ? ».
« Oui, je sais, c’est rapide, mais c’était une évidence entre nous. Je n’ai jamais été aussi bien avec un gars. Et Dieu sait que j’ai fait un certain nombre de crash tests… et puis, au pieu… ».
« Ok, ok, j’ai compris ! je suis très content pour vous, pour toi ».
Je me lève et je m’approche d’elle pour lui refaire la bise et la serrer fort dans mes bras.
« Je vais me marier mais ça ne doit rien changer à notre relation. Tu seras toujours mon petit cousin adoré et je serai toujours là pour toi ».
« J’espère ».
« Tu peux y compter ».
« Vous allez vous marier quand ? ».
« Au printemps ».
« C’est génial ».
« Je sais que c’est un peu tôt, mais j’ai un truc à te demander ».
« C’est quoi ? ».
« Je ne me vois pas proposer à quelqu’un d’autre que toi d’être mon témoin ».
Je suis tellement touché que j’en perds mes mots.
« M-m-moi ? » je finis par bégayer.
« Oui, oui, toi. Tu es la personne dont je suis la plus proche, et tu es un gars formidable ».
« J’accepte avec plaisir ».
« Et il est bien évident que le témoin préféré de la mariée est invité à venir accompagné du gars qui le rend heureux ».
« Si seulement je pouvais te dire que ce sera possible ».
« Ca le sera peut-être d’ici-là ».
« J’aimerais bien ».
« Cool. C’est une affaire qui roule, alors. Sinon » elle enchaîne sans transition « je crois savoir que demain est un jour spécial pour toi ».
« Mon anniversaire… ».
« Tiens » fait-elle, en sortant de son grand sac un paquet cadeau coloré et en me le tendant.
« Je t’ai offert un peu de lecture. J’ai découvert cette saga il y a deux ans et j’ai vraiment accroché » elle m’explique pendant que je défais le paquet. Je découvre alors un coffret contenant trois livres en format poche.
Harry Potter à l’école des sorciers.
Harry Potter et la chambre des secrets.
Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban.
J’ai bien sûr entendu parler de cette saga. Mais je ne me suis pas encore penché sur le sujet. J’attendais la sortie du premier film qui est annoncée pour la fin de cette année.
« Merci beaucoup ma cousine ».
Je ne le sais pas encore, mais je suis à la veille de découvrir une saga prenante et qui me tiendra en haleine pendant près de 10 ans, jusqu’au dernier tome et jusqu’au dernier film.
« Ourson ».
Un peu plus tard dans la soirée, un nouveau coup de fil de mon bobrun vient égayer mon présent.
« P’tit loup ».
Et là, petit loup me raconte qu’il a été reçu par le président du club, qui lui a glissé une grande enveloppe avec un contrat mentionnant un très bon salaire et d’autres avantages. Comme par exemple un appartement payé par le club, et dont il prendra possession dans quelques semaines.
« Et tout ça pour foutre quatre coups dans un ballon ! » il s’extasie.
« Fais gaffe à toi, Jérém. Tu te souviens des mots de Daniel, à Campan ? Fais gaffe à ne pas te blesser ».
« Yes, ourson ».
« T’es sorti avec tes nouveaux potes, hier soir ? ».
« Oui, on a un peu fait la fête. Heureusement qu’aujourd’hui je n’avais pas entraînement. Ils sont sympas, mais, putain, qu’est-ce qu’ils sont fêtards ! ».
Je prends sur moi pour ne pas lui demander comment ça s’est passé, s’il a été sage. Je ne veux pas l’agacer. Et pourtant, à chaque fois qu’il me parle de ses nouveaux potes, je ressens comme une piqûre au ventre. Je pense à la promiscuité des vestiaires, aux regards, aux envies que cela peut faire naître, aux douches, aux corps qui s’effleurent, aux envies que cela peut faire grandir.
« Tu me manques, p’tit loup » je tente de me rassurer.
« Toi aussi, toi aussi ».
Le vendredi, je passe mon temps à essayer de tuer le temps. Jérém me manque de plus en plus.
Thibault aussi me manque. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin je me suis réveillé avec la conviction qu’il m’appellerait. Je ne sais pas pourquoi, mais j’avais cette intuition. Je crois que j’ai rêvé de lui cette nuit.
En me levant, j’ai repensé à toutes les fois où nous avions pris un verre ensemble, où il m’avait soutenu, où il m’avait conseillé pour mieux comprendre mon bobrun. J’ai repensé à sa douceur, à sa bienveillance, à sa droiture. Je n’arrivais pas à croire que ça se terminerait de cette façon. J’ai attendu son coup de fil pendant toute la journée, en me donnant des créneaux probables. Midi, l’heure du repas, 18 heures, la fin probable de ses entraînements, 20 heures, le repas du soir, après 20 heures et jusqu’à minuit, la soirée. Chacun de ces « créneaux » est venu et est passé sans que rien ne se passe. J’ai souvent regardé mon téléphone, mais il est resté muet. Pendant la soirée, le moment où il aurait pu difficilement me dire une fois de plus « je suis pas mal occupé » ou « je dois y aller » j’ai eu envie de faire un nouvel essai, de le rappeler. Je n’ai pas eu le courage. Il m’a bien fait comprendre qu’il n’avait pas envie de me voir. Et, certainement, qu’il n’avait non plus envie que je l’appelle.
J’ai également passé ma journée à attendre le coup de fil de Jérém. Je me doutais que je n’aurais pas de ses nouvelles pendant la journée. Jérém n’est pas très « sms ». L’écriture c’est pas vraiment son truc. Je le vois au fait qu’il met des plombes à répondre à mes messages, je le vois au fait qu’il préfère appeler plutôt qu’écrire. J’imagine que pendant la journée il n’a pas trop le temps de passer des coups de fil. Ces contacts espacés créent un manque de plus en plus fort. Mais je sais que je ne peux rien y faire.
Alors, j’ai pris mon mal en patience et j’ai attendu le soir pour entendre sa voix. J’ai attendu, longtemps. A 22 heures, toujours pas de coup de fil de Jérém. Je décide de l’appeler.
Il ne répond pas. Je tombe sur sa messagerie. Rien que sa voix enregistrée me fait vibrer et m’excite. Ça m’inquiète aussi. Pourquoi il ne m’a pas appelé ce soir ? Je laisse un message qui finit par « Rappelle-moi, tu me manques trop p’tit loup ».
Une heure plus tard, toujours pas de nouvelles. A minuit non plus. Je me dis qu’il a encore du sortir faire la fête avec ses potes. Comme hier soir déjà. Mais ce soir, il a oublié de me donner de ses nouvelles. Je ne peux m’empêcher de me demander si ses nouveaux potes sont déjà en train de l’éloigner de moi.
Je finis par m’endormir, pour la première fois sans nouvelles de mon Jérém depuis Campan.
Lorsque je me réveille le lendemain matin, samedi, de bien bonne heure, je trouve un message envoyé à 2h36.
« J’ai bu un coup avec pote, je rentre là ».
Me voilà à la fois rassuré et inquiet. Il ne lui est rien arrivé, c’est le plus important. Mais en même temps, me voilà pris de court par les évènements. A peine il débarque sur Paris, il s’est déjà fait de nouveaux potes, avec qui il sort, il fait la fête, avec qui il va forcément croiser des nanas. Et ces nouveaux potes, ils sont comment ? Est-ce qu’ils sont tous hétéro purs et durs ? De toute façon, Jérém est le genre de bogoss atomique capable de susciter bien de vocations, le genre de bogoss capable de rendre l’hétérosexualité une notion bien mouvante, rien qu’en le côtoyant. Alors, en le voyant à poil dans un vestiaire…
Quant à Jérém, il connaît désormais très bien le plaisir entre garçons. Il a franchi le pas avant moi, et avec moi, il a exploré une vaste palette de cette sexualité. Il assume de plus en plus ses envies. Est-ce qu’il saura résister à la tentation masculine à laquelle il sera confronté ? « Je ne suis pas pd, moi ». Ça a bon dos. Il a quand même couché avec Thibault, son meilleur pote, non ?
Arrête ça, Nico, tout de suite. Julien a raison, si tu commences à cogiter comme ça, tu vas devenir fou. Il est juste sorti prendre un verre pour ne pas rester seul dans son coin. Il est naturel et sain qu’il se fasse de nouveaux potes, surtout parmi les gars avec qui il va partager l’aventure du rugby pro.
J’attends 8 heures pour lui envoyer un message.
« Bonjour le fêtard, ça va ce matin ? »
Une minute plus tard, le téléphone sonne.
« Bonjour, Ourson, ça va ? ».
Ça me fait plaisir d’entendre sa voix. Même si elle est pâteuse et traînante, comme s’il avait la gueule de bois.
« Bonjour, ça va, oui. C’est toi qui as l’air fatigué… ».
« Laisse tomber, les gars c’est de vrai fous. Ils n’en avaient jamais assez. Je suis rentré très tard. Je suis complètement en vrac ».
Puis, il enchaîne, sans transition :
« Bon anniversaire Nico ».
Sur le coup, je suis surpris.
Depuis mon réveil, je n’avais même pas encore percuté qu’on était samedi et que je fêtais mes 19 ans. Mais Jérém y a pensé. Il y a pensé, putain, il y a pensé ! Mon cœur se vide instantanément de toutes les pensées négatives d’un instant d’avant et se remplit d’une joie intense.
« Merci, Jérém, merci beaucoup ».
Je suis ému aux larmes.
« Tu vas faire la fête ? » il me questionne.
« Non, je n’ai rien prévu. Je pense que maman fera un gâteau ».
« Si j’étais là, je te ferais bien la fête ».
« Je ne dis pas que je n’en ai pas envie… ».
« Putain, moi aussi j’ai trop envie… ».
« Rien que d’entendre ta voix j’ai envie de te faire jouir ».
« T’es un petit coquin, toi… ».
« Pas plus que toi… ».
« Qu’est ce que c’était bon à Campan ! » je l’entends soupirer.
« Je ne te le fais pas dire ! Je te ferais bien une petite gâterie là ».
« Je suis presque à la bourre, là. Il faut que je me lève, que je prenne ma douche. Il faut que j’aille à l’entraînement ».
J’ai envie de prendre la douche avec lui.
« J’espère que ça va aller ».
« Ca va aller, aujourd’hui je vais juste faire de la muscu ».
Soudain, rien que le fait de l’imaginer en débardeur en train de transpirer en soulevant de la fonte me fait bander. J’ai les tripes en feu à force d’avoir envie de le faire jouir. D’autant plus que l’image de la salle de muscu me renvoie à un souvenir des plus torrides avec mon Jérém.
Je bande instantanément.
« Tu te souviens du soir où tu m’as fait venir à la salle de muscu au terrain de rugby ? ».
« Oh que oui… ».
« Le soir où tu m’as baisé la bouche sur la table du développement couché, en prenant appui sur la barre ».
« C’était excitant à mort ».
« Et après une cigarette, tu m’as pris sur la table de massage ».
« Je me souviens très bien, c’était booooooon !!! ».
« Putain que oui, c’était bon ! » je confirme.
C’était l’époque où sa tendresse me manquait à en crever. Une époque où le cœur du bobrun me semblait totalement inaccessible. Ah, putain, mais c’était aussi l’époque où je n’étais que son objet sexuel, où il me baisait comme et quand l’envie lui en prenait, sans apparemment se soucier de mes envies à moi. L’époque où je découvrais la puissance de sa virilité, son incroyable endurance, ses attitudes de petit macho à la queue bien chaude. J’ai envie de sa queue. J’ai envie de le faire jouir. J’ai envie de son jus de petit mâle. Je bande dur. Je me caresse. J’ai envie de me branler. Je ne peux pas m’en empêcher. Je sens que je vais devoir aller au bout.
« T’es un sacré mec, toi… un sacré mâle… qu’est-ce que tu m’as fait jouir depuis qu’on couche ensemble… » je commence à le chauffer, alors qu’une idée saugrenue traverse mon esprit.
« Tu me fais vraiment de l’effet. Et ton petit cul, c’est le pied ».
« Tu l’aimes, mon cul, hein ? ».
« Laisse tomber, rien que d’y penser je bande ».
« Qu’est-ce que tu as envie de lui faire à mon petit cul ? ».
« De bien le secouer et de lui gicler dedans… ».
J’adore l’entendre dire ça. Je ne m’en lasse pas. « Bien le secouer et lui gicler dedans ». D’autant plus que je ressens dans sa voix une excitation grandissante. J’ai envie de lui, j’en crève. Et son envie à lui décuple encore la mienne. Rien qu’en entendant sa voix, son excitation, sa façon de me parler de son envie d’être « le mâle », c’est comme s’il était en moi en train de me limer. Mon trou se contracte, un frisson d’excitation y prend naissance et se propage dans tout mon corps. Sept cents bornes nous séparent, et pourtant ce beau mâle arrive presque à me baiser par téléphone interposé. Je suis à lui.
« T’es encore au lit ? » je le questionne.
« Oui, pourquoi ? ».
« Tu es nu ? ».
« Presque ».
« Tu portes quoi ? ».
« Un débardeur ».
« Blanc ? ».
« Oui ».
« Tu dois être sexy à mort ».
« Je pense » il lâche, coquin.
Mon excitation grimpe en flèche.
« Tu bandes ? ».
« Oui ».
« Bien dur ? ».
« Tu connais ma queue ».
« Elle doit être raide comme un piquet ».
« Pire que ça ».
« Tu te branles ? » je le questionne.
« Il se pourrait… ».
« Qu’est ce que j’ai envie de la toucher ».
« Moi j’ai plutôt envie que tu la suces ».
« J’en crève d’envie ».
« Tu te branles aussi ? ».
« Grave ! ».
« Tu me ferais quoi si t’étais là ? » il me questionne à son tour.
« Je te sucerais jusqu’à te rendre fou, je prendrais ton gland bien au fond de la gorge, comme tu aimes ».
« Ah oui… ».
Je sens que son excitation grimpe de seconde en seconde, d’échange en échange. Alors j’insiste, je le chauffe à bloc.
« Et puis je le lècherais les tétons ».
« Hummmmmm ».
« Et les couilles, tout en te branlant ».
« Aaaahhhhh ».
« Et aussi le trou ».
« Oooohhhh ouiiiiii ».
« C’est bon, ça, hein ? » je le cherche.
« Laisse tomber, tu me fais mouiller le gland ».
« J’ai bien envie de goûter à ça ».
« J’ai bien envie de sentir ta langue jouer avec mon gland ».
« Je ne me ferais pas prier ».
« Et après ? » il veut savoir, alors que ses ahanements me donnent la mesure de son excitation extrême.
« Après, je t’offrirais mon cul. Parce que je sais que tu as envie de lui gicler dedans ».
« Oh que oui… ».
« Si tu étais là tu jouirais dans mon cul ? ».
« Oh oui, mais d’abord dans ta bouche parce que sinon ça va venir trop vite ».
« J’avalerais tout ».
« C’est bon ça… ».
« Et après tu pourrais me prendre ».
« Et sentir ton cul bien chaud qui enserre ma queue ».
« Et me remplir… ».
« Et te remplir le cul, oui… oh… oui… ».
Soudain, j’entends ses ahanements s’emballer.
« Je vais jouir » il m’annonce, la voix déjà cassée par l’orgasme ravageur.
« Fais toi plaisir » je lâche, ne pouvant faire autre chose que lui donner ma bénédiction. J’aimerais tellement au moins le voir jouir, faute de pouvoir le faire jouir. Mais le fait de n’avoir que le son de son orgasme, le fait de l’entendre jouir au téléphone, d’entendre ses râles de plaisir est quand même terriblement excitant.
« C’est malin, j’en ai foutu partout sur le torse, jusqu’au cou » il lâche, après un instant de silence.
Soudain, j’imagine sa peau mate, ses abdos, ses pecs, brillants de son sperme odorant et chaud, les poils du torse humides.
Je me branle toujours.
« Quel gâchis ! J’ai envie de tout lécher ».
« Je te laisserais bien faire… même si tout ça serait bien mieux dans ta bouche ou dans ton cul ».
« Ca c’est clair ! ».
J’ai tout juste le temps de terminer ma phrase lorsque je ressens une onde de plaisir prendre naissance dans mon bas ventre, se propager dans mon corps, embraser chacune de mes fibres et submerger ma conscience. Et mon torse reçoit à son tour de bonnes traînées de sperme chaud.
« T’as joui aussi ? » il demande.
« Oui ».
« On est fous ! ».
« C’était trop bon ».
« C’est vrai. Mais ce serait tellement mieux en vrai ».
« Je sais. En tout cas, c’était un beau cadeau pour mon anniversaire ».
« Je ne t’ai même pas offert de vrai cadeau ».
« Tu m’en as fait plein. Ton coup de fil la semaine dernière pour m’inviter à Campan était un énorme cadeau. Les quelques jours à Campan, les plus beaux de ma vie, c’était un autre, immense cadeau. Et ta chaînette ».
« Tu la portes toujours ? ».
« Oui, bien sûr ! ».
« Tu l’aimes bien, hein ? »
« Je l’aime trop. Quand je la sens glisser sur ma peau, j’ai un peu l’impression d’être avec toi, et que tu es avec moi. Et que tu es… en moi… ».
« Me tarde de te voir ».
« A qui le dis-tu ».
« Il faut que j’aille à la douche maintenant ».
« Bonne douche alors, et bonne journée ».
« A toi aussi, ourson ».
« Je t’aime, p’tit loup ».
Je viens de raccrocher et je sens remonter en moi la douce fatigue, l’apaisement total qui suit l’orgasme. Je laisse mon corps en profiter, je laisse chacun de mes muscles se détendre. J’essuie mon torse, je tire les draps. Je me laisse glisser vers un délicieux sommeil matinal déclenché par le plaisir. Ça fait du bien de commencer la journée en jouissant. Même si je préférerais 10.000 fois commencer la journée rempli de sa virilité et de son sperme.
J’ai le sourire aux lèvres. Parce que ce petit partage sensuel à distance, parce que les mots de Jérém m’ont rassuré quant au fait que les bonnes ondes de Campan résistent à la distance. Par ce coup de fil, j’ai retrouvé exactement le même Jérém que j’ai laissé trois jours plus tôt. Il lui tarde de me revoir. Je suis bien. Je suis heureux. Et je m’endors comme un bébé.
Lorsque j’émerge, il est presque 10 heures. Sur mon tél, un message de ma cousine :
« Bon anniversaire, cousin ! ».
« Bon anniversaire ! » m’accueille maman lorsque je la rejoins dans la cuisine.
Je passe la matinée à écouter de la musique et à avancer mon récit sur mon séjour à Campan. Je prends un plaisir fou à essayer de faire revivre sur papier ces jours inoubliables, à transcrire les répliques, à décrire les personnalités de ces gens hors du commun qui m’ont tant touché. Mais ce qui me donne le plus de plaisir, c’est de raconter les gestes, les mots, les regards, les attitudes, l’amour de mon Jérém. Je veux fixer ces souvenirs, je ne veux pas les laisser s’effacer de ma mémoire. Un peu plus tard dans la journée, j’aurais des photos. Mais il n’y a que les mots pour retranscrire mes états d’esprits, mes ressentis, mon bonheur.
Midi arrive très vite, on déjeune à 13 heures. Maman a fait un gâteau à la meringue, garni de grains de grenade et de groseilles. Mon préféré. Il était délicieux. Je suis un garçon comblé. Presque gâté. Lorsque je sors de table, il est l’heure du rendez-vous avec mes souvenirs photographiques.
[Les paragraphes qui suivent contiennent à nouveau des expériences que notre époque à oubliées. Alors, enjoy-it, lol].
A 14 heures pétantes, je franchis la porte du magasin. Je file au comptoir photo. Je m’impatiente pendant que la nana parcourt les dizaines d’enveloppes en attente sans trouver la mienne.
« Je crois qu’elles ne sont pas prêtes, il faudra repasser mardi ».
« Mardi ? » je demande, ahuri.
Mais putain, mardi c’est dans trois jours, c'est-à-dire une éternité, je ne vais pas pouvoir attendre jusqu’à là. Mais c’est même bien pire que ça ! Lundi soir je pars à Bordeaux et je ne pourrai passer les chercher que dans deux semaines au mieux ! La déception et la frustration s’emparent de moi. Je ressens du dépit, du désespoir, de la tristesse. Je ne vais pas pouvoir tenir jusqu’à là ! Au secours !
« Vous êtes sûre qu’elles ne sont pas arrivées » j’insiste.
« Attendez… ah, si, les voilà ».
Putain, tu pouvais pas mieux regarder d’entrée, et éviter de me faire une frayeur ?
Elle me tend la précieuse enveloppe avec un geste machinal. Comme si elle me passait un chiffon sale, et non pas un objet d’une valeur inestimable.
« Génial. Merci beaucoup ».
Je l’attrape et le simple contact avec l’enveloppe, son poids dans mes mains me rendent déjà heureux.
« Sinon, si vous voulez des photos instantanées, nous avons des appareil Polaroïd. Et au rayon électronique, ils ont de nouveaux appareils numériques ».
« Non, merci, j’aime bien les vraies photos. Bonne journée ».
Je sors du magasin en vitesse, impatient de découvrir le résultat. Impatient de revoir mon Jérém. Je me pose sur un banc de la place Wilson. J’essaie d’ouvrir l’enveloppe, mais mon impatience me rend la tâche plus difficile que prévu.
J’y arrive enfin, et je sors le petit paquet de photos avec un soin extrême, comme s’il s’agissait d’un objet sacré.
Et là, paf, première claque, je tombe sur une photo de mon Jérém à cheval, le torse droit comme un I, une façon bien virile de tenir les rênes, le regard concentré, le sourire aux lèvres. Beau comme un dieu. Je feuillète, les mains tremblantes.
Quelques photos de paysage, magnifiques. Une autre photo de Jérém, en train de brosser Unico. Il est légèrement penché en avant, le biceps visible bien bandé, tirant dangereusement sur la manchette de son t-shirt gris un peu souillé, les cheveux bruns en bataille, la chaînette qui était encore la sienne pendant dans le vide, le regard fixé sur son étalon. Le bogoss en mode nature, en mode campagne, en mode montagne. Loin du mec toujours bien soigné de Toulouse, c’est le bogoss sans artifices. Simplement et naturellement beau, comme une évidence.
Une autre photo de Jérém à cheval, complètement ratée.
Une autre, prise pendant la première soirée au relais de l’asso de cavaliers. Jérém est à côté de Charlène, un sourire magnifique sur son visage.
Encore une photo floue de Jérém. Grrrrr !!!
Deux photos « à oreilles », des paysages signés par la présence des extrémités poilues de ma monture. Encore Jérém à cheval, sexy à mourir, qui regarde l’appareil, et celui qui a pris la photo (moi, en l’occurrence) d’un regard doux et touchant.
Encore des paysages.
Le tas de photos à découvrir s’amoindrit dangereusement. Mais pourquoi j’ai fait autant de photo de paysages ? Pourquoi je n’ai pas fait plus de photos de mon Jérém ?
C’est là que je tombe sur LA photo qui me tire les larmes. Jérém et moi, à cheval, l’un à côté de l’autre.
Notre toute première photo ensemble. Et en plus, elle est très belle. La lumière est époustouflante, les couleurs magnifiques, la mise au point parfaite. C’est la plus belle de toutes. Je ne suis peut-être pas objectif, mais pour moi, c’est la plus belle de toutes. Jérém est souriant, il a l’air vraiment bien. Et moi, je suis fou de bonheur. C’était le plus beau moment de ma vie. Ça transpire de la photo, ça crève les yeux. Je ne peux retenir mes larmes.
Des larmes dont l’intensité monte encore au fil des photos suivantes. Car Charlène n’en a pas fait qu’une, elle en a fait trois, comme pour bien immortaliser ce beau moment. Trois photos, identiques à quelques détails près, comme des variations sur un même thème de bonheur absolu. Merci Charlène, merci infiniment. Soudain, je me sens bête de ne pas avoir pensé à demander le numéro de Charlène, j’aurais vraiment voulu la remercier et lui envoyer le double de quelques unes de ces photos.
Me voilà désormais l’heureux possesseur d’une poignée de photos de mon Jérém. Au final, la moisson photographique n’a pas été mauvaise. Je retourne dans le magasin pour laisser les négatifs pour un deuxième tirage. J’offrirai ces photos à mon Jérém à la première occasion où nous nous reverrons. Il me tarde !!!
J’ai passé le reste de la journée à essayer d’imaginer à chaque instant ce que mon bobrun est en train de faire. Est-ce qu’il est sur le banc de muscu ? Est-ce qu’il déconne avec ses nouveaux potes ? Est-ce qu’ils le matent ? Est-ce qu’il les mate ? Qu’est-ce qu’il va faire ce soir ? Sortir encore ? Où ? Est-ce qu’il va se faire draguer par des nanas ? C’est inévitable. Est-ce qu’il va savoir dire non ? Est-ce que Julien a raison, qu’il faut laisser faire et juste exiger qu’il se protège ? Le fait est que nous n’avons pas parlé de cela. Comment en parler, d’ailleurs ? Sujet délicat, et auquel je n’ai même pas pensé dans le bonheur de Campan. Dans ma naïveté, je me disais qu’on saurait nous attendre sagement. Mais Julien m’a ouvert les yeux. De toute façon, c’est facile à comprendre et à concevoir. Une bombasse comme Jérém, lâché dans la jungle sexuelle parisienne, au milieu de requins et surtout de requines, est une « proie » de choix. Comment j’ai pu être aussi naïf pour croire qu’il tiendrait ?
Oui, j’aurais lui parler de protection, de capote. Je pourrais lui en parler au téléphone. Mais comment aborder le sujet sans paraître relou ? De plus, j’ai l’impression que lui en parler, serait comme lui donner le feu vert pour qu’il vive des aventures. D’un autre côté, le fait de ne pas lui en avoir parlé, c’est ne pas savoir à quoi m’attendre.
Je tente de me rassurer en me disant que je pense qu’il va se protéger, il m’a dit qu’il se protégeait. Je me souviens de sa capote volée de son jeans le dernier jour où il était venu chez moi, avant qu’on se bagarre, lorsqu’il m’avait avoué qu’il couchait avec une nana mais « qu’il se protégeait ». Je me souviens que le fait d’apprendre qu’il se protégeait m’avait fait une belle jambe. Le fait de savoir qu’il couche ailleurs, même avec capote, m’avait brisé le cœur. Et même aujourd’hui, malgré les mots très sensés de Julien, lorsque j’essaie d’imaginer mon bobrun coucher ailleurs, même avec une capote, j’ai le ventre en feu et je ressens une colère sourde mais dévorante s’emparer de mon esprit et de mon corps.
Voilà des idées qui monopolisent mon esprit ce samedi après-midi-là.
Heureusement, de temps à autre, d’autres pensées remontent à ma conscience.
Des pensées plaisantes, comme le souvenir de l’annonce du mariage de ma cousine, et le marque de sa grande considération à mon égard en me demandant d’être son premier témoin. Ça me touche vraiment.
En rentrant à la maison, je montre les photos à maman.
« Tu as fait du cheval ! ».
« C’était génial ! ».
Lorsqu’elle tombe sur les photos de Jérém et moi, elle me dit :
« Vous êtes beaux tous les deux. Et vous êtes bien ensemble, vous avez l’air tellement heureux ! ».
« Ça se voit tant que ça ? ».
« Ça crève les yeux ! ».
A 18 heures, je reçois un coup de fil de mon pote Julien. Il m’invite à sortir le soir même, avec lui et d’autres potes à lui ».
« On va se faire une virée au Shangay pour fêter ton départ pour Bordeaux ».
« Je vous paierai un coup à boire, c’est mon anniversaire ».
« Alors il faut faire la fête ! ».
« C’est clair ! ».
Comme il n’y a personne en boîte de nuit avant minuit, la soirée commence dans un bar du centre-ville. Mon pote Julien est sur son 31, avec une petite chemise blanche avec le col et les bords des pans de couleur bleue, bien ajustée à son torse, les deux boutons du haut ouverts sur la naissance de ses pecs, un beau jeans délavé, des chaussures de ville, le bronzage impeccable, le sourire ravageur. Bref, élégant, charmeur et excessivement sexy.
Et puisque l’une des lois régissant l’Univers, du moins le mien, est celle selon laquelle « le bogoss attire des potes bogoss », ses deux potes ne sont plutôt pas mal non plus. Vraiment pas mal. Jérôme, c’est un blond un peu costaud, mais drôle et charmant. Quant à Adil, c’est un bon spécimen de ce que la reubeuterie peut offrir de sexytude un peu sauvage et fort virile. Et pourtant, son apparence dégage une certaine douceur, tout comme ses gestes, sa façon de parler et le ton de sa voix. En fait, ce gars est à la fois très mec et puits à câlins.
Autour des bières, j’écoute les potes discuter de voitures, de nanas, de foot. Que des sujets qui me passionnent. Me voyant un peu à part, Julien décide de porter un toast à mes études à venir à Bordeaux. Et là, à ma grande surprise, le bogoss Adil me demande quel cursus je vais suivre. Lorsque je mentionne le cursus de Sciences de la Terre et de l’Environnement, il me répond qu’il est en troisième année en sciences naturelles. Alors, pendant que Julien et Jérôme discutent entre eux, Adil me raconte son entrée à la fac, il me parle de ses rencontres, de sa passion pour les études, de comment il a dû se battre pour suivre cette voie alors que sa famille le poussait à bosser dès la fin du lycée. Il me parle de ses difficultés, de son manque de temps pour les études à cause du boulot de livreur qu’il est obligé de garder en parallèle pour payer ses frais.
Son récit me donne la mesure de la chance qui est la mienne. Je n’aurais pas besoin de bosser pour me payer la fac. Du moins pas les premières années. Alors qu’il y a plein d’étudiants qui y sont obligés.
Je lui pose des questions sur la vie à la fac, il me répond généreusement. C’est génial de pouvoir partager l’expérience des autres. Ça m’aide à appréhender plus sereinement la nouvelle vie qui sera la mienne dans tout juste 48 heures.
Adil me parle aussi de ses projets futurs, une Maîtrise pour être enseignant et/ou chercheur. Il vise haut le beau gosse. J’aime beaucoup son parcours d’études et de vie. Adil est très sympa et il a l’air d’un mec bosseur, droit dans ses baskets. Je ressens de l’admiration pour ce gars.
Il est environ 23h30, nous sommes toujours en train de discuter, lorsque quelque chose d’inattendu se produit. Mon téléphone se met à vibrer dans ma poche. Mon cœur fait un sprint de 80 à 1000 bpm en une fraction de secondes. Je n’ai pas besoin de regarder le petit écran pour savoir qui essaie de me joindre.
Jérém. Je ne m’attendais pas à qu’il m’appelle ce soir, et encore moins à cette heure. Je laisse vibrer, jusqu’à ce que la vibration s’arrête. Et alors que Julien entraîne Adil dans une nouvelle conversation, j’en profite pour sortir dans la rue et rappeler mon bobrun.
« Ourson ! » je l’entends s’exclamer, en guise d’accueil affectueux.
« Petit loup ! ».
« Tu dormais déjà ? ».
« Non… ».
« Tu fais quoi ? ».
« Je suis sorti prendre un verre ».
« Seul ? ».
« Non ». Et là je prends peur. Je réalise que Jérém m’a déjà fait une sorte de scène de jalousie au sujet de Julien. Si je lui dis que je suis avec lui et ses potes, il va s’imaginer des choses qui ne sont pas vraies. J’ai peur qu’il croie que je vais voir ailleurs. Je suis bien placé pour savoir comment la distance peut exacerber la jalousie. Je ne veux pas qu’il se pose des questions et qu’il y réponde en prenant de la liberté de son côté. Alors, je choisis d’arranger un peu la réalité. Un petit mensonge sans conséquence est parfois préférable à une vérité qui peut soulever des doutes.
« Je suis sorti prendre un verre avec ma cousine » je me prépare à lui dire.
Mais je n’ai pas le temps d’énoncer mon petit arrangement avec la réalité, je viens tout juste de prononcer le mot « avec » que j’entends dans mon dos la voix de Julien, bien claire et portante m’annoncer :
« Allez Nico, gourre, on file au Shangay… ah pardon… t’es au téléphone… ».
« C’est qui ce mec ? » j’entends illico Jérém me questionner. Me voilà soudainement mis en porte à faux.
« C’est… Julien… le moniteur d’autoécole ».
« Celui que j’ai croisé avec toi l’autre soir ? ».
« Non, non, non, non, pas du tout. Lui je ne veux plus le revoir. C’est l’autre moniteur, le blond, celui qui m’a fait toutes les leçons de conduite. Tu l’as vu une fois qu’on s’est arrêtés au feu devant la brasserie à Esquirol ».
« Tu fous quoi avec lui ? ».
« Il m’a invité prendre un verre avec ses potes à lui ».
« Et il te veut quoi ? ».
« Rien, rien du tout. On est amis, c’est tout. Je te promets. J’ai bien le droit de faire une virée avec un pote… comme toi avec tes nouveaux potes ».
« Et avec ton pote tu vas au Shangay ».
Eh oui, il y a ce facteur « aggravant » dans l’histoire. Le Shangay est une boîte avec un espace dédié aux gays. Et Jérém le sait. Vu de l’extérieur, et à distance, ça fait louche, en effet.
Je sens que Jérém fait la gueule. Je sens presque le bruit de ses questionnements.
« Je vais au Shangay pour danser et boire un coup. Je ne vais pas y aller pour draguer ».
« J’espère ».
« T’inquiète pas, c’est toi que j’aime, c’est de toi que j’ai envie ».
« Je vais sortir moi aussi ce soir ».
« Je ne veux pas que tu penses à mal. Ce mec est hétéro à 200%. Et même s’il était gay, je n’ai pas envie de coucher avec d’autres que toi. Il ne faut pas que tu sois jaloux ».
« Je ne suis pas jaloux ».
« Je serai sage, je t’attendrai, Jérém ».
« Je l’espère ».
« Tu seras sage aussi ? ».
« On verra » fait-il sur un ton moqueur.
« Ne rigole pas stp. Tu seras sage ? ».
« Ouiiiiiiiii » il finit par lâcher, sur un ton agacé.
« J’ai envie de te serrer contre moi ».
« Moi aussi ».
« Tu me manques ».
« Toi aussi ».
« Je t’aime petit loup ».
« Ne fais pas de bêtises ».
« N’en fais pas non plus ».
D’une part, sa jalousie me fait peur, car elle pourrait le motiver à faire de mauvais choix de son côté. Mais d’autre part, qu’est-ce que ça fait du bien de savoir qu’il tient à moi !
Au Shangay, nous nous rendons évidemment dans la salle « hétéro ». Dès notre arrivée, Julien se met à draguer à tout va. Rien qu’avec le regard. Pétillant, coquin et charmeur. Et avec le sourire. Ravageur, magnétique, hypnotisant. Il a une facilité à aller vers les nanas, ou plutôt, à attirer les nanas vers lui, qui est époustouflante. Son sourire, à la fois solaire et carnassier, est un véritable aimant à gonzesses. On dirait mon Jérém six mois plus tôt, le soir où il a emballé deux nanas pour un plan à quatre avec son pote Thib.
Une demi-heure après notre arrivée, nous sommes assis à une table, en compagnie de plusieurs nanas. Comme d’habitude, Julien joue les clowns, il fait son pitre, il est drôle, il fait rire tout le monde. Son pote Jérôme lui donne la réplique et les nanas sont conquises. On dirait un couple comique. « Il y en a un qui épluche les oignons et l’autre qui pleure » aurait dit Coluche. Adil, quant à lui, est plus discret, plus réservé. Mais non moins sollicité par les nanas.
La présence de toutes ces nanas ne m’enchante pas. Ce n’est plus la même ambiance qu’au bar de tout à l’heure. Là-bas, on était entre mecs, il n’y avait pas tant de musique, on s’entendait parler sans avoir besoin de crier. Et surtout, les mecs étaient en mode « soirée entre potes », alors que là ils ont basculé en mode « drague du samedi soir ». Et si je pouvais me connecter à eux dans la première configuration, il m’est impossible de le faire dans la deuxième.
Une nana dont je n’ai même pas retenu le prénom commence à me parler, et très vite elle me pose des questions sur ma vie sentimentale. Je n’ai pas trop envie de causer. Et surtout pas de ma vie intime. Je n’ai pas la force de mentir non plus. Le petit échange avec Jérém de tout à l’heure m’a un tantinet perturbé. Mon esprit est happé par cet « impair » dont les conséquences me font peur. Je ne veux pas perdre sa confiance, parce que je veux pouvoir lui faire confiance.
Malgré mes réponses en format monosyllabique, la nana ne se décourage pas. Elle est collante. Je ressens clairement que si je voulais, ce soir je pourrais la mettre dans mon lit. Mais je ne veux pas. C’est la première fois qu’une nana me montre autant d’intérêt. Oui, c’est génial de se sentir désiré. Même quand le désir n’est pas réciproque. Mais bon, au bout d’un moment, elle commence à m’agacer.
Je crève d’envie de lui crier que j’aime les mecs. Mais je me dis que ça ne servirait à rien. Elle n’a pas besoin de savoir.
Il est une heure. Je décide d’aller danser pour me changer les idées. La nana me suit sur la piste. Elle se colle à moi. J’essaie de garder mon espace vital, elle n’en a rien à faire, elle me marche sur les pieds. Sa présence m’agace. D’autant plus que son parfum m’écœure. Autant j’aime les parfums de mec. Autant les parfums de fille, surtout quand ils sont trop insistants, je ne peux pas.
J’ai envie de me barrer. Je cherche un prétexte pour lui signifier mon départ en la décourageant de proposer quoi que ce soit pour la fin de la soirée. Elle essaie de m’embrasser. Je m’esquive.
« Je crois que je vais y aller ».
« Qu’est-ce qu’il y a, je ne te plais pas ? ».
Depuis quelques minutes, j’ai repéré au bord de la piste de danse un beau reubeu, très bien foutu, le regard viril, terriblement sauvage, limite agressif. Son visage est entouré d’une belle barbe brune bien fournie, remontant bien haut sur les joues. Il porte une chemise blanche, les manches retroussées au-dessus de ses coudes, les deux boutons du haut ouverts, laissant dépasser une belle pilosité brune. Le mec dégage une puissance brute de mâle par laquelle je me sens attiré comme une aiguille par un aimant puissant, une puissance par laquelle mon instinct primaire me donne envie d'être secoué, défoncé et rempli jusqu'à plus de jus. Ce mec me fait terriblement penser au reubeu que j’avais maté une fois en boîte de nuit jusqu’à qu’il repère mon manège et qu’il vienne vers moi avec un air tellement menaçante qu’il m’avait poussé à prendre les jambes à mon cou. J’ai appris de mes erreurs, mes regards sont plus discrets ce soir.
Alors, avec ma chieuse de nana, je choisis de jouer la carte de la vérité.
« Tu vois ce mec là, avec la chemise blanche ? ».
« Tu le connais ? ».
« Non, mais c’est le genre de mec que je kiffe à mort ».
« Ah mais tu es pd ».
« Gay ça me va mieux ».
« Ah, c’est pour ça que tu ne veux pas de moi ».
« Certes. Mais aussi parce que tu es trop casse-couilles » je faillis lui balancer.
Au lieu de quoi, je me limite à un :
« Je vais vraiment y aller, là, je suis naze ».
Je la plante au milieu de la piste et je passe dire au revoir à Julien et ses potes.
« Donne des nouvelles quand tu es à Bordeaux ».
« Je n’y maquerai pas ».
« Et quand tu passes sur Toulouse, sonne-moi ».
« Ok, merci beaucoup, merci pour tout ».
« De rien mon pote » fait-il, avec un grand sourire, en me serrant dans ses bras. Ah putain, comment ses pecs sont saillants et son parfum captivant !
« Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n’hésite pas » il ajoute.
« Merci. Toi aussi, si tu as besoin de quelque chose ».
« Bon courage petit mec »
« Au revoir Julien ».
Définitivement, ce gars est quelqu’un de vraiment adorable.
Avant de quitter le Shangay, je ne peux m’empêcher de jeter un dernier regard au beau reubeu à la chemise blanche. Et de me dire que ce qui me fascine chez ce genre de mecs typés, c’est la façon dont ils dégagent une virilité brute, incarnée avec une intensité inouïe.
Mais il y a aussi parmi eux, des mecs avec des origines maghrébines, des gars comme Adil, des mecs tout aussi virils, mais avec une tête à bisous.
Je rentre très vite à la maison. Pendant le trajet, puis dans mon lit, je me demande toujours et encore ce que Jérém est en train de faire. Si ce soir je me suis fait draguer par une nana, il doit se faire draguer par dix nanas. Est-ce qu’il va tenir bon ?
« Je suis rentré. Je pense très fort à toi ptit loup ».
Voilà le texte du sms que je décide de lui envoyer pour le rassurer, pour me rassurer.
Il est 4 heures lorsque je regarde mon téléphone pour la dernière fois. Et toujours pas de réponse de Jérém. Mais qu’est-ce qu’il est en train de faire ?
Le dimanche matin, je me réveille à 8 heures. Autant dire qu’après uniquement 4 heures de sommeil, je ne suis pas au top de ma forme. Et pourtant, impossible de me rendormir. Toujours pas de message sur mon téléphone. Je commence à m’inquiéter. Julien avait raison. Si au bout de quatre jours de distance j’en suis déjà à ce stade de cogitations, qu’est-ce que ça va être dans deux semaines, dans quelques mois ? Il a raison, ça va me bouffer. Je devrais arrêter d’y penser. Mais je n’y arrive pas.
9 heures. J’ai trop envie de l’appeler. Il est trop tôt. Qui sait à quelle heure il est rentré. Déjà que le soir d’avant il est rentré à 2h30 du mat ! Il doit dormir. Pourvu qu’il soit rentré seul…
10 heures, envie de l’appeler, 11 heures, c’est toujours trop tôt. Je ne veux pas le réveiller.
Midi arrive, déjeuner en famille. Une heure trente, est ce que je vais oser l’appeler ? Non, pas encore.
C’est sur le coup de 15 heures que je trouve enfin le courage de composer son numéro. Et je tombe direct sur sa messagerie. Tout comme à 16 heures. Et à 17 heures. Putain, mais qu’est-ce qu’il fout ?
Putain, mais pourquoi j’ai accepté de sortir en boîte avec Julien ? J’ai peur de l’avoir blessé, peur qu’il croit que je couche ailleurs et qu’il se sente autorisé à coucher ailleurs.
J’aurais du rester à la maison hier soir. Il n’y aurait pas eu d’embrouille. Je sais que ce sont des considérations stupides. Je ne peux pas m’empêcher de vivre. D’autant plus que lui aussi est sorti. Et c’est bien normal. Doute et confiance, deux plats d’une balance à équilibre instable.
Je fais une dernière tentative à 20 heures. Et là, mon Jérém décroche enfin.
« Oui… » il répond. Pas d’« ourson » cette fois-ci. Quelque chose a changé.
« Salut petit loup, ça va ? ».
« Je suis naze ».
« J’ai essayé de t’appeler cet après-midi ».
« J’avais le téléphone éteint ».
« Tu as fait quoi ? ».
« J’ai dormi jusqu’à trois heures et je suis sorti manger un bout et faire un tour. Je n’étais jamais monté à Paris ».
« Cool. Et hier soir, c’était bien ? ».
« On a beaucoup picolé ».
« Ah ».
« Et toi, tu t’es amusé avec ton pote ? ».
« C’est un gars vraiment sympa. Mais au Shangay il a dragué trop de nanas et je suis parti assez tôt. T’as vu mon message ? ».
« Oui ».
Je le sens crispé.
« J’ai été sage, tu sais. Je me suis fait draguer par une nana mais je l’ai envoyée bouler » je tente de le rassurer.
Je lui parle des photos que j’ai récupérées dans l’après-midi. Ce qui me donne l’occasion de reparler de certains moments de Campan. Et là, je sens mon Jérém se décrisper peu à peu. Il évoque des souvenirs à son tour, nous retrouvons notre complicité petit à petit. Je suis ému. Car cette complicité est la joie la plus grande de ma vie. Sans elle, je serais bien malheureux.
« J’ai un mal au crâne terrible » il m’avoue « il faut que j’arrête de sortir autant ».
Son ton est rassurant, je pense que lui aussi a été sage.
Lundi 17 septembre 2001.
Le lundi, je me réveille de bonne heure. C’est le grand jour. Ce soir je pars pour Bordeaux. Ce soir, commence ma nouvelle vie d’étudiant de fac. Ce soir, je vais prendre possession du petit meublé que je n’ai vu qu’en photo à l’agence. Ce soir je vais me retrouver seul entre quatre murs en terre inconnue. Je vais dîner seul, je vais m’endormir seul. Sans mon Jérém. Et sans la rassurante proximité de mes parents. Je suis à la fois excité et mort de peur.
Je passe la matinée à faire mes valises, et à remplir ma petite voiture. En fait, c’est un petit déménagement. Maman me charge de vivres, comme si je devais tenir un siège de plusieurs mois. La nourriture est l’une des voies principales empruntées par les mamans pour montrer leur amour.
Il est deux heures, je suis en train de ranger la dernière valise dans ma voiture, lorsque mon téléphone se met à vibrer dans ma poche. Je le sors vite m’attendant un appel surprise de mon bobrun. Mais une surprise de taille m’attend lorsque je regarde le petit écran indiquant avec insistance :
« Thibault ».
Mon cœur fait là aussi un sprint digne de la fusée Ariane. Je n’arrive pas à croire qu’il m’appelle. Soudain, j’ai les mains moites, le souffle court. Mais je ne peux pas rater l’occasion. Je dois répondre. Je prends une profonde inspiration et je décroche.
« Salut Thibault ».
« Salut Nico, ça va ? ».
« Bien et toi ? ».
« Ça va. Alors, tu te prépares à partir ? ».
Il a retenu que je pars ce soir à Bordeaux. Ce mec est vraiment incroyable.
« Oui, je viens de ranger la dernière valise dans ma voiture ».
« T’as le temps de faire un saut chez moi pour un café ? ».
« Quand ? Vers quelle heure, je veux dire… ».
« Maintenant si tu veux ».
« J’arrive ».
Vers le 15/02
Life is a journey, not a destination.
La vie est un voyage, pas une destination.
 5 commentaires
5 commentaires
-
Par fab75du31 le 30 Janvier 2020 à 22:04
Happyness is not a destination, is a way of life.
Le bonheur, n’est pas une destination, mais un chemin (mode) de vie.
Jeudi 13 septembre 2001.
Le lendemain de mon retour sur Toulouse, je me réveille dans un état d’esprit étrange, dans lequel se mélangent des opposés, le bonheur le plus radieux et la tristesse la plus sombre. L’écho de l’amour partagé avec mon bobrun pendant ces quelques jours à la montagne vibre toujours en moi. Mais en même temps, le manque et la distance se font sentir de façon violente.
C’est le premier jour où je me réveille chez moi, depuis Campan. La première fois où je me réveille à Toulouse, dans mon lit, sans Jérém à mes côtés, ou du moins à proximité.
Alors, en cet instant de flottement entre sommeil et veille, entre rêve et réalité, en ce « lieu » imaginaire où tout semble encore possible, je cherche mon bobrun dans les draps, je cherche sa présence, son parfum, sa peau, la chaleur, le contact rassurant de son corps. Pendant un instant, j’arrive presque à me créer l’illusion d’être encore avec lui. Car mon t-shirt, ma peau, mon corps, mon être tout entier portent son « odeur ».
Je me force à garder les yeux fermés, je me force à entretenir cette illusion le plus longtemps possible. Mais lorsque je me résigne à accepter l’évidence, à admettre que mes mains ne rencontrent que des draps vides, que je suis seul dans mon lit, ce sont mes larmes qui balaient les dernières « poussières de rêves ».
Je crois que cette nuit j’ai rêvé de mon bobrun. Je crois que j’en ai rêvé toute la nuit durant. J’ai rêvé qu’on faisait l’amour, qu’on se serrait très fort l’un contre l’autre, qu’on se couvrait de bisous. J’ai rêvé de son sourire, de son regard amoureux. J’ai rêvé qu’on était ensemble et qu’on ne serait plus jamais séparés.
Et pourtant, force est de constater que nous le sommes. Et que si hier matin encore j’étais avec lui – au réveil, pendant le petit déj – aujourd’hui nous sommes loin l’un de l’autre. Commencer une journée sans lui, la première d’une série à la durée indéfinie, ça ne me motive pas vraiment à me lever. Son absence m’assomme.
Je n’ai pas senti de suite cette absence dans toute sa violence. Pas jusqu’à ce réveil.
Certes, dès l’instant où nous nous sommes séparés hier matin, il m’a manqué. Pendant le voyage de retour, tout le long de la route, et même lorsque je suis rentré à St Michel, il m’a manqué, à chaque instant.
En arrivant sur Toulouse, j’ai retrouvé ma ville comme après le retour d'un très long voyage. J’ai eu l’impression de ne plus la reconnaître. Comme si elle avait profondément changé depuis mon départ. En roulant sur la rocade, en parcourant les rues, en regardant les façades, en retrouvant les commerces et les quartiers d’une ville familière et pourtant distante, je me suis senti « étranger ». J’ai eu comme l’impression que mon départ, c’était il y a des années. Et pourtant, il ne s’était écoulé qu’une poignée de jours. Bien sûr, rien n’a vraiment changé depuis vendredi dernier, à part la météo. Grise et pluvieuse alors, intensément ensoleillée ce mercredi. Non, rien n’a changé, à part mon regard, mon ressenti. A part l’absence de mon Jérém. « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ».
Mais lorsque j’ai retrouvé ma rue, lorsque j’ai garé la voiture au garage, lorsque j’ai refermé la grande porte derrière moi, lorsque j’ai passé le seuil de la porte du cellier et que j’ai fait la bise à maman, lorsque je me suis réfugié dans ma chambre, je me suis senti comme protégé. Jérém me manquait horriblement, bien sûr. Et pourtant, ce n’était pas aussi violent que ce matin. Je crois que j’étais comme dans le prolongement de la magie de nos retrouvailles. C’est un peu comme lorsqu’on revient d’un beau voyage et qu’on a du mal à « atterrir » dans notre tête, parce qu’on a encore les yeux pleins d’étoiles.
Jusqu’à hier soir, j’étais encore sur mon petit nuage. Au point que, par moments, mon inconscient me chuchotait la folle impression que la porte de ma chambre pourrait s’ouvrir d’une minute à l’autre et que mon Jérém pourrait débarquer pour passer sa vie avec moi. Rien que cela. Alors qu’il était déjà loin, en route pour la capitale, en route pour sa nouvelle vie.
C’est sûrement pour ne pas redescendre de mon petit nuage que je n’ai pas non plus eu envie d’appeler qui que ce soit hier après-midi. Ni ma cousine, ni Julien, ni même Thibault. En fait, j’ai passé l’après-midi à me replonger dans les souvenirs de ces petites vacances, et à essayer de les mettre par écrit. Car je veux me rappeler à tout jamais des moindres moments, de chaque rencontre, de chaque conversation, de chacun des personnages dont j’ai fait la connaissance là-haut. Je ne veux pas oublier ce petit monde et du bonheur qu’il m’a apporté. Et, surtout, je veux me souvenir de chaque mot, du moindre sourire, du moindre regard, du moindre geste de mon Jérém amoureux.
Quand je pense que j’ai failli ne pas aller le rejoindre. Et que j’ai donc failli ne pas connaître la joie immense de retrouver mon Jérém, de le découvrir dans un décor inattendu et surprenant. Aimant et touchant. Il s’en est manqué de peu pour que je passe à côté de ma vie.
La seule personne que j’ai laissé rentrer dans ma bulle, c’est ma maman.
Hier, lorsque je suis rentré, elle m’a dit qu’elle était très soulagée de me revoir enfin à la maison. Elle m’a dit aussi qu’elle s’était beaucoup inquiétée après les attentats de New York.
« Mais je n’étais pas à New York ! » je lui ai rétorqué.
« Je sais. Mais pendant quelques heures, on a tous cru que c’était la fin du monde. Et tu n’étais pas sous mes yeux ! »
« Je comprends… ».
Il est plutôt simple à comprendre, le cœur d’une maman, lorsqu’on tend bien l’oreille.
Elle m’a ensuite demandé si mes vacances dans les Pyrénées s’étaient bien passées.
Je lui ai dit à quel point j’avais été heureux pendant ces quelques jours avec mon Jérém.
« Tu es vraiment très amoureux ! ».
« Je n’ai jamais ressenti ça de ma vie ».
« Et lui aussi, il t’aime ? »
« Je crois bien, oui… ».
« Il te l’a dit ? »
« Non, mais il me l’a montré de tant de façons ».
« A savoir ? ».
« Il s’est excusé pour le mal qu’il m’a fait ».
« Ah, quand-même ! ».
« Je te promets, il a été doux, adorable, aimant, à un point que je ne pensais plus possible ».
« Votre petite bagarre a l’air de lui avoir ouvert les yeux ».
« C’est certain ! T’imagines qu’il a même fait son premier coming out avec ses potes… c’est énorme ! ».
« Ah, carrément. Et il est où maintenant ? ».
« En route pour Paris. Le club de rugby qui l’a recruté le mois dernier l’a convoqué pour faire les derniers examens ».
« Et vous allez faire comment pour vous revoir ? ».
« Je ne sais pas encore, mais on va y arriver ! ».
Le reste de l’après-midi a glissé sans crier gare. Tout pris dans mon écriture, je n’ai pas vu le temps passer. Le soir est venu, l’heure du dîner avec, puis celle du coucher. Et un signe de sa part. Un sms.
« Je sui bien arrive. Tu me manque ».
Un petit message doux comme un baiser. Comme une caresse. Une caresse qui, malgré les larmes qu’elle m’a tirées, m’a fait sentir bien, aimé, et m’a aidé à trouver le sommeil. Un simple sms et j’ai eu l’impression que mon bobrun était à nouveau côté de moi.
Mais ce matin, jeudi, mon bobrun me manque horriblement. Je n’ai pas envie de me lever. Pas envie de sortir, de me balader dans cette ville de Toulouse où je suis désormais certain de ne pas pouvoir croiser mon Jérém. Une ville où son absence est totale, une ville qui me remplit de tristesse. Sa présence dans l’absence est déchirante. Saudade.
Depuis mon réveil, je n’ai cessé de revoir la 205 rouge s’éloigner de Campan. La douceur des souvenirs se mélange à la violence de la séparation. Et dans mes souvenirs, je retrouve également le drame américain de la veille. Je retrouve la peur.
Le réflexe est alors d’allumer la radio, pour voir si pendant la nuit, pendant mon sommeil, il ne s’est pas produit d’autres catastrophes. Heureusement, ça ne semble pas être le cas. Mais les infos parlent toujours des attentats de New York. Sur toutes les stations.
L’écho du 11 septembre retentit toujours dans ma conscience. En entendant parler et reparler de ces attentats, je retrouve intacte l’impression qu’on m’a arraché un bras, l’impression de ressentir l’odeur du sang et de la fumée dans mon nez.
Hier soir, au journal de 20 heures, qui s’est prolongé bien au-delà de sa durée normale et dont le seul sujet était les attentats, la télé n’a cessé de nous repasser en boucle les images des avions qui s’encastrent dans les tours, des tours en feu, des tours qui s’effondrent, des hommes et des femmes en sang.
On a l’impression de vivre une sorte de retour au moyen âge, et le spectre de la guerre est réel. On a l’impression que ces attentats incroyables vont secouer nos civilisations et nos démocraties occidentales jusqu’à la racine et que tout ce qu’on a connu, paix, prospérité, relative liberté, va bientôt disparaître.
Les médias contribuent grandement à créer et entretenir l’ambiance de panique qui sature l’esprit des gens.
J’ai peur, comme tout un chacun a peur. Peur que ça pète ailleurs, peur que le temps nous soit compté. J’ai retrouvé le cocon familial et cela me rassure. Mais j’ai tellement besoin de mon Jérém, de me retrouver dans ses bras puissants, chauds et rassurants. Tellement besoin de dormir avec lui, me réveiller avec lui, me sentir aimé et protégé. J’ai besoin de mon Jérém, il n’y qu’avec lui que je me sentirai en sécurité. Et si c’était vraiment les dernières heures qu’il nous est donné de vivre avant l’Apocalypse, il serait dommage, ce serait un gâchis effroyable, de ne pas les passer ensemble à faire l’amour.
Et si un attentant semblable se produisait à Paris ? Je frissonne à l’idée qu’un truc horrible puisse arriver dans l’une des capitales les plus en vue du monde occidental.
Alors, non, rien ne me motive à me lever en ce triste jeudi matin.
Puis, en me retournant dans mon lit, il se passe quelque chose. Je sens les mailles de ma chaînette glisser sur ma peau. Sa chaînette. Quelle bonne idée, quel beau geste de sa part de me donner cette chaînette. Je ne la quitterais pour rien au monde.
La chaînette de Jérém est bien lourde, la caresse du métal est parfois bien chaude, parfois fraîche, elle m’apporte toute une palette de sensations, entre émotion, nostalgie et excitation.
Cette chaînette qui a été au contact de sa peau pendant des années, qui est comme imprégnée de sa virilité radioactive. Cette chaînette qui a reçu la vibration de tant d’orgasmes de mon bobrun. Avec moi, avec d’autres. Mais le plus grand nombre, avec moi. Cette chaînette que je trouvais si sexy sur mon beau mâle brun, était l’un des « ingrédients » du désir qu’il provoquait en moi. Cette chaînette est désormais à moi. C’est presque un « trophée ». Et en même temps, la plus belle preuve de son amour.
Je ne suis pas sûr de la porter avec le même panache que lui, mais je l’adore. Car je me sens bien avec elle. En la sentant autour de mon cou, j’ai un peu l’impression que Jérém est avec moi. Et en moi.
Elle me donne de l’énergie. Elle me motive à quitter mes draps.
Pourtant, ça ne suffit pas. Je sens que pour pouvoir démarrer cette nouvelle journée, j’ai besoin d’un petit shoot de mon Jérém. J’ai alors l’idée de lui envoyer un nouveau sms.
« Bonjour beau mec ».
Rien que le fait de l’avoir envoyé, sans même avoir de retour, suffit à me requinquer. Ma journée a désormais un but. Celui de recevoir la réponse de mon bobrun.
En attendant, je pars me doucher, je m’habille, je prends mon petit déj. Mon attente est de plus en plus fébrile. Mais après le petit déj, toujours pas de réponse.
Il est 9 heures. Qu’est-il est en train de faire à cet instant précis ? Est-il déjà chez le médecin qui doit l’examiner ? Est-ce qu’il est déjà en boxer en train de se faire reluquer par de jeunes infirmières ?
Pourquoi n’a-t-il pas pensé lui aussi à m’envoyer un message pour me souhaiter la bonne journée ?
Parce qu’il a d’autres chats à fouetter ce matin, et il doit pas mal stresser.
Pourquoi ne m’appelle-t-il pas, pourquoi il ne se repose pas sur moi si il stresse ?
Parce qu’il est comme ça, il garde tout pour lui. Il va sans doute m’envoyer un message un peu plus tard dans la journée.
Après le petit déj, j’appelle mon futur proprio à Bordeaux pour fixer un nouveau rendez-vous pour signer le bail pour le meublé. Le type a l’air gentil et arrangeant, il me dit qu’il me fait confiance pour signer le jour de mon emménagement, c'est-à-dire le jour de la rentrée à la fac. Ce qui m’évitera un aller-retour. Sur les photos de l’agence, l’appart a l’air correct. Pourvu qu’il n’y ait pas embrouille une fois sur place.
Entre midi et deux, je passe d’autres coups de fil. J’appelle d’abord ma cousine pour lui dire que je suis rentré et pour lui parler un peu de mon long week-end, en attendant de pouvoir lui raconter en détail lorsque je la verrai en vrai. Mais elle est très occupée et je n’arrive pas à lui raconter grand-chose. A part lui dire que je viens de passer les plus beaux moments de ma vie toute entière.
« Je suis vraiment heureuse pour toi, mon cousin ».
« Merci beaucoup. Et toi, ça se passe toujours bien avec ton beau Philippe ? ».
« Ça se passe merveilleusement bien. D’ailleurs, j’ai quelque chose à t’annoncer ».
« C’est quoi ? ».
« Je te dirai quand on se verra ».
Intrigué, j’insiste.
« Allez, raconte !!!! ».
« Tu peux bien patienter un peu, je devrais pouvoir me libérer demain ».
Puis, elle a rapidement pris congé et raccroché. Me laissant intrigué par le petit mystère qu’elle n’a pas voulu me dévoiler.
J’ai alors appelé mon pote Julien. Je lui ai demandé s’il avait le temps pour prendre un verre. Il m’a répondu qu’il avait des cours toute la journée mais qu’il pouvait se libérer sur le coup de 18h30. Il n’a pas pu s’empêcher de me demander si j’avais pris cher. Je ne me suis pas privé de l’envoyer chier.
J’aime beaucoup notre relation. Son humour, ses expressions grivoises, sa coquinerie, le tout sous couvert d’une bienveillance qui me fait chaud au cœur. Car ce mec est un véritable pote désormais, et il me fait bien rire. C’est drôle, il m’aura fallu attendre la fin du lycée pour trouver un pote.
Lorsque je raccroche d’avec Julien, je prends une longue inspiration et je passe le dernier et le plus difficile des trois coups de fil de la journée.
Rien qu’en lançant le numéro, et a fortiori lorsque la tonalité retentit dans mon oreille, mon cœur fait une accélération vertigineuse. Car j’ai toujours en tête la distance que j’avais ressentie dans sa voix lorsque je l’avais appelé avant mon départ pour Campan. Ça m’a marqué. J’ai peur de retrouver cette distance telle quelle. Il m’avait promis de me rappeler. Il ne l’a pas fait. J’ai peur de paraître insistant, ridicule. J’ai peur de provoquer de l’agacement. Et pourtant, je dois le faire. Je ne peux pas ne pas faire une dernière tentative de m’expliquer avec Thibault.
A la troisième tonalité, j’ai l’impression d’avoir le cœur assis sur mes cordes vocales. C’est là que l’ancien bomécano, le bopompier, le nouvellement « beau demi de mêlée du Stade Toulousain » décroche enfin.
« Salut Nico ».
C’est un accueil typiquement « thibaudien ». J’ai toujours eu l’impression que sa façon de glisser le prénom de son interlocuteur dans la phrase était une marque de sa considération.
« Salut, tu vas bien ? ».
« Ca va, ça va… et toi ? ».
« Ca va aussi » je lui réponds, avant qu’un silence gêné s’installe entre nous.
Nous n’avons pas échangé dix mots. Et j’ai à nouveau l’impression que le jeune pompier est distant.
« Ça se passe bien les entraînements ? » j’arrive à glisser pour débloquer la situation.
« Oui, très bien, mais je n’ai jamais été aussi fatigué de ma vie ».
Puis, il enchaîne, sans transition.
« Nico, tu as des nouvelles de Jé ? Tu sais s’il est parti à Paris ? ».
« Oui, il est parti hier ».
« Et il a passé ses examens médicaux ? ».
« Je crois qu’il les passe en ce moment même ».
Puis, un nouveau silence nous rattrape. Je décide de forcer les choses.
« Thibault, ça te dirait qu’on prenne un verre ? ».
« Je n’ai pas trop le temps en ce moment ».
« Je vais bientôt partir à Bordeaux pour mes études. Je voudrais vraiment te voir avant. J’ai des trucs à te dire. Je me suis mal comporté avec toi ».
« Laisse tomber ça, Nico. C’est mieux si on oublie tout ça ».
« Juste un moment, s’il te plaît ».
« Je ne sais pas si c’est une bonne idée pour l’instant. S’il te plaît, n’insiste pas ».
Sa détermination me touche et m’impressionne. Elle m’attriste. Et pourtant, elle force le respect.
« Je n’insiste pas, alors ».
« C’est mieux comme ça, je t’assure ».
Depuis quelques jours, à chaque fois que j’ai pensé rappeler Thibault, je me suis demandé si ça n’allait pas être trop tard pour rattraper le coup avec lui. Je crois que je tiens là ma réponse. Je n’ai plus d’arguments à lui opposer. Je culpabilise, j’ai envie de pleurer. Du coup, je ne sais pas comment mettre fin à cette conversation qui vient de me confirmer que j’ai perdu un ami.
Alors, dans un dernier élan d’espoir, je décide de jouer le tout pour tout.
« J’ai énormément d’estime pour toi, Thibault. Tu es un gars en or. Vraiment. Tu es un modèle pour moi. Ton amitié est précieuse pour moi ».
« Nico… ».
Pendant une poignée de secondes, un silence interminable me donne la mesure du malaise qui s’est installé entre nous.
« Je… je » je l’entends bafouiller. Je le sens touché, ému par mes mots.
Je touche du doigt le mal que je lui ai fait et qui lui empêche désormais de surmonter la distance créé par la souffrance. Thibault est blessé. Je l’ai blessé. J’ai blessé ce gars qui était mon ami, un ami sincère. Je l’ai blessé parce je n’ai pas su essayer de comprendre que, pour une fois, il ait pu avoir envie de penser à son propre bonheur. Parce que je n’ai pas su comprendre que, sous sa maturité, sa générosité, son altruisme, son abnégation, Thibault est un être sensible, on ne peut plus humain, et amoureux.
Je me sens minable. J’ai envie de pleurer. J’essaie de me maîtriser, non sans mal.
« Moi aussi je t’aime bien » il finit par lâcher.
« Je regrette tellement, si tu savais ».
« On a tous agi d’une façon qui n’était pas la bonne ».
Un nouveau silence s’installe, pesant.
« Thibault… ».
« Je dois y aller maintenant ».
« Rappelle-moi, quand tu veux… ».
« Tu es toujours sur Toulouse ? »
« Oui, mais pas pour longtemps. Je pars lundi soir à Bordeaux ».
« Bon courage pour la fac, Nico ».
Là, je suis assommé. Car cette formule ressemble à un adieu. J’ai vraiment du mal à retenir mes larmes.
« Merci… et bon courage à toi pour le Stade. Fais attention à toi, essaie de ne pas te blesser. Ce serait dommage qu’il t’arrive quelque chose ».
« Merci Nico. Adishatz » il me lance.
« Adishatz… je te dirai pour ses examens » j’ai tout juste le temps de lui relancer, avant que la communication ne soit coupée de son côté.
Désormais, j’en ai le cœur net. J’ai perdu l’amitié de Thibault. Je n’ai senti aucun reproche direct dans ses mots, et pourtant j’ai senti qu’il a été affecté par mon comportement. Jérém pense qu’il a besoin de temps pour surmonter tout ça. Mais moi j’ai bien peur que cela soit plus grave que ça. J’ai peur que, pour se protéger, il coupe les ponts pendant un temps tellement long que si un jour on se recroise, on sera à nouveau de parfaits étrangers. Je sais qu’il ne me rappellera pas.
Ce coup de fil m’a sapé le moral. Je m’en veux horriblement.
Je ressens la tristesse m’envahir. Soudain, Jérém me manque encore plus fort. Je regarde mon téléphone, toujours pas de message de sa part. J’aimerais tellement me blottir dans ses bras pour me réconforter. J’ai envie de le voir, de le toucher, de le serrer contre moi, de l’embrasser, de faire l’amour avec lui. J’ai envie d’entendre sa voix, d’avoir de ses nouvelles, de savoir comment se sont passés ses examens médicaux. Je tourne en rond dans ma chambre.
Je mets un cd de Madonna, cette amie que je connais depuis mon adolescence et dont la "présence", les chansons, ont marqué chaque moment de ma vie. Elle est là quand je suis heureux et quand je ne vais pas bien. Elle m'accompagne, sa présence et sa musique font que d'une certaine façon je ne me suis jamais senti seul même dans les pires moments. Et pourtant, cet après-midi, malgré sa musique, la solitude me prend à la gorge.
Je sors les photos que Thibault m’avait données un jour, lorsque nous étions potes. Une époque, hélas révolue.
Je retrouve Jérém assis sur la pelouse de la prairie des Filtres, on voit une arcade du Pont Neuf tout à gauche de l’image. Le buste soutenu par ses bras tendus derrière son dos et ses mains posées à plat sur le sol. Il est habillé d’un simple jeans et d’une chemise à carreaux noirs et blancs, les manches retroussées, ouverte sur un t-shirt blanc sur lequel sa chaînette de mec est négligemment abandonnée, le regard ténébreux. Tenue et attitude, très, très, très, mais alors, très très très très très meeeeec !
Je retrouve également Jérém en maillot de rugby. Beau comme un Dieu.
Et je retrouve ma préférée, mon bobrun sur la plage, torse nu, le bronzage ajoutant des couleurs à sa peau mate, la lumière du soleil mettant en valeur et en relief la musculature parfaite de son corps.
Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai la chance de faire l’amour avec un mec pareil. Et encore moins à croire que je suis quelqu’un de spécial pour ce mec. Qu’il a fait son premier coming out pour moi.
Sur ces trois photos Jérém est plus jeune mais déjà tellement sexy. J’ai tellement envie de lui. J’attrape son t-shirt et son boxer volés dans la corbeille à linge de l’appart de la rue de la Colombette, j’étale les trois photos à côté de moi et je me branle. L’excitation et la montée vers le plaisir me font très vite oublier tous mes tracas.
J’imagine le corps de mon bobrun contre le mien, sa peau chaude enveloppant la mienne, je ferme les yeux et je retrouve la sensation de sa queue dans ma bouche, de ses va et vient, de ses giclées puissantes, de son goût à la fois fort et doux de jeune mâle. Je retrouve sa présence virile entre mes fesses, je me sens envahi par son manche, enivré par son plaisir. J’ai tellement envie de faire jouir ce mec, putain !
La puissance de sa virilité, le goût de son jus de mec me manquent comme une drogue dure. Je revois ses biceps, ses pecs, ses abdos, sa bonne petite gueule se contracter sous l’effet de la décharge de l’orgasme. Je m’imagine bien rempli de sa semence chaude et dense. Qu’est-ce que je ne donnerais pas à cet instant pour qu’il soit là, en train de gicler en moi ! Et je jouis. Avec une intensité inouïe.
Dans les instants qui suivent l’orgasme, je suis envahi par cette sensation d’intense apaisement qui fait tellement de bien. Une sensation qui, hélas, ne dure pas longtemps.
Lorsque je redescends, je repense au moment où le bomécano m’a offert ces images. C’était pendant l’été dernier, la seule fois où il m’avait invité prendre un verre chez lui. Je venais de lui avouer mes sentiments pour son pote. Même si ça faisait un moment qu’il avait compris.
Je me souviens qu’il m’avait parlé de l’anniversaire de son pote Jéjé.
« Dans moins de trois mois, il va fêter ses vingt ans » il m’avait raconté « et j’ai prévu de lui faire une surprise. J’ai envie de l’amener au Mas d’Azil pour lui offrir un saut à l’élastique de 80 mètres de haut. Je sais qu’il va kiffer ».
L’anniversaire de Jérém, c’est dans moins d’un mois. Je doute fort que cela se fasse.
Soudain, je réalise qu’il serait bon que j’aille voir mon bobrun à Paris le week-end de son anniversaire. J’aimerais qu’on puisse se voir avant, mais au pire, je ne peux pas rater le coche du week-end du 13 et 14 octobre, juste avant son anniversaire le 16. Est-ce que je vais lui faire une surprise ? Il faudrait déjà que je sache où il crèche et que je sois certain de son emploi du temps. Que je sois certain de ne pas le déranger. De ne pas trop exposer notre relation. Ça fait beaucoup d’inconnues. Putain, son anniversaire c’est rien que dans un mois. Comment vais-je tenir jusque-là ? J’aimerais tellement pouvoir aller le voir dès ce week-end !
Soudain, en regardant une énième fois les photos de Jérém, je me rappelle que ce ne sont plus les seules que je possède de mon bobrun. Car il y en a bien d’autres dans mon appareil jetable de 24 poses, et qu’il suffit de les amener à développer pour retrouver mon bobrun, d’une certaine façon.
Ceci me donne une raison pour sortir de ma tanière. Ca me changera les idées, en attendant le rancard avec Julien.
[Attention : les paragraphes qui suivent décrivent des gestes et des plaisirs aujourd’hui disparus, inconnus pour les nouvelles générations nées avec le tout numérique et le tout Internet. Et pourtant, qu’est-ce que c’était bon ! Enjoy-it !].
En début d’après-midi, je me rends au grand magasin de cd et livres de la place Wilson. Je laisse les négatifs au comptoir. La nana m’annonce que je peux passer les récupérer samedi 14 heures. Deux jours, ça va être super long ! Je suis tellement impatient de savoir si les photos sont réussies ! Je suis tellement impatient de revoir mon Jérém tel que je l’ai retrouvé à Campan !
Et pourtant, il y a dans cette attente quelque chose de magique. Car c’est bien cette attente, ajoutée au prix à débourser pour obtenir une quantité limitée de clichés, qui donne à ces derniers leur valeur. Pourvu qu’il n’y ait pas d’accident au développement, car ces photos que je n’ai pas encore vues sont déjà si précieuses à mes yeux !
Etant sur place, je profite pour faire un tour dans les rayons cd et dvd. Je flâne, je fouille dans les bacs, je découvre, je laisse mon regard se balader dans cet univers coloré et plein de tentations. Dans les bacs, à la lettre M, je m’attarde sur la section Madonna, de loin la plus fournie de toutes. Les albums côtoient des maxi cd contenant des remix, ou même des cd pas vraiment officiels. Je vérifie s’il y a des cd qui ne sont pas encore dans ma collection. Un cd de pressage américain et au packaging cartonné contenant des remix du titre « Music » attire mon attention. Je ne l’ai pas. Aujourd’hui, je vais encore enrichir ma collection. Je ressens un vrai plaisir. Je le prends, impatient de l’écouter.
Soudain, je me rappelle m’être dit que j’achèterais le cd de Starmania, cet opéra futuriste et prémonitoire que j’ai découvert à Campan. Je cherche, je ne trouve pas. Je cherche un vendeur, je demande. Il m’indique le rayon, avec le sourire. Il m’explique que c’est la version de 1998, celle montée pour les 20 ans de l’opéra rock. Il ajoute qu’il l’aime beaucoup, car elle est à son avis plus sobre et peut-être plus aboutie même que l’original de 1978.
Aujourd’hui, j’explose mon budget musique. Quand je serai à Bordeaux, je devrais faire davantage attention, car la vie étudiante a des priorités autres que les cd.
Je me dirige vers la caisse. Et là, un choc m’attend. Venant en sens inverse et se dirigeant vars le rayon cd, mon regard est aimanté par un petit brun excessivement mignon, avec un brushing de bogoss, un physique de parfait petit con sexy, une peau délicieusement mate, et une petite gueule du genre à faire jouir avec une urgence plus qu’absolue. Une petite gueule bien connue, avec un air de famille. Putain, si je m’attendais à ça, à tomber sur Maxime, le frérot de mon Jérém !
Le bogoss est accompagné de sa copine. Et lorsqu’il me repère, sa belle petite gueule s’ouvre dans un sourire à faire pleurer tous les Dieux de l’Univers. Ah, putain, qu’est-ce qu’il est beau lui aussi, beau étant largement insuffisant à qualifier une telle présence, et le bonheur qu’elle dégage. Un bonheur qui n’a d’équivalent que dans celui provoqué par son frère. A une différence près : le petit Tommasi, tout en étant aussi charmant que son frère, est davantage souriant et jovial. Ça tranche énormément avec le petit gars terrifié, en pleurs et en colère que j’ai découvert dans le hall de l’hôpital de Purpan, le jour de l’accident de Jérém.
« Hey, Nico, tu vas bien ? » me salue le petit mec, très chaleureux, en me claquant la bise.
« Très bien et toi ? ».
« Bien, bien. Je te présente ma copine. Nico, Claire, Claire, Nico ».
« Alors, comment ça s’est passé à Campan ? » il enchaîne.
« Très bien… ».
J’ai envie de lui dire « très bien parce que ton frère était tendre, doux, parce qu’il m’a fait comprendre à quel point je compte pour lui, parce qu’on a fait l’amour tant de fois, parce qu’il a fait son coming out ».
Au lieu de quoi, je me contente d’ajouter :
« J’ai fait du cheval pour la première fois de ma vie et j’ai rencontré des gens formidables ».
« Et Jérém il allait bien ? » il me demande, alors que la copine part faire un tour dans les rayons.
« Il était en forme. Il attendait le coup de fil de Paris ».
« Je l’ai eu ce matin, il attendait pour commencer le visites. Il me tarde d’être à ce soir pour savoir ».
Qu’est-ce que c’est beau cette complicité et cette proximité entre frères.
« Moi aussi ».
« Il m’a dit que lui aussi il a passé un très bon moment. Il avait l’air vraiment content que tu l’aies rejoint ».
« C’était génial ».
« Maintenant, il va falloir faire des bornes pour vous voir » il ajoute.
« Je sais, ça va être plus compliqué ».
« Paris et Bordeaux c’est pas si loin ».
« Il me tarde d’aller le voir ».
« A lui aussi ça lui tarde. Tu comptes vraiment beaucoup pour lui, tu sais… ».
« J’espère qu’il ne va pas m’oublier ».
« Non, il ne t’oubliera pas. Mais il va falloir te battre ».
« Je sais ».
« Allez Nico, je vais rejoindre Claire, avant qu’elle fasse la gueule. Content de t’avoir vu ».
« Moi aussi je suis content de t’avoir vu ».
« Au plaisir de te revoir » fait-il, en partant vers le rayonnage, après m’avoir claqué une nouvelle bise et avoir laissé traîner un clin d’œil des plus charmants et sexy.
« J’espère ».
« Tiens » fait-il, en revenant soudainement sur ses pas « je vais te filer mon numéro, et tu vas me filer le tien. Si jamais, un soir on se fera une bouffe ».
Vraiment adorable le petit gars. Je note son numéro sur mon portable et je lui donne le mien.
« Bon courage pour tes études ».
« Merci ».
Je le regarde s’éloigner avec sa démarche bien mec. J’adore ce petit gars. Je crois que j’ai trouvé un nouvel ami.
La télé tourne en continu à la maison. Le monde s’accroche à l’info pour tenter d’apaiser sa peur. Une info qui hélas, distille davantage de questionnements dans l’esprit des gens qu’elle apporte de réponses. Une info qui ne fait qu’alimenter encore cette peur, sans jamais l’apaiser.
Les images effrayantes des impacts des avions sur les tours jumelles et de leur effondrement continuent de tourner en boucle. Des experts de tout bord, dans toutes les langues, se succèdent dans les émissions spéciales qui bouleversent les programmations des chaînes.
Le discours du président américain de la veille est lui aussi passé et repassé et décortiqué sans cesse. Ce qui me frappe le plus dans ses mots, c’est « la guerre ». Une guerre « contre la terreur » qui se veut réponse ferme au sentiment de peur de toute une civilisation. Mais qui, à bien regarder, a un goût de vengeance pure. Une guerre qui veut laver une humiliation, sans se pencher sur la compréhension des raisons qui ont conduit à ce désastre. Une guerre pour éradiquer le terrorisme, par la violence. Une guerre pour créer la paix. Un bel exemple d’oxymore. Car la guerre ne fait en général que créer la guerre. Dans une guerre, il n’y a pas de gagnant. A l’échelle du temps, il n’y a que des perdants.
Cette guerre me fait peur. Jusqu’où elle va nous mener ? Est-ce que les attentats de New York ne sont qu’un avant-goût de l’horreur que vont connaître nos pays occidentaux ?
Je dois retrouver Julien en début de soirée. Je lui ai donné rendez-vous dans une brasserie. Un endroit que je n’ai pas choisi au hasard. Une brasserie à Esquirol. La brasserie où Jérém a travaillé pendant tout l’été passé. J’ai envie de sentir les vibrations de ce lieu qui demeure à mes yeux marqué et imprégné par la présence de mon bobrun.
J’arrive une demi-heure avant le rendez-vous. Il n’y a pas grand monde et j’ai la chance de pouvoir m’installer à la même table où j’étais installé le jour où je suis venu le voir à la brasserie, le dernier jour de la semaine magique où il était venu chaque jour me faire l’amour à la maison pendant sa coupure de l’après-midi.
Je regarde la terrasse presque vide, ses tables inoccupées et je revois mon bobrun avec sa belle chemise blanche, bien ajustée à son torse de fou, les manches retroussées, deux boutons du haut ouverts laissant entrevoir sa chaînette posée sur le relief de ses pecs délicatement poilus. Je le revois, avec son pantalon noir élégant et ses baskets blanches et rouges, un plateau rond chargé de boissons, je le revois voltiger entre les tables, avec son assurance, avec son sourire charmeur et ravageur. Je le revois en train de se faire draguer par deux nanas.
En attendant Julien, j’ai le temps de prendre un café, prétexte pour accéder aux toilettes de l’établissement. Non pas que j’aie vraiment besoin d’aller au petit coin. Ce dont j’ai vraiment envie, c’est de revoir et d’approcher la porte du fond du couloir, celle qui donne sur la petite cour qui mène à la réserve, cet endroit rempli de bouteilles au milieu desquelles mon Jérém a voulu que je lui fasse une gâterie qui s’était révélée terriblement excitante.
Je prends même le risque de pousser la porte qui donne sur la petite cour, comme pour pénétrer un peu plus dans le souvenir. Soudain, à la vue de la porte entrouverte de la réserve, je ressens une bouffée de chaleur monter à mon visage. Mon cœur se tape un sprint mémorable, ma respiration devient espacée et profonde. L’excitation s’empare de moi. Je bande comme un âne. J’ai envie de lui à en crever. Réflexe pavlovien.
Car en une fraction de seconde, je retrouve intactes les sensations de ce jour-là, ce mélange de peur de nous faire gauler et d’excitation extrême. Je retrouve dans mon nez le parfum de sa peau, la chaleur de son corps, les petites odeurs de sa virilité moite de transpiration. Dans mes oreilles résonne le bruit de sa ceinture qui se défait, de sa braguette qui s’ouvre, de son boxer qui glisse sur ses cuisses, de sa queue tendue qui jaillit en claquant sur ses abdos, de ses ahanements de plaisir. Dans ma bouche je ressens la raideur de son manche. Et ses giclées, leur puissance, leur goût divin. Putain de jeune mâle, que ce Jérémie ! Quand je pense que c’est lui qui m’a proposé cette galipette !
J’ai encore envie de me branler. Pendant un instant, l’idée de m’enfermer dans les toilettes pour me soulager me traverse l’esprit, mais j’y renonce. Je reviens à ma table et je me perds à nouveau dans mes souvenirs. Je repense à la semaine magique, aux après-midis chez moi, dont cette pipe dans la réserve avait été le point d’orgue avant le clash qui allait nous séparer pendant un mois. Un mois horrible, le pire moment de ma vie, après cette belle semaine qui était à ce moment-là le plus beau souvenir de ma vie. Et pourtant, après la souffrance, un nouveau bonheur, encore plus grand, était venu. Campan.
Mais ce bonheur avait été de courte durée. Une poignée de jours magiques, avant une nouvelle séparation difficile. Mais cette fois-ci, c’était l’amour qui l’avait rendue difficile, et non pas la bagarre. Un amour que nous partagions, dont les preuves tangibles étaient des larmes que nous partagions également.
La séparation à Campan était le déchirement de deux êtres qui s’aiment et qui se sentent aimés. Peut-être la plus déchirante de toutes des séparations. Certes, pas une séparation définitive, mais une séparation avec des vœux de retrouvailles. Des retrouvailles sans échéance précise, avec une distance dans le temps et dans l’espace. Une séparation qui pourrait faire vaciller les bonnes dispositions de mon bobrun encore fraîches, jeunes et fragiles.
« Eh, oh ! Tu es parti ou, là ? » se moque le beau Julien en me secouant au sens propre (je sens sa main se poser sur mon cou par derrière, l’enserrer et le remuer légèrement) que figuré, de mes rêveries.
Tout pris dans mes réflexions, je ne l’ai même pas vu arriver.
Mais lorsque je reviens à moi, sa présence se dévoile à mes yeux avec la force d’une claque en pleine figure.
Avec son sourire incendiaire, sa voix éraillée et sexy, ses attitudes de charmeur, son t-shirt noir bien ajusté à son physique élancé, sa peau bronzée, ses yeux pétillants, sa dentition parfaite et immaculée de jeune loup conquérant, et ce parfum hypnotisant qui avait failli me faire rater ma conduite à l’époque, le boblond est toujours aussi craquant.
« Alors, comment se sont passées ces retrouvailles avec ton mec ? ».
« Très bien »
« Vous avez bien profité de vos corps ? ».
« Oh que oui ».
« Quel coquin, ce Nico ! ».
« Et il a même voulu que je lui fasse l’amour ».
« Toi, tu lui as fait l’amour ? ».
« Oui ».
« Je pensais que tu étais passif ».
« Je le pensais aussi. Mais j’ai pris beaucoup de plaisir ».
« C’était ta première fois ? ».
« Oui ».
« Félicitations, alors, tu n’es plus puceau à présent ».
« C’est ça ! ».
« Quand je pense que tu hésitais à y aller ! ».
« C’est vrai… merci de m’avoir convaincu. Et d’ailleurs, encore merci d’être venu faire démarrer la voiture ».
« C’est rien. Alors, raconte, il t’a demandé en mariage ? » il plaisante.
« T’es con ! Non pas vraiment, mais c’était génial, vraiment génial. Il m’a amené chez lui, il a une vieille bicoque là-haut, dans les montagnes. Il a été tendre, doux, il m’a beaucoup parlé de lui, il m’a dit à quel point il tenait à moi. Il m’a présenté ses amis cavaliers, on a fait du cheval ensemble. C’était la première fois que j’en faisais, je suis tombé, je suis remonté en selle. J’ai rencontré des gens drôles et ouverts d’esprit. Et un soir, il m’a embrassé devant tous ses potes ».
« Ah, carrément ! Couillu, le mec ! ».
« Oui, couillu… on a bien rigolé, on s’est fait des bisous, beaucoup de bisous, et beaucoup venaient de lui. On s’est caressés, on s’est serrés l’un contre l’autre, on a dormi ensemble, on s’est réveillés ensemble, on s’est douchés ensemble, on a mangé ensemble, comme un vrai petit couple. C’était tellement, tellement bien ! »
Pendant que je parle, j’en ai les larmes aux yeux. C’est la première fois que je parle si précisément de ces jours magiques à Campan et soudain, la parole ravive le souvenir, et la souffrance que me procure le manque de Jérém se fait sentir comme une plaie béante sur laquelle on aurait jeté du sel.
« Et puis le coup de fil de Paris est arrivé. Et il a dû partir, hier matin ».
« Il te manque, hein ? » fait le boblond, en saisissant mon bras avec sa main chaude et ferme et en caressant ma peau avec son pouce.
« Tu peux pas savoir à quel point. Surtout après ce qui s’est passé avant hier ».
« C’est horrible, on est tous sous le choc. Ça m’a tellement secoué que j’ai ressenti le besoin de prier. Ça devait faire plus de dix ans que je n’avais pas prié. Mais avant-hier soir, j’ai eu besoin d’aller à St Sernin et prier pour toutes ces victimes. J’ai prié pour que rien de semblable n’arrive en France, et que ça n’arrive plus jamais nulle part dans le monde. J’ai prié pour que les Hommes reviennent à la raison, et pour qu’il n’y ait pas une guerre qui pourrait tout effacer de la surface de la planète ».
« Ça dépasse l’entendement » je commente.
« Mais il faut aller de l’avant, il ne faut pas cesser de vivre. Vous allez vous revoir quand ? ».
« Je n’en sais rien… c’est ça qui est le plus dur à supporter ».
« Tu dois lui manquer aussi ».
« Oui, il me l’a dit hier soir ».
« Alors vous allez vous revoir bientôt ».
« Ça dépend de lui, de comment il va être installé, de son emploi du temps. La semaine prochaine c’est ma rentrée à Bordeaux. Ce ne sera pas avant 15 jours au mieux, et plusieurs semaines au pire ».
« L’essentiel c’est que ça arrive, que vous vous retrouviez. Plus l’attente sera longue, plus vous aurez du plaisir à vous retrouver ».
« J’espère qu’il ne va pas m’oublier à Paris ».
« Il ne t’oubliera pas ».
« Il y a tellement de tentations la bas ».
« Je ne te dis pas qu’il ne couchera pas ailleurs, mais tu seras toujours celui qui a la place de choix dans son cœur ».
« Coucher ailleurs ? » je fais, déstabilisé par ses mots.
« Tu te doutes bien que tu ne peux pas lui demander de ne pas se vider les burnes pendant des mois ».
« Je préfère ne pas y penser ».
« Toi aussi tu auras des occasions ».
« Je n’en veux pas ! ».
« Si tu t’obstines à lui réclamer la fidélité et à lui imposer l’abstinence, tu vas le perdre ».
Je pousse un souffle de détresse.
« Et si tu t’imposes l’abstinence » il continue « tu vas devenir fou. L’important, c’est que vous vous protégiez quand vous allez voir ailleurs. Que vous ne vous rameniez pas de saloperies. C’est ça que tu dois exiger de lui et c’est aussi ça que tu dois lui garantir ».
« Je ne veux pas coucher ailleurs, et je ne veux pas qu’il couche ailleurs ».
« Je ne te parle que de sexe. Il sera toujours ton Jérémie et tu seras toujours son Nico à lui ».
« Qui me garantit qu’en couchant ailleurs, il ne va pas tomber amoureux d’un autre ? ».
« Personne. Et c’est vrai aussi de ton côté. Mais c’est le risque à prendre pour donner une chance à votre relation. Toi non plus tu ne tiendrais pas ».
« Si ».
« Admettons. Mais pour lui ça va être plus compliqué ».
« Pourquoi ? ».
« Un joueur de rugby pro, bogosse comme lui, dans une ville comme Paris, il sera sollicité à mort. Il ne tiendra pas. Si tu lui demandes de ne pas coucher, il sera obligé de te mentir. Et un jour tu découvriras ses mensonges et tu auras mal. Vous vous finirez par vous vous disputer et vous quitter ».
« Tu es si négatif ! ».
« Non, je suis réaliste. Je te parle de mon expérience avec les nanas ».
« Je ne sais pas si je suis capable d’accepter que Jérém couche ailleurs ».
« Si tu n’acceptes pas ça, ta vie va vite devenir un enfer. Tu vas être rongé par la jalousie et les questionnements et tes études vont s’en ressentir. Et en plus, tu vas le perdre ».
« Ecoute, Nico » il continue, tout en posant sa main sur la mienne, pour me rassurer « il a 20 ans, laisse-le papillonner jusqu’à ce qu’il en ait marre. Et toi aussi fais des expériences. Imagine s’il part un jour à l’étranger pour une carrière internationale, ce sera encore plus difficile. [Je frissonne à la simple évocation de cette possibilité que je n’avais encore jamais envisagée]. Dis-toi qu’il a fait un grand pas vers toi en faisant son coming out ».
« J’ai peur que ses bonnes intentions et sa volonté de s’assumer ne durent pas longtemps à Paris ».
« Pourquoi ça ? ».
« A Campan on était au milieu de nulle part, entouré de gens bienveillants. Mais à Paris, dès qu’il va être connu, j’ai peur qu’il veuille à tout prix garder les apparences et remettre de la distance entre nous ».
« C’est vrai, je n’y avais pas pensé. Mais n’oublie jamais que tu es quelqu’un de spécial pour lui. S’il ne peut pas assumer ta présence dans sa vie dans l’immédiat, le forcer ne servirait à rien. Montre-lui ton amour et n’exige pas plus que ce qu’il peut te donner. Sois patient et prête attention aux petites choses qui t’assurent de son amour, au-delà de ses coucheries et de ce que son environnement sportif lui impose comme limites ».
Les mots de Julien me secouent. Car il a mis le doigt précisément là où ça fait mal. Je sais que Julien a raison, mais c’est horriblement dur à entendre et à admettre. Car le cœur a ses raisons que la raison ignore, et le cœur aime mieux écouter ses propres raisons plutôt que celles de raison. Alors, je préfère penser que nous allons y arriver, que notre couple va résister à la distance sans que nous ayons besoin d’aller voir ailleurs.
Jérém me manque horriblement. Sur le chemin vers la maison, je lui envoie un nouveau sms.
« Tout se passe bien ? ».
Deux minutes plus tard, je reçois sa réponse.
« Pas encore finit, je tappelle tt l heure ».
Pendant le dîner, j’attends fébrilement son coup de fil. Mais à 20 heures il n’est toujours pas arrivé. A 21 heures non plus.
Ce n’est qu’à 21h50 que mon portable se met à vibrer et que l’écran affiche les dix chiffres familiers associées au prénom tant aimé de mon Jérém.
« Ourson… » je l’entends répondre à mon simple « Allo ? ». Le ton de sa voix est calme et doux comme une caresse. Et dans ce petit surnom, je retrouve toute sa tendresse, son amour.
« Comment ça va ? » je le questionne.
« Bien ».
« Alors, ces visites médicales ? ».
« Ils m’ont fait foutre à poil, ils m’ont regardé sous toutes mes coutures, ils m’ont fait toute sorte d’examens, prises de sang, test de souffle, j’avais l’impression d’être une voiture et de passer le contrôle technique ».
« Verdict ? Avec ou sans contre-visite ? ».
« Sans. Il semblerait que je suis pas trop détraqué ».
« C’est bon alors ? ».
« Ouiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!! A priori je signe le contrat demain et je commence les entraînements dès mercredi ! ».
Sentir Jérém à ce point heureux m’émeut jusqu’aux larmes. On dirait un gosse le jour de Noël. Je voudrais tant être à ses côtés pour partager cette joie avec lui. Fêter ça avec un resto. En faisant l’amour.
« Je suis tellement content pour toi ».
« Merci, merci ».
« Tu l’as dit à Maxime ? ».
« Non, je vais l’appeler juste après. Je voulais te l’annoncer en premier ».
Adorable.
« Je l’ai croisé aujourd’hui en ville avec sa copine. Il m’a demandé comment s’était passé Campan ».
« Il est curieux le petit ».
« Il est très sympa ».
« Il est génial ».
« Comme son frère ».
« Tu me manques, Nico ».
Lire ces mots dans un sms, m’a ému aux larmes. Les entendre de sa vive voix, me bouleverse.
« Toi aussi tu me manques. Il me tarde de te revoir ».
« Dès que je serai installé, promis ».
« Tu dors où ce soir ? ».
« Dans un hôtel payé par le club. J’ai une chambre toute pour moi. Et il y a d’autres joueurs juniors à côté. Mais dès le mois prochain je devrais avoir un appart ».
La simple idée de la proximité d’autres jeunes joueurs que j’imagine d’emblée bien foutus et sexy, mais aussi seuls, un peu déboussolés par cette ville inconnue, par ce changement d’horizon, par cette vie nouvelle, et qui ne seraient pas contre un peu de compagnie et d’intimité, suffit à produire en moi une flambée de jalousie.
« Tu vas faire quoi ce soir ? ».
« On a prévu d’aller prendre un verre avec les gars ».
« Tu restes sage ! » je ne peux m’empêcher de lui glisser en rigolant.
« T’inquiète, je ne vais pas trop boire ».
« Je parlais des gars » je fais, sur un ton taquin.
« Ah, mais je ne suis pas pd, moi ! » il se marre.
« C’est ça ».
« J’ai envie de toi ».
« Moi aussi, j’ai eu envie de toi depuis ce matin ».
« Ce matin je me suis branlé en pensant à toi » il me glisse.
« Moi aussi… ».
« Quel gâchis ».
« Je ne te le fais pas dire ».
« Passe une bonne soirée, Nico ».
« Toi aussi, Jérém, et bon courage pour demain ».
« Bisous ».
« Bisous ».
Ce soir, dans mon lit, j’ai du mal à trouver le sommeil. Je repense aux mots de Julien : « il n’a que 20 ans, laisse-le papillonner ». Et je repense aux mots de Jérém : « On a prévu d’aller prendre un verre avec les gars ». Mais aussi, et surtout, à ses autres mots : « j’ai envie de toi ». Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais j’ai encore envie d’y croire. Et je m’endors en pleurant, à la fois de bonheur et de tristesse.
Mais avant de partir dans les limbes, j’envoie un message à Thibault.
« Les examens se sont bien passés. Jérém commence les entraînements lundi ».
« Merci Nico ».
 6 commentaires
6 commentaires
-
Par fab75du31 le 21 Novembre 2019 à 05:22
Après l’amour, je me suis endormi assez rapidement. Je crois que j’ai passé une bonne partie de la nuit dans les bras de mon bobrun. Dans ses bras, mon sommeil était plus apaisé.
Lorsque j’émerge, le radio-réveil indique 6h52. Je n’ai dormi que 4 heures. Jérém n’est déjà plus au lit.
Peu à peu, le souvenir de son départ imminent remonte à mon esprit. Mais, très vite, ce sont les souvenirs des images horribles de la veille qui accaparent ma conscience.
Et avec eux, les questionnements sur l’avenir. Pourquoi se lever ce matin ? Pourquoi se quitter, alors que plus rien n’a de sens ? Pourquoi ne pas tout envoyer valser et rester ensemble, tant qu’on est vivants ? Comment et pourquoi reprendre la vie après ça ? A quoi bon ?
Et pourtant, la vie a déjà repris autour de moi.
Un beau feu crépite dans la cheminée. La cafetière chauffe sur la plaque en fonte. Le café est en train de monter avec ce bruit si particulier, accompagné de cet arôme intense qui remplit la pièce, et qui sent le bonheur du réveil aux côtés du gars que j’aime. Un nouveau jour va bientôt se lever.
Je n’ai pas besoin de chercher Jérém comme la veille. Je reconnais le doux bruit de l’eau de la douche, le délicieux parfum de son gel-douche qui vient titiller mes narines. Puis, c’est le parfum de son déo qui vient exciter mon odorat.
Quelques instants plus tard, le bogoss déboule de la salle de bain avec un brushing au gel encore humide, la barbe bien taillée, aux contours nets et réguliers, le torse enveloppé par un t-shirt blanc soulignant le relief de ses pecs, la carrure de ses épaules, la puissance de ses biceps, la couleur mate de sa peau, la couleur sombre de ses tatouages. Il traverse la petite pièce bien à l’aise dans son beau boxer orange moulant divinement ses cuisses et ses fesses musclées.
Tout peut s’effondrer autour de nous, il y a un truc qui ne change pas. C’est la beauté surnaturelle de mon bobrun. Ah, putain, qu’est-ce qu’il est sexy !
Mais il y a autre chose qui, apparemment, n’a pas changé : c’est son envie de me faire des câlins.
Me voyant réveillé, il vient dare-dare me faire un bisou.
« T’as bien dormi ? » il me demande.
« Dans tes bras, je dors toujours bien ».
Le bogoss amorce un petit sourire aussi beau que le plus beau des levers de soleil.
« Et toi, t’as bien dormi ? ».
« Pas beaucoup ».
« Ca va aller pour la route ? ».
« Oui, je vais faire des pauses ».
« Tu sais où tu vas dormir ce soir ? ».
« On m’a donné l’adresse d’un hôtel » fait le bobrun, tout en commençant à ramasser ses fringues et en les fourrant en vrac dans son grand sac de sport.
Je le regarde faire et j’ai envie de pleurer. Le moment de nous séparer approche à grand pas. Les « gestes de l’adieu » s’accomplissent devant mes yeux et j’ai l’impression que je vais crever. Une partie de moi tente toujours de lutter contre l’inéluctable, elle cherche toujours le moyen de ne pas être séparée du gars que j’aime plus que tout au monde. Non, je n’arrive pas encore à accepter le fait que dans une heure ou deux je ne pourrai plus le voir, lui parler, le toucher, le câliner, faire l’amour avec lui.
Comment arriver à accepter, et même à concevoir, l’idée de me séparer de lui, alors que le seul endroit au monde où je me sens vraiment bien, et où je me sens désormais en sécurité, c'est dans le creux de ses bras ?
Je n’ai pas envie de me lever, j’ai l’impression que si je reste au lit, je peux arrêter le temps. J’ai besoin d’arrêter le temps. Mais mon bobrun ne semble pas partager ce besoin. Pour lui, tout a l’air de se dérouler normalement, selon « les plans » :
« Tu passes à la douche, Nico ? ».
« Ouais… » je fais, avec tristesse.
« Vas-y, alors, après je vais faire un peu de ménage ».
Je prends une profonde inspiration, et je prends surtout bien sur moi pour quitter les draps. Je me lève d’un bond, je me dirige vers la salle de bain comme un robot, sans regarder en arrière, me faisant violence à chaque pas pour ne pas faire demi-tour.
J’ouvre l’eau de la douche, je laisse couler. Je lance un regard dans la petite pièce, j’essaie de m’imprégner de chaque détail de cette petite maison du bonheur que je vais quitter d’ici peu. Je fixe mon regard sur chaque objet me parlant de lui. Sa serviette humide accrochée au mur, son t-shirt gris de la veille juste à côté, son boxer abandonné au sol, le gel pour cheveux, le rasoir, le déo posés en vrac sur le rebord du lavabo. J’essaie de m’imprégner de cette « scène du quotidien » partagé avec mon bobrun, j’essaie de graver dans ma mémoire les moments de bonheur que j’ai eu la chance de vivre pendant ces quelques jours. Est-ce que je vais en connaître de semblables à Paris ?
Je me fais une nouvelle fois violence pour passer sous la douche. Le bruit de l’eau couvre celui de mes sanglots. Après la douche, ma serviette se charge d’éponger tout autant mon corps que mes larmes incessantes. Avant de regagner le petit séjour, j’essaie de me maîtriser. Je ne veux pas gâcher ces derniers moments ensemble avec ma tristesse.
Lorsque je le rejoins, Jérém est en train de dévorer une épaisse tartine pleine de confiture tout en buvant de bonnes gorgées de café fumant. Oui, définitivement, la vie a repris en ce 12 septembre 2001.
« Dis-donc, t’avais faim ! ».
« Grave ! Pas toi ? » il me lance, sur un ton presque insouciant.
« Si… ».
Oui, moi aussi j’ai faim. Car la veille nous n’avons pas dîné.
Alors, je mange, beaucoup, malgré la boule au ventre qui grossit de minute en minute. Je sais que je suis en train de vivre notre dernier réveil, notre dernier petit déjeuner ensemble. Je cherche désespérément le moyen d’en profiter un max, de ne pas me laisser gâcher ce moment par ma tristesse. Je cherche, sans trouver. Jérém ne parle pas, moi non plus.
Je réalise qu’à l’approche d’une séparation, les derniers instants ensemble sont les plus durs et ils sont de plus en plus durs au fur et à mesure que le moment de se quitter approche.
Les voir glisser sur le silence est tellement frustrant, tellement dur à vivre, tellement cruel qu’une partie de moi commence à souhaiter que ça se termine le plus vite possible.
Je sais que je regretterai ce souhait dès l’instant où je serai séparé de mon Jérém. Mais là, j’ai juste envie d’être seul et de pleurer son départ.
Après le petit déjeuner, le bogoss s’attaque au ménage. Je l’aide à ranger, balayer, nettoyer. La pièce étant petite, à plusieurs reprises nous nous encombrons l’un l’autre. Nos épaules se frôlent, nos mains s’effleurent, nos regards se croisent, nos lèvres se cherchent. Je ne suis pas un grand fan du ménage, mais j’adore ce moment, car c’est l’un des derniers que nous partagerons tous les deux avant longtemps. Ce ménage me met presque de bonne humeur. Mais lorsqu’il se termine, je sens une nouvelle tristesse m’envahir.
Après un tour dans la salle de bain pour ramasser ses affaires, Jérém passe un beau jeans délavé et déchiré par endroits. Sexy à mort. Et là, il a ce geste inouï de soulever son t-shirt blanc, de le coincer au milieu de ses abdos pour être plus à l’aise pour boutonner sa braguette.
Définitivement, mon Jérém est un véritable petit Dieu, un petit Dieu d’une beauté et d’une sexytude aveuglantes. Et ce t-shirt blanc si bien porté, couplé avec ce jeans, il n’y a pas tenue plus sexy à mes yeux. Définitivement, dès qu’il va descendre de sa voiture à Paris, les nanas et les mecs vont lui sauter dessus.
Je le regarde boucler les boutons de sa braguette et je sens une envie violente s’emparer de moi. Une envie rendue carrément obsédante par une voix au fond de moi qui me dit que c’est peut-être la dernière fois que je pourrai profiter de ce petit Dieu. La dernière avant longtemps. Ou la dernière tout court.
Non, non, non, je ne peux pas le laisser partir comme ça, sans lui faire une dernière pipe, sans lui offrir un dernier intense orgasme en guise de souvenir de moi, sans goûter une dernière fois à son jus divin.
Je m’approche de lui presque d’un bond, juste à temps pour lui empêcher de fermer le dernier bouton.
Je glisse deux doigts derrière la braguette, je caresse doucement sa queue au repos.
« On n’a pas le temps ».
« T’es tellement, tellement, tellement sexy avec ton t-shirt blanc moulant… tu me rends dingue… ».
Sans prêter attention à ses mots, je laisse mes doigts défaire le deuxième bouton, puis descendre un peu plus le long du coton élastique, effleurer la bête encore endormie.
« Nico… » fait Jérém, sans pour autant rien entreprendre pour m’en empêcher.
« On a bien cinq minutes » je lui chuchote, alors que mes doigts ont trouvé son gland et commencent à le caresser à travers le tissu fin. Et alors que la bête tapie sous le coton fin commence à donner des signes de réveil imminent.
Et là, pour toute réponse, je l’entends pousser une bonne expiration.
« On a cinq minutes, alors ? » je m’enhardis.
« Tu sais que je ne sais pas résister ».
« Je sais ».
L’idée de lui faire une pipe dans cette tenue me donne le tournis.
Un instant plus tard, le bogoss a trouvé un bout de mur auquel appuyer ses épaules. Et moi, je suis à genoux devant sa braguette entrouverte, devant son boxer orange, devant son t-shirt blanc moulant tous ses muscles.
Je défais à nouveau les boutons du bas, j’ouvre grand sa braguette. Je fais glisser le jeans sur ses cuisses, je pose mon nez et mes lèvres sur le tissu orange. Je suis immédiatement frappé par le bonheur olfactif dont il est imprégné, un délicieux mélange de petites odeurs de lessive, de queue fraîchement douchée, de mâlitude. Je suis assommé par la douceur du tissu, par la chaleur radioactive de sa virilité. Mes lèvres et mon nez ne peuvent s’empêcher de faire des petits mouvements pour capter un peu plus de ce bonheur olfactif et tactile qui les enivre.
Et le bonheur suprême c’est de sentir sa queue palpiter, gonfler rapidement, prendre de l'ampleur et déformer le tissu élastique. C’est la sentir impatiente de s’échapper, de se déployer dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, belle, raide, fière, conquérante, n'attendant que d’être avalée.
Et lorsque sa main se pose sur ma nuque pour presser un peu plus mon visage contre sa belle bosse de mec, je crois que je vais disjoncter. En une fraction de seconde, je me revois à genoux devant lui le jour de notre première « révision » pour le bac. Lui, avec son t-shirt blanc moulant et avec un simple jeans, la braguette ouverte, les deux pans de tissu ballants avec les bouts de sa ceinture de mec, prêt à se faire sucer. Comme ce matin. Je me rappelle de sa main sur ma tête, comme ce matin.
Sa tenue est la même, ma position aussi. La position de sa main aussi. Mais l’intention de cette dernière est bien différente que celle d’autrefois.
En ce jour de printemps déjà lointain, son but était de rapprocher un peu plus mon visage de sa virilité, de m’expliquer sans détours qui était le mâle. Alors que ce matin, si le geste n’a rien perdu de son côté excitant, son but semble être avant tout de caresser, d’apaiser.
C’est la première fois que ça m’arrive d’être à la fois excité et ému. Je ressens à la fois une violente envie de le pomper jusqu’à le faire jouir, et une immense tristesse qui me donne envie de pleurer, pleurer, pleurer.
Je tente de me ressaisir, d’aller au bout de cet « adieu sexuel » que j’ai voulu. Je glisse mes doigts entre l’élastique du boxer et sa peau, j’amorce le mouvement pour faire descendre ce dernier rempart dissimulant la vue de sa virilité déformant le coton doux.
Mais ma tristesse a raison de mon excitation. Et malgré mes efforts pour la retenir, cette dernière s’envole, me laissant face à face avec la première.
Je n’aurai jamais cru un jour éclater en sanglots devant la queue raide de mon bobrun. Je me sens con, je n’aurais pas dû lui proposer ça. Je lui ai un brin forcé la main pour lui faire une dernière gâterie et maintenant qu’il bande dur, je ne vais pas pouvoir arriver au bout de mes intentions. Quel gâchis ! Et quel numéro de guignol ! J’ai l’impression de me ridiculiser comme jamais à ses yeux. J’ai l’impression que je suis en train de gâcher nos adieux. Je ne sais pas comment je vais pouvoir le regarder dans les yeux après ça.
Je m’enfonce à vitesse grand V dans ces réflexions destructrices lorsque je sens ses mains glisser sous mes aisselles, m’invitant à me remettre debout. Le bobrun me prend dans ses bras, me serre contre son torse chaud, il caresse ma nuque avec une douceur adorable.
« Je… suis… dé… solé… » je marmonne entre deux sanglots.
« Ca va aller, ça va aller ».
« Je voulais te faire plaisir une dernière fois ».
« C’est pas grave, on remettra ça plus tard » il me chuchote, avec une vibration de mâle dans sa voix qui a le pouvoir de m’apaiser.
Le bobrun me câline longuement. Ses caresses et ses bisous ont une délicatesse, une pudeur, une douceur dans lesquelles je ressens la mélancolie qui est la sienne, une mélancolie qui ressemble à la mienne, même si elle se manifeste de façon moins explicite.
Le contact avec son corps, l’étreinte de ses bras, ses caresses, ses bisous, son empreinte olfactive, la chaleur de sa peau : sa présence a le pouvoir de m’apaiser. Je voudrais que cette étreinte ne se termine jamais.
Mais l’heure tourne hélas. Et à un moment j’entends le bobrun lâcher :
« Il va falloir y aller ».
Un instant plus tard, après un dernier bisou, notre étreinte se relâche.
Je le regarde reboutonner sa braguette, non sans mal, vu la proéminence toujours remarquable de sa bosse. Je le regarde boucler sa ceinture. Ses gestes sont rapides, assurés, ils ont quelque chose de très viril. Je le regarde passer ses baskets rouges, passer une main dans ses cheveux pour les arranger.
Sa façon de porter le t-shirt moulant est juste scandaleuse.
Et alors que je m’attends à voir disparaître le coton blanc aveuglant sous un pull à capuche, je vois Jérém fouiller dans son sac de sport et passer le maillot de rugby que je lui ai offert. Cela me touche. Mais pas autant que son clin d’œil complice qui semble signifier : « comme je te l’ai dit une nuit sur l’oreiller, ce maillot représente quelque chose d’important à mes yeux. C’est un cadeau précieux parce que c’est toi qui me l’as offert ».
Un instant plus tard, le bogoss complète sa tenue avec le pull capuche rouge avec des inscriptions blanches qu’il m’avait prêté la veille pour monter à Gavarnie. Le bas du t-shirt blanc dépasse du pull, couvrant une partie de sa braguette.
Il est tellement sexy que ça me fait regretter encore plus de ne pas avoir réussi à le faire jouir une dernière fois dans ma bouche. J’ai presque envie de lui proposer à nouveau. Mais les minutes se succèdent impitoyablement, et je sais qu’il n’a pas la tête à ça ce matin. Car sa tête est déjà en voyage pour Paris.
Je m’habille à mon tour. Je ramasse mes affaires en silence, tout en regardant le bobrun boucler son sac de sport. Je le regarde emballer sa vie pour pouvoir la transporter ailleurs, loin. Le geste de faire ses bagages prend alors toute une symbolique à mes yeux, la symbolique du départ, du changement, comme s’il apprêtait à devenir quelqu’un d’autre, ailleurs. Loin de moi. J’ai l’impression que je ne pourrai jamais suivre le changement qui va s’opérer dans sa vie et que je serai vite déphasé. Que je ne reconnaîtrai pas mon Jérém lorsque je le reverrai.
L’idée de la séparation imminente me rend triste comme les pierres, m’envahit jusqu’à me couper le souffle, jusqu’à me donner mal au ventre, jusqu’à me rendre fou.
Jérém vient de fermer son sac de sport dans un grand bruit de zip. Je le regarde se diriger vers la cheminée, jeter de l’eau sur les braises pour éteindre le feu. La flamme disparaît d’un coup, dans un grand nuage de fumée blanche.
C’est fini, petite maison à la montagne. Nous allons te quitter. Quitter le bonheur immense que tu nous as offert pendant une poignée de jours magiques. Est-ce que je reverrai un jour cette cheminée allumée ? Est-ce que je retrouverai un jour ce bonheur ?
Quelques instants plus tard, nous sommes dehors, sous le petit appentis. Nous nous faisons face. C’est toujours violent de croiser son regard brun, et ça l’est encore plus lorsque je réalise qu’il retient la même émotion que la mienne.
« T’as rien oublié ? » il me demande, la gorge visiblement nouée.
« Non, je ne crois pas… je ne sais pas… » je bafouille, complètement perdu et dépassé par les événements.
Si, j’ai oublié un truc : une partie de mon cœur. Car elle est restée coincée dans cette maison à la montagne, dans ces montagnes, dans son lit, dans ses bras, et je sais que je ne pourrai jamais la récupérer.
J’ai envie de pleurer, j’ai envie de crever. Nous nous échangeons des bisous enfiévrés.
« C’est ici qu’on se quitte ? » je lui demande.
« Je… je vais passer dire au revoir à Charlène et aux chevaux. Tu viens avec moi ? ».
Ce petit sursis est à la fois le bienvenu, mais également une prolongation annoncée de ces instants d’adieu de plus en plus pénibles. Et pourtant, j’accepte sans hésitation.
Jérém monte dans sa voiture, je monte dans la mienne. Je claque la porte et je suis une nouvelle fois en larmes. Je regarde une dernière fois la petite maison laissant échapper un filet de fumée mourant de sa cheminée et je me sens mourir à l’intérieur.
Je regarde la 205 rouge démarrer, quitter la petite cour, s’engager sur la route, je la suis. J’ai la gorge nouée, la tête proche de l’explosion.
Lorsque nous arrivons au petit centre équestre, Charlène est en train de petit déjeuner.
« Je n’arrive pas à décoller ce matin » elle nous confie, alors que la télé repasse en boucle les images des attentats de la veille.
Après avoir pris un café en sa compagnie, nous descendons au pré pour dire un vrai revoir aux chevaux, chose que nous n’avions pas eu la tête ni le cœur de faire la veille.
Unico et Tequila sont postés devant le fil, ils nous attendent de pied ferme. Bille aussi. Le petit cheval en forme de boule semble très en forme ce matin, il nous accueille en se roulant sur le dos tout en poussant de courts hennissements. Il a l’air heureux. Cette attitude est sa façon à lui de nous faire partager son bonheur.
Comme je t’envie, petit cheval, comme je vous envie, Unico et Téquila, vous qui ne savez pas que votre maître va partir et que vous ne le reverrez pas avant longtemps ! Si vous saviez comme je vous envie de ne pas pouvoir pleurer !
Je regarde mon Jérém faire des papouilles à ses trois équidés. C’est touchant, émouvant.
Lorsque nous remontons au centre équestre, Charlène est en train de s’éloigner en tracteur, une botte de foin piquée sur la fourche frontale.
« Elle va revenir dans quelques minutes » fait Jérém, tout en s’allumant une clope.
Mais un instant plus tard, après avoir tiré deux taffes à peine, il la jette par terre, l’écrase sous son pied.
« Viens-là » il me lance, tout en m’entraînant dans la sellerie et en refermant et en verrouillant la porte derrière nous. Dans son regard, une étincelle lubrique qui me met instantanément en fibrillation.
Dans le petit espace, le bogoss me prend dans ses bras et me couvre de bisous.
Un instant plus tard, il se laisse glisser à genoux devant moi, il défait ma braguette, descend mon boxer et commence à me sucer. Chaque va-et-vient de ses lèvres, chaque caresse de sa langue m’apporte un frisson inouï qui me fait vibrer de la tête aux pieds. Le plaisir a le pouvoir d’éloigner ma tristesse.
Dans un premier temps, le bobrun s’y prend avec douceur et c’est terriblement bon. Mais très vite, ses va-et-vient se font plus rapides. Et je sens mon orgasme venir à grand pas.
Mais avant que cela se produise, j’ai besoin de l’avoir moi aussi en bouche une dernière fois. Après ce qui s’est passé tout à l’heure, j’avais renoncé à l’idée de lui faire une dernière pipe. Mais désormais, après cette gâterie impromptue, mon excitation a rejailli. J’ai horriblement envie de lui, de lui donner du plaisir, de le faire jouir une dernière fois. Je ne veux pas rester sur l’« échec » de tout à l’heure. Non, je ne peux pas ne pas le sucer, ne pas le faire jouir, ne pas retrouver son goût de petit mâle sexy une dernière fois.
Alors je passe mes mains sous ses aisselles, l’invitant à se remettre debout. Le bogoss ne se fait pas prier. Un instant plus tard, il me fait face, m’embrasse. Il défait la zip de son pull. Le maillot se dévoile, avec le bas du t-shirt blanc qui dépasse toujours sur sa braguette.
A genoux devant lui, je contemple sa bosse bien rebondie, devinant précisément la position de sa queue tendue. J’ai envie de hurler tellement je suis happé par sa virilité dissimulée.
Mais le bogoss me réserve une surprise. Apparemment, il a bien retenu mes mots de tout à heure. Et il veut me faire plaisir. Il tombe le pull à capuche, ainsi que le maillot, dévoilant le t-shirt blanc dans toute sa splendeur.
Pendant longtemps, on a cru que dans ce spectacle barbare qu’on appelle corrida, c’était la couleur rouge de la muleta qui excitait les taureaux, victimes de la bêtise humaine. C’était faux, mais on l’a cru.
En revanche, ce qui n’est pas faux du tout, c’est que la couleur blanche d’un t-shirt moulant un beau torse de mec, et à fortiori celui de Jérém, excite le Nico au plus haut point. Elle lui fait perdre toute raison. Elle embrase instantanément et violemment son désir, son instinct animal, car elle démultiplie à ses yeux la sexytude masculine.
Je regarde mon bobrun en train de défaire sa braguette, tous pecs dehors. Devant ce t-shirt blanc si magnifiquement porté, je capitule.
Et à l’instant précis où sa virilité jaillit de son boxer, à l’instant où j’enveloppe sa queue avec mes lèvres, où je l’entends pousser ce premier soupir de bonheur et de satisfaction, j’ai l’impression que tant de bonheur sensuel va avoir raison de moi, et que mon cœur va s’arrêter. La chaleur, la raideur, le gabarit, les va-et-vient de sa queue entre mes lèvres envahissent ma bouche et me font me sentir bien. Tout comme ses doigts enfoncés dans mes cheveux. Car ils me font me sentir non seulement désiré, mais aussi et surtout aimé.
Je le pompe lentement, tout en appréciant à sa juste valeur cette occasion de lui offrir du plaisir, de le faire jouir, qui sera la dernière avant longtemps. Je pourrais le sucer pendant des heures, des jours entiers, si seulement je pouvais le retenir, ou plutôt retenir le temps. J’ai envie de retarder le plus possible son orgasme, faire monter son désir et son excitation à des sommets inouïs, insupportables, avant de le voir capituler face à une jouissance délirante, et qui le marquerait pour longtemps.
Hélas, le temps nous est compté. Mais il n’y a pas que ça. La situation atypique nous expose à des risques.
D’ailleurs, un bruit de voiture nous signale l’arrivée potentielle d’un cavalier venu monter son cheval. Et qui, tôt ou tard, va essayer de pénétrer dans la sellerie.
Je continue à pomper mon bobrun en redoublant d’entrain pour accélérer son orgasme.
Je ne m’y suis pas trompé. En effet, nous ne tardons pas à entendre les voix bien connues de JP, de Carine et de Satine. Elles approchent rapidement de là où nous sommes.
« On va chercher les selles d’abord » j’entends annoncer par JP.
Soudain, je retrouve le souvenirs de pipes faites dans les chiottes du lycée, ou à la Bodega, ou au KL, ou dans l’entrée de l’immeuble rue de la Colombette, ou dans la 205 garée dans la rue au petit matin, des moments rendus encore plus excitants par le danger de se faire gauler
JP vient de saisir la poignée de la porte et de tirer dessus. Soudain, j’arrête de sucer le bobrun. La porte claque contre son cadre dans un bruit assourdissant. Mais son intention rencontre la résistance du verrou.
« C’est fermé ? » j’entends Carine le questionner.
« On dirait bien. Charlène a du oublier d’ouvrir ce matin ».
« Je ne l’ai pas vue en arrivant. J’espère qu’elle n’est pas partie faire ses courses ».
« Non, elle doit être en train de s’occuper des chevaux au pré avec Jérémie et Nico. Les voitures immatriculées 31 sont les leurs » fait JP, l’homme de bon sens « en attendant, on peut aller chercher les chevaux ».
Les deux femmes semblent se ranger à son avis et j’entends leurs voix s’éloigner.
Je lève le regard, Jérém me sourit. Et sa main sur ma nuque imprime une petite poussée bien virile, m’indiquant de reprendre ce que j’ai laissé en plan. Sa queue raide et humide me nargue, me happe.
Je la reprends en bouche illico et une petite surprise m’attend. Fait rare chez mon bobrun, il se dégage de son gland un petit délicieux goût de mouille d’excitation que j’adore, que je ressens et je reçois comme un petit cadeau d’adieu.
Ses petits coups de reins se font plus rapides. Le bas de son t-shirt blanc ondule au gré des va-et-vient, effleure mon front, mon nez, m’enivre avec ce parfum de lessive et de propre qui me rend dingue.
Mon excitation grimpe à des niveaux délirants. Je suis à deux doigts de lui proposer de me relever, de me retourner, de me prendre, de jouir en moi, lorsque je réalise que je suis en passe de me laisser dépasser par les événements.
Le bobrun prend une profonde inspiration, il arrête ses coups de reins. Je sens son corps tout entier se relâcher, ses muscles se relâcher. Et alors que je continue de le pomper, une longue séquence de giclées chaudes et épaisses atterrit sur ma langue, sur mon palais, remplit ma bouche. Son goût de petit mâle, un goût un peu fort mais doux, délicieux, rassurant envahit ma bouche et mon esprit. Et ça m’apaise.
Définitivement, sentir ce petit Dieu vibrer de plaisir, le voir jouir, voir sa petite gueule déchirée par l’orgasme, est le plus beau spectacle de l’Univers. Un spectacle qui n’a de pareil que dans celui de le voir juste après, assommé par le plaisir, le visage levé vers le ciel, la bouche entrouverte pour chercher son souffle, le torse moulé dans le coton blanc ondulant sous l’effet d’une respiration accélérée par l’effort sexuel.
Un instant plus tard, Jérém passe ses mains sous mes aisselles, me fait relever. Il me fait retourner, il enfonce sa queue toujours raide comme l’acier en moi. Puis, il commence à envoyer des petits coups de reins tout en me branlant. Et un instant plus tard, je jouis sur le sol jonché de brindilles de paille, en manquant de justesse de souiller un harnachement abandonné dans un coin.
Le bogoss se retire de moi. Je le regarde remontrer son boxer, reboutonner sa braguette. Le silence après du Mozart, c’est encore du Mozart. Et regarder un gars qui se rhabille après l’amour est tout aussi excitant que de le regarder se dessaper et prendre son pied.
Jérém se rapproche de la porte, ouvre le verrou, entrebâille le battant, il tend l’oreille. Et il me sourit.
« C’est bon, on peut y aller » il me lance, alors qu’on entend au loin les voix des trois cavaliers s’approcher à nouveau, accompagnées par le bruit cadencé des sabots des chevaux.
Je sors à mon tour de la petite pièce et je me laisse entraîner par Jérém dans un petit détour pour éviter de tomber nez à nez avec la petite bande.
Nous les retrouvons une minute plus tard, alors qu’ils sont en train de discuter du sujet qui est sur toutes les lèvres depuis 24 heures.
« Salut les gars, comment ça va ce matin ? » nous demande JP, sur un ton chaleureux, tout en nous faisant la bise. Sa barbe est douce, sa gentillesse exquise.
« Ca va, ça va » fait Jérém « je pars à Paris ce matin. Ils ont fini par m’appeler ».
« Ah, ça c’est une grande nouvelle ! ».
« Oui ».
« C’est un petit oui, ça… ».
« Ca va, ça va… ».
« Je sais que ce n’est pas facile de partir ou de regarder partir quand on est bien avec quelqu’un » fait JP, en regardant Jérém et moi à tour de rôle.
« Oui, c’est dur » fait Jérém « très dur ».
Ça me fait plaisir de lui entendre dire, avec ses mots, de l’entendre dire autour de lui. De l’entendre « dire » que c’est dur de partir alors qu’il est bien avec moi.
« Mais Paris n’est pas à l’autre bout du monde. Et quand deux esprits sont faits pour être ensemble, ils finissent toujours par se retrouver, peu importe la distance, peu importe les circonstances ».
Ses mots me font du bien.
« Il faut profiter de la vie, il ne faut pas baisser les bras, il faut croire à l’avenir » continue JP.
« Pas facile après ce qui s’est passé hier » fait Satine.
« C’est quand même incroyable qu’on ait pu faire ça, il faut être de sacrés tarés. C’est de la violence gratuite » enchaîne Carine.
« Ces attentats n’ont absolument rien de gratuit. Au contraire, ils ont une dimension éminemment politique. Dans leur horreur, ils ont une portée historique. Et dans l’histoire, chaque événement survient pour une raison bien précise, même si nous n’arrivons pas à la saisir, ou à la comprendre ».
« Moi j’ai peur qu’il y ait une troisième guerre mondiale » fait Satine.
« La réponse à ces attentats va être violente, c’est inévitable. L’Amérique a été attaquée. Elle fera tout pour laver cette offense. Comme après Pearl Harbor, avec Hiroshima et Nagasaki ».
« Tu penses qu’elle va faire usage de l’arme nucléaire ? ».
« Non, je ne pense pas qu’elle ira jusqu’à là, car d’autres puissances possèdent l’arme nucléaire aujourd’hui et cela pourrait engendrer une escalade incontrôlable. Il en va de la survie même de l’Humanité. Mais la riposte sera longue et déterminée ».
« Bush l’a dit hier soir dans son discours » ajoute Carine.
« Mais la violence n’arrangera rien. Elle tuera des terroristes, certes, mais aussi des innocents. Mais elle ne tuera pas le terrorisme. Elle ne fera qu’engendrer encore plus de haine, et cette haine nourrira le terrorisme. On ne pacifie pas avec les armes. On ne fait que préparer les conflits de demain ».
« Mais qu’est-ce que nous pouvons faire contre cela ? ».
« Il ne faut pas céder à la peur. Il ne faut surtout pas faire le jeu de ceux qui tentent de la propager. Il ne faut pas faire le jeu de ceux qui veulent terroriser pour appeler la violence. Il faut rester soudés. Et continuer à vivre ».
La sagesse de JP est une lumière d’espoir dans le brouillard confus de la peur qui m’a envahi depuis la veille. Pourquoi ce ne sont pas des JP qui nous gouvernent ? Le monde irait tellement mieux, je pense.
« Il va falloir que j’y aille » fait Jérém, tristement.
« Je te souhaite un bon démarrage à Paris et une belle carrière pleine de succès » fait JP en serrant très fort mon Jérém dans ses bras.
« Sois heureux là-bas mais n’oublie jamais ce qui te rend vraiment heureux. N’oublie pas que tu as un gars qui t’aime et aussi des amis qui seront toujours là pour toi ».
Lorsque l’étreinte prend fin, Jérém est visiblement ému, il retient ses larmes de justesse.
« Viens là, petit con » fait Charlène, émue elle aussi « je suis tellement heureuse pour toi. Mais tu vas me manquer ! ».
« Vous aussi vous allez me manquer. Mais je reviendrai, je reviendrai bientôt » fait-il, la voix cassée par l’émotion.
« Toi aussi, Nico, tu vas nous manquer » fait JP « tu reviendras nous voir avec Jérémie, ok ? ».
« Ok, c’est promis ».
C’est dur de partir, de quitter ces amis dont la présence nous fait tant de bien. Nous devons nous faire violence pour nous retourner et repartir vers nos voitures.
« Tu viens avec moi dire au revoir à Martine ? » je l’entends me lancer.
J’ai envie de le prendre dans mes bras, de mélanger nos émotions, de nous offrir un dernier instant de douceur. Mais Jérém trace tout droit, il semble pressé d’en finir avec cette torture.
Nous approchons des voitures, le moment de nous séparer approche à grand pas. Non, il n’y aura pas d’autre final pour notre histoire. Le compte à rebours continue, impitoyable. Tout va si vite, c’est si violent. C’est insupportable. J’en ai le souffle coupé, la tête qui tourne, j’ai l’impression que mes jambes vont me faire défaut.
« Jérém », je l’appelle, alors qu’il a déjà saisi la poignée de la porte de la 205 rouge.
« Jérém, s’il te plaît » j’insiste, alors que le bobrun ne semble pas réagir à mon premier appel, alors que mes larmes coulent sur mes joues.
Jérém se retourne et me prend dans ses bras et il me serre très fort contre lui. La puissance de son étreinte, la chaleur de son corps, sa présence olfactive ont une fois de plus le pouvoir de me rassurer et de m’apaiser instantanément.
C’est doublement dur de le quitter alors que le monde que nous connaissions jusqu’à là s’effondre, alors que la peur se mélange à la tristesse. Est-ce que je serai en sécurité Bordeaux ? Est-ce qu’il sera en sécurité à Paris ? J’ai l’impression que nous ne serons en sécurité que si nous sommes ensemble, pour veiller l’un sur l’autre.
Je pleure, tout en caressant son cou, sa nuque, ses beaux cheveux bruns.
« Ne pleure pas, Ourson » je l’entends me chuchoter « sinon tu vas faire pleurer Petit Loup aussi… ».
« Tu aimes, alors, Petit Loup ? ».
« J’aime beaucoup ».
« Je ne veux pas qu’on soit séparés ».
« On se reverra, Ourson, et on s’appellera… ».
« Mais qui sait quand… ».
« Bientôt, bientôt ».
« Ne m’oublie pas Jérém ».
« Je ne t’oublierai pas ».
Pendant le court trajet vers le village, je n’arrive pas à contrôler mes sanglots.
Après avoir annoncé à Martine la nouvelle du départ de Jérém pour Paris, nous sommes confrontés à des nouveaux adieux émouvants.
En sortant de l’épicerie, alors que Martine est accaparée par un client, Jérém se saisit de l’un des beaux briquets métalliques exposés au comptoir. Avec un geste assuré et est très viril, il ouvre le capuchon, produisant un intense cliquetis métallique, ainsi qu’une belle flamme puissante.
Pendant un instant, je crois que Jérém va l’acheter. Mais je me trompe. Un instant plus tard, le bogoss coupe la flamme en refermant le capuchon, deuxième geste bien viril. Et il pose à nouveau le beau briquet à côté des autres.
Et alors qu’il sort dans la rue tout en s’allumant une nouvelle clope, je lui lance un « J’arrive » et je m’attarde encore quelques instants dans l’épicerie.
Lorsque je le rejoins, Jérém est sous la halle, au même endroit où il se trouvait le jour où ce week-end magique a commencé. La halle des retrouvailles. La halle de son premier bisou. La halle du bonheur. Et, désormais, la halle de nos adieux.
« Qu’est-ce qui va se passer maintenant ? » je l’entends me demander, l’air inquiet.
Je trouve son attitude terriblement touchante.
« Je ne sais pas. Mais on va y arriver » je m’entends lui répondre.
Je m’approche de lui et je le prends dans ses bras.
« Toi non plus, ne m’oublie pas » je l’entends me chuchoter, la voix étranglée par l’émotion.
Ses mots et sa tristesse me touchent au plus profond de moi. Je sais désormais que je suis quelqu’un de spécial pour lui. Et pourtant, une partie de moi a envie de lui poser mille questions. Est-ce que nous sommes ensemble pour de bon ? Est-ce que nous sommes un couple ? Qu’est-ce que nous sommes en droit d’attendre l’un de l’autre ?
Mais je n’ai pas le cœur à ça.
A l’autre bout de la halle, une femme trace son chemin. Je reconnais en elle la même qui, le jour de nos retrouvailles nous voyant nous embrasser, nous avait regardés de travers. Aujourd’hui, elle nous regarde à nouveau. Et pourtant, son regard me semble moins dur, j’ai presque l’impression que notre émotion la touche aussi.
« Comment je pourrais t’oublier, Jérém ? Tu es l’amour de ma vie » je finis par lui répondre.
Et là, je vois le bobrun pencher la tête vers l’avant, porter ses deux mains derrière le cou, et décrocher sa chaînette de mec.
« Tiens, prends-la avec toi ».
« Tu rigoles ou quoi ? Je ne peux pas… » je fais, bouleversé par son geste.
« J’insiste ».
« Non, Jérém… je sais ce qu’elle représente pour toi ».
« Je veux que tu la gardes ».
Je suis déboussolé par ce cadeau. Je ne veux pas qu’il se prive de ce souvenir, de cet objet si symbolique.
« Tu vas la prendre, c’est tout » fait le bobrun, en avançant vers moi, en passant derrière mon dos et en passant le précieux bijou autour de mon cou.
Je sais que je n’aurai pas gain de cause cette fois-ci non plus. De toute façon, je n’ai ni la force ni l’envie de me « bagarrer » avec mon Jérém.
Le poids et la chaleur du métal me font du bien. J’ai déjà la chance de la porter en une autre occasion, après que Jérém l’avait perdue chez moi lors de la semaine magique. C’était avant notre séparation brutale à Toulouse. Le poids me parle de sa présence. Mais c’est la première fois qu’elle m’apporte la chaleur de sa peau mate. Et ça me donne mille frissons. Décidemment, cet objet est magique. Ensorcelé à tout jamais par des années au contact avec la mâlitude de mon Jérém.
« Comme ça je serai toujours avec toi » je l’entends me chuchoter, alors que ses doigts frôlent à plusieurs reprises la peau de ma nuque en essayant de boucler le maillon de raccord.
« Merci, Jérém, merci ».
Je suis tellement touché par son geste que, pour un peu, j’en oublierais de lui donner le petit cadeau que j’ai prévu pour lui.
« Moi aussi j’ai quelque chose pour toi » je lui annonce, en lui tendant le gros briquet en métal qu’il avait essayé en sortant de l’épicerie.
« C’est quoi, ça ? ».
« Un petit cadeau. Comme ça, tu penseras souvent à moi ».
« T’es fou, toi, c’est cher ! ».
« Ca me fait plaisir, j’ai vu qu’il te faisait envie ».
Le bogoss saisit le petit mais lourd objet. Ce nouveau contact de ses doigts avec les miens me donne des frissons. Une nouvelle fois, sous l’effet d’un geste rapide et assuré, le capuchon saute, en produisant le cliquetis rapide et bien caractéristique, ainsi qu’une belle flamme jaune et bleue.
« Je n’en ai jamais eu un de si beau ! » fait-il, tout en me serrant très fort dans mes bras et en plongeant son visage dans le creux de mon épaule.
« Je sais que tu veux en finir avec les clopes. Mais en attendant… ».
« Tu sais, je crois que je ne suis pas près d’arrêter ».
« Pourquoi ça ? ».
« Je stresse, j’ai peur de ne pas y arriver ».
« Bien sûr que tu vas y arriver, tu es un champion, je crois très fort en toi » je tente de le rassurer, en portant une main sur son épaule charpentée.
Jérém s’approche de moi et me fait un bisou.
« Merci Nico ! C’est un très beau cadeau. Mais, tu sais, je n’ai pas besoin de ça pour penser souvent à toi » il me chuchote.
Nous nous retrouvons dans la même position qu’à Gavarnie, front contre front, nez contre nez, en train de nous échanger des bisous légers, en silence, en retenant nos larmes de justesse. C’est notre façon de nous dire l’un l’autre que nous n’avons pas envie de nous quitter. C’est notre façon de sentir la présence de l’autre le plus intensément possible, comme pour nous en imprégner, pour la porter avec soi malgré la distance.
Ce sont vraiment nos derniers instants ensemble. J’ai envie de crever. Je souffre déjà le martyre en pressentant le désespoir qui m’envahira dès l’instant où je serai séparé de l’amour de ma vie. Pendant un instant, je suis à deux doigts de lui demander de ne pas partir, de ne pas me quitter.
Et pourtant, je suis tellement heureux pour ce petit mec qui s’apprête à accomplir son rêve. Heureux et fasciné.
En effet, qu’est-ce qu’il est craquant ce petit mec qui semble avoir trouvé sa voie, qui s’en va accomplir son destin, qui a les couilles de partir loin, de partir d’une certaine façon « à l’aventure », de quitter sa ville, ses potes, ses repères, de se jeter dans un monde inconnu. J’admire son choix, son courage. Qu’est-ce que je suis fier de lui !
Et pourtant, en pensant à son départ, je me dis aussi que je ne fais pas le poids face à ses rêves de gloire, que ce qui compte pour lui avant tout c’est sa future carrière, et qu’il serait prêt à tout y sacrifier. Je serais presque sur le point de l’accuser d’égoïsme, et de lui en vouloir.
Mais est-ce que je peux seulement lui en vouloir d’avoir envie de réaliser son rêve ? De quel droit pourrais-je ne serait-ce qu’imaginer un seul instant lui demander d’y renoncer pour moi ? Aimer, n’est-ce pas être heureux du bonheur de l’autre avant de lui demander de nous rendre heureux de la façon dont nous avons besoin ?
Quand on aime, on ne peut pas demander de choisir entre l’amour et son rêve. Déjà, parce on ne peut jamais être certain du choix de l’autre. Aussi, je m’en voudrais de l’empêcher de réaliser ses rêves. Lui aussi il m’en voudrait. Il m’en voudrait pour le fait même de le lui demander. De toute façon, il partirait quand même. Et ma tentative désespérée de le retenir gâcherait quelque chose pour tous les deux.
Pour moi, car je serais confronté à un « non », à un choix qui n’est pas celui que j’attends. Pour lui, car ça lui montrerait que je fais passer mon bonheur avant le sien.
Alors, pour douloureuse que cette séparation puisse paraître, elle est inévitable. Je n’ai aucun pouvoir de l’empêcher, et il vaut mieux que je ne fasse rien pour l’empêcher.
Garder un fauve en cage est un geste égoïste. Car c’est précisément sa liberté, son indomptabilité qui nous fascine. Un fauve en cage est triste et malheureux.
J’ai envie de croire que notre belle histoire ne se finira pas, que ces derniers instants à la montagne ne sont pas un adieu, mais juste un « au revoir ». Non, ça ne peut pas être un adieu, nous sommes trop bien ensemble, notre amour est trop fort, on doit arriver à s’aimer malgré la distance.
Je tente de me rassurer, de penser positif, mais c’est dur, dur, dur.
Jérém me regarde droit dans les yeux.
« Merci encore d’être venu, Nico ».
« Merci à toi, Jérém, de m’avoir appelé. Ces derniers jours ont été les plus beaux de ma vie ».
« Ces quelques jours avec toi ont été géniaux ».
« Je n’aurais jamais pu espérer un meilleur cadeau pour mon anniversaire » je lâche, en réalisant soudainement à quel point j’aurais envie de fêter cette échéance imminente avec lui et à quel point il va me manquer ce jour-là.
« C’est quand ton anniversaire ? ».
« Le 15 septembre ».
Jérém hoche de la tête, il plisse les yeux d’une façon hyper sexy, il amorce un petit sourire plein de tendresse.
A cet instant précis, j’ai très envie de lui dire je t’aime.
« Jérém… » je me lance.
« Quoi ? » fait-il, avec beaucoup de douceur.
« Je t’aime, Jérém Tommasi ! ».
Jérém, JTM : comme une évidence, un pléonasme bâti autour d’une simple petite consonne.
Comme d’habitude, sa seule réponse à mes trois petits mots, les trois petits mots les plus beaux de l’Univers, est de me faire des câlins et des bisous.
Je sais que je suis quelqu’un de très spécial pour lui. Pendant ces quelques jours, je l’ai senti, il me l’a montré, et il me l’a dit plein de fois. Mais ça me ferait un bien fou de lui entendre dire ces trois petits mots à son tour.
Je le sais, il m’aime lui aussi, à sa façon. Mais j’ai besoin de lui entendre dire. J’en ai besoin maintenant. Ça me rassurerait, ça m’aiderait à apaiser la tristesse de cette séparation qui me happe comme dans un précipice sans fin. Est-ce qu’un jour j’aurai le bonheur de l’entendre me dire ces trois petits mots magiques ?
Un simple « moi aussi » ferait l’affaire.
« Je va vraiment falloir que j’y aille maintenant ».
Un dernier bisou volé sous la halle, et j’accompagne Jérém à la 205 rouge garée dans la rue.
« Fais attention sur la route » je lui lance, comme un dernier « je t’aime » déguisé, alors qu’il a déjà ouvert la porte et qu’il s’apprête à s’asseoir au poste de conduite.
« Toi aussi fais attention à la route, jeune conducteur ».
Je tends la main vers lui pour caresser une dernière fois ses cheveux bruns. Ses lèvres caressent mes doigts. J’ai l’impression que je vais m’effondrer d’un instant à l’autre.
« Je t’envoie un message quand j’arrive, si c’est pas trop tard ».
« Envoie quand même, même si c’est très tard ».
« Au revoir, Nico ».
« Au revoir, Jérém ».
La porte de la voiture se referme dans un claquement sourd et définitif, sans appel. Le moteur démarre.
Voilà, l’instant de notre séparation est arrivé. Il est là, devant moi. Rien ne peut le repousser. Ainsi se terminent ces petites vacances magiques. Tout simplement. Impitoyablement. Sans musique poignante, sans ralenti d’image qui soulignerait le côté dramatique du moment, sans chute spectaculaire, sans coup de théâtre imprévu qui changerait le scénario écrit d’avance. L’instant d’avant on était encore ensemble, l’instant d’après on est séparés.
Je regarde la 205 rouge quitter le parking et rouler droit devant elle, les larmes aux yeux. Je la regarde s’éloigner, devenir de plus en plus petite au fur et à mesure qu’elle prend de la distance. La 205 rouge s’en va, elle amène loin le gars que j’aime, loin de moi.
Je suis pétrifié de peurs. La peur de le perdre, la peur qu’il lui arrive quelque chose, la peur de ne plus jamais le revoir.
J’ai envie de l’appeler, de lui dire de faire demi-tour, de m’amener à Paris avec lui. Mais je ne le fais pas. Qu’est-ce que je ferais à Paris avec lui ? Est-ce qu’il voudrait de moi à Paris ?
Le ciel est couvert, il fait froid. Lorsqu’il fait gris, le paysage de la montagne s’habille de couleurs ternes. Et cela s’emmêle à ma tristesse, lui offrant un terreau fertile.
Je regarde la 205 jusqu’à ce qu’elle disparaisse de ma vue, engloutie par le brouillard. Et même après, il se passe un long moment avant que j’arrive à quitter la rue des yeux.
Je suis son ourson, il est mon petit loup, j’ai sa chaînette, je ne la quitterai jamais. Il a mon briquet, il pensera à moi à chaque fois qu’il allumera une clope. Je m’accroche à cela pour empêcher la douleur de me terrasser.
Je me dirige vers ma voiture, mais je n’ai pas envie de prendre la route. Ce petit village où j’ai passé les moments les plus heureux de ma vie semble me retenir.
Je ne peux m’empêcher de faire un dernier tour à l’épicerie. Sous prétexte d’acheter un truc à boire, j’ai envie de prolonger un peu plus mon séjour à la montagne.
« Oh, Nico, t’as l’air à ramasser à la petite cuillère » fait Martine, sans détour.
« C’est dur de le voir partir ».
« Mais vous allez vous revoir, j’en suis certaine ».
« Alors, il a aimé le briquet ? » elle enchaîne.
« Je crois que oui ».
« Ca m’a fait plaisir de te rencontrer Nico, et je suis certaine que ceci n’est qu’un au revoir et que nous reverrons bientôt ».
Les mots et l’accolade de Martine me font un bien fou. Je trouve enfin le courage de rejoindre ma voiture et de quitter ce petit Paradis sur terre.
A la sortie du village, le brouillard m’enveloppe. Il fait gris, il fait humide, il fait hiver. A l’horizon, les nuages et le brouillard se confondent, la terre et le ciel se mélangent.
Mon regard est une dernière fois happé par les éléments simples et puissants, immuables, l’eau, la roche, par la nature indomptée de la montagne, une nature qui force le respect et remet à sa place. Une nature qui impressionne et qui ramène à l’humilité.
Les larmes aux yeux, je zappe la radio. J’ai besoin de musique pour me changer les idées, pour m’empêcher de penser à cette séparation, pour ne pas devenir fou. Je zappe jusqu’à capter les rares fréquences qui passent entre ces montagnes.
Mais à chaque fois je tombe sur des émissions qui parlent d’une seule et unique info, les horribles événements de la veille.
En roulant, je regarde les maisons, les arbres, les rues, les villages, les commerces, les voitures, les passants. Tout me paraît étranger, comme si je revenais après un très long voyage et que tout avait changé pendant mon absence. J’ai l’impression que depuis 24 heures, il s’est écoulé un siècle. En écoutant les infos, je réalise que je vais retrouver un monde qui n’est plus celui que j’avais quitté en montant quatre jours plus tôt.
J’écoute juste quelques instants, pour m’assurer que rien de nouveau ne s’est produit pendant la nuit. Je suis soulagé de savoir qu’il ne s’est rien passé de plus, à part l’effondrement d’un nouvel immeuble à Manhattan, touché par la chute des deux tours jumelles.
Mais je n’ai pas envie d’entendre les détails macabres de la catastrophe. Je vais assez mal, j’ai assez peur, je n’ai pas la force d’en rajouter. Alors je continue de zapper. Je fais plusieurs fois le tour de la bande FM, avant de tomber sur une voix que je reconnais instantanément. C’est la voix féminine qui racontait l’histoire de Starmania dans l’émission passionnante sur laquelle j’étais tombé la veille en montant vers Gavarnie avec Jérém.
[« Et maintenant, la suite de notre émission consacrée à Starmania. L’opéra-rock fourmille de thèmes toujours d’actualité. On pourrait songer à l’omniprésence du béton et des matières artificielles, aux villes tentaculaires aux gratte-ciels vertigineux, à ce numéro sur le dos évoqué dans la chanson Monopolis, désormais concrétisé par ce numéro de portable que chacun traîne avec soi et qui permet de nous tracer, de nous surveiller.
On peut penser au pouvoir de la télévision (et désormais d’Internet) dans un monde hyper-médiatisé, à son rôle dans la manipulation de l’information, à sa contribution dans la création du consensus autour d’une classe dirigeante qui mène des politiques qui vont souvent à l’encontre de l’intérêt général, au profit d’une poignée de nantis amis du pouvoir qui tirent les ficelles. A l’opposition entre le monde Occidental, garant de la liberté, et le Tiers Monde obscurantiste.
Le monde dépeint par Starmania semble oppressé, dominé par la consommation et dénué de liberté d’expression. La société elle-même semble soigneusement structurée et organisée, ne laissant guère de place à des idées différentes, ou autre chose que ce qui est déjà programmé par la pensée unique.
Tout cela est bien représenté par le discours électoral de Zéro Janvier, frappant de similarité avec les pires paroles politiques d’aujourd’hui : »].
Pour enrayer la nouvelle vague terroriste/Nous prendrons des mesures extrémistes
Nous imposerons le retour à l'ordre/Si on ne peut pas vivre dans la concorde
Nous mettrons la capitale/Sous la loi martiale
(…)
Si on veut éviter de faire que la terre/Devienne un jour un seul pays totalitaire
L'Occident doit fermer ses frontières/A toute influence étrangère
(…)
Cessons de nous ruiner pour le tiers-monde/Qui nous remerciera bientôt avec des bombes
Assurons d'abord notre survivance/Je suis pour l'Occident l'homme de la dernière chance
[« Zéro Janvier n’est qu’un avatar de tous les hommes politiques autoritaires qui se transforment en dictateur, tant en mots qu’en apparence. Ses chances de gagner sont assurées car, en plus d’être probablement le plus riche homme de l’Occident, il n’hésite pas à se marier à Stella Spotlight, star en pleine déchéance, pour assurer son image dans le show-business. Autant de choses qui, réunies dans une seule main, peuvent mener à la dictature.
Face à ce danger, les Étoiles Noires font donc rapidement figure d’anarchistes, de bandes de jeunes voulant seulement perturber l’ordre public, cherchant à combattre la société en place qui n’œuvre pas pour le bonheur du plus grand nombre.
Ils projettent de commettre un attentat contre le candidat favori des élections. Mais Sadia retourne sa veste en révélant ce projet à Zéro Janvier, pour qui elle travaillait depuis le début.
Sadia est probablement l’un des personnages les plus intéressants de l’opéra-rock. Son but n’aura été que de pousser les Étoiles Noires à répandre la terreur dans la population, pour mieux assurer une victoire électorale à l’Etat policier de Zéro Janvier »].
L’histoire développée dans Starmania a un écho particulier après les événements de la ville. J’en ai des frissons dans le dos.
[« L’opéra-rock interpelle forcément » continue l’animatrice « car les thèmes de Starmania sont intemporels et, on peut le dire, visionnaires. Nous les vivons tous les jours. Starmania est une réflexion sur nos vies, si riches de choses matérielles, mais si pauvres et vides à bien des égards. Car, au final, seul l'amour compte. Starmania dit tout cela.
D’ailleurs, la solitude est l’un des thèmes principaux de l’opéra rock »].
On dort les uns contre les autres/On vit les uns avec les autres
On se caresse on se cajole/On se comprend on se console
Mais au bout du compte/On se rend compte
Qu'on est toujours tout seul au monde
On danse les uns avec les autres/On court les uns après les autres
On se déteste on se déchire/On se détruit on se désire
Mais au bout du compte/On se rend compte
Qu'on est toujours tout seul au monde
[…]
Nos planètes se séparent/Aujourd'hui pour toujours
Faut pas me retenir, m'en vouloir/Si je pars
Nos planètes se séparent/Comme la nuit et le jour
[…]
A quoi sert de vivre/S'il faut vivre/Sans amour
Evidemment, les couplets de cette chanson ont une résonance particulière en moi. Mille questions ressurgissent à mon esprit. Quelle va être la suite de notre histoire ? Est-ce que nous arriverons à nous voir régulièrement ? Est-ce que la distance physique ne mettra pas de la distance entre nos sentiments ? Comment Jérém voit les choses, notre avenir, qu’est-ce qu’il est vraiment prêt à assumer ? Est-ce qu’une fois qu’il sera à Paris, il se souviendra de qu’on a vécu à Campan dans la petite maison en pierre ?
Je ne lui ai pas demandé tant qu’il était temps de le faire et maintenant c’est trop tard. Est-ce qu’il m’aurait répondu seulement ? Et de quelle façon ?
J’ai tellement envie de pleurer.
[« Et c’est une nouvelle fois la lucidité de Marie-Jeanne, la serveuse automate, que nous retrouvons dans le grand final de l’opéra »] annonce l’animatrice de l’émission.
J'ai la tête qui éclate/J'voudrais seulement dormir/M'étendre sur l'asphalte/Et me laisser mourir
Stone/Le monde est stone/Je cherche le soleil/Au milieu de la nuit
(…) J'ai plus envie d'me battre/J'ai plus envie d'courir
Comme tous ces automates/Qui bâtissent des empires
Que le vent peut détruire/Comme des châteaux de cartes
Stone/Le monde est stone
(…) J'sais pas si c'est la terre/Qui tourne à l'envers
Ou bien si c'est moi/Qui m'fais du cinéma/Qui m'fais mon cinéma
J’ai envie de pleurer et je pleure à chaudes larmes.
L’émission se termine, suivie d’une longue page de pub que je gobe pendant un long moment avant de trouver le courage de recommencer à zapper.
Je zappe longuement en évitant les infos omniprésentes, je zappe jusqu’à tomber sur une chanson dont je ne comprends pas les mots mais dont la musique, la voix et la mélancolie s’accordent bien à ma propre mélancolie.
[« Saudade est un mot portugais, du latin solitas » explique l’animateur « qui exprime un sentiment complexe où se mêle mélancolie, nostalgie et espoir. Saudade est un mot portugais difficile à traduire.
Le dictionnaire français Larousse le définit comme « sentiment de délicieuse nostalgie, désir d'ailleurs » mais il n'y a pas de mot exact qui correspond à Saudade en français.
La saudade est une « tension entre contraires » : d'une part le sentiment d'un manque, d'autre part l'espoir et le désir de retrouver ce qui nous manque. L'objet du manque peut-être un passé heureux, une personne ou encore un lieu. Lors des conquêtes portugaises en Afrique, la saudade exprimait notamment le désir des colons de retrouver leur pays.
Ce sentiment met en jeu une certaine relation au temps : c’est une manière « d’être présent dans le passé, ou d’être passé dans le présent »].
C'est exactement le sentiment qui m'habite à cet instant précis.
Dans ma tête prennent forme des couplets que j’écrirai dès mon retour sur Toulouse le soir même.
Saudade, quand ta voiture s’éloigne
Et je ne sais pas quand on se reverra
Saudade, quand la distance devient injustice
Car je voudrais que tu sois dans mes bras
Saudade, une solitude dans laquelle tu es bien présent
Avec nos rires, ta voix qui me touche et me fait vibrer
Saudade, me demander quand tu reviendras, si tu reviendras
Repenser à tes mots, « on se reverra, ourson », qui font chaud au cœur
Saudade, lorsque j’appelle ton nom jusqu’à en perdre le souffle
Et je pleure en comptant chaque minute qui nous sépare
Il est 22 heures passées, je viens de griffonner sur un papier ces quelques mots, allongé sur mon lit, dans la pénombre de ma chambre. Et mon portable se met à couiner. Mon cœur fait une accélération digne d’un moteur de Ferrari. Pendant un instant, je fixe mon téléphone, incapable de le saisir. Je me demande ce que je vais trouver dans ce message qui vient d’arriver.
Mais très vite, je succombe à l’impatience de savoir.
« Je sui bien arrive. Tu me manque ».
Et je pleure à chaudes larmes.
Cher lecteur,
après cet épisode, je vais prendre une petite pause. En décembre, il n'y aura pas d'épisode. Je prends quelques semaines pour me reposer un peu et pour avancer dans l'écriture de la suite.
Merci de ta fidelité et de ta comprehension.
Un merci particulier à ceux qui laissent des commentaires.
Fabien
Pour ceux qui voudraient acheter le livre Jérém&Nico ou contribuer au financement de l’écriture de cette histoire sans avoir à rentrer ses propres données sur tipeee, de façon sécurisée et SANS frais, il est désormais possible d’envoyer des contributions via PAYPAL, en cliquant sur ce bouton :Même un petit, chaque geste est le bienvenu.
 11 commentaires
11 commentaires
-
Par fab75du31 le 21 Novembre 2019 à 05:08
Lorsque le deuxième avion frappe la tour Sud en direct à la télé, j’ai la tête qui tourne comme si on m’avait mis un coup de poing en pleine figure. C’est irréel, atroce, terrifiant. Là c’est clair que ce ne peut pas être un accident.
Je pense aux gens qui étaient dans les avions, je pense à ceux qui sont dans la deuxième tour. Il va y avoir des morts, beaucoup de morts. Je suis pris par une intense sensation de dégoût, je crois que je vais vomir.
Les images au sol montrent des pompiers en train d’accourir sur les lieux pour porter secours. Je les regarde s’engouffrer dans les immeubles, partir au cœur de la catastrophe pour essayer de sauver des vies. Plus que jamais j’admire leur courage et leur dévouement dans leurs mission. Les secours contre les attaques sanglantes, les pompiers contre les terroristes, ou tout ce que l’Humanité peut produire de meilleur vs tout ce que l’Humanité peut produire de pire. Combien de ces gars et de ces femmes héroïques vont perdre leur vie dans cette catastrophe en essayant d’en sauver d’autres ? Est-ce que les tours vont tenir le coup ? Combien de morts civils ? Des dizaines, des centaines ?
Soudain, je pense à Thibault. Si une catastrophe semblable devait arriver à Toulouse, il serait très probablement en première ligne. Il prendrait tous les risques pour accomplir sa mission. Un frisson parcourt mon dos et provoque une douleur intense à hauteur des cervicales. Combien d’adorables Thibault parmi ces soldats du feu à l’autre bout de l’Atlantique ?
Nous sommes incapables de quitter la télévision des yeux. Je regarde les images, j’écoute la voix de l’animateur scander les détails de la catastrophe. J’entends le bruit des sirènes, les cris de gens terrifiés, la bande son d’une ville en guerre. Plus les minutes passent, plus ce que je vois me glace le sang. Je suis paralysé, crispé par une terreur jamais connue auparavant.
A un moment, je me surprends à me déconnecter du flot incessant d’infos et d’horreurs. Comme dans les récits de voyages astraux, lorsqu’on regarde son propre corps depuis le plafond. Le son de la télé m’arrive comme filtré par une épaisseur d’eau. C’est un silence lourd, violent, traumatisant, irréel lui aussi. C’est le silence de la terreur. Tout semble s’être figé autour de nous.
Je regarde Jérém, je regarde Charlène. Je n’arrive pas à croiser leurs regards, rivés sur l’écran, ni à attirer leur attention, avide de la moindre info, ni à me connecter à leurs esprits, happés par l’impensable. L’un comme l’autre, ont l’air perdus, désorientés. A quoi pensent l’un et l’autre devant ces images ?
Je n’avais encore jamais vu mon Jérém dans cet état. On n’est pas préparé à tant d’horreur. Dans son attitude, j’ai l’impression de déceler un effroi qui ne fait qu’accroître encore le mien.
Mais l’attitude de Charlène me touche encore davantage que celle de Jérém. Car si Jérém est un mec, c’est un jeune mec. Il a mon âge, à un an près. Je peux comprendre qu’il soit secoué.
Mais Charlène, c’est une adulte. C’est une autre génération. Elle n’a pas connu la guerre non plus, mais elle doit forcément avoir de l’expérience, du recul.
Je n’avais jamais eu l’occasion de voir un adulte terrifié. Voir un adulte paniquer, c’est terrible. A cet instant précis, je réalise que les adultes aussi peuvent être effrayés comme des enfants. Car on est tous des enfants face à ce qui nous dépasse.
Devant le regard désemparé de Charlène, je sens une peur et un désespoir immenses m’envahir. Je me souviendrai à tout jamais du regard terrifié de Charlène. Tout comme je me souviendrai toute ma vie de cette journée, de ces instants où le monde a basculé dans la terreur.
Les mots « attentat terroriste » tournent en boucle dans la bouche de l’animateur. Avec des détails de plus en plus précis sur le nombre de « tarés des airs » à l’origine de tout cela.
J’ai la sensation d’avoir été poignardé en plein dans le dos. J’ai du mal à seulement imaginer qu’un esprit humain ait pu concevoir tant de mal. Pourquoi ? Comment on a pu en arriver là ? Qui a voulu ça ? Pourquoi ? A qui profitent ces attentats ?
Mais aussi, comment tout cela a pu se produire, à fortiori dans la plus grande puissance économique et militaire du monde ? Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de contrôles suffisants aux embarquements des aéroports pour prévenir ce genre de risque ? Où étaient les services de renseignements bien connus, CIA et FBI ? Et le Pentagone ? Ça sert à quoi tous ces milliards alloués à la défense nationale ?
Je ressens du vertige, et un malaise de plus en plus profond. J’ai l’impression que, minute après minute, l’écran aspire toute mon énergie, ma joie, mon âme. La mienne, tout comme celle de Jérém et celle de Charlène. Et, je l’imagine, celle des millions et des milliards de personnes à travers le monde qui sont devant leurs télés à cet instant précis.
J’ai les mâchoires serrées, j’ai du mal à respirer, j’ai l’impression qu’après ça rien ne sera plus pareil et que le mot bonheur sera rayé à tout jamais de la face de la Terre. Devant la télé ou tout ce que j’ai connu jusque-là semble en train de basculer à tout jamais, j’ai l’impression que mon âme est touchée et abîmée pour toujours.
Le sentiment d’horreur monte encore d’un cran lorsque l’animateur commence à parler de la stabilité des tours, de leur capacité présumée à tenir debout après un tel impact. La simple évocation de leur solidité suffit pour installer le doute sur le fait qu’elles puissent au contraire ne pas résister à l’attaque.
Non, ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver ! Pitié, non, pas ça ! Combien de gens sont encore à l’intérieur ? Combien de pompiers ? Combien de gens vont perdre la vie si tout cela s’effondre ? Des centaines ? Des milliers ?
Scotché devant la télé, devant ces images de guerre, je prends brutalement conscience de la fragilité de l’Homme, de la civilisation, de la paix, du monde tel qu’on le connaît. Ou qu’on se l’imagine.
Les commentaires affolés de l’animateur, lui aussi visiblement secoué, ne font qu’alimenter la panique face à ce cauchemar. Un cauchemar, hélas, loin d’être terminé.
Il est presque 16 heures lorsqu’on apprend qu’un troisième avion de ligne se serait écrasé sur le Pentagone. Le Pentagone, rien que ça. Le siège de la puissance militaire américaine vient d’être touché à son tour par une attaque terroriste. Mais comment est-ce possible, comment ? Jusqu’à quand ça va continuer à frapper, combien de fois encore, à combien d’endroits ?
J’ai l’impression que c’est la fin du monde, l'apocalypse, le jour du jugement dernier tel qu’on me l’a enseigné au catéchisme.
Une vue grand angle de Manhattan nous montre les deux tours en feu. Les deux panaches de fumée noire qui s’en échappent défigurent le ciel bleu et transforment les Streets en paysage lunaire. Depuis son îlot, la Statue de la Liberté semble regarder ce désastre, impuissante.
Le journaliste parle de dizaines de milliers de personnes travaillant dans les tours. Combien ont déjà péri, combien ont pu sortir, se mettre à l’abri ?
Je me surprends à prier pour que les tours tiennent bon, pour qu’elles ne s’effondrent pas.
Combien de temps pour effacer tout ça, ces cicatrices, ce traumatisme, combien de temps pour que la ville retrouve sa splendeur d’avant ? Comment effacer toute cette souffrance ? Est-ce qu’il est seulement possible d’effacer un tel traumatisme de la mémoire de ceux qui l’on vécu et qui ont survécu, de ceux qui ont perdu des proches, de ceux qui l’ont vécu dans leur ville, dans leur pays, dans leur chair ? De ceux qui ont vu la mort en face ?
Plan serré sur l’une des tours en feu. Quelque chose tombe le long de la façade en verre. Un, deux, dix points noirs traversent l’écran de haut en bas. Et l’horreur s’ajoute à l’horreur lorsque l’animateur explique que des gens pris au piège et en proie à la panique se jettent dans le vide.
Ces corps courbés comme des « virgules noires », comme on les appellera plus tard, sautent par douzaines des fenêtres du bâtiment en feu, se tenant parfois la main.
Il n’y a même plus de mot pour décrire ce que je ressens en voyant ces images.
Et pourtant, le cauchemar est toujours loin d’être terminé. Très loin.
« Oh, my God ! Oh, my God ! » on entend crier soudain de toute part.
Il me faut un instant pour réaliser ce qui se passe.
Charlène pousse un cri d’horreur.
La deuxième tour percutée est en train de s’effondrer comme un château de cartes, emportant avec elle l’illusion que les morts ne puissent se compter que par centaines.
Un immense nuage de débris et de poussières provoqué par le souffle de l’effondrement envahit les rues comme un tsunami. La télé montre des gens qui courent dans la rue pour ne pas être percutés, ensevelis.
J’ai froid, très froid et je ne peux m’empêcher de trembler. J’ai l’impression que le sang se glace dans mes veines. Je suis tétanisé. Jérém me serre très fort la main.
La tour vient de tomber et j’ai l’impression qu’on m’a arraché un bras. Des cris paniqués résonnent partout. Combien de morts civils, combien d’innocents, combien de pompiers ? Pourvu qu’au moins la deuxième tour tienne bon !
J’assiste à l’apocalypse, et ça se passe à New York. Des avions ont été lancés contre le symbole même de la ville, la ville de tous les rêves, l’un des endroits dans le Top Ten des destinations que je rêvais de visiter un jour.
Soudain, je repense à une conversation de la veille, pendant le repas chez Florian. Je repense à Carine qui voulait voir les tours jumelles de près et qui regrettait de ne pouvoir se trouver à New York en ce moment même. Et je repense à cette phrase tristement maladroite de Martine : « Tu vas attendre l’année prochaine, tes tours ne vont pas s’envoler ! ».
Mais le cauchemar n’est toujours pas terminé. Il nous réserve encore deux horribles rebondissements.
D’abord, un animateur nous annonce qu’un quatrième avion s’est écrasé en Pennsylvanie, en rase campagne. On apprend qu’il se dirigeait sur Washington et que la Maison Blanche était probablement visée.
Puis, quelques minutes plus tard, la tour nord s’effondre à son tour. Sa chute nous donne définitivement la certitude que ces attentats se solderont avec un bilan humain atroce.
Un malaise immense se propage dans mon esprit, j’en ai l’estomac remué, la tête qui tourne, et je me demande si je ne vais pas vomir ou perdre connaissance.
Je ressens l’horrible mais intense sensation qu’un nouveau membre m’a été arraché et qu’il gît béant, au sol, devant mes yeux.
Je fixe la télé et l’impression de sentir monter de l’écran, avec les images atroces et les sons glaçants, l’odeur de feu, de poussière, de fumée, d’incendie, de sang, de chair déchirée, de corps brisés, calcinés. C’est l’odeur d’une blessure tellement grave infligée à l’Humanité qu’elle n’en guérira jamais, un traumatisme capable de faire revenir nos civilisations en arrière de plusieurs décennies, si ce n’est des siècles, à une époque de barbarie sans nom.
J’ai peur, très peur, j’ai envie de pleurer. Et je finis par pleurer, en tremblant comme une feuille. Je serre un peu plus fort la main de Jérém, il serre la mienne un peu plus fort aussi.
Nous sommes tous abasourdis, assommés. En 1h30, nous avons été les spectateurs du film catastrophe de loin le plus marquant de l’histoire. Aucun scénariste hollywoodien, même pas le plus tordu, n’aurait pu seulement imaginer un truc pareil.
On vient d’assister au dernier acte de la terreur des cieux mais à cet instant précis nous ne savons pas que c’est le dernier. Nous restons longtemps devant la télé, en attendant des nouvelles horreurs.
Nous vivons dans la terreur, en nous demandant ce qui va encore se passer et où. Où ça va frapper maintenant, dans une minute, dans une heure, demain, après demain ? Et si ça arrivait à Paris ? Ou à Toulouse ? Où serons-nous désormais en sécurité ? Où nous sentirions-nous désormais en sécurité ?
La peur s’installe dans les esprits. On savait déjà que le terrorisme existait. Mais là, il prend une dimension inédite. La menace d’un terrorisme plus puissant et implacable que jamais vient de surgir de nulle part et nous prend par surprise.
Ce jour a certainement changé la face du monde. Le 11 septembre 2001, je le vois un peu comme « ma » chute du Mur de Berlin. Trop jeune à l’époque de ce qui s’était passé en 1989, je n'ai pas vraiment eu conscience sur le moment de cet événement marquant qui a tourné une page d'histoire.
Les gens qui l’ont vécu, ont compris d’emblée qu’il y aurait un avant et un après la chute du mur. Et je crois qu’on sait tous qu’il y aura un avant et un après les attaques des tours jumelles.
Avant ce 11 septembre, la naïveté de mes 18 ans m’amenait à croire que le monde dans lequel je vivais pouvait me garantir la sécurité, la liberté, la paix, le bien-être économique, l’état de droit, un avenir radieux. Et qu’il pouvait le faire indéfiniment, quoi qu’il arrive. Comme si tout cela était acquis.
Hier encore, le 10 septembre 2001, cette naïveté me faisant oublier que le monde que je connaissais ne s’était construit que tout récemment, peu avant ma naissance. Que ça ne faisait même pas soixante ans que l’Europe connaissait la paix, après des siècles de conflits et deux guerres mondiales. Que la guerre froide, la menace d’un affrontement entre Etats-Unis qui se serait très probablement déroulée sur le sol européen, ne s’était dissipée que depuis une dizaine d’années. Et que l’écho des tirs d’artillerie et l’odeur des incendies et du sang ne se sont pas encore effacés des territoires de l’ex Yougoslavie, théâtre d’une guerre bien moderne, en plein cœur de l’Europe si civilisée, et pas si loin de nous. Sans compter que partout dans le monde, à Beyrouth, à Gaza, au Rwanda, la guerre et la mort font rage au quotidien. Mais c’est si loin…
Les Etats-Unis c’est loin, encore plus loin. Mais pas dans nos esprits. Ce qui se passe là-bas, nous touche, et nous nous sentons concernés. Car leurs villes ressemblent à nos villes, aux villes de l’an 2000. Leurs vêtements ressemblent aux nôtres, leur mode de vie ressemble au nôtre. Leurs films, leurs séries, leurs musiques sont les nôtres, car il est bien vrai que de New York à Tokyo on danse le même disco. On se retrouve en eux, dans leur civilisation, dans leur mode de vie, dans leur façon de voir le Monde. Et lorsque leur pays, leur civilisation est attaquée, on se sent attaqués avec eux.
Je crois qu’à cet instant précis nous nous sentons tous Américains. Comment ne pas se sentir profondément solidaires de ce peuple et de ce pays attaqué par surprise, attaqué dans la société civile ?
On se sent attaqués comme les Américains, humiliés comme les Américains, incrédules, apeurés, assommés, en colère, comme les Américains.
Devant une catastrophe d’une telle ampleur, je prends brutalement conscience du fait qu’en 2001 on peut encore tuer au nom de la religion, comme au Moyen Age, au temps des croisades et des invasions sarrasines. Je réalise que si la religion est une notion en perte de vitesse dans nos sociétés occidentales, ce n’est visiblement pas du tout le cas dans d’autres sociétés.
Je réalise avec effroi que le sentiment de sécurité que je ressentais vis-à-vis de notre monde splendidement évolué, un monde que je croyais solide et à mesure de pouvoir indéfiniment garantir la paix et la prospérité, n'était qu'illusion et que ça pouvait s'arrêter en un instant.
Je réalise que, malgré l’évolution de nos sociétés occidentales, malgré l’argent, la science, la technologie, le droit, les ordinateurs, tout cela demeure bien fragile. Car rien n’est acquis pour toujours.
Je réalise que je fais désormais partie de la génération terrorisme : une génération qui n’a pas connu les guerres dans son propre pays, mais qui sait que ça peut péter n’importe où.
Pour moi, ces attentats sonnent le glas d’une illusion, d’une certaine forme d’innocence, d’insouciance. Définitivement, après ça, les choses ne seront plus jamais comme avant. Je crois que le 11 septembre 2001 m’a brutalement arraché de mon enfance.
Plus de quinze ans après, je n’ai pas oublié ces images, ces sensations. Et lorsque j’y repense, j’en ai encore des frissons.
Les infos continuent d’arriver à flots. Les images des impacts d’avions sur les tours passent en boucle. Les journalistes nous gavent de détails qui nous donnent de plus en plus précisément l’ampleur de la catastrophe. On commence à faire une estimation des morts, des blessés. On entend parler de guerre sainte, de croisade, des mots qu’on croyait appartenir définitivement au passé, définitivement enterrés. On se rend compte que c’est le retour à la barbarie.
La vision des deux tas fumants de celles qui ont été jusqu’à il y a deux heures encore les deux plus hautes tours de la planète me hante. Combien de vies brisées dans les décombres ?
Nous n’arrivons toujours pas à nous décoller de l’écran. Je crois que nous attendons toujours le générique de fin du film catastrophe auquel nous venons d’assister. Nous veillons sur le Monde, par le biais de la télé, comme on veillerait sur un mourant dans l’espoir de retarder son départ.
Je crois que nous avons tous peur que ce ne soit pas encore fini. Pourquoi ça ne frapperait pas encore, après tout ? Quand ? Où ? Si cela a été possible dans la plus grande puissance économique et militaire de la planète, ça doit être possible de frapper ailleurs. Ça peut désormais frapper n’importe où, n’importe quand. C’est horrible d’avoir peur.
On retient tous nos souffles. Les minutes passent, une demi-heure, une heure. Rien ne vient. On commence à penser que c’est fini. Du moins pour aujourd’hui, du moins pour l’instant.
Qu’est ce qui va se passer après ça ? Demain, après demain, dans un mois, dans les années à venir ?
Le spectre de la guerre plane à l’horizon. Les Etats-Unis humiliés vont certainement réagir militairement. Sommes-nous à l’aube d’un nouveau conflit mondial ? De l’Apocalypse, la fin du monde ? Sommes-nous en train d’assister aux dernières heures de la civilisation et de l’espèce humaine ?
Comment quitter la télé des yeux pour reprendre le cours de nos vies alors que tant d’inquiétudes habitent nos esprits ?
D’ailleurs, comment reprendre le cours des choses après ça ? Comment recommencer ne serait-ce qu’à respirer à pleins poumons après ça, alors qu’on a tous une énorme boule au ventre qui ne veut pas partir ?
Comment vivre après ça ? Comment vivre avec ça ? Comment croire en l’Humanité après cela ? Comment faire des projets, des études, comment partir bosser, après ça ? A quoi bon reprendre le cours normal des choses ? Comment avoir envie de faire quoi que ce soit après ça alors que tout peut se terminer quand on s’y attend le moins ? Comment être heureux, avoir de l’espoir en l’avenir, comment vivre sa jeunesse après ça ? Comment aimer, comment faire l’amour ? Comment être heureux à nouveau, alors que la simple idée d’essayer de l’être paraît une insulte aux victimes de cette horreur qui dépasse l’entendement ?
A côté de ce drame, tout paraît désormais futile, sans importance, sans utilité.
Comment ne pas laisser la peur nous ronger ?
Jérém demande à utiliser le téléphone de Charlène pour appeler son frère Maxime.
Dans un moment de lucidité, je pense à maman. Je demande à mon tour à Charlène d’utiliser son téléphone. Pendant le coup de fil, je sens qu’elle est très inquiète de me savoir loin. Elle me demande quand je compte rentrer.
« Demain, demain, en fin de matinée ».
J’ai envie de pleurer en prononçant ces mots. Et je pleure en raccrochant le combiné.
L’idée d’être éloigné de Jérém m’est de plus en plus insupportable. Comment ça pourrait en être autrement, alors que le seul endroit au monde où je me sentirais désormais en sécurité c'est dans le creux de ses bras ?
Nous aidons Charlène à soigner les chevaux. J’ai l’impression que cela dure une éternité, que nos gestes sont empâtés, comme s’ils avaient perdu toute motivation. Charlène nous propose de rester manger avec elle. J’entends Jérém décliner son offre. Nous ne nous sommes pas concertés mas moi non plus je n’ai pas envie de rester. J’ai envie de profiter de ces dernières heures en sa compagnie, j’ai envie de l’avoir tout pour moi. J’ai envie de pleurer, et j’ai besoin de pleurer dans ses bras.
Je l’entends également expliquer en deux mots la raison de notre visite, la nouvelle de son départ pour Paris le lendemain. Raison dont on n’avait pas pu lui faire part avant, accaparés comme on l’était par l’Horreur. J’entends Charlène féliciter son « protégé ». J’entends leurs échanges comme enveloppés dans un brouillard épais, comme dans un écho lointain.
Les félicitations de Charlène sont sincères. Et pourtant, je décelé une note de tristesse dans sa voix. Elle est visiblement émue.
« Fais bien attention à toi, mon grand » fait-elle, en serrant longuement Jérém dans ses bras et le couvrant de bisous comme une maman aimante et inquiète.
« Et toi aussi, Nico, fais bien attention à toi » elle me lance dans la foulée, tout en me serrant à mon tour très fort dans ses bras.
« Essayez d’être heureux, essayez malgré tout. La vie doit gagner, pas la peur. Nous ne devons pas nous laisser avoir par la peur, nous ne devons pas rentrer dans le jeu d’une poignée de tarés qui veulent nous empêcher de vivre, d’être libres, d’être heureux ».
Pendant le retour vers la petite maison, Jérém demeure silencieux. Il a l’air tout aussi secoué que moi. J’ai envie de le serrer contre moi, j’ai envie de lui dire que je ne veux pas qu’on se quitte, que je veux rester avec lui pour toujours, qu’il n’y a qu’en restant ensemble qu’on sera en sécurité.
Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quels mots utiliser. Tout paraît si creux après ce qui vient de se produire. J’ai envie de pleurer, mais je me fais violence pour me retenir.
Alors je renonce à la parole. Je choisis d’essayer de communiquer avec lui à l’aide d’un câlin. Je passe une main dans son cou, je glisse le bout de mes doigts dans ses cheveux bruns.
Et là, sans que je l’aie vu venir, mon Jérém éclate en sanglots. Jérém, le mec viril qui n’est pas vraiment du genre à perdre le contrôle des émotions et à les montrer ouvertement, est en train de pleurer à chaudes larmes devant mes yeux. Le voir ému devant les images horribles de la télé m’a beaucoup touché. Mais le voir éclater en sanglots me bouleverse. C’est dur de voir un homme pleurer. Devant ses larmes, les miennes ne peuvent se retenir plus longtemps.
De retour à la petite maison, il rallume le feu. Là encore ses gestes sont lents, sans motivation. C’est lorsqu’il allume une clope près de la cheminée que je réalise que depuis notre arrivée chez Charlène il n’avait pas fumé.
Je m’approche de lui, je passe mes bras autour de sa taille, je le serre contre moi, je plonge mon visage dans le creux de son cou.
Ni lui ni moi n’avons faim. Nous nous mettons au lit et nous restons longtemps en silence, dans les bras l’un de l’autre. A chaque seconde je me dis qu’on devrait profiter de ces derniers instants pour parler, pour rigoler, pour faire l’amour. Et pourtant, nous n’avons pas le cœur à ça. Nous venions de retrouver notre complicité sur la butte au cœur de cirque de Gavarnie, et voilà qu’elle nous échappe à nouveau, emportée par des événements terribles.
Je suis inquiet. Inquiet par ce qui va se passer demain, dans un mois, dans un an. Pour notre séparation, pour l’avenir du monde après ce désastre.
« Tu crois qu’il va se passer quoi, maintenant ? » je finis par le questionner à un moment.
« Je ne sais pas ».
« J’ai peur que ça frappe ailleurs ».
« Ce n’est pas impossible ».
« J’ai peur qu’il y ait la guerre ».
« Je crois qu’on a tous peur de ça ».
« Tu vas me manquer, Jérém ! ».
« Toi aussi, toi aussi… ».
Je pleure. Jérém me serre très fort dans ses bras et me couvre de bisous tout doux.
« Nous devrions essayer de dormir » je l’entends chuchoter.
Il a raison, l’heure tourne, et demain il a un long voyage à faire.
J’essaie de m’endormir, mais la peur me hante.
Ce soir, quand le soleil se couche, tout l’occident a peur.
Lorsque le sommeil vient enfin, il est peuplé de cauchemars et ponctué par de réveils en sursaut.
Jérém aussi semble avoir du mal à dormir. Il tourne sans cesse dans le lit, sans arriver à trouver la bonne position. Ce qui contribue certainement à mes réveils répétés.
Le petit radio réveil indique 2h45 lorsqu’il se lève pour aller fumer une nouvelle cigarette près du feu.
« T’arrives pas à dormir ? ».
« Je suis désolé, je t’empêche de dormir aussi ».
« C’est pas grave, c’est surtout pour toi que je m’inquiète, tu as un long trajet à faire demain ».
« Ca va aller ».
De retour au lit, Jérém me prend dans ses bras. Qu’est-ce que j’aime me sentir enveloppé par son corps chaud et musclé. Qu’est-ce que ça va me manquer !
Je sens son souffle chaud dans le cou. Je sens les battements rapides de son cœur. Soudain, je me rappelle que cette nuit est certainement la dernière occasion qui nous est donnée de faire l’amour avant longtemps. Pourtant, ni lui ni moi n’osons nous y lancer.
J’en ai terriblement envie mais pour la première fois de ma vie je ne suis pas à l’aise avec cette envie. Je culpabilise de penser au sexe alors que dans une ville meurtrie on compte les morts par centaines, alors que de milliers de secouristes sont à pied d’œuvre pour chercher des survivants dans les décombres fumantes, alors que le monde entier est traumatisé.
Comment ne pas culpabiliser de faire l’amour après ça ?
Soudain, je repense aux mots de Charlène.
« La vie doit gagner, pas la peur. Nous ne devons pas nous laisser avoir par la peur, nous ne devons pas rentrer dans le jeu d’une poignée de tarés qui veulent nous empêcher de vivre, d’être libres, d’être heureux ».
Oui, je repense aux mots de Charlène et tout va mieux. Car elle a raison. Ces attentats ont détruit des vies, et ils visent à en traumatiser bien d’autres. Il ne faut pas que cela arrive. Notre seule arme est de continuer à vivre. Il faut bien du courage, bien de l’énergie pour continuer à vivre après ça. Et pourtant, il le faut.
Car, demain ce sera trop tard. Demain Jérém ne sera plus là, près de moi. Et peut-être qu’après demain une catastrophe semblable nous empêchera de nous retrouver pour de bon. Alors, il faut profiter de l’instant présent, de notre jeunesse, du plaisir que nos corps et nos esprits peuvent nous offrir. Tant qu’on est vivants, personne ne nous empêchera d’être heureux ensemble.
« J’ai envie de toi, Jérém » je chuchote dans le noir.
« Moi aussi » je l’entends me répondre.
Cette nuit, nous faisons l’amour. C’est un amour tout doux, tout comme le sont les bisous qu’il pose sans cesse sur mon cou et sur mes épaules, tout comme l’est l’étreinte de ses bras puissants.
Ce moment de plaisir, de complicité et de tendresse avec Jérém, c’est tout ce dont j’ai besoin en ce moment.
Après l’amour, mon bobrun m’enveloppe toujours avec son torse et ses bras puissants.
Définitivement, il n’y a que dans son étreinte que je me sens en sécurité.
Pour ceux qui voudraient acheter le livre Jérém&Nico ou contribuer au financement de l’écriture de cette histoire sans avoir à rentrer ses propres données sur tipeee, de façon sécurisée et SANS frais, il est désormais possible d’envoyer des contributions via PAYPAL, en cliquant sur ce bouton :Même un petit, chaque geste est le bienvenu.
 3 commentaires
3 commentaires
-
Par fab75du31 le 4 Novembre 2019 à 23:40
Pour ceux qui voudraient acheter le livre Jérém&Nico ou contribuer au financement de l’écriture de cette histoire sans avoir à rentrer ses propres données sur tipeee, de façon sécurisée et SANS frais, il est désormais possible d’envoyer des contributions via PAYPAL, en cliquant sur ce bouton :Même un petit, chaque geste est le bienvenu.
Lorsque je me réveille, le bobrun n’est plus dans le lit. Je le cherche du regard, dans le petit séjour, autour de la cheminée, en train de fumer une clope ou de faire le café, il n’est pas là. Je tends l’oreille, à l’affût du moindre bruit venant de la salle de bain. En vain. Tout est silence dans la petite maison.
Le feu crépite dans la cheminée, mais pas de trace de mon Jérém. Je me lève, enroulé dans une couverture, je jette un regard à travers la fenêtre. Il n’est pas non plus devant l’entrée, ni dans la cour. D’ailleurs, la 205 rouge n’est pas là non plus.
Je cherche dans ma tête, il ne m’a rien dit la veille. Je reviens au lit, en me disant qu’il a dû partir faire une course. Oui, il existait jadis un temps où l’on ne dégainait pas le portable au moindre imprévu. Déjà, parce que le portable n’était pas encore dans toutes les poches. Et quand il l’était, il ne captait pas forcément. Ensuite, parce que la technologie ne nous avait pas encore rendus esclaves du « tout, tout de suite ». Certes, on s’énervait déjà quand le portable ne captait pas, mais ce n’était pas le drame que cela peut représenter aujourd’hui. Au fond, on était moins stressés. Moins informés, mais moins inquiets.
En attendant son retour, j’ai le temps de laisser remonter les souvenirs de ce dîner magique avec les potes de l’asso de cavaliers, cette soirée spéciale où il s’est passé quelque chose d’inespéré, le premier coming out de mon Jérém. Et quel coming out, quelle façon touchante de le faire, en me donnant un bisou devant tout le monde, pour exprimer en un instant, dans l’essentiel et sans fioritures, tout ce qu’il avait à dire. Lorsque je repense à ce baiser, j’en ai encore des frissons.
Entouré de bienveillance et d'amour, porté par les discussions et les encouragements de ses amis, Jérém s’est autorisé à être heureux. Certes, cela s’est passé dans un environnement très favorable, au milieu de gens très ouverts d’esprit. N’empêche que j’ai l’impression qu’après ça, tout devrait être plus simple.
Et aussi, bien évidemment, je repense à l’amour qu’on s’est donné cette nuit. Et, surtout, à ce que mon bobrun a voulu essayer pour la toute première fois.
Lorsque je repense à moi en lui, en train de lui faire l’amour, je n’arrive pas encore à réaliser que cela s’est vraiment produit. Que le bogoss, le rugbyman très populaire qui s’est tapé la moitié des nanas du lycée et qui a dû faire mouiller l’autre moitié rien qu’en existant, s’est donné à moi. A moi, qui n’étais au départ que son vide-couilles. Du moins c’était l’impression que j’en avais.
Que de chemin parcouru depuis le lycée, depuis l’image du petit hétéro bisexuel, macho, sexuellement actif, incorrigiblement actif, l’image que je m’étais forgée à son sujet et qui m’attirait et m’impressionnait au plus haut point. Oui, que de chemin parcouru depuis ses attitudes de mâle dominant pendant nos premières révisions !
Et le fait qu’il ait eu envie de m’offrir sa première fois me touche et me flatte d’une façon inattendue. Je mesure à sa juste valeur le cadeau qu’il m’a fait, ce cadeau que je n’avais même pas imaginé qu’il puisse envisager de m’offrir un jour.
Après cette nuit, mon Jérém n’en est pas moins viril à mes yeux. Il lui a fallu des sacrées couilles pour assumer cette envie qui va tellement à l’encontre de ce qu’il avait prétendu être jusque-là. Jérém demeure et il demeurera à jamais « mon mâle ». Mais, depuis hier soir, depuis cette nuit, le gars est devenu encore un peu plus humain. Parce que non seulement il s’est donné à moi, mais il s’est d’une certaine façon dévoilé, confié à moi.
J’aimerais bien connaître en détail le déclic qui s’est produit dans la tête de mon beau Jérémie. Certes, hier soir, il avait un peu bu, un bon peu même. Je pense que cela aussi a dû jouer son petit rôle dans ce qui s’est passé.
Mais j’imagine que, comme pour le coming out, il a surtout dû sentir que le moment était venu, que ça devait se faire. Il en avait envie, voilà tout. Et peut-être que, dans un cas comme dans l’autre, l’imminence du coup de fil de Paris a pu jouer le rôle d’étincelle, lui faisant prendre soudainement conscience que c’était « maintenant ou jamais ».
En tout cas, c’était bon, terriblement bon. Lorsque j’ai joui en lui, ma jouissance était tellement puissante que j’ai cru en devenir fou. Pendant un court instant, alors que mon esprit s’évaporait sous la déferlante de l’orgasme, j’ai même cru que je n’y survivrai pas, comme certains insectes qui ne survivent pas à l’amour.
Plus je pense à ce nouveau et incroyable plaisir, plus j’ai envie de recommencer. Je sens que la prochaine fois que nous coucherons ensemble je vais penser à ça, sans cesse, comme une idée obsédante. Est-ce qu’il aura envie de recommencer ? Je risque d’être frustré. Déjà que jusque-là, à chaque fois que nous nous donnions du plaisir, j’étais frustré de ne pas avoir mon bobrun partout en moi à la fois, maintenant je vais être frustré de ne pas pouvoir à chaque fois venir en lui.
Oui, j’ai terriblement envie de recommencer. Mon corps le réclame, mon égo le réclame aussi. Car il n’y a pas que le premier qui a joui de cette nouvelle expérience. Mon égo aussi a joui, tout aussi intensément. Et il a envie de ressentir à nouveau le frisson du petit mâle qui jouit dans l’« autre ». Je crois qu’il y a pris goût. Je pense que la prochaine fois je serais bien plus à l’aise. Ça donne de l’assurance de jouer au petit mec.
Et aussi des nouveaux fantasmes inspirant les plaisirs solitaires.
Soudain, je réalise que je bande à vitesse grand V. Je commence à me caresser en pensant à ma queue coulissant entre ses fesses bombées de rugbyman. Et, très vite, je perds le contrôle, de bonnes traînées chaudes atterrissent sur mon torse.
Mais lorsque je reviens de cet étourdissement passager que provoque l’orgasme, lorsque je rentre dans la phase de « reflux » après le plaisir solitaire, je ressens monter en moi une forme d’anxiété que l’excitation et le plaisir avaient masquées jusque-là. Une anxiété qui prend rapidement de l’ampleur.
Je repense à Paris, aux tentations auxquelles Jérém sera sans cesse confronté. Est-ce qu’il saura résister à l’envie de coucher ailleurs ? Est-ce que cette nouvelle envie, ce nouveau désir, ce nouveau plaisir, qui par définition ne peut être satisfait que par un mec, ne le poussera pas encore plus fortement vers la tentation ? Est-ce qu’il pourra m’être fidèle ? Est-ce qu’il pourra ne serait-ce l’envisager ? Est-ce que j’arriverai seulement à lui faire promettre de l’être ?
A cet instant précis, je me sens accablé, j’ai la sensation que je perdrai mon Jérém dès l’instant où il aura posé un pied sur le sol parisien. Soudain, le fait de me retrouver seul dans la petite maison en rajoute à mon angoisse. Ou est-tu parti, Jérém ? Pourquoi n’es-tu pas là ?
Les minutes passent et je commence à m’inquiéter de son absence. Je me lève, je reviens à la fenêtre. Toujours pas de 205 rouge dans la cour. Je regarde mon portable. Toujours pas de réseau.
Je commence à me poser des questions, à vouloir interpréter son absence qui se prolonge. Il peut être chez Charlène, en train de prendre le café et de discuter chevaux. Il est peut être chez Martine, ou chez son pote fromager, ou chez n’importe lequel de ses potes cavaliers. Peut-être qu’il a crevé un pneu. Ou qu’il lui est arrivé un accident. Non, Nico, arrête ça tout de suite, ne commence pas à penser au pire.
Soudain, ce départ inattendu de Jérém avant mon réveil me fait repenser à un autre matin, après une nuit magique à l’appart de la rue de la Colombette, un matin où je m’étais réveillé seul dans son lit, un matin où il était parti avant mon réveil, car il n’assumait pas ce qui s’était passé entre nous pendant la nuit. Et il ne s’agissait là que de tendresse et de câlins…
J’espère que ce coup-ci il n’est pas parti aussi parce qu’il étouffait ici, parce qu’il n’avait pas envie de voir ma tronche dès le réveil, parce qu’il ne peut assumer ce qui s’est passé hier soir, cette nuit. J’espère qu’il ne s’est pas tiré parce qu’il a honte, parce qu’il m’en veut, parce qu’il n’est pas bien dans sa peau. Pourvu qu’il ne regrette pas, pourvu que ça ne le pousse pas à revêtir à nouveau son armure de petit macho, à revenir sur toutes les avancées spectaculaires de ces quelques jours dans les Pyrénées.
J’en arrive même à regretter d’avoir accepté de lui faire l’amour. Pourtant il le voulait. Mais cette envie n’était peut-être là qu’à cause de l’alcool. Comme d’autres envies avaient été jadis dictées par le joint. J’aurais dû le comprendre. J’aurais dû me maîtriser. Mais comment lui refuser cela, alors qu’il le demandait avec insistance ? Si je ne lui avais pas donné, il aurait fini par le chercher ailleurs.
Et maintenant le mal est fait. Pourvu que ce ne soit pas irréparable.
Dans ma tête, je me jure que cela ne se reproduira pas, même s’il le redemande, même si j’ai kiffé à fond et que j’ai terriblement envie de recommencer. Mais pitié, reviens Jérém, reviens vite, s’il te plaît !
Je regarde le portable une nouvelle fois, toujours « Pas de réseau ». Fait chier ! Je sens comme une boule s’installer dans mon ventre, grandir de minute en minute, m’oppresser, me couper le souffle.
Je panique, je commence à bâtir les scenarios les plus catastrophiques, mon bobrun qui change son attitude du tout au tout, qui n’assume à nouveau plus rien, ni notre plaisir, ni nos câlins, ni notre amour. Je le vois faire marche arrière toute, me dire de partir vite et de ne plus jamais essayer de le contacter. J’ai peur de son regard noir, de sa colère. Une fois encore, je ressens la sensation que j’ai tant de fois ressentie en partant de l’appart de la rue de la Colombette, et notamment ce fameux matin où je m’étais réveillé seul dans son lit, la sensation que je ne le reverrai plus jamais, qu’il va me laisser tomber comme ça, sans explications et sans recours possible.
Non ce n’est pas possible, pas après ce qu’on a vécu ce week-end, pas après ce qu’on a entendu à l’asso. Non, il ne va pas m’abandonner dans cette petite maison, il ne va pas me quitter de cette façon. Ce n’est pas possible. Et pourtant, je commence à imaginer que ça puisse être possible.
Pendant un instant, je me dis qu’il ne reviendra pas. Je regarde ma voiture et je me dis qu’il ne me reste qu’à ramasser mes affaires et partir. Puis, le crépitement dans la cheminée me fait prendre conscience que ce feu est un signe qui devrait me réconforter. S’il comptait ne pas revenir, il n’aurait pas pris la peine d’ajouter du bois et de faire flamber.
Et pourtant, je n’arrive pas à me rassurer. Je ne tiens plus en place. Je me lève, je regarde une nouvelle fois par la fenêtre. Toujours pas de voiture. Je fais le tour de la petite maison, je regarde sur chaque meuble à la recherche d’un mot qu’il m’aurait laissé. Rien du tout. Je panique.
Je commence à m’habiller à toute vitesse, bien décidé à prendre ma voiture et à me rendre à la superette chez Martine et chez Charlène pour savoir si elles ont vu mon Jérém.
Je viens tout juste de passer mon boxer, mes chaussettes et mon pantalon, lorsque j’entends un bruit de moteur. Je regarde une nouvelle fois par la fenêtre, et je vois la 205 rouge se garer devant la porte.
Mon cœur s’emballe, je suis soulagé, j’ai l’impression de respirer à nouveau après un trop long moment d’apnée, ma boule au ventre se dissipe d’un coup. Soudain, je me trouve idiot d’avoir imaginé « le pire ».
La porte d’ouvre, le bogoss rentre dans le petit séjour. Immanquable pull capuche gris sur t-shirt blanc, short en dessous du genou, baskets, cheveux bruns en bataille, peau mate, il est sexy à mourir. Qu’est-ce que ça fait du bien de le voir enfin !
« Salut petit loup » je lui lance en m’approchant de lui pour l’embrasser.
« Salut » il me lance, laconiquement.
Mais elle est passée où la mention « ourson » ? Très vite, j’ai l’impression que quelque chose cloche ce matin.
Mon intuition se confirme lorsque je m’approche de lui pour l’embrasser et renouer avec la complicité de nos câlins de la veille. Me voyant approcher et franchir son espace vital, Jérém a une réaction surprenante, presque « défensive ». Puis il se ressaisit, et il m’embrasse brièvement. Nos lèvres se rencontrent fugacement, et ça n’a rien à voir avec les élans de la veille.
Je suis surpris. Abasourdi. En une fraction de seconde, je passe de la joie immense de le retrouver, à la désolation de voir l’un de mes pires scénarios se réaliser. Oui, ce que je craignais s’est bel et bien produit. Son attitude a changé. Ce matin, mon bobrun a l’air bien soucieux. Il a mauvaise mine.
« Ça va, toi ? » je tente de faire bonne figure.
« Oui… ».
« T’étais parti où ? » je le questionne.
« Chez Martine pour acheter des cigarettes et des croissants… merde… ils sont restés dans la voiture ».
Le bobrun se précipite dehors et il revient avec un sachet en papier rebondi.
« Ah, merci, c’est super gentil » je tente de le décrisper. Son attention me touche.
« Je vais faire le café ».
Soudain, je m’en veux de ne pas avoir pensé un seul instant à préparer moi-même le café, au lieu de passer le longues minutes à paniquer. En rentrant dans le petit séjour, mon Jérém aurait été submergé par l’arôme rassurant, il aurait été touché par mon petit geste et ça l’aurait peut-être mis de meilleur poil. L’odeur du café est un pourvoyeur de bonheur puissant. Il n’y a pas que la musique ou l’alcool ou le joint qui adoucissent les mœurs.
Je regarde mon Jérém pendant qu’il s’affaire avec la cafetière. Ce matin, il a l’air complètement à l’ouest. Ses gestes, d’habitude si aisés et rapides, ont quelque chose de maladroit. Le réservoir d’eau lui échappe des mains, il tombe dans l’évier avec un bruit assourdissant.
« Fait chier » je l’entends marmonner entre les dents.
En versant le café dans le filtre directement depuis le sachet, il fait déborder, et il s’énerve à nouveau. Il tente de visser les deux réservoirs, le pas de vis semble réfractaire, il insiste. A la suite d’un mouvement brusque, du café tombe sur son pull et sur le carrelage.
« Merde, merde, merde » je l’entends pester.
Il arrive enfin à serrer les deux parties de la cafetière, et cette dernière atterrit sur le feu. Pendant ce temps, je passe un t-shirt et j’attrape le balai pour nettoyer, mais le bobrun m’en empêche.
« Laisse » il me lance sèchement, en m’arrachant l’outil des mains.
Définitivement, ce matin mon bobrun est de mauvais poil. Et je commence à m’inquiéter sérieusement.
« Qu’est-ce qui se passe ? » je le questionne.
« Il ne se passe rien, j’ai juste fait tomber du café ».
« Je vois bien que ça ne va pas ».
« Je te dis que ça va ».
Oh, putain, on dirait nos conversations rue de la Colombette. Moi qui essaie d’escalader un mur de verre et Jérém qui met de l’huile dessus pour qu’il soit encore plus glissant.
« T’as pas bien dormi ? » je tente de lui faire la conversation. Ou, plutôt, de ne pas regarder les choses en face.
« Pfffffff ! ».
Là il n’y a plus de doute, notre complicité de la veille s’est envolée. J’ai envie de pleurer. J’ai envie de partir. Je passe mon pull, j’approche de la fenêtre et je regarde dehors pour cacher les larmes que je n’arrive pas à retenir.
Dehors, il fait très gris. Tout comme dans le petit séjour. Le brouillard sur les pentes est de plus en plus épais et menaçant. Tout compte fait, je me demande si c’est une bonne chose d’aller se balader aujourd’hui.
Soudain, je sens sa présence juste derrière moi. Le bobrun passe ses bras autour de ma taille, il me serre contre lui, il me fait un bisou, un seul, dans le cou et il me chuchote :
« Désolé, c’est vrai, je n’ai pas très bien dormi cette nuit ».
« Qu’est-ce qui s’est passé ? J’ai pris trop de place ? J’ai ronflé ? ».
« Non, non, ça m’arrive parfois. Mais ça va aller, laisse-moi le temps d’émerger, le café va me faire du bien ».
« D’accord » je fais, un brin rassuré, tout en me retournant et en cherchant à l’embrasser. Mais, en dépit de ses mots qui se veulent rassurants, son attitude demeure distante. Ses lèvres sont peu chaleureuses.
Allez, ne te prends pas la tête Nico, s’il a dit qu’il a besoin de temps pour émerger, laisse-lui le temps. Sois confiant. Et change de sujet.
« Elle allait bien, Martine ? ».
« Oui, elle avait l’air. Je lui ai dit qu’on partait à Gavarnie ce matin ».
« T’es sûr que c’est une bonne idée d’y aller aujourd’hui ? » je profite pour lui faire part de mes doutes.
« Pourquoi ça ? ».
« Regarde ce brouillard ».
« Ca va aller ».
« Pourquoi on n’y irait pas plutôt demain ? ».
« Non, on y va aujourd’hui » fait-il, sèchement.
« On y va aujourd’hui » il se reprend sur un ton plus calme « parce que c’est pas sûr que demain la météo sera meilleure ».
Je me range à son avis et je n’insiste pas. Je passe à la douche. Lorsque je reviens, le café vient de monter, nous déjeunons en silence. Un silence qui me fait mal au cœur. Car, malgré ses explications, je sens qu’il y a un malaise, un malaise que je ne sais pas comment dissiper. Je connais un peu mon bobrun et je sais que le questionner davantage ne ferait que le braquer.
Et pourtant, notre complicité des jours précédents me manque terriblement. Où est-elle passée ? A quel moment l’avons-nous perdue ? Comment on fait pour la retrouver ? Ni la confiture, ni le bon pain, ni les chocolatines, ni même le café n’ont la même saveur sans cette délicieuse complicité.
Jérém a vite avalé son café et une chocolatine, il est parti à la douche, il est revenu avec les cheveux encore humides, sexy à tomber, et il s’est installé à côté du feu pour se griller une clope.
« Tu t’es mis de la confiture sur le pull » il me lance sur un ton monocorde alors que je ne peux détacher les yeux de lui, tout en me forçant à terminer la dernière chocolatine.
Je regarde mon pull taché et je rigole. Jérém ne rigole pas. Son regard est fermé, ses traits immobiles. J’ai à nouveau envie de pleurer.
Jérém termine sa cigarette et s’approche du lit. Il fouille dans son sac de sport et il en sort un pull à capuche rouge avec des inscriptions blanches floquées. Il s’approche de moi et me le tend.
« Il est bien chaud » il me lance.
Son geste me touche.
« Merci ».
Je me déleste de mon pull taché et je passe le sien.
Dès le premier contact, le tissu m’a paru doux, chaud et agréable. Mais lorsque je le passe, lorsque le tissu caresse la peau de mes bras et de mon cou, lorsque mon nez plonge dans l’univers olfactif dont sont imprégnées ses fibres, je manque de peu de disjoncter.
Car ces fibres portent à la fois le parfum de sa lessive, son parfum à lui, la signature olfactive de sa présence. Les tissus qui ont caressé sa peau sont comme marqués à tout jamais par cette mâlitude radioactive qui se dégage de lui et qui imprègne tout ce qu’il approche.
Ce pull est comme une caresse, comme une étreinte de mon bobrun, une étreinte et une caresse parfumées, qui remplacent un peu celles qu’il ne semble plus disposé à m’offrir aujourd’hui. Enveloppé dans ce pull, j’ai presque l’impression d’être dans ses bras.
Soudain, je repense à cette chemise qu’il m’a passée un jour pour couvrir mon t-shirt taché lors de nos fougueuses « révisions », et qu’il ne m’a jamais réclamée. Je l’ai passée parfois, pour retrouver son odeur, pour retrouver sa présence. J’adore porter ses vêtements, j’adore sentir sa présence autour de moi, sur moi.
« Il est un peu grand » je rigole « mais il est très chouette ! Merci, Jérém ! ».
Je tente de lui donner un bisou, qu’il me rend sans entrain.
Quelques minutes et une nouvelle cigarette plus tard, nous sommes en route vers Gavarnie.
Au village, nous prenons la direction de La Mongie. Je suis toujours autant émerveillé par les paysages à la fois domestiqués et indomptés de la montagne, par l’architecture typique de la région, par ces petites maisons en pierre, recouvertes d’ardoise, par les petits ponts, par les murs de soutènement en pierre, autant de témoins de la rudesse de la vie dans la région dans les siècles passés.
Ici, dans les Pyrénées, j’ai l’impression d’être dans un autre monde, dans une autre dimension. Ici tout a l’air plus simple et plus authentique qu’en ville, la vie, les gens, les relations humaines.
La 205 rouge file tout droit sur sa route. Le ciel est gris, il y a du brouillard dans la vallée, les couleurs sont ternes, tristes. Un fin brouillard tombe sur le parebrise. Il fait gris dehors, et j’ai toujours l’impression qu’il fait gris dans la voiture aussi, entre Jérém et moi.
J’ai envie de lui poser mille questions mais je ne veux pas empirer la situation, je ne veux pas gâcher l’espoir qu’il « émerge » enfin, comme il me l’a promis. Ou alors, au contraire, est-ce qu’il ne vaudrait-il mieux crever l’abcès tout de suite ? Il faut juste que je trouve le bon moment et les bons mots.
Plusieurs kilomètres plus loin, je n’ai toujours pas trouvé ni l’un ni les autres. La fine pluie a cessé. Le brouillard est toujours épais, mais il a l’air de vouloir se dissiper au loin. Ce qui ne semble pas être le cas de celui qui plombe l’humeur de mon bobrun.
Le silence dans la petite voiture se prolonge et devient de plus en plus gênant. De temps à autre j’essaie de faire la conversation, mais le bobrun n’est vraiment pas causant ce matin.
Faute de savoir comment lui parler, je le regarde en train de conduire. Sa façon de tenir le volant, en l’empoignant fermement, est très virile. J’ai toujours aimé regarder mon Jérém au volant, car il dégage quelque chose à la fois de très sexy et de profondément rassurant. J’ai l’impression que rien ne peut m’arriver quand je suis en voiture avec lui. Que je pourrais le suivre jusqu’au bout du monde.
Soudain, les souvenirs d’autres voyages dans la 205 rouge remontent en moi, les souvenirs de retours de boîte de nuit vers l’appart de la rue de la Colombette, souvenirs de l’époque de ma totale soumission à ses envies de mâle dominant. Lors de ces voyages, Jérém était silencieux aussi, et distant. Et si, comme je le craignais, ce qui s’est passé cette nuit marquait un retour en arrière drastique ?
Nous traversons le village de La Mongie, nous apercevons le départ du téléphérique sans apercevoir le Pic du Midi, enveloppé par le brouillard.
« T’es déjà monté tout en haut ? » je le questionne.
« Oui, il y a quelques années, mais c’était un jour comme aujourd’hui, couvert ».
« Alors t’as rien vu ».
« Si, j’ai vu la mer de nuages. Le sommet est quasiment tout le temps au-dessus des nuages. On les traverse avec le téléphérique. Là-haut, il fait soleil presque en permanence ».
« Ça doit être beau la mer de nuages ».
« Ça l’est, mais on ne voit rien du paysage ».
« J’aimerais y monter un jour ».
« C’est pas donné, mais ça vaut le coup ».
« J’aimerais qu’on y monte tous les deux » je précise mon propos.
« Il faut y monter l’été » c’est sa réponse laconique, alors qu’il vient d’allumer la radio, comme pour faire diversion.
Les petites enceintes de la voiture grésillent sur une fréquence chargée de bruits parasites.
« Vas-y, cherche une station qui capte » il me lance, en remettant sa deuxième main sur le volant.
Mais moi, au contraire, j’ai envie d’éteindre, et de chercher à savoir enfin ce qui le chagrine.
Et pourtant, je m’exécute. Mais j’ai beau parcourir plusieurs fois de bout en comble le spectre entre 88 et 108 MHz, je ne capte que des bouts de mots et de musiques parasités par d’insupportables grésillements.
Du moins, jusqu’à ce que je tombe sur une chanson bien connue et qui me prend instantanément aux tripes. Par chance, la station semble relativement stable, le grésillement est toujours présent mais acceptable.
(…) Il y aura certainement/Sur les tables en fer blanc
Quelques vases vides et qui traînent/Et des nuages pris aux antennes
Je t'offrirai des fleurs/Et des nappes en couleurs/Pour ne pas qu'octobre nous prenne
Une chanson qui me donne envie de pleurer car elle me parle de cet automne qui arrive, de ce temps qui avance et qui finira par me séparer de mon Jérém. Et l’idée de nous séparer alors que notre complicité s’est envolée m’est encore plus insupportable. Il faut absolument que je trouve le moyen de la retrouver. Mais où et comment aller la chercher ?
La chanson se termine, j’ai besoin de me rassurer en caressant le cou et la nuque de mon Jérém. Mais, comme cela avait été le cas pour le bisou lors de son arrivée à la petite maison, il a un mouvement d’esquive, comme s’il ne supportait pas ce contact.
« Qu’est-ce qu’il y a ? Tu n’aimes plus ? ».
« Il fait jour, on peut nous voir ».
« Et c’est grave ? Tu m’as bien embrassé sous la halle, le jour de mon arrivé ».
Jérém ne répond pas, il se contente de secouer la tête et d’allumer une nouvelle cigarette. Mon malaise et ma tristesse gonflent de minute en minute.
Je suis à deux doigts de le questionner. Le bobrun doit le sentir car il ne m’en laisse pas l’occasion. Il prend l’initiative de meubler le silence en faisant une nouvelle recherche sur la radio, en calant sur une fréquence diffusant du rock, et en montant le son.
Devant nous, le brouillard se dissipe un peu. La route de fond de vallées serpente dans un paysage de pentes douces couvertes d’une végétation rase mais verdoyante. Un peu plus haut, la flore est dense et luxuriante, comme laine à moutons. En remontant encore les pentes, le paysage devient de plus en plus minéral, le gris devient la couleur dominante.
Nous longeons un quartier avec de nombreuses résidences à flanc de montagne, plus ou moins stylées.
La fréquence radio se volatilise à nouveau, je me remets à chercher. Et je tombe sur une radio où l’animateur raconte une histoire étrange.
[« … en entendant cette émission, j’ai presque fait une crise cardiaque » racontait à l’époque un habitant du Bronx « j’étais scotché à ma radio et je n'ai pas éteint avant que le programme soit presque terminé. [...] Quand le « Secrétaire de l'intérieur » a été présenté, j'étais convaincu qu'il s'agissait de McCoy. J’ai paniqué. Je me suis précipité dans la rue et il y avait des gens qui couraient dans toutes les directions ».
Le 30 octobre 1938, dans la soirée, la radio américaine CBS diffusait un récit radiophonique raconté par Orson Welles. Inspiré du roman « La Guerre des Mondes », cette fiction a été présentée comme une émission d'actualité, avant que la supercherie ne soit dévoilée. Le canular a fait paniquer une partie de l'Amérique, qui a cru qu'une invasion de Martiens hostiles était en cours].
La radio se met à grésiller à nouveau, la station est perdue. Je recommence à zapper, j’erre longuement sur les fréquences sans arriver à trouver quelque chose d’écoutable.
Jusqu’à ce que, au bout d’un moment d’intenses grésillements, je suis accroché, harponné, scotché par la mélodie, la voix et les mots d’une chanson que je découvre pour la toute première fois. Par chance, j’arrive à stabiliser la fréquence.
De New York à Tokyo/Tout est partout pareil
On prend le même métro/Vers les mêmes banlieues
Tout le monde à la queue leu leu/Les néons de la nuit/Remplacent le soleil
Et sur toutes les radios/On danse le même disco/Le jour est gris la nuit est bleue
Dans les villes/De l'an deux mille/La vie sera bien plus facile
On aura tous un numéro/Dans le dos/Et une étoile sur la peau
On suivra gaiement le troupeau/Dans les villes/De l'an deux mille
(…)
Monopolis/Il n'y aura plus d'étrangers/On sera tous des étrangers
Dans les rues de... /Monopolis
Et qui sont tous ces millions de gens/Seuls/Au milieu de.../Monopolis…
Je suis abasourdi. Pour moi, cette chanson, c'est une révélation, une claque. Ça me donne des frissons partout, des jambes jusqu'à la racine des cheveux. Car, en quelques couplets et sans détours, cette chanson parle de la vie dans les villes d’aujourd’hui, de métro-boulot-dodo, de standardisation des modes de vie, de dépersonnalisation, de perte d’identité, d’exploitation, de masses humaines se comportant comme de troupeaux de moutons, d’uniformisation culturelle, de surveillance de masse. Et, par-dessus tout, de solitude.
Portée par cette voix à la fois si belle et si troublante, cette chanson dépeint en trois minutes à peine un monde sombre, dénué de toute couleur et de tout bonheur, dans lequel les gens ont l’air d’avancer comme des fantômes. C’est saisissant, inquiétant. Est-ce nous allons y arriver bientôt, « Dans les villes de l’an 2000 », dans cette société de fous ? Ou bien, est-ce que nous y sommes déjà dedans, sans même nous en rendre compte ?
Je n’en reviens pas de ne pas connaître un truc aussi génial. Ça date de quand, c’est sorti quand ? J’ai terriblement envie de me procurer le cd pour mieux réécouter ce petit chef d’œuvre, j’ai besoin de savoir qui en est l’auteur et le compositeur, et qui est la chanteuse qui m’a donné tant de frissons.
Et alors que je commence à me sentir frustré que le titre se termine sans que je ne sache rien de cela (il y avait aussi une époque où Shazam n’existait pas), voilà que sur les dernières notes de musique, une voix féminine vient m’offrir le bonheur d’en savoir un peu plus sur cette chanson et sur sa genèse.
[« Monopolis est l’une des chansons d’ouverture de Starmania, opéra-rock cultissime de Luc Plamondon et Michel Berger. On ne présente plus Starmania, car il est peu probable de ne pas en connaître au moins une chanson, tant certaines sont passées dans la culture collective : « Le blues du businessman », « Ziggy », « SOS d’un terrien en détresse », ou encore « Le monde est stone »].
Je connais en effet la chanson de Ziggy et « Le monde est stone ». Notamment car la première parle d’un garçon qui aime les garçons et elle a été reprise par Céline Dion, alors que la deuxième a été reprise en anglais par Cindy Lauper. Mais je ne connaissais jusqu’ici Starmania que de nom, et de façon plutôt abstraite.
[« Créé en 1979 » continue l’animatrice radio « Starmania est un bel exemple de dystopie.
Dystopie, quésako ? Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Une dystopie peut également représenter une utopie ou une idéologie qui vire au cauchemar. Ce genre est souvent lié à la science-fiction, ou à l'anticipation.
L’action de Starmania se situe peu avant les années 2000, dans un monde futuriste, hyper-urbanisé et hyper-industrialisé. La surface de la Terre semble n’être plus que décombres et la population vit dans des villes-capitales souterraines. Alors que les métro est aérien. Définitivement, c’est un monde qui tourne à l’envers.
Une bande de zonards menée par Johnny Rockfort, lui-même mené par une dénommée Sadia, devient terroriste pour lutter contre Zéro Janvier, un riche constructeur de gratte-ciels qui se présente aux élections pour la présidence de l’Occident. Rien que cela »].
Quand tout l'monde dort tranquille/Dans les banlieues-dortoir
On voit les Etoiles Noires/Descendre sur la ville
(…) C'est la panique sur les boulevards/Quand on arrive en ville
Il se passe quelque chose à Monopolis
Quand le soleil se couche tout l'Occident a peur
[« La première partie de notre émission consacrée à Starmania s’achève ici. La suite demain à la même heure sur nos ondes. Nous vous laissons avec l’un des airs les plus connus de l’opéra-rock, « La Complainte de la Serveuse automate ». Marie-Jeanne, la serveuse de l’Underground café, est peut-être le personnage le plus lucide dans ce décor de gens complètement déconnectés d’eux-mêmes. Bonne écoute, je vous retrouve demain »].
J'ai pas d'mandé à v'nir au monde/J'voudrais seul'ment qu'on m'fiche la paix
J'ai pas envie d'faire comme tout l'monde/Mais faut bien que j'paye mon loyer
J'travaille à l'Underground Café
Encore une chanson magnifique, qui parle une fois de plus de solitude, d’un monde où le bonheur est absent, ou les Hommes se sentent frustrés dans leurs aspirations profondes, d’une société qui offre des biens matériels mais qui est fatale pour l’épanouissement de tout un chacun.
Starmania. J’ai bien retenu le nom de l’opéra. J’aimerais tellement pouvoir écouter l’émission du lendemain, et découvrir la suite des chansons et de l’analyse de l’animateur. Je ne sais pas si cela sera possible. J’en doute fort.
Quoi qu’il en soit, dès mon retour à Toulouse, une virée dans un célèbre grand magasin culturel de la place Wilson s’impose. Il me tarde d’avoir le cd et de découvrir toutes les chansons de ce chef d’œuvre.
Pendant un court instant, mon retour de Toulouse m’apparaît comme une source de bonheur. Un instant qui se dissipe très vite et très violemment, lorsque je réalise que ce retour est synonyme de séparation de mon Jérém. Alors, je n’ai aucune raison de me réjouir d’être à Toulouse. Et encore moins maintenant, alors que j’ai perdu la connexion magique avec mon bobrun et que je n’arrive pas à la retrouver, à l’instar de cette radio dont je balaie les fréquences sans arriver à capter quoi que ce soit d’intelligible.
Jérém enchaîne les cigarettes et demeure silencieux, l’air complètement ailleurs. Je tente de garder espoir que son moral puisse se lever, se dégager, qu’un rayon de notre belle complicité des derniers jours puisse pointer à travers les nuages de sa mauvaise humeur et arriver à réchauffer mon cœur frigorifié. J’espère que ça va lui passer, qu’il va se rendre compte que rien de ce qui s’est passé hier soir ou cette nuit n’est grave, et que notre amour vaut bien plus que tous les remords. Des remords qui n’ont d’ailleurs aucune raison d’être.
Mais plus le temps passe, plus j’ai du mal à garder cet espoir. Ma tristesse ne fait que gonfler encore et encore. J’ai de plus en plus de mal à retenir mes larmes. Kilomètre après kilomètre, cette virée qui devait être magique, devient un cauchemar d’inquiétude.
Après Luz-Saint Sauveur, la vallée devient de plus en plus encaissée, la route serpente à flanc de montagne. Sur la droite, en contrebas, coule une rivière.
« Tu sais ce que c’est cette rivière ? » je le questionne.
« C’est le Gave de Pau. Il prend sa source à Gavarnie, par la grande cascade » il m’explique, avant de continuer, sur un ton plus taquin « et il descend jusqu’à Lourdes, où ses eaux deviennent soudainement miraculeuses ».
Et là, alors que je n’y espérais plus, je sens sa main se poser sur ma cuisse, chaude, lourde, rassurante. Je pose à mon tour ma main sur la sienne et nos doigts s’entrelacent. Mon cœur bondit, l’ascenseur émotionnel est violent. Je passe de la tristesse au bonheur en une fraction de seconde. Mes larmes changent de signe instantanément et je ne peux plus les retenir, mes yeux s’embuent.
Une fois de plus, j’ai l’impression de respirer à nouveau après une longue apnée. Par ce simple contact de nos doigts, j’ai l’impression de retrouver mon Jérém.
« Ca va Nico ? » il me questionne.
« Maintenant ça va ».
J’ai envie de le couvrir de bisous et de câlins, j’ai envie de le serrer très fort contre moi, j’ai envie de sentir nos corps nus l’un contre l’autre, j’ai envie de plonger mon nez dans les poils doux de son torse, j’ai envie de faire l’amour avec lui.
La route est étroite et sinueuse. Nous sommes ralentis pas un camping-car que nous avons chopé à Luz et que nous n’avons pas pu doubler depuis.
Le contraste est saisissant entre la paroi rocheuse à notre gauche et la falaise à notre droite au fond de laquelle circule la rivière alimentant une végétation luxuriante.
A l’approche de Gavarnie, Jérém fait un écart pour éviter de justesse un gros caillou tranchant tombé sur la route et qui aurait pu crever un pneu.
Au détour d’un virage, nous arrivons à destination. Dès l’entrée du village, la vue du cirque rocheux s’offre à nous. Sa forme en amphithéâtre est spectaculaire et majestueuse. Nous nous garons sur un petit parking. Je suis impatient de marcher vers le géant de pierre.
Nous traversons un quartier de restaurants et de magasins, ces derniers exposant toute sorte de bibelots souvenirs. Dans des paniers en hauteur, des armées de marmottes en peluche sifflent sur notre passage.
Au fur et à mesure que nous nous éloignons du village, les commerces se font plus espacés, et nous rentrons dans une région marquée par la musique de la rivière roulant sur les cailloux, une région où la montagne reprend peu à peu ses droits.
Le cirque se dresse devant nous. Je repère la fameuse cascade sur la gauche. Notre destination paraît étonnamment proche. Mais, à en juger par l’impression de vitesse ralentie de la cascade, ce sentiment de proximité n’est qu’illusion. D’ailleurs, un panneau en bois indique : « Cascade 2h15 ».
« Ca va faire une sacrée trotte » je commente.
« Ca c’est un timing pour les vieux, nous on va faire ça en moitié temps ».
« Si tu le dis… ».
Et en effet, mon bobrun avance d’un pas soutenu. J’essaie tant bien que mal de suivre, porté par le bruit sec et cadencé de nos pas sur les cailloux.
Nous quittons peu à peu la civilisation pour nous aventurer dans la nature. Nous continuons de suivre la rivière à contre-courant, alors que le chemin commence à monter doucement. Nous tombons sur un petit pont en pierre de toute beauté.
Nous ne sommes pas les seuls marcheurs, mais il n’y a vraiment pas grand monde aujourd’hui. L’été est bel et bien derrière nous.
Nous arrivons dans une prairie d’estive rasée par les bêtes pendant leur séjour à la belle saison. Le soleil est enfin de sortie, il fait chaud, le bobrun tombe le pull à capuche, il fait péter le t-shirt blanc mettant en valeur son torse musclé et ses biceps puissants. Il est vraiment sexy à mourir. Mais toujours excessivement silencieux. Si seulement je pouvais retrouver le Jérém de la veille, putain !
Le chemin se fait de plus en plus pentu et rentre dans un sous-bois où la lumière du jour n’arrive qu’à faible intensité. Ici, au pied des arbres, on sent remonter les odeurs de terre, d’humidité, de feuilles mortes, l’odeur de l’automne.
Au gré de nos pas, le cirque se cache et se dévoile par surprise. Lorsqu’il réapparaît dans une ouverture dans la végétation, il semble désormais nous surplomber. Mais là encore, ce n’est qu’illusion. Un autre panneau en bois indique : « Cascade 1h45 ».
La pente de plus en plus importante, ainsi que la marche sur les cailloux sans chaussures adaptées, me ralentissent. Mais le bobrun, bien musclé, avance toujours d’un pas rapide. Il me distance. Je n’essaie pas de le retenir, je garde mon souffle pour l’effort. Je ne veux pas non plus l’agacer.
Puis, à un moment, il finit par se retourner. Et là, me voyant ramer, il me sourit, pour la première fois de la journée. Je devrais en être heureux, mais j’ai l’impression que son sourire est terne. D’ailleurs, il disparaît très vite de son visage.
Au bout de nombreux virages et de nombreux efforts, nous arrivons aux pieds d’une grande bâtisse sur laquelle est peint, en grandes lettres capitales, l’intitulé de « Hôtel de la Cascade ».
Nous arrivons par l’arrière, nous contournons l’édifice. Mais les volets sont fermés, la terrasse est déserte. Le cirque se dresse devant nous.
« C’est ici que mon père s’est arrêté » il me raconte, après s’être assis sur un petit mur en pierre et avoir allumé une clope.
« Et tu voulais aller plus loin ».
« Il faisait chaud, et je voulais aller me baigner à la cascade. Je croyais qu’il y avait un grand bassin avec d’autres enfants en train de jouer ».
« T’avais quel âge ? ».
« Sept, peut-être huit ans ».
La cascade sur la gauche du cirque nous nargue. Un sentier de plus en plus escarpé, étroit, à flanc de montagne, nous sépare de notre destination ultime.
« Allez, en marche ! » fait mon bobrun en écrasant le mégot sur une pierre, avant de le glisser dans sa poche.
Nous reprenons notre avancée sur un chemin peu aisé, un parcours très « sportif », permettant à la puissance physique de mon bobrun de s’exprimer pleinement. C’est beau d’être aussi musclé.
Au bout d’un bon moment de marche, nous contournons une butte positionnée pile en face du cirque. En fait, elle donne l’impression d’être installée précisément au cœur du cirque. On dirait une perle posée dans sa coquille ouverte.
Le cirque est de plus en plus imposant, il nous enveloppe, il nous domine. Je me sens tout petit devant son regard multi-millenaire, « multi » à un point que ma raison ne peut même pas concevoir. Et je me sens tout petit devant cette nature indomptée.
Jérém file tout droit vers la cascade et je m’efforce de rester derrière lui. La vision de son dos en V et de ses épaules charpentées m’aide à avancer, comme un mirage de bogossitude s’éloignant sans cesse et m’entraînant dans son errance.
La végétation disparaît peu à peu, laissant la place à la roche nue. Des sifflements de rapaces tournoyants dans les airs résonnent dans l’amphithéâtre naturel.
Vingt mètres devant moi, Jérém s’arrête soudainement, ce qui me permet de le rattraper.
« Tu fatigues ? » je le charrie.
« Ecoute » fait-il, sans prêter attention à mes mots.
« Quoi, les oiseaux ? ».
« Non. Ecoute bien, tu entends ces sifflements rapides, fins, aigus ? ».
Je tends l’oreille et effectivement, j’arrive à distinguer ce sifflement de celui des rapaces.
« Oui, je l’entends ».
« Ce sont des marmottes ».
« Mais ça ne siffle pas comme celles des magasins au village » je rigole.
« Ca siffle comme des vraies » il se moque.
« J’aimerais en voir de près ».
« Ca m’étonnerait qu’on y arrive » fait le bobrun.
« En revanche » il continue « ça ne m’étonnerait pas qu’on croise des Dahus ».
« Des quoi ? ».
« Des Dahus. Tu connais pas ? ».
« Non ».
« Le Dahu ressemble à un Isard ».
« C’est quoi un Isard ? ».
« Un chamois des Pyrénées. Donc, le Dahu ressemble à un Isard, sauf qu’il a les deux pattes de droite qui sont plus courtes que celles de gauche… ».
Et là, devant mon regard incrédule, il précise :
« C’est pour mieux se tenir à flanc de montagne ».
« T’es con » je fais, tout en rigolant de sa blague.
Jérém aussi se marre, il rigole, et son sourire me réchauffe le cœur.
Nous recommençons à marcher et le paysage devient de plus en plus lunaire, 100% minéral.
La cascade est de plus en plus proche, mais une dernière côte raide nous y sépare. Jérém file tout droit, finger in the nose.
Son cul bien rebondi est une machine de guerre et un bonheur pour le regard. Et quand je pense qu’il a été à moi, pas plus tard qu’il y a quelques heures, j’en banderais presque sur le champ, si seulement je n’étais pas à ce point à bout de souffle. Vraiment, c’était trop bon de lui faire l’amour. J’espère vraiment que ce n’est pas à cause de ça qu’il n’est pas bien dans ses baskets aujourd’hui. Et pourtant, à quoi d’autre pourrait être dû son changement radical d’attitude ?
A la moitié de l’ascension, la fatigue me gagne. Je n’en peux plus, j’ai besoin d’une pause, je me pose sur une roche. Je regarde mon bobrun tracer tout droit, comme un TGV. C’est à la fois fascinant et décourageant.
Au bout d’une minute à peine, je me fais violence pour reprendre la marche et ne pas me faire trop distancer par Jérém. Même si, désormais, c’est certain, il arrivera au pied de la cascade avant moi.
Je monte en zigzaguant pour apprivoiser la pente, mais c’est dur quand même. Je glisse, je dérape. Plusieurs dizaines de mètres plus haut, mon bobrun s’est posé aussi. Il fume une cigarette. Mais où trouve-t-il tout ce souffle ?
Après un gros effort physique, en arrivant près de lui, je dérape une nouvelle fois. Le bogoss se lève, jette sa cigarette et je sens sa main attraper la mienne. Le contact avec sa peau, avec sa prise puissante me fait du bien, me rassure, me touche, m’émeut, me charge de l’énergie nécessaire pour accomplir la dernière ligne droite sur la côte raide.
« Merci ».
Jérém reprend de l’avance, je trime pour franchir les derniers mètres, alors que le bruit de la cascade devient un peu plus tonitruant à chaque pas. J’ai à la fois chaud, à cause de l’effort prolongé, et froid, à cause du contact de ma transpiration avec l’air glacé et humide qui passe les vêtements.
Jérém est arrivé à la cascade, il se tient juste devant, les jambes légèrement écartées, les mains sur les hanches, une attitude qui semble traduire une belle satisfaction pour son exploit. Mais le bogoss a froid aussi, et très vite il remet son pull à capuche.
Un dernier effort, le plus dur, et j’y arrive enfin, j’arrive moi aussi au pied de la cascade, je rejoins mon Jérém. Et je reçois de plein fouet l’air humide sur ma peau, ainsi que le bruit assourdissant de l’eau jaillissant de la roche, percutant violemment les rochers après une chute de cent mètres, pour alimenter une rivière et tant de vie sur son parcours.
Je regarde mon Jérém, il me regarde à son tour, je lui souris. Lui aussi me sourit. Et son beau sourire semble enfin libéré. La fierté pour son exploit doit y être pour quelque chose, mais ce sourire me permet de recommencer à espérer.
« J’ai toujours eu envie de venir ici » il m’explique, en criant, pour se faire entendre par-dessus le bruit assourdissant.
« C’est magnifique » je commente.
« Je suis content d’y être venu avec toi » il ajoute, en me regardant droit dans les yeux. Son regard est à nouveau doux et adorable.
Nous nous faisons face. Je sais que nous sommes seuls, car il n’y a personne dans les parages à moins de longues minutes de marche au ralenti dans un environnement difficile. De plus, nous sommes protégés par les roches, par le bruit sonore de la cascade.
Alors je m’enhardis. J’attrape le deux cordelettes de son pull à capuche, je l’attire contre moi. Jérém oppose une certaine résistance, le temps de balayer à son tour l’horizon du regard.
« Il n’y a personne, t’inquiète. Ce ne sont pas les Dahus qui vont nous regarder de travers » je le taquine.
Réplique qui me donne droit à un nouveau magnifique sourire de bobrun.
Jérém avance vers moi, et m’embrasse. Nos lèvres et nos langues se mélangent, ses mains enserrent les miennes.
Eh bien voilà, voilà où elle se cachait notre complicité non pas perdue mais simplement égarée. Elle nous avait devancés au pied de la grande cascade du cirque de Gavarnie et elle nous attendait. J’ai froid, je frissonne, mais je suis heureux.
Un instant plus tard, le bogoss passe derrière moi, me prend dans ses bras et il me serre très fort contre lui. Tout en posant quelques bisous très doux dans mon cou.
La chaleur de ses bras et de son torse me fait du bien. Au corps, tout comme à mon esprit.
Nous restons un petit moment là-haut, enlacés, à contempler la puissance de l’eau et de la montagne. Avant d’entamer la descente, nous échangeons un dernier bisou.
Dans ce paysage lunaire à forte pente, la descente est tout aussi fatiguant que la montée. Car elle mobilise des muscles déjà bien fatigués, les fait travailler à « contre-sens » et elle oblige à négocier le moindre déplacement pour ne pas glisser et se ramasser plusieurs dizaines de mètres plus bas.
Jérém est plus rapide, mais il finit par m’attendre au pied de la côte. Nous avançons d’un pas soutenu, l’appétit motivant notre marche que je crois calée, pour lui comme pour moi, sur le chemin le plus court pour arriver au village et à la nourriture.
Mais lorsque nous arrivons à hauteur de la butte en plein cœur du Cirque, sans prévenir, Jérém grimpe dessus. Sans hésiter, je marche dans ses pas.
Le bogoss s’assoit par terre, il allume une cigarette. Il a à nouveau l’air soucieux, ailleurs. Je m’assois à côté de lui. Je décide de mettre mes peurs de côté et d’en avoir le cœur net.
« Qu’est-ce qui ne va pas, aujourd’hui, Jérém ? ».
« Tout va bien ».
« Non, je vois bien que quelque chose te tracasse ».
Un silence entrecoupé par des taffes est sa seule réponse.
« Tu regrettes ce qui s’est passé hier à la soirée ? » je tente de le cuisiner.
« Non, pas du tout. Au contraire, ça m’a fait du bien ».
C’est déjà ça. Mais ça ne répond pas à mes questionnements. Alors, je décide d’y aller franco :
« Et ce qui s’est passé cette nuit ? ».
Le bogoss demeure silencieux, le regard perdu au loin.
« Je veux pas t’embêter avec ça, mais tu n’as rien dit après, alors je ne sais pas ».
« J’avais envie de savoir comment c’est ».
« T’as aimé ? »
« J’avais envie de te faire plaisir ».
« C’est pour ça que tu l’as fait ? ».
« Je savais que t’en avais envie ».
« T’as eu mal ? ».
« Un peu, au début ».
« Je m’y suis mal pris ? ».
« C’était une première fois… »
« Et après, t’as aimé ? ».
« Oui… enfin… je ne ferais pas ça tous les jours. Je préfère comme on fait d’habitude ».
Un instant plus tard, il écrase sa cigarette dans l’herbe et range le mégot dans sa poche. Puis, après avoir pris une profonde inspiration, il me lance à brûle-pourpoint :
« J’ai un truc à te dire, Nico ».
Cette simple phrase a le pouvoir d’éveiller en moi une peur bleue. Instantanément, un frisson géant me glace le dos.
« Si ce matin je suis allé chez Martine » il continue « c’était pas juste pour acheter le petit déj ».
Le cœur dans la gorge, incapable d’émettre le moindre mot, je le laisse parler.
« J’y suis allé aussi pour écouter mes messages ».
Soudain, tout devient clair dans ma tête. Mon cœur s’emballe, je sens un flot de larmes se presser au seuil de mes yeux.
« Et il y avait un message de Paris… » je le devance, sans possibilité de me tromper, hélas.
« Oui… ».
Un coup de massue sur la tête. Voilà ce que je ressens à cet instant précis. Bien sûr, à une ou deux reprises, je m’étais posé la question de savoir si son changement d’attitude n’était pas plutôt lié à ce coup de fil, ou du moins à son imminence. Certes, il ne l’a jamais évoqué. Et pourtant, dans mon for intérieur je me dis qu’il doit y penser quand même. Mais pas un seul instant j’aurais imaginé que ce coup de fil était déjà tombé et que tout allait se précipiter si vite.
Je me sens soudainement perdu, abandonné. J’ai l’impression qu’un abysse de solitude et de tristesse s’ouvre devant moi, m’aspire inexorablement.
« Tu dois partir quand ? » j’arrive quand même à le questionner, après un moment de silence nécessaire pour revenir à moi, comme après un choc.
Et là, deuxième coup de massue, à la puissance décuplée :
« Je dois être au club jeudi matin. Alors, je dois partir demain ».
« Si vite ? ».
« Oui… ».
« C’est pour ça que tu faisais la tête ».
« Ca me pesait de devoir te l’apprendre ».
« Pourquoi tu ne me l’as pas dit avant ? ».
« Je ne savais pas comment te le dire ».
« J’avais le droit de savoir » je lance, tout en éclatant en sanglot.
« Tu vois, je ne voulais pas ça » fait-il, visiblement ému lui aussi, en se glissant derrière moi et en me prenant dans ses bras.
J’attrape ses mains et je les serre contre mon cœur. J’essaie de maîtriser mes sanglots, mais je n’y arrive pas. Car c’est la fin de ce bonheur à la montagne. Je suis content pour lui, mais triste de devoir le quitter.
« Combien de temps il faudra avant qu’on se retrouve ? ».
« On se retrouvera bientôt, dès que je serai installé ».
J’ai envie de lui parler de Paris, de ses nanas, de ses mecs, de ses tentations, de mes peurs. J’ai à la fois envie de lui poser tant de questions et peur de le faire.
Mais ses bisous dans le cou et la caresse de sa barbe sur ma peau ont le pouvoir de m’apaiser peu à peu. Je sens sa présence, je sens son amour, c’est si fort, que je me dis que c’est si spécial ce qu’il y a entre nous que ça résistera à la distance.
Et pourtant, j'éclate une nouvelle fois en sanglots. C’est nerveux, incontrôlable. Jérém me serre très fort dans ses bras, il fait tout ce qu’il peut pour me rassurer.
« Ne pleure pas, ourson, ça me rend triste aussi. Tu sais, je ne pars pas à la guerre ».
« Ne m’oublie pas, Jérém… » je lui lance en pleurant. Une poignée de mots qui résument parfaitement toutes mes peurs et ma tristesse.
« Je ne pourrais pas ».
Le ciel se couvre à nouveau, la couleur grise revient en force avec son côté à la fois mélancolique et romantique.
« Pourquoi tu ne m’as pas redemandé la chemise que tu m’as donné un jour, après une révision ? » j’ai soudainement envie de lui demander.
« Pour te laisser un souvenir de moi ».
Nous restons assis, enlacés, sur la butte au cœur du cirque en pierre, le vent frais sur la peau, pendant un bon moment. Ses bras chauds et son torse chaud m’enveloppent, comme le cirque nous enveloppe. Il n’y a que dans ses bras que je trouve un apaisement à ma tristesse.
Quelques gouttes commencent à tomber, et nous obligent à repartir. Sans cela, je crois que nous aurions pu rester là, sur la butte, enlacés, à tout jamais.
Avant de reprendre la descente, nous nous faisons un dernier câlin front contre front, nez contre nez, les mains enserrées autour du visage l’un de l’autre, nous nous échangeons des bisous pleins de fougue, comme rageurs, parce que volés au temps qui bientôt nous empêchera d’en échanger d’autres.
En descendant, nous marchons côte à côte, en échangeant des regards complices, des petits sourires émus. Et dans son regard, je lis son amour.
Au village, nous prenons des sandwichs pour calmer notre faim.
« Pour le Pont d’Espagne, c’est raté aujourd’hui » fait mon bobrun en regardant la pluie tomber.
« C’est dommage ».
« On ira une autre fois » il annonce.
« Promis ? ».
« Promis ! ».
De retour au chalet, nous faisons l’amour, un amour doux, tendre, câlin. Nous savourons à fond ces derniers instants ensemble avant la fin de ce week-end magique, avant le saut vers l’inconnu qui nous attend dans quelques heures à peine.
Après l’amour, Jérém me regarde et me sourit. Son sourire est beau, adorable.
« Pourquoi tu souris ? ».
Pour toute réponse, il me fait un bisou.
« A quoi tu penses ? ».
« Tu es beau, Nico, et tu es vraiment un super mec ».
« Pourquoi tu dis ça ? ».
« Parce que tu as fini par m’apprivoiser ».
C’est beau ce qu’il vient de dire, et ça me touche.
« Ca n’a pas été une mince affaire ».
« Il y a un truc qui m’a touché chez toi depuis toujours » il enchaîne, alors que mes doigts se glissent presque tout seuls dans sa toison de mâle.
« C’est quoi ? ».
« Ce sont tes yeux ».
« Mes yeux ? ».
« Tu as de grands yeux dans lesquels on lit tout ce que tu ressens. Tu as un regard rêveur, comme celui d’un enfant qui découvre le monde. C’est un regard un peu naïf, mais curieux, et qui se laisse émerveiller ».
« Un peu trop naïf, peut-être… ».
« Non, pas du tout. Tu es un gars timide et très sensible, tu es un gars à fleur de peau. Tu manques d’assurance, et ça te rend vraiment touchant ».
« Merci ».
Et alors que je n’ai pas encore totalement accusé le coup du bonheur apporté par ses mots, le bogoss enchaîne déjà :
« Et pourtant, tu m’impressionnes ».
« Moi… je t’impressionne ? T’as vu ça où, toi ? ».
« Si, je te promets. J’aime ton côté fonceur et ta façon de ne pas te laisser décourager par les difficultés. J’aimais bien quand tu essayais de me tenir tête ».
« Quand j’essayais de t’embrasser ? ».
« Oui, par exemple ».
« Et pourtant tu me jetais comme une merde ».
« Je sais, et pourtant j’aimais ».
« Si j’avais su… » je fais, sans pouvoir arrêter de caresser cette douce toison mâle sur ses pecs.
« Tu as l’air de quelqu’un de doux, de fragile » il continue « et pourtant, tu as du caractère, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. J’aime ton coté assumé ».
« Je ne m’assume pas tant que ça, il n’y a pas grand monde à qui j’ai dit que je suis homo ».
« Mais tu sais depuis longtemps que tu aimes les mecs et tu n’as jamais essayé de lutter pour être quelqu’un d’autre que toi-même. Franchement, je trouvais que tu étais courageux de supporter les moqueries au lycée ».
« J’en ai pas mal bavé ».
« Je sais. Mais j’ai toujours eu l’impression que même si tu en souffrais, tu acceptais qui tu étais ».
« Quand on a commencé à me traiter de pd, je ne savais même pas ce que c’était. Je crois que je me suis vraiment accepté le jour où je suis tombé amoureux. C’est là que je me suis dit : pourquoi je m’interdirais de vivre ça ? C’est tellement bon d’être amoureux. Ce jour-là, c’était le premier jour du lycée, dès que je t’ai vu ».
Pour toute réponse, le bogoss recommence à poser des bisous tout doux sur ma peau.
« On a tous besoin de quelqu’un à aimer, peut-être plus encore que de quelqu’un qui nous aime » je réalise soudainement à haute voix.
L’amour de l’autre nous dévoile à nous même. Le bonheur nous inspire.
« Parfois » continue le bobrun « quand tu passais au tableau ou que tu étais interrogé par un prof, quand je te voyais lutter contre ta timidité et contre les moqueries, j’avais envie de te prendre dans mes bras, de te rassurer, de te protéger ».
« Pourquoi tu ne l’as pas fait ? ».
« Pendant les cours ? » il se marre.
« Non, je veux dire, pourquoi tu n’es pas fait comprendre avant ce que tu ressentais vis-à-vis de moi ? ».
« Je ne voulais pas être gay ».
« Et moi, je ne fais pas trop gay ? » j’enchaîne, après un petit silence.
« Mais pas du tout. T’es un beau petit mec, très différent de l’idée que je me faisais des gays. Avant de te rencontrer, je pensais que tous les gays étaient très efféminés ».
« Il y en a qui le sont, et ils ont le droit d’exister eux aussi… ».
« Oui, c’est sûr, mais moi je ne kiffe pas. Toi tu es doux, timide, réservé, mais tu es quand même masculin. Et ça, j’ai vraiment kiffé. Pendant tout le lycée, j’avais envie de t’approcher. Toi, et personne d’autre ».
« Et pourtant, t’as couché avec d’autres mecs avant moi ».
« Ce sont des occasions qui se sont présentées sans que j’aille vraiment les chercher. Mais c’était toi que je kiffais. Depuis le premier jour du lycée ».
« Qu’est-ce qui t’a touché ce jour-là ? ».
« Ton regard. Tu m’as regardé comme si j’étais un dieu. Personne ne m’avait encore regardé de cette façon, même pas les nanas. Ton regard me manquait quand tu n’étais pas en cours. En fait, tu me manquais tout court » il enchaîne après un moment de silence.
« Toi aussi tu me manquais quand tu n’étais pas en cours » je me précipite de lui répondre, tout en le serrant très fort dans mes bras.
« Tu crois au destin ? » il me demande.
« Je crois, oui… ».
« Quand on s’est croisés dans la cour du lycée le premier jour, j’ai ressenti un truc bizarre, comme si on se connaissait depuis longtemps, depuis toujours, depuis une autre vie, comme si on avait été séparés et qu’un se retrouvait à nouveau, et qu’on se reconnaissait sur le champ ».
Je me suis souvent demandé ce que Jérém me trouvait, pourquoi il m’avait choisi, moi, pour ses révisions. Et je me suis aussi demandé ce qu’un gars comme Jérém pouvait bien ressentir vis-à-vis de ma façon d’être, de ma personnalité.
Désormais, je suis fixé. Et ça fait chaud au cœur. Je n’aurais jamais pensé qu’il me kiffait à ce point, qu’il me trouvait tant de qualités, qu’il appréciait tant de choses en moi, et qu’il avait tant de considération à mon égard. D’ailleurs, je n’imaginais même pas qu’on puisse me kiffer de cette façon, me trouver tant de qualités, et qu’on puisse avoir tant de considération à mon égard. Et surtout pas que je puisse toucher, impressionner un mec comme Jérém, un mec qui avait l’air de tout sauf de quelqu’un de facilement impressionnable.
Je n’aurais jamais pensé qu’il serait sensible à ma sensibilité, à ma timidité, à ma gaucherie, et qu’il me cernerait aussi bien. Et qu’il saurait l’exprimer, qu’il aurait le cran de le faire de façon si précise. Ce mec auparavant si fier et sûr de lui, si mystérieux, accepte désormais de s’ouvrir à moi. Jérém est un gars sensible et intelligent.
Je m’étais déjà senti apprécié dans le regard de Stéphane et, dans des proportions différentes, dans celui de Martin, celui de Julien et dans celui de Thibault. Mais cette fois-ci, la sensation est puissance mille car je me sens apprécié dans le regard bienveillant du gars que j’aime. Son regard me fait un bien fou. Et il m’émeut aux larmes.
Le regard de l’autre, lorsqu’il est bienveillant, et à fortiori lorsqu’il est amoureux, nous fait nous découvrir à nous-mêmes.
J’ai été ébloui par le Jérém « petit con hypersexy ». J’ai été attiré par son corps de dieu grec, par sa belle petite gueule à faire jouir d’urgence. J’ai été fasciné et comblé par sa sexualité débordante de jeune mâle. J’ai été intrigué par un bobrun ténébreux et mystérieux qui cachait des fêlures. J’ai été amoureux d’un gars dont le cœur m’était inaccessible. Et je suis désormais fou amoureux d’un petit mec touchant, un mec au grand cœur, un mec vraiment bien. Et je crois, j’en suis certain même, que je n’ai jamais été aussi amoureux de lui.
Après m’avoir ému avec ses mots, mon bobrun s’est une nouvelle fois donné à moi. Et, en dépit de ses mots sur la butte à Gavarnie, je sais qu’il a pris du plaisir. Quant à moi, j’étais moins stressé, car je possédais désormais quelques repères. Et ça a été juste délirant.
Puis, ça a été à mon tour de me donner à lui une nouvelle fois. J’en avais envie, et mon bobrun a pris son temps. Nous avons chacun joui deux fois, une première en se donnant à l’autre, une deuxième en faisant l’amour à l’autre.
Et c’était divinement bon à chaque fois. Pendant l’amour, il n’y avait plus d’actif, plus de passif, juste deux corps qui se donnaient du plaisir, un plaisir qui passerait presque au second plan par rapport à cette communion des esprits et de l’amour qui est le plus intense des bonheurs.
On aurait pu attendre le soir pour refaire l’amour, mais on en avait tous les deux très envie. Et au fond de moi, quelque chose me disait qu’il ne fallait pas attendre et qu’il fallait profiter tant qu’il en était encore temps.
Il est 14h55 lorsque nous débarquons chez Charlène pour lui annoncer le départ de Jérém et pour revoir les chevaux une dernière fois. Je le sais, car j’ai regardé mon portable en arrivant au centre équestre pour vérifier s’il y avait du réseau. Je voulais appeler maman pour lui annoncer mon retour le lendemain. Mais il n’y a pas de réseau.
La pluie tombe drue, il fait froid. Il y a de la lumière dans la cuisine, on tape à la porte. Un instant plus tard, Charlène vient nous ouvrir. Mais ce n’est pas la Charlène rigolote et souriante qu’on connaît. La Charlène qui se présente à nous a les yeux hagards, le teint blanc comme un chiffon. Elle a la tête complètement déconfite, on dirait qu’elle vient de voir un fantôme.
« Qu’est-ce qui se passe ? » la questionne Jérém.
« Vous ne savez pas ? ».
« De quoi, on ne sait pas ? ».
« De ce qui se passe… ».
« Dis-nous ce qu’il y a, tu nous fais peur, là ».
« Un avion de ligne a percuté une tour ».
« Où ça ? ».
« A New York ».
« Mais comment ça, un avion percuté une tour ? Comment c’est possible ? » fait Jérém, incrédule.
« Venez regarder la télé ».
On se souvient tous ce qu’on faisait et avec qui on était en ce 11 septembre 2001, lorsqu’on a appris que les Etats-Unis étaient attaqués. Moi j’étais à Campan, avec mon Jérém et Charlène.
Les images qui se présentent à mes yeux sont incroyables. L’une des Twin Towers est en feu, une épaisse fumée noire s’échappe de plusieurs étages et assombrit le ciel bleu.
« Ca s’est produit il y a quelques minutes » nous explique Charlène « un avion de ligne s’est encastré dans la tour. Les programmes viennent d’être interrompus, sur toutes les chaînes on ne parle que de ça ».
« Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Comment c’est possible ? » je tente de comprendre l’incompréhensible.
« Au départ ils ont parlé d’un départ de feu, puis d’un accident ».
Charlène vient tout juste de terminer sa phrase, lorsque nous entendons l’animateur prononcer les mots « détournement d’avion », « attentat terroriste », « kamikaze islamiste ».
« Non, pas ça… » fait Charlène, horrifiée.
L’inconcevable prend forme dans nos oreilles et dans nos têtes. Et l’incrédulité cède soudainement la place à la sidération, à un profond sentiment de malaise, d’écœurement, à une souffrance qui est un mélange d’horreur, d’injustice, d’impuissance.
Cette catastrophe se passe à des milliers de kilomètres de moi et pourtant je la sens si proche, je la sens dans mes tripes. Et c’est la même chose pour Charlène et pour Jérém. On est tous scotchés à la télé, sciés, abasourdis, anéantis. La main de Jérém cherche la mienne, nos doigts s’entrelacent, les yeux toujours rivés sur l’écran.
Ma raison bugge face à ce drame qui la dépasse. Elle ne peut pas supporter tant d’horreur, alors elle se livre au déni. Je me dis que ce n’est pas possible, qu’on est en train de regarder un mauvais film catastrophe. Ou qu’on est les victimes d’un canular médiatique. Comme celui d’Orson Welles il y a 60 ans.
Et alors que je tente de me persuader que d’ici peu l’animateur du flash info va vendre la mèche et que le cauchemar va prendre fin, un deuxième avion surgi de nulle part traverse le ciel comme un éclair et va s’encastrer dans la deuxième tour, après l’avoir percutée de plein fouet, avec une violence inouïe. Une boule de feu et de fumée se dégage instantanément, comme une image de l’enfer. Chantal pousse un cri d’horreur.
« Mais il y a des gens là-dedans ! ».
Non, le cauchemar ne va pas prendre fin de sitôt, il n’en est qu’à son début.
Soudain, des couplets entendus à la radio le matin même remontent à ma conscience, résonnent dans mes oreilles et font se dresser tous les poils de mon corps :
Il se passe quelque chose à Monopolis
Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur
MERCI pour vos commentaires sur l’épisode précédent.
Merci pour ce débat qui s’est amorcé depuis quelques épisodes, un débat sur l’homosexualité, sur le regard que notre société porte sur elle, sur la notion de respect qui devrait être à mon sens le principal moteur du bien vivre ensemble et d’appréhender toutes les différences.
Merci pour vos réflexions et votre sagesse et qui m’inspirent et inspirent les mots et les actes de mes personnages.
Fabien.
 6 commentaires
6 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Jérém&Nico - Saison 1