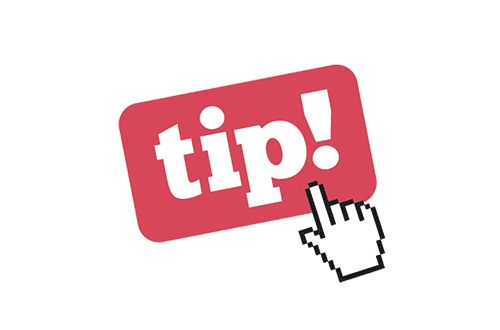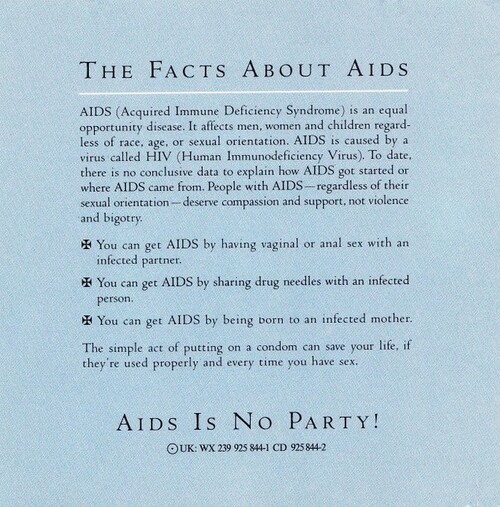-
Par fab75du31 le 8 Décembre 2023 à 22:28
Amsterdam, 1er décembre 2023. Speech de Madonna.
Aujourd’hui, c’est la journée mondiale contre le SIDA.
Vous pensez à ça ? C’est important pour tout le monde ?
Peut-être que tout ça peut paraitre très lointain, peut-être que cela ne vous parle pas, on peut même penser que chaque jour est un jour de fête.
Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il n’y a pas de cure pour le SIDA. Les gens continuent de mourir du SIDA, vous savez ?
Quand j’ai débarqué à New York, j’ai eu la chance de rencontrer et devenir amie avec de nombreux magnifiques artistes, musiciens, peintres, chanteurs, danseurs, écrivains.
Et puis, un jour, ces gens ont commencé à devenir malades, et personne ne comprenait ce qui se passait. Les gens commençaient par perdre du poids, et puis ils tombaient comme des mouches. Ils allaient à l’hôpital, et là non plus personne ne comprenait ce qui était en train de se passer.
Les infos appelaient ça le « cancer gay », parce que ça sévissait principalement dans la communauté gay. Et ça, c’était une honte terrible. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez ça, maintenant, mais dans les premières années ’80 ce n’était pas cool d’être gay, ce n’était pas accepté d’être gay. Vous comprenez ça ou vous considérez juste vos droits pour acquis ?
Aujourd’hui, on peut se tenir debout et dire « je suis gay ».
Mais à l’époque, s’assumer était une action très brave et très courageuse.
Je ne sais pas si vous imaginez vraiment ce qu’a été, à cette époque où être gay était considéré comme un péché, comme quelque chose de dégoûtant, de voir soudainement une vaste portion de la communauté gay commencer à tomber comme des mouches.
Les gens mouraient partout. Et quand je dis qu’ils mouraient partout, je ne suis pas en train d’exagérer. Chaque jour je me réveillais et j’apprenais qu’un nouvel ami était touché. J’allais leur rendre visite, je m’assoyais sur le côté du lit pour les regarder mourir.
Et pendant ce temps, dans la communauté médicale personne ne voulait faire quoi que ce soit. Parce qu’ils disaient que ces gens méritaient de mourir. Oui, c’est ce qu’ils disaient.
C’étaient des temps affreux. J’ai personnellement perdu beaucoup d’amis bien aimés. J’aurais donné mes bras si j’avais pu trouver une cure pour leur permettre de vivre.
J’ai vu tellement de gens mourir, homme et femmes, enfants, hétéros, gays, etc. Parce qu’à cette époque le sang des transfusions n’était pas testé.
Les enfants aussi étaient ostracisés s’ils avaient le HIV. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c’étaient des temps dévastateurs. Pour moi, c’est comme si une entière génération avait été anéantie.
Et j’ai vu mon meilleur ami Martin en train de mourir. J’ai serré sa main, il souffrait énormément, il pouvait tout juste respirer, il voulait me chanter Maria Callas, Casta Diva. Et je lui ai dit, s’il te plait, Martin, laisse tomber. Et je regardais son esprit quitter son corps. Je ne sais pas si vous le savez, mais pendant « Live to tell », il est le premier visage qui apparait.
Et il y en a beaucoup d’autres après.
Mais je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez désolés pour moi. Je veux que vous sachiez à quel point vous êtes chanceux maintenant, à quel point vous êtes chanceux d’être vivants. Maintenant vous pouvez prendre un médicament et être protégés, c’est fou.
Et je me retiens chanceuse d’avoir moi-même survécu à cette triste époque.
Quand j’ai été à l’hôpital Saint Vincent à New York pour visiter des patients qui étaient mourants, leurs familles ne voulaient plus rien avoir affaire avec eux. C’était dans les années ’80.
Il y avait toute une salle dans laquelle il n’y avait que deux infirmières qui acceptaient de rentrer et de soigner ces malades. Car tout le monde disait « si tu touches une personne avec le SIDA, tu vas l’attraper ».
Et j’ai avance dans cette salle et j’ai vu tous ces hommes haletant leur dernier souffle, et tout ce qu’ils voulaient, c’était un câlin. Et j’ai marché entre les lits de beaucoup d’entre eux, et je leur ai fait des câlins. Et ils étaient dans un état de démence et ils pensaient que j’étais leur mère et ils disaient « Maman, merci d’être enfin venue ».
Je ne sais pas si cette scène, cette salle de spectacle est le bon endroit pour raconter ça, mais vous n’avez pas idée de ce que c’était pour tous ces personnes d’être laissés sur le côté, comme s’ils n’avaient pas d’importance, comme si leurs vies n’avaient pas d’importance.
Vous n’avez pas idée d’à quel point vous êtes chanceux maintenant, à quel point nous sommes chanceux.
Mais les gens peuvent être si cruels, vous savez ?
Et quand je suis revenue à la maison ce jour-là, après avoir visité cet hôpital, la presse était postée devant l’immeuble de mon appartement à Central Park West, et on m’a demandé : « Madonna, Madonna, c’est vrai que vous avez le SIDA ? ».
Je leur ai répondu : « Non, je me soucie juste des gens qui ont le SIDA ».
Il y a quelques années, j’ai écrit des livres pour enfants. Un jour, une femme s’est approchée de moi, elle est venue me parler et m’a dit : « Vous écrivez des livres pour enfants, vous avez des enfants, vous prenez soin des enfants, est ce que vous savez qu’il y a un pays en Afrique où plus d’un million d’enfants sont nés avec le SIDA ? ».
Et je lui ai dit : « De quoi parlez-vous ? ».
Et elle m’a parlé de ce pays appelé Malawi.
Et j’y suis allée, et c’était comme une histoire qui se répète. Je suis allée dans les hôpitaux, j’ai vu les corps empilés les uns sur les autres.
J’ai vu les gens mourir partout. Il n’y avait pas de médicament, aucun traitement, rien, pas d’antirétroviraux disponibles.
Des décennies plus tard, c’était comme voir l’histoire se répéter. Et c’est de cette façon que j’ai rencontré mon fils David, dont la mère était morte du SIDA, et tous mes enfants que j’ai adoptés au Malawi. Mes beaux enfants.
Une fois de plus, je ne vous raconte pas ça pour avoir votre compassion, je n’essaie pas de me faire mousser. Je veux juste parler de l’étroitesse d’esprit de certains gens. Et cela me rend malade, et cela devrait tous vous rendre malades aussi.
Où je veux donc en venir ?
Je veux juste honorer tous ceux que nous avons perdus à cause du SIDA, ceux qui vivent avec le SIDA, et ils sont nombreux.
Merci à la recherche médicale et aux gens qui ont consacré du temps à la sensibilisation.
Mais vous savez, à notre époque où nous avons accès à tant d’informations, l’ignorance n’a pas d’excuses. Si on peut mettre un terme à quoi que ce soit, que nous puissions s’il vous plaît mettre un STOP à l’ignorance !
Est-ce que je vous ai endormis ? Pensez-vous que j'allais terminer le spectacle de ce soir et ne pas parler de ça ?
La seule chose qui peut tous nous sauver, c’est la lumière qui nous fait briller, la lumière qui est dans chacun de nous. Nous devons la partager avec tout le monde. Alors, s’il vous plait, allumez vos lumières, s’il vous plait, allumez vos lumières, ne me faites pas supplier !
Son émotion lors de son discours était palpable par toutes et tous. Sa voix chevrotante lorsqu’elle évoque tous ces amis touchés par la maladie et décédés m’a ému. Ses mots semblaient venir directement de ses tripes. J’étais assez près d’elle, à quelques mètres à peine, pour voir qu’elle était tellement habitée par ses propos qu'elle en tremblait comme une feuille. J’ai même cru que la petite bouteille qu’elle tenait entre sa paume et son pouce allait se fracasser au sol. Je la voyais si menue, si fragile, elle était si émouvante à cet instant.
J’ai envie de la croire sincère. En fait, je trouve que plus elle vieillit, plus elle devient humaine et touchante. Et sincère.
Elle demande qu’on allume les torches de nos portables.
« Ne me faites pas vous prier ! » elle nous encourage
A cet instant, la salle est illuminée par des milliers de lumières de portables. C’est beau et terriblement émouvant.
Et là, elle chante « I will survive » juste avec un accompagnement de guitare, elle chante avec le public :
https://www.youtube.com/watch?v=AMimoWTyJfM 3 commentaires
3 commentaires
-
Par fab75du31 le 5 Novembre 2023 à 20:04
Mercredi 16 septembre 2015.
En ce milieu du mois de septembre 2015, pour fêter mes 33 ans, j’ai cassé ma tirelire et je me suis offert une petite folie. Un rendez-vous au Madison Square Garden à New York avec Madonna et 20.000 autres Rebel Hearts.
— Tu chanteras et tu danseras pour deux, mon Nico, m'a lancé Elodie, ma cousine adorée, qui n’a pas pu m’accompagner, préférant rester avec sa petite famille.
— Tu lui passeras le bonjour de ma part, m’a glissé Stéphane, mon pote adoré, qui n’a pas pu m’accompagner, préférant rester auprès de son chéri.
Pour mon séjour en solo aux USA, l'idée de loger chez l'habitant me paraît d’emblée agréable. Sur Internet, je survole les annonces et je finis par tomber sur une offre qui retient mon attention. Situé entre Lower Manhattan et East Village, un loft bordé par une immense baie vitrée avec vue imprenable sur le skyline de la Grande Pomme.
Je clique sur l'annonce. Entre la photo principale, avec vue sur le séjour, et la description du logement, un petit rond avec un selfie des proprios. On y trouve une petite brune, Betty. Mais, surtout, surtout, surtout, un très charmant Justin. Un p’tit con à casquette avec des airs de p’tit branleur sexy en diable.
Je clique sur la photo, ça l’agrandit un peu. Le mec a vraiment l'air grave bandant dans son t-shirt blanc avec une échancrure plutôt affolante.
Ce n'est pas le logement le plus abordable. Mais, entre la vue imprenable sur New York et la bonne petite gueule de Justin, mon choix est vite fait. J’ai envie de le voir de près, ce p’tit branleur.
Après un voyage d’une quinzaine d’heures, Blagnac et Paris me semblent très loin derrière moi, appartenant presque à un autre monde, à une autre vie. Un autre monde et une autre vie qui s’effacent complètement de ma mémoire lorsque le profil vertical et minéral de New York se dessine au-delà de l'immensité d'eau et de ciel, première vision de terre et de civilisation depuis de longues heures. La première fois qu'on arrive à New York par les airs, avec un beau soleil, c’est le genre de spectacle qui marque l’esprit.
Les gratte-ciels semblent m’ouvrir les bras, comité d'accueil silencieux et majestueux devant lequel je me sens tout petit. Car cette ville dégage une impression de grandeur, de toute puissance. A vrai dire, c’est plutôt une illusion, qui frappe le regard mais qui ne trompe plus l’esprit. Car l’illusion s’est évaporée un matin d’il y a 14 ans, jour pour jour, lorsque deux avions, en modifiant leurs trajectoires sous la contrainte terroriste, ont modifié à tout jamais celle de cette ville et du monde entier.
Je me souviens du regard sonné de Charlène lorsqu’elle nous avait annoncé ce qui était en train de se passer, alors que Jérém et moi étions venus lui annoncer qu’il partait jouer à Paris. Je me souviens de notre excursion à Gavarnie juste avant, des longues minutes passées dans ses bras sur la butte devant la grande cascade. Je me souviens de ces jours où j’avais été fabuleusement heureux, alors que le monde était en train de basculer.
L’aéroport JFK se profile à l'horizon, matérialisé par des centaines d'avions garés en grappes autour des nombreux terminaux.
A New York, comme à Toulouse et à Paris, il fait encore chaud en ce mois de septembre. Alors, Blagnac, Orly, Charles de Gaulle ou JFK, c’est le même combat. Les halls d’aéroport sont des concentrés massifs de mâles. Des bruns, des blonds, des châtains, des poilus, des imberbes, de toutes les races, de tous les âges, de toutes les provenances, de toutes les catégories – les petits cons insolents, les mâles affirmés et virils, les jeunes papas sexy, les baroudeurs, les métrosexuels, les « plutôt nature ». Des mecs beaux, sexy, impertinents, ou simplement touchants, attirant tour à tour mon attention au travers de quelques éléments visuels – une belle petite gueule, un corps bien bâti, ou bien un physique plus ordinaire mais à l’intense sensualité, un brushing insolent, un t-shirt bien porté, un débardeur aux bretelles divinement tendues sur des épaules dénudées – ou d’éléments olfactif – une note de parfum qui traîne sur le passage d’un beau garçon et qui vrille instantanément mes neurones. Des mecs dont les attitudes masculines – une façon de se tenir, de marcher, de mâcher un chewing-gum, un regard charmeur, un autre viril – sont souvent inconscientes. Et justement pour cela, terriblement émoustillantes. Un nombre incalculable de beaux mecs défile sous mon regard émerveillé, et très vite saturé. Au bout de quelques secondes, je ne sais plus où donner du regard, et du désir.
Tous ces mecs sont autant de coups de poing reçus dans mon ventre, autant de frustrations à digérer. Car tous ces destins de bogoss me sont inaccessibles. Leurs vies resteront à jamais mystérieuses et secrètes, et les dizaines de questions qui assaillent mon esprit à leur sujet resteront sans réponse. C’est cette frustration, aussi douloureuse soit-elle, qui rend justement ces petits instants si furieusement magiques.
Un ami m’a dit un jour que New York s’apprivoise en émergeant du métro. En provenance de JFK, je suis son conseil avisé. Je sors du « subway avec la chanson « Ray of light à fond dans mes écouteurs.
Et comme dans le clip de la chanson, une multitude de New-Yorkais semble défiler autour de moi et s’agiter dans un flux ininterrompu et frénétique qui me donne le vertige. Les gens, comme le liquide vital circulant dans les veines souterraines d’une ville monstre. C’est la vie à 1000 à l'heure, celle qu’on s’imagine régner dans cette ville qui ne dort jamais.
Je reste immobile à côté de la sortie de métro pendant un petit moment, comme pour m’imprégner de cette folle dynamique, ou plutôt pour m’y habituer, pour redescendre du choc provoqué par toute cette énergie, cette animation, cette hétérogénéité raciale et culturelle, cette diversité par rapport à la France. Un garçon passe, et un autre, et un autre encore, tous plus beaux et sexy les uns que les autres. Mon cerveau est assailli par une telle quantité de stimuli qu’il n’a presque plus de ressources pour détecter et apprécier le Masculin, pourtant son intérêt majeur.
Les chansons de l’album « Confessions on a dancefloor s’enchaînent dans mes écouteurs pendant que je me promène dans la ville.
A Central Park, je marche en cadence sur le rythme entrainant de « Hung Up ».
A Times Square, j’enchaîne avec « Sorry ».
Au Madison Square Garden, je me laisse emporter par « Let It Will Be ».
A l’Empire State Building, « Forbidden Love » enchante mes pas.
L’énergie de New York est comme une ivresse qui me cueille dès le premier verre, ça monte à la tête très vite. Plus je la découvre, plus j’ai envie de m'imprégner de cette ville, de sa modernité, de son hétérogénéité, de ses contradictions.
Mais pour l’heure, le décalage horaire ne me rate pas. En milieu d’après-midi, qui serait déjà très tard le soir en France , je ressens un énorme coup de fatigue. J’ai besoin de manger un bout et de me poser. Le rendez-vous au Madison approche, j’ai besoin d’être en forme.
Je cherche l’immeuble, l’étage, l’appart. Je sonne, la porte s’ouvre sur un magnifique espace de vie empli de lumière. L’endroit est exactement comme sur la photo, le séjour longé par une immense baie vitrée ouverte sur les gratte-ciels.
Oui, la porte s’ouvre, et je suis reçu par toi, P’tit con. Toi aussi, tu es presque comme sur la photo… mais en dix fois mieux ! Je t'avais trouvé mignon sur l’annonce. Mais là, en vrai, tu es carrément canon !
En sortant de l’ascenseur, juste avant de sonner à ta porte, j’écoutais « Beautiful Stranger » une chanson qui dit :
Haven't we met/Ne s'est-on pas déjà rencontrés
You're some kind of beautiful stranger/Tu es une sorte de bel inconnu
You could be good for me/Tu peux être bon pour moi
I have the taste for danger/J'ai le goût du danger
Et je trouve que cette chanson te sied à merveille. Tu as 22, 23 ans max. Et tu es sexy, terriblement, dangereusement sexy.
En cette belle et chaude journée, tu te balades torse nu dans l’appart, et tu es assez à l’aise avec ta demi-nudité pour aller ouvrir la porte à un inconnu dans cette tenue, pour lui laisser découvrir et apprécier un parfait exemple de physique de p’tit con. Un torse élancé mais tout en muscles, des épaules joliment bâties, des pectoraux sculptés et imberbes entre lesquels se balade une longue chaînette de mec, des abdos délicieusement saillants d’où prend naissance une fine ligne de poils bruns qui disparaît dans un short gris style molletonné. Ce dernier laissant non seulement dépasser l’élastique d’un boxer blanc de marque, non seulement apprécier la naissance d’un pli de l'aine saillant, mais également deviner une belle bosse sur le devant. Ta peau a l’air fabuleusement douce.
Et pour couronner le tout, tu as une jolie petite gueule d’ange sexy en diable, un visage aux traits parfaits sublimés par cette touche de perfection, une petite barbe d'une semaine taillée avec soin.
Tu es beau par nature et insolemment sexy par choix délibéré. Ça n’expliquerait pas autrement ce look « torse nu totalement décomplexé », ou cette putain de casquette vissée à l'envers et très haut sur la tête, couvrant juste le sommet de ton crâne et dégageant en grande partie tes cheveux châtain clair coupés presque à blanc. Ou encore, ce parfum de mec à l’essence poivrée, entêtante, qui se dégage de toi. Ou encore, détail qui finit de m’assommer, cette insolence, cette canaillerie permanentes dans ton regard.
Petit mec, tu pues le sexe à 100 mètres à la ronde. Ton regard pénétrant, ton physique insolent, ton attitude de bogoss branleur sont une pure provocation, une tentation cruelle pour ceux qui aiment les beaux garçons. Ça prend aux tripes. Le désir que tu inspires est violent, brutal, brûlant, déchirant.
Face à ton attitude de p’tit branleur effrontément sexy, un peu trop sûr de toi, de ton physique, de ton charme et, certainement, de ta queue aussi, face à cette belle insolence, cette effronterie, cette insouciance, cette inconscience, cette assurance qui est l’apanage de celui à qui la vie n’a pas encore eu l’occasion d’apprendre l’humilité, je ressens en même temps l’envie de te gifler pour tenter de calmer ton arrogance et l’envie encore plus brûlante, encore plus violente, encore plus irrépressible, de te calmer par le plaisir, de te faire jouir jusqu’à ce que tu demandes grâce.
Te faire jouir, c’est juste une nécessité impérieuse.
Oui, le « p’tit con », en tant que catégorie « Mâle junior » est capable de nous mettre devant bien de contradictions.
— Hi ! je te salue, beau New-Yorkais.
— Hi ! tu me réponds, tout en m'offrant une bonne poignée de mec et un sourire des plus canaille.
Ça ne fait qu’une poignée de secondes que je suis devant toi, et ça y est, je viens de perdre tous mes moyens. Car tu me rends dingue !
Tu me fais la visite de l'appart, tu me conduis jusqu'à ma chambre, tout en me donnant quelques consignes en anglais que je tente de capter tant bien que mal.
Ta copine n’a pas l’air d’être là, et je n’ai même pas envie de te demander où elle est, si elle va revenir bientôt. Je suis tellement bien ici, seul avec toi.
Puis, tu t’éclipses. Tu viens de disparaître de ma vue et déjà tu manques à ma vue. Envie furieuse de toi, Justin, envie de savoir comment t’es monté, mais surtout envie violente de te donner du plaisir.
Je me demande ce que ça doit faire de s’occuper d’un mec comme toi, de te donner tout ce que tu demanderais, réclamerais, exigerais, de te sentir prendre ton pied. Je me demande comment un parfait p’tit con comme toi se comporte au lit.
Un quart d’heure plus tard, je m'installe dans un fauteuil du séjour. J’ai envie de profiter du soleil qui filtre au travers des baies vitrées et qui chauffe ma peau, ainsi que de la vue sur la puissance verticale de la ville.
Mais comment me détendre, comment me vider l’esprit en profitant de la vue, alors que toi, p’tit con, tu reviens dans le séjour et promènes ton insolente jeunesse devant moi, toujours torse nu, toujours avec cette sempiternelle casquette qui te donne une allure de figurine Playmobil en version méga sexy.
Alors, comment me contenter de mater un paysage de béton et de verre alors qu’un magnifique paysage d’abdos et de pecs happe mon regard et hante mon esprit ?
Ta présence me trouble. Et pourtant, lorsque tu disparais à nouveau dans le couloir, je n’arrive pas davantage à profiter du paysage. Car la vue perd bien de son charme sans ta présence dans mon horizon.
Je me dirige vers ma chambre. En fait, je te piste. La porte de la tienne est entrouverte. Et toi, p’tit con, tu es en train de faire des pompes à côté du lit.
Je me fige à te regarder, happé par la vision de tes muscles en tension, sous l’effet du travail et de l’effort. Tu tournes la tête, nos regards se croisent. Soudain, je suis mal à l’aise, je voudrais trouver la bonne réplique pour justifier mon regard, ma présence, pour te féliciter pour ta plastique de fou sans trahir mon désir brûlant. Bien évidemment, les mots me font défaut. Pourtant, dans ma tête, c’est la fête. Alors, je me contente de te sourire, avant de me réfugier dans ma chambre.
Allongé sur le lit, dans la pénombre, ton image n’a de cesse de me hanter. Tu as l’air d’un petit mec du genre plutôt glandeur, qui se laisse vivre, qui sait profiter, dans tous les sens du mot, un mec qui ne fait pas grand-chose de sa vie. Je ne sais pas quelle définition te correspond le mieux, je crois que « p’tit branleur sexy » te va comme un gant. Et cette idée m’excite grave…
Grâce à toi, Justin, cet après-midi j'ai eu droit à quelques moments de bonheur. L’irrésistible fraîcheur de ta p’tit contitude provoque en moi un désir viscéral, déraisonnable, irrépressible. Ton physique de p’tit con, ta belle petite gueule, ton regard, ton sourire, ta simple présence, tout chez toi pétille d’une jeunesse ravageuse. Quand on te regarde, on se dit que ta jeune virilité ne doit avoir ni plus ni moins que le goût du bonheur.
Et de surcroît, un p’tit con comme toi n’est jamais à court de surprises. La première m’attend lorsque je me rends aux toilettes. Lorsque je pose la main sur la poignée de la porte, celle-ci s’ouvre toute seule, et je me retrouve face à toi. Pendant une fraction de seconde, je croise ton regard, ce regard jamais dépourvu d’une petite étincelle canaille. Tu es un sacré charmeur, petit Justin !
Je suis à moins d’un mètre de ton torse et ton parfum remonte par mes narines et met direct mes neurones en PLS.
Tu avances, tu passes devant moi tout en te tripotant je ne sais quel élément de ton service trois pièces au travers du tissu molletonné. C’est toujours fascinant de réaliser à quel point certains mecs ne semblent pas se rendre compte à quel point le fait de se tripoter le paquet de la sorte peut donner des sueurs autour d’eux.
Mais côté « surprises », le meilleur reste à venir. Ça se passe en fin d’après-midi, lorsque je me dirige à nouveau vers ma chambre. Je pose la main sur la poignée, et voilà que la porte s’ouvre toute seule. Pas celle de ma chambre, mais celle juste à côté, celle de la salle de bain.
Toi, bel étalon, tu apparais dans un nuage de vapeur sentant le gel douche et le deo de bogoss. Tu apparais évidemment torse nu, la peau et les cheveux encore humides, juste couvert d’une serviette nouée autour de la taille. Lorsque tu captes mon regard sur toi, tu me lances un petit sourire plein de malice qui ferait fondre un glacier. J’ai l’impression que tu as compris que je te kiffe un max et que tu me nargues, que tu me provoques, que tu t’amuses avec moi. Tu veux ma peau ! Je sens que ma santé mentale vacille.
Tu continues ton chemin, je te regarde traverser le couloir et disparaître dans ta chambre. Mon cœur alterne emballements à répétition et ratés soudains.
Avant de me rendre dans ma chambre, je ne peux résister à la tentation d’un détour par cette salle de bain que je soupçonne de receler un univers de bonheur absolu après qu’un p’tit con comme toi ait pris sa douche.
La pièce est en effet saturée de vapeurs et d'un intense parfum de propre et de mec sexy. Ici, tout me parle de toi, qui étais à poil, juste là, un instant plus tôt.
Je me prends à imaginer tes gestes quotidiens et intimes dans sa salle de bain. Tu te dessapes, tu poses ton boxer et ton t-shirt recelant ses bonnes petites odeurs de la journée. Tu passes sous l’eau, te savonne, l'odeur du gel douche imprègne ta peau. L’eau coule entre tes pecs, glisse sur tes abdos, sur ton sexe. Tu te caresses peut-être sous l’eau, tu te fais peut-être même plaisir jusqu’au bout.
Tu sors de ta douche tout propre, tout frais, auréolé de ta sexytude aveuglante. Tu te sèches. Tu te postes devant ton miroir, tu vaporises copieusement ta peau avec ton déo. Sous les aisselles, sur le torse, laissant autour de toi une fraîcheur entêtante qui envahit la pièce et flotte longtemps dans l’air après ton passage. Tu te coiffes, tu t’habilles. Tant d'images, de scénarii mille fois joués dans ma tête, mettant en scène nombre de ces p’tits cons à hurler qui, comme toi, me rendent dingue.
Lorsque je reviens dans le séjour, tu es installé sur le canapé, devant la télé, toujours torse nu, mais tu portes un nouveau short molletonné. Tenue réglementaire de bogoss, quoi.
Je m’installe sur « mon fauteuil » et, pendant que tu zappes entre mille chaînes, je suis hypnotisé par ta présence. Tes vingt ans m'éblouissent, tes oreilles fines me donnent une furieuse envie de les lécher, de les mordiller.
Je voudrais te parler, mais de quoi ? Mon anglais n’est pas assez bon pour tenir une conversation, et je suis sûr que même si c’était le cas, tu ne serais pas intéressé par ce que j’aurais à te raconter. Même mes questions te sembleraient nazes.
Finalement, contre toute attente, c’est toi qui te charges de rompre la glace.
Tu me demandes d’où je suis en France, et ce que je viens faire à New York. Je suis heureux que la conversation soit engagée. Je te parle de Toulouse, tu me dis « You came from Toulouse, so are you a looser ? ». Je t’explique que je viens pour le concert de Madonna. « Old singer », tu commentes, tout en entonnant quelques mesures de son dernier grand éclat en date auprès du grand public, datant d’il y a dix ans déjà, « Hung Up ».
Je t’en foutrai des Old Singer, saleté de p’tit con !
La conversation se poursuit autour des sites incontournables de la ville. Tu me parles, je ne comprends pas tout, je t’écoute, je te mate, je bous de l’intérieur. Plus je t’écoute, plus je trouve qu’au-delà de ta sexytude bouillante, tu es touchant. Ton débit de parole est lent, ton timbre, assez doux. Malgré la barrière d’un anglais que je suis loin de maîtriser correctement, je ressens dans ta voix un délicieux mélange des vibrations viriles et d’intonations transpirant un je-ne-sais-quoi d'enfantin.
Par moments, tes mots semblent même laisser transparaître une certaine naïveté, ou candeur, tes attitudes, une forme de timidité et de fragilité. Comme si tu n’étais pas aussi sûr de toi que tu le prétends en exhibant sans réticences ton corps de fou.
Ton zapping prend fin et notre conversation aussi. Tu mates une émission sans intérêt.
Quand je te regarde, affalé contre le dossier du canapé, les cuisses un tantinet écartées, le bassin bien vers l’avant, l’élastique du boxer qui dépasse outrageusement du short, le bras levé, le coude plié, la main entre la tête et le dossier du canapé – m'offrant ainsi une vue magnifique sur ton aisselle légèrement poilue, sur tes tétons saillants, sur ta peau lisse, musclée, parfumée – ton entrejambe pratiquement offert, la bosse qui se dessine de façon insolente, qu’est-ce que je donnerais pour te sucer, là, tout de suite, sur le canapé !
Tu fixes l’écran de la télé avec un regard intense, concentré, tu es sexy à tomber. J’ai envie de promener ma langue sur chaque centimètre carré de ta peau.
Je ne peux pas renoncer à immortaliser une telle splendeur mâle. Je ne t’aurai pas, beau Justin, je ne te ferai pas jouir comme tu le mérites, mais je t’amènerai « dans mes bagages », et je t’inviterai dans mes branlettes.
J’étudie donc la stratégie pour capter l’instant d’éternité. Le reportage photo « Tranche-de-vie-de-bogoss » est une opération risquée mais très stimulante. Une action délicate, nécessitant une bonne dose de patience et de discrétion. Il faut capturer l’animal à son insu, pour que le naturel, composante majeure de son charme, soit préservé. Il faut à tout prix éviter d’attirer l’attention du spécimen si on veut mener le hold up photographique à bon port. Et, accessoirement, si on veut éviter de prendre sa main dans la gueule.
Hélas, j'ai beau y mettre toute ma discrétion. Tu tournes la tête pile au moment où je prends le plus de risque pour obtenir un bon cliché.
Ton regard fixe et interrogatif, noir et hostile, se fige alors dans l'écran du téléphone. Et mon sang se fige lorsque je t’entends me lancer, sur un ton plutôt « mec des cités à la sauce new-yorkaise » :
— What the fuck are you doing ?
Euh… qu’est-ce que je suis en train de faire ???
— No… nothing… je bégaie.
— T’étais en train de me prendre en photo ? tu aboies dans ton anglais américain bien serré, le ton entre interrogateur et accusateur.
Dans ma tête, c’est le tsunami. Je panique. Comment me sortir de ce pétrin ? Impossible de nier l'évidence, je me suis fait gauler. Alors, autant jouer cartes sur table. Tu ne vas quand même pas me péter la gueule. Je sais que j’ai pour moi l’arme ultime de la dissuasion des années Internet, le commentaire client. En moins de 100 caractères, je peux pulvériser ta réputation.
— Si, je te prenais en photo ! j’admets calmement.
— Why ? Pourquoi tu me prenais en photo ? tu me questionnes, ta voix passant rapidement d’un ton accusateur à un ton plutôt agressif.
Et toujours cette chanson qui trotte dans la tête…
If I'm smart then I'll run away/Si j'étais futé je m'enfuirai
But I'm not so I guess I'll stay/Mais je ne le suis pas donc je pense que je vais rester
Heaven forbid/Surtout pas
I'll take my chance on a beautiful stranger/Je vais tenter ma chance avec un bel inconnu
— Parce que tu es vraiment sexy, je me sens à l’aise pour te répondre.
— Espèce de pédé !
Voilà ton commentaire de p’tit con.
— Oui, je suis pédé. Et les mecs comme toi, ça me fait craquer, j’enfonce le clou. J’ai l’impression de ne plus avoir de limites.
— Rien à foutre, moi je n'aime que les nanas !
Voilà ta conclusion sans appel.
— Ça, j'en suis sûr, c'est bien pour ça que tu me plais autant, je te cherche.
Pas de réaction de ta part. Ton regard est toujours rivé sur l’écran télé. Au point où j'en suis, je décide d'y aller cash, en espérant employer les bons mots dans une langue qui n’est pas la mienne.
— Et je pense que je saurais te faire des choses que les nanas ne t’ont jamais fait…
— Sans façon, tu me lances, toujours sans quitter l’écran télé des yeux.
— T'as jamais eu envie de coucher avec un mec ? je te provoque.
— Tu me prends pour qui ? tu réponds sur un ton agacé, en posant à nouveau ton beau regard noir sur moi, fulminant comme un ciel d’été avant l’orage.
— Tu as tort… tu pourrais kiffer ce que je pourrais te faire ! je trouve le cran de te renvoyer.
— Je ne crois pas, non, tu assènes sèchement, en zappant mécaniquement sur la télécommande.
— Je n’ai pas pris de photo, t’inquiète, je tente de calmer le jeu.
Je m’efforce de ne rien montrer, mais cette petite confrontation m'a bien secoué. J'en tremble carrément. Je déteste la confrontation, je suis du genre plutôt à éviter le conflit. Et me prendre le chou avec un mec, en anglais, ça me fait encore plus bizarre.
Après quelques interminables instants de silence, tu allumes ta console et tu lances un jeu vidéo du style « je suis l’arme à recharge illimitée qu’on voit en bas de l’écran et je tire sur tout ce qui bouge ». Typiquement, un jeu vidéo de p’tit con.
Je te regarde malmener la manette sans fil, l’orienter dans l’espace devant toi pour provoquer des mouvements à l’écran. Perso, je n’arrive pas à comprendre comment on peut cramer son temps de cette façon. Même si je n’avais rien à faire de mes journées, je trouverais toujours plus intéressant pour employer mon temps que de jouer à un jeu vidéo, notamment de ce style, où l’on ne fait que dégommer tout ce qui bouge.
En revanche, te regarder jouer, toi, te voir happé par le jeu, te voir te défouler, ça c’est une activité à laquelle je pourrais me consacrer pendant des heures. Avec ton torse nu, tes pecs et tes abdos saillants, ta peau douce, ta chaînette de mec, ta casquette vissée à l’envers sur ta tête, tout pris par ton jeu, tu me renvoies illico à la toute première révision avec Jérém, lorsque, après m’avoir dépucelé et baisé de partout, il m’avait lancé, avant que je quitte l’appart :
« Pas un mot à personne de ce qui s’est passé aujourd’hui, compris ? Sinon, je te défonce ».
— Tu veux jouer ? je t’entends me lancer, me tirant ainsi des assauts de la nostalgie.
Sans attendre ma réponse, tu me tends une manette, sans pour autant quitter l’écran des yeux.
— Tu ne veux pas plutôt jouir ? je crame d’envie de te demander du tac-au-tac.
Hein ?!?!?! Qui, moi ? Jouer à un jeu vidéo ? Est-ce que j'ai la tête d'un mec à jouer à des jeux vidéo ? Je n'ai jamais eu envie de mettre les doigts sur une manette, et je ne suis même pas sûr d'avoir assez de doigts pour maîtriser toutes les touches !
— Je ne sais pas jouer à ces trucs-là ! j’avoue, terrorisé à l’idée de me ridiculiser devant un petit mec de dix ans mon cadet.
— Who cares, man ? Just play ! On s’en fout… joue ! tu m’ordonnes.
— Tu vas me mettre une raclée ! je te balance, tout en me retenant de justesse de te balancer qu'il y a d'autres raclées bien plus agréables à recevoir de la part d’un mec comme toi.
— Joue, je te dis ! tu insistes sur un ton de plus en plus appuyé, te penchant vers moi pour mettre la manette carrément entre mes mains. Ton deo de p’tit con me percute à nouveau de plein fouet. Comment veux-tu que je me concentre au jeu, après avoir sniffé ton odeur ?
Et là, j’ignore comment c'est sorti, mes mots mes surprennent en même temps qu’ils glissent de mes lèvres :
— Ok, je joue. Mais après je te suce !
— Win, first ! je t’entends lâcher, un petit sourire lubrique au coin des lèvres.
Gagne, d’abord.
Putain ! Soudain j’ai l’impression que dans ta tête tu as déjà fait un pas vers le grand saut. Que tu envisages désormais de déroger à ta règle « je n’aime que les nanas ». J’ai l’impression que tu as déjà envie de ce que je te propose.
— Je vais gagner, t’inquiète ! je bluffe, enivré par cette petite ouverture de ta part.
— Jamais de la vie, tu es trop vieux pour ça, tu ricanes.
Je sais que je n’ai aucune chance de gagner. Et que je ne gagnerai donc pas mon « pari ». Mais tant pis. Ce début de complicité avec toi, magnifique Justin, m’enivre déjà.
— P’tit con, va ! je te balance, tout en m'installant à côté de toi et en frôlant ta main au passage. Premier contact physique avec toi, p’tit con, depuis ta poignée de main à mon arrivée. Contact fugace entre les bouts de nos doigts, frottement léger, mais frisson intense pour moi, comme une décharge électrique qui se propage dans tout mon corps.
Tu relances le jeu, tout en m’expliquant le fonctionnement en trois mots. Enfin, deux mots : Tu + tires !
Le jeu défile, sans que je sache vraiment ce que je suis censé faire. J’appuie sur toutes les touches, je me trouve gauche, maladroit, je ne sais même pas si je suis en train de marquer des points ou d’en perdre.
Je ne sais pas pendant combien de temps nous jouons à ce jeu de massacre. Ce que je sais, c’est que lorsque mon regard tombe sur les scores, ma surprise est immense et mon incrédulité totale en constatant que le mien est plus élevé que le tien. De son côté, le compte à rebours n’affiche plus que quelques secondes. La victoire est à portée de main, la pipe aussi ! Bien sûr, je suis conscient que tu es toujours en mesure d’annuler notre « pari », que tu peux avoir changé d’avis, ou juste avoir joué avec moi. Peut-être que cette pipe n’a même jamais été envisagée dans ta tête.
Mais il faut que j’en aie le cœur net, il faut à tout prix que je garde mon avantage. Je continue d’appuyer comme un malade sur le bouton qui me sert de gâchette. Et lorsque « Game Over » s’affiche enfin en grand en haut de l’écran, mon côté de l’écran clignote en bleu et affiche « Winner ».
— J’ai gagné ! je triomphe.
— Je n’ai pas trop fait d’effort pour gagner non plus, tu me mets à l’aise direct.
— Tu as vraiment envie que je te suce, alors !
Une bonne flamme lubrique embrase désormais ton regard. Tes mots, ton attitude et tes gestes dévoilent tes envies.
Tu poses ta manette sur la table basse, tu écartes un peu plus les jambes, tu glisses ta main dans le tissu molletonné, tout en me balançant, le regard rivé dans le mien :
— Tu veux la voir, n'est-ce pas ?
— Depuis que j’ai vu ta photo sur le site, j’y vais franco.
— Et tu veux la sucer, tu enchaînes, l’air de plus en plus assuré, de plus en plus maître de la situation, de plus en plus excité.
— Oui, autant que tu veux te faire sucer, je me lâche.
Décidément, cette chanson semble écrite sur mesure pour toi…
I looked into your eyes/J'ai regardé dans tes yeux
And my world came tumbling down/Et mon monde s'est effondré
You're the devil in disguise/Tu es le démon déguisé
That's why I'm singing this song/Voilà pourquoi je chante cette chanson
Toi, petit démon à la gueule d’ange, déguisé en jeune mec charmeur et sexy, toi, tentation irrépressible, ravageuse !
Ton regard est celui du serpent au jardin d’Eden, ton corps le fruit défendu. Comment je la comprends, à cet instant, cette conasse d'Ève. Mon Paradis pour « croquer » dedans.
— Les pédés comme toi ont besoin de la queue d'un mec pour prendre leur pied, tu surenchéris.
Tes mots de petit macho me chauffent à bloc, tout en m’inspirant une impression de déjà entendu, faisant appel à des souvenirs liés à des jours lointains, dans l’espace et dans le temps. Comme ils sont lointains, et en même temps si proches, car toujours en moi, dans mon cœur, la rue de le Colombette, et l’année 2001 ! A croire que, au-delà de l’espace et du temps, l’espèce « p’tit con » possède un vocabulaire spécifique qui transcende les langues.
— C’est tellement ça, je me livre sans résistance, sans honte aucune.
Je ressens ton désir de me voir soumis à ta domination de jeune mâle. Alors, je décide d’assumer mes envies à 100%.
— Je suis sûr que tu vas kiffer ce que je vais te faire !
— Du style ? tu me lances, l’air intrigué.
Ta question me donne un bel avantage, un avantage inattendu, et me fait pousser des ailes.
— Une vraie pipe, pour commencer !
Car tu n’es vraiment qu’un p’tit con à faire jouir d'urgence.
— Tu ferais mieux de venir sucer avant que je change d'avis ! tu me lances, l’air de t’impatienter, alors que ton érection se manifeste désormais très nettement sous le tissu molletonné.
— Tu veux faire ça ici ? je m’inquiète.
— Elle ne te plaît pas la vue ? fais-tu, décontracté au possible.
— On ne risque pas d’être surpris par ta cop…
— Elle n’est pas là, tu me coupes net, avant d’enjoindre sur un ton péremptoire :
— Suce !
Je viens de me glisser entre tes cuisses, je suis enfin là où j’ai le plus envie d’être au monde, à genoux devant toi, p’tit branleur sexy. J’approche mon visage de ton short jusqu’à poser carrément mon nez sur cette belle bosse proéminente. Et j’ai l’impression de sentir l’odeur de ta teub à travers le coton.
Je tire un bout de la cordelette nouée juste en dessous de ton nombril. D’un geste très naturel, tu lèves le bassin pour mieux laisser glisser le short et le boxer le long de tes cuisses.
Le voilà le Saint des Saints de ta virilité, cette belle queue s’érigeant au-dessus d’une délicieuse touffe de poils châtain clair.
Je ne peux résister plus longtemps à l’envie de la prendre en bouche et de commencer à te pomper. Je te suce avec désir, avec entrain, j’ai envie de te montrer que tu as eu raison de te laisser aller, et j’ai envie en même temps de te remercier de me faire ce cadeau.
Tu as gardé ta casquette sur la tête et j’aime ça, que tu gardes ta casquette de Playmobil bandant pendant que je te suce. Je sens ton regard sur moi, et j'aime ça aussi, que tu me regardes à genoux, accroupi entre tes jambes, pendant que j’œuvre pour t’offrir le plaisir que tu exiges.
Non, je n’arrive pas à croire que tu m’aies laissé gagner pour gagner une pipe au passage, l'air de rien. « Je n’aime que les nanas ». C’est ça, p’tit con, à d’autres !
Ta respiration joue désormais la partition de ton excitation. Tu fermes les yeux, tu lèves la tête vers le ciel, tu ouvres la bouche à la recherche de ton souffle, coupé par le plaisir. Tu profites désormais sans vergogne des talents de ma langue et de mes lèvres.
Ma main te branle et ma langue fait des « 8 » bien appuyés sur tes bourses, et ça aussi, tu as l’air de bien apprécier.
Je descends vers ton entrecuisse, et tu me laisses faire. Du moins jusqu’à ce que ma langue effleure l’entrée de ta raie. Tes mains se posent alors sur mes épaules, elles me retiennent fermement.
Alors, quoi ? T’as peur de … ? De ne pas aimer ? Ou, au contraire, de trop aimer ?
A croire que là aussi, au-delà de l’espace et du temps, lorsque la p’tit contitude est confrontée à ses fantasmes et à ses envies les plus refoulées, les réactions demeurent immuables.
Le fait est que tu DOIS goûter à ça, beau New-Yorkais, c’est obligé, et tu dois y goûter aujourd’hui même, et ça doit être moi et personne d’autre l’artisan de ce bonheur qui t’attend ! Je force avec mon buste et j'arrive enfin à effleurer ta raie avec le bout humide de ma langue. Et là, presque instantanément, comme lorsqu’on tape le bon code sur un clavier et qu’une porte s’ouvre, tes bras cessent toute résistance. Je te vois te détendre, puis attendre, offert, impatient.
Non seulement ta résistance cesse, mais très vite tu écartes un peu plus tes jambes, tu ouvres grand tes cuisses, tu laisses glisser tes fesses bien au bord du canapé, même un peu dans le vide. Ton corps tout entier œuvre pour me dégager la voie. Tu es désormais complètement offert à ma langue, sans limites et sans pudeur.
Alors j’y vais franco. Avec mes deux mains, j’écarte tes fesses et avec ma langue j’y vais de plus en plus fort, de plus en plus profondément, ivre d’avoir enfin le droit d’accéder à l’endroit ultime de ton intimité.
Je ne me trompe pas en affirmant que jamais avant cet après-midi, personne ne t’avait fait ça ? Et que tu ne t’attendais pas, ce matin, en te levant, à découvrir en ce 16 septembre 2015, ce truc de dingue, et encore moins par l’œuvre de la langue d’un garçon ?
Toi qui as voulu d’abord me retenir parce que, j’imagine, dans ta tête « il n’y a que les pédés qui aiment ça », dès l’instant où tu y as goûté, tu as aimé, et pas qu’un peu.
Tes deux mains voulaient me repousser, elles veulent désormais me rapprocher. Elles se posent sur ma tête, tes bras exercent une pression de plus en plus forte, violente, animale pour que mon visage et ma langue s'enfoncent encore plus en toi. Tu y vas tellement fort que j'ai presque du mal à respirer. Pourtant, cela me chauffe à bloc.
Alors, je n'ai plus qu'une envie, celle de te faire jouir du cul, p’tit branleur sexy !
Ma langue se déchaîne, te sentir prendre ton pied à fond est comme une drogue qui mène vite à l’addiction. C’est une escalade de plaisir et d’excitation. Des spasmes violents secouent ton beau corps, notification inconsciente de la tempête de nouvelles sensations qui fait des ravages dans ta tête.
J’y vais comme un fou, encouragé par la vision que tu m’offres, ton torse allongé à l’horizontale sur le canapé, tes pecs et tes abdos saillants ondulant au rythme de ta respiration haletante, tes couilles bien pleines et ta queue raide, ton gland flirtant avec ton nombril, suintant une petite goutte brillante provoquée par une excitation hors normes. C’est l’image d’un bonheur absolu. Le tout, à quelques centimètres à peine de mes yeux.
L’une de tes mains finit par quitter ma nuque et atterrir sur ta queue. Tu commences à te branler pendant que je te bouffe le cul. On dirait bien que ma petite astuce coquine t’a donné une envie furieuse de jouir ? Est-ce que j’ai réussi, ça, moi, « l’espèce de pédé » ?
C’est lorsque je sens ton corps se raidir, lorsque je t’entends pousser un râle profond de satisfaction, lorsque je sens ton orgasme débouler, c’est à cet instant que j’ai ma réponse.
Lorsque je lève la tête, un spectacle magnifique se présente à moi. Tes giclées parsèment tes pecs et tes abdos, jusqu’à ton cou.
Nos regards se rencontrent. Et là j’ai la certitude que tu as envie de la même chose dont j’ai envie.
Polir ton gland, ne pas laisser une seule goutte de ton nectar de mec, profiter de cette main que tu me tends, comme un ordre silencieux, comme une évidence, lécher tes doigts gluants de ce jus brûlant de p’tit branleur. De là, démarrer un merveilleux voyage des sens, un voyage qui se poursuivra vers tes abdos, qui remontera ensuite vers tes pectoraux, sans oublier de s’attarder autour de tes tétons bien saillants. Lécher ta peau douce, ton torse tiède, m’enivrer de ton odeur, lécher, savourer, apprécier, avaler avidement toute trace brillante de ton orgasme.
La raison a tendance à s’éclipser face aux envies primaires suscitées par un mec comme toi, réaction animale à la testostérone.
Le fantasme est si fort, si puissant, si excitant, je le devine à ton regard qu’il l’est tout autant dans ma tête que dans la tienne.
Et pourtant, ce fantasme restera un fantasme. Tout comme ça le restera celui qui me hantait juste avant que tu jouisses, celui de te laisser te décharger dans ma bouche et avaler direct ta virilité, ta jeunesse, ta sexytude, ton insolence.
C’est frustrant, c’est râlant, c’est rageant. Mais le fait est que je ne te connais pas, mec. Qui sait où un p’tit queutard de ton espèce a pu laisser traîner sa belle queue dans une ville aux mille tentations comme New York.
Alors, bien que l’ivresse des sens (je n’ai toujours pas joui) m’inspire des idées débridées, une petite voix de trentenaire me dit qu’il vaut mieux assumer une petite frustration plutôt que risquer une grosse infection.
Je me contenterai alors de survoler ton paysage anatomique à très basse altitude avec mon nez, pour m’enivrer de cette odeur de nectar de jeune mec, tout en me faisant violence pour empêcher ma langue de s’en délecter. C’est une odeur forte et douce à la fois, elle est à l’image de ton regard, de ta voix, de tes attitudes de jeune mâle, de toi. Cette odeur, c’est tout toi, du « pur jus » de p’tit con.
Tu pars fumer à une fenêtre. Appuyé au rebord, ta cigarette au bec, le regard perdu dans l’immensité du paysage urbain, tu me fais penser à un autre gars, cigarette au bec, appuyé au parapet de sa terrasse, une terrasse si lointaine dans l'espace et dans le temps. Lui aussi, lorsqu'il avait joui, il avait besoin de ce petit plaisir faisant écho – ou le prolongeant d’une certaine manière – à celui que je venais de lui offrir.
Lorsque tu écrases ton mégot, lorsque tu te retournes, je vois dans ton regard que tu n'en as pas eu assez. Je le vois à ta queue que tu en as pas eu assez. Lui non plus il n’en avait pas eu assez, il n’en avait jamais assez. Heureuse jeunesse !
Je te regarde avancer vers moi, impatient et excité de découvrir ce dont tu as envie maintenant. Tout comme en ce lointain jour de mai, avec lui.
Tu passes à côté de moi, sans un mot, tu te diriges vers le couloir.
— C’mon, follow me ! je t’entends lancer.
Mais oui, je vais venir avec toi je te suivrais même en enfer, maintenant que j’ai la chance d’accéder à ta virilité !
Je te suis, tu te diriges vers ma chambre. Tu rentres, je rentre derrière toi. Je n’ai pas le temps de fermer la porte, tes mains me saisissent déjà, je me retrouve allongé sur le lit. Je te regarde et je sais que tu as à présent envie de me défoncer. Tu me laisses tout juste l’occasion d’enlever mon short et mon boxer, tu me retournes comme une crêpe. Tes gestes ont la précipitation de l’excitation bien avancée.
Je me trouve allongé sur le ventre, face à la porte glacée du placard. Je te vois dans le miroir, je te regarde en train de grimper sur le lit, derrière moi, je vois ta queue tendue avancer vers mon entrejambe. Je sais que t’as envie de me baiser, de défouler sur moi ce rut que j’ai provoqué en toi.
Tu viens en moi, sans te protéger. Une partie de moi est en alerte rouge, elle tente de me prévenir sur le niveau de risque et d’inconscience de la situation. Mais une autre partie de moi crève d’envie de s’abandonner à l’un des désirs les plus brûlants enfouis en moi, un désir inassouvi depuis la dernière fois où j’ai fait l’amour avec Jérém, il y a bientôt huit ans, celle de me laisser remplir par le jus d’un si beau garçon. Alors, je te laisse faire, je suis fou, je me laisse faire.
Je tente de réconcilier les deux parties en conflit dans ma tête en me disant que je te laisserai juste faire pendant un moment, et que je te demanderai de sortir et de passer une capote avant de jouir.
Je te laisse commencer à coulisser en moi, à me tringler, sans rien savoir de toi, sans savoir si tu es clean, sans savoir à quelle « distance » se situe ton orgasme. Tu pourrais très bien jouir très vite, et mon raisonnement fallacieux ne me protégera pas des risques que j’aurai pris.
De toute façon, je sais très bien que lorsque le plaisir sera enclenché, je n’aurai pas le courage ni l’envie de l’arrêter. Que je n’aurais qu’une envie, d’aller jusqu’au bout, et de te laisser te vider les couilles dans mon cul.
Te sentir coulisser en moi, me sentir possédé par toi, p’tit branleur sexy, dominé par ta virilité et tes envies, c’est pour moi un bonheur indicible. Tout mon corps est embrasé par une excitation que je n’ai pas ressentie depuis des années. Ta queue me remplit à merveille, elle m’offre le plaisir physique. Mais ton image dans la glace – ta belle petite gueule crispée par l’excitation, ta casquette toujours vissée sur ta tête, ton torse et ta chaînette ondulant au gré de tes coups de reins, ton attitude de jeune mâle en quête de son seul plaisir, un mâle qui ne vas pas me lâcher tant qu’il ne se sera pas vidé les couilles – déclenche en moi le plaisir ultime, un plaisir purement mental, le plus puissant de tous, celui du mec qui aime se sentir « l’instrument » du plaisir d’un beau mâle. Jouir avec tout mon corps et tout mon esprit, peu de garçons ont su m’offrir ce bonheur suprême.
Tu prends appui sur mes épaules pour donner plus de puissance à tes coups de reins. Lorsque tu te penches un peu plus sur moi, je sens le contact léger de ta chaînette longue et fine entre mes omoplates. Soudain, je suis rattrapé par le souvenir d’un autre miroir, d’une autre chaînette, plus courte, plus épaisse, mais tout aussi sexy.
« Ouvre les yeux, putain, et regarde ce qui t'arrive, regarde comment tu te fais baiser, comme une pute ! ».
Décidément, il avait le sens de la formule pour me faire bander.
Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te laisser jouir en moi, beau Justin !
Heureusement, j’ai toujours une capote sur moi. Tu tiques un peu, mais tu finis par te résoudre à la passer avant de revenir en moi et recommencer à me pilonner.
Je n’ai pas à attendre longtemps avant d’entendre à nouveau ton râle de mec tentant d’apprivoiser son orgasme. Le reflet du miroir me montre ton corps secoué par l’explosion de ton plaisir de mec. Ta tête part vers l’arrière, ton torse se bombe, ton bassin ondule frénétiquement. Tu jouis.
Et moi, j’ai envie de pleurer. Y-a-t-il quelque chose de plus fabuleusement beau que de voir un mec comme toi submergé par le plaisir qu’il a atteint en coulissant en moi ?
Un instant plus tard, tu t'abandonnes sur moi de tout ton poids, la respiration bruyante, le rythme cardiaque très rapide. Comme lui, tu restes immobile pendant quelques instants, la queue toujours raide, toujours enfoncée en moi, tu récupères de « tes émotions ».
Lorsque tu te déboîtes de moi, je me retourne instinctivement, car j’ai besoin d’être rassuré. J’ai besoin de savoir que la capote est toujours sur ta queue et qu’elle a résisté à ta fougue de jeune étalon. Ma mésaventure avec Benjamin il y quelques années résonne toujours en moi, à chaque fois que je me fais prendre. Tout va bien de ce côté-là, je suis rassuré.
J’ai quand même la forte impression que si je t’avais laissé faire, parti comme tu étais parti, fougueux, excité, impétueux, débordant de testostérone bouillante, toi tu aurais été au bout, tu m’aurais joui dans le cul. Tu n’es vraiment qu’un sale gosse, appartenant à cette génération qui semble ignorer le B.A.BA des bonnes pratiques en matière de sexe, une génération qui n’a pas vécu l’hécatombe du SIDA dans les années ’90, une génération qui n’était pas encore là quand Freddy Mercury n’était déjà plus là. Une génération qui, encouragée par l’alibi du PrEP, la fausse conviction que la trithérapie est une promenade de plaisir, grandit dans une désinformation qui lui fait imaginer que le SIDA n’est guère plus grave qu’un rhume, s’autorisant par conséquent une insouciance dans les pratiques sexuelles qui traduit à la fois un défaut flagrant de respect de soi et une attitude criminelle envers l’autre.
Pour peu que, comme de nombreux petits cons de ton espèce et de ton âge, tu te berces dans la fausse illusion que tremper la queue dans un cul inconnu ça ne représente pas de risque pour toi, tu ne voyais certainement pas le problème.
Il m’a fallu faire face à ta fougue, à ton impatience, cette nouvelle impatience de jouir amenée par la découverte de nouveaux plaisirs. Il m’a fallu en même temps lutter violemment contre mon envie viscérale de recevoir en moi la décharge virile d’un p’tit con comme toi.
Mais j’ai quand même réussi à imposer ce bout de caoutchouc grâce à qui, en te regardant t’en débarrasser, le réservoir bien rempli, avant de le coiffer d’un petit nœud, je peux terminer de me branler et jouir le cœur léger.
Dans les rues de New York.
Une demi-heure et une douche plus tard, je me balade à nouveau dans les rues de New York, mon entrejambe me rappelant à chaque pas le bonheur de m’être fait sauter par toi, bel inconnu prénommé Justin.
L’heure du concert approche. Je me dirige vers le Madison Square Garden à grand pas. Dans mes écouteurs, les chansons de l’album « American Life ». Elles me ramènent à Capbreton, pendant sa convalescence, après son accident au genou.
L’excitation monte en flèche lorsque j’aperçois la foule qui se presse devant les entrées. Et ça me fait chaud au cœur. Madonna a beau ne plus vendre autant de disques qu’à la grande époque, ne plus passer en radio, faire des choix artistiques qui ne font plus l’unanimité, changer d’apparence et pas toujours dans le bon sens, abuser du bistouri. Après trente ans de carrière, elle demeure néanmoins une bête de scène capable d’aligner en quelques mois plus de 80 dates sur quatre continents, une icône pop capable d’attirer à elle près de deux millions de fans disposés à engager des sommes considérables pour la voir en vrai.
Comme d’habitude, elle se fait attendre. Le public l’appelle, se chauffe tout seul. Entre agacement et impatience, les fans n’en peuvent plus.
Lorsque l’intro vidéo démarre enfin sur des percussions aux basses rutilantes, lorsque les danseurs déboulent sur scène avec des costumes qui semblent sortis tout droit de l’armée des soldats de terre cuite de l’empereur Qin, voilà, la salle est en délire.
Mais lorsqu’elle apparaît enfin, enfermée dans une cage à 20 mètres du sol, la salle s’embrase carrément. On la retrouve comme on retrouverait une amie qu’on ne voit que très rarement, mais avec qui la communion spirituelle demeure intacte, comme si on s’était quittés la veille. Une amie avec qui on aurait fait les quatre cents coups, avec qui on partage d’innombrables souvenirs. Des souvenirs communs, ses chansons, auxquels chacun d’entre nous en accroche d’autres plus personnels. Une amie à qui on pardonne tout ou presque, car elle ne nous a jamais laissé tomber.
Les nouvelles chansons se mélangent aux anciens tubes incontournables. La puissante « Iconic » fait l’ouverture du show, « La vie en rose » s’invite dans la playlist et l’incontournable « Holiday » clôt la grande messe, comme à chacune de ses tournées.
Ses tenues se sont rallongées, elles sont plus couvrantes que par le passé. Les années ont passé, la Star ne souhaite plus montrer autant d’elle qu’auparavant. Pour entretenir le mythe, il vaut mieux parfois se montrer discrète. Niveau danse, la souplesse est moindre, l’assurance d’antan vient un peu à manquer. Dans les précédentes tournées, on avait l’impression, car l’illusion était savamment entretenue, que tout ce qu’elle faisait, danse, présence scénique, n’était qu’un jeu d’enfant accompli presque sans effort, qu’elle en avait toujours sous le champignon, qu’elle aurait pu faire encore mieux si seulement elle l’avait voulu. Désormais, on a l’impression qu’elle est à fond sur le champignon, qu’elle atteint ses limites. On voit qu’elle donne tout, comme elle l’a toujours fait sur scène, mais qu’elle ne pourrait pas donner plus. Et, surtout, qu’elle ne peut plus donner autant qu’avant. Elle en devient touchante.
Pour son dernier album, elle nous a tous un peu perdus, fans de la première heure et grand public, avec ses nouvelles productions et sa promo en demi-teinte, mais le show qu’elle nous offre est fabuleux, elle se rattrape de façon grandiose.
Car sa plus grande force, c’est sa présence, cette présence qui traverse les décennies, et ma vie, et qui en constitue l’un des rares éléments de stabilité, comme un repère, au milieu des tempêtes, et même de la plus grandes de toutes, celle qui m’a mis à terre il y a désormais presque huit ans, lorsque Jérém est sorti de ma vie.
Je sors du Madison les yeux pleins d’étoiles.
Il n'est que minuit, et la nuit new-yorkaise semble si jeune et si pleine de promesses. Tout grouille autour de moi, les gens, les rues, les voitures, les bruits de la ville, les enseignes clignotantes et les écrans géants illuminant Times Square comme en plein jour.
Je regarde la foule circuler autour de moi et, une fois de plus, je suis comme étourdi par toutes ces occasions, toutes ces rencontres possibles, toutes ces vies qui se croisent, qui s'effleurent sans que les destins se rencontrent. C’est la foire des occasions, des occasions manquées. Je me dis que, peut-être, dans toute cette foule, deux êtres faits l’un pour l’autre passent à côté l’un de l’autre sans se voir, comme dans un Mahjong avec beaucoup trop de tuiles.
Je ressens comme un état d’ivresse, j’ai l’impression de percevoir toute l’énergie de vie de la foule, une énergie qui semble se propager à travers le sol, courir dans les rues, sur le bitume et irradier en moi, comme si j’étais connecté avec tout ce qui est vivant.
Je suis à New York et j’ai l’impression que je ne me suis jamais senti aussi vivant. Je suis cueilli par une espèce d’immense euphorie. Dans cette ville immense et étrangère, tout semble tellement possible, y compris apprendre à vivre avec un passé douloureux, avec le manque, le déchirement, le deuil impossible.
Oui, la nuit est jeune, et il y a plein d'endroits où je voudrais aller. Des bars, gays, ou pas. Une partie de moi a envie de savourer tout ce qu’est capable d’offrir la Grande Pomme.
Je marche pendant une heure, sans arriver à me décider à franchir l’une ou l’autre des entrées en dessous d’enseignes toutes plus clignotantes et criardes les unes que les autres.
Le fait est qu’une force irrépressible, irrésistible, violente m’entraîne vers toi, P’tit branleur sexy.
Je suis rentré au Madison en pensant à toi, p’tit con, à ce que tu m’avais fait une heure plus tôt.
Je suis sorti du Madison toujours en pensant à toi, à cette furieuse envie de recommencer ce que tu m’as fait quelques heures plus tôt.
Et là, pendant que je marche dans les rues de New York, alors que chacun de mes pas m’apporte toujours l’écho de ta venue en moi, j’ai encore furieusement envie de toi, un peu plus à chaque instant, à chaque pas.
J’ai envie de rentrer, envie de savoir si tu es encore levé si tu as envie de recommencer. Au fond de moi, je n'arrive même pas à croire que c'est arrivé. Au fond de moi, je sais que je vais finir seul à me branler dans ma chambre et que j’aurais gâché ma première nuit à New York. Dans le doute, je passe acheter des capotes dans une pharmacie. Et je viens à ta rencontre, beau Justin.
A l’appart, le séjour est plongé dans le noir. Enfin, dans le noir comme peut l’être un appart à New York avec une énorme baie vitrée laissant filtrer les lumières de toute une ville.
Pendant que je me perds dans la contemplation de cette immense fourmilière étincelante, je remarque un reflet de lumière bleutée et nerveuse d’un écran venant du couloir.
Je suis le reflet, jusqu’à l’entrebâillement de la porte de ta chambre. Te voilà, p’tit con sexy, allongé sur ton lit, toujours torse nu, devant ta télé, les yeux et les doigts rivés sur ton portable. Tu ne m’as pas entendu rentrer, tu ne m’as pas vu en train de te mater. J’adore cet instant où je te contemple sans que tu en sois conscient.
La simple vue de ton corps provoque en moi des frissons géants. Quand je pense que je me suis tapé ça, je suis toujours sur le cul. J’ai envie de pousser la porte et te sauter dessus sans attendre.
Et là, tu tournes ta tête et tu captes enfin ma présence. Tu me fixes pendant un instant. Tu sais que je te désire au-delà du raisonnable, tu sais que tu peux me demander absolument tout ce que tu veux. Tu me souris, triomphant, et tu baisses ton short et ton boxer.
If I'm smart then I'll run away/Si j'étais futée je m'enfuirais
But I'm not so I guess I'll stay/Mais je ne le suis pas alors je pense que je vais rester
Tu as envie de tirer un dernier coup pour bien dormir, c’est ça ? Et bien tu l’auras ton dernier coup !
Quand je pense que tu ne voulais pas coucher avec un mec et maintenant c'est toi qui m’offres ta queue de ton propre chef !
Je m’approche de toi et tu éteins la télé. La chambre est désormais plongée dans un noir presque total. Je viens te sucer en m'orientant à ta respiration, à la chaleur de ton corps, à l’odeur de ta teub. Te sucer dans le noir, c’est très excitant. Dans le noir, ton plaisir, mon plaisir, tiennent dans des sensations autres que visuelles, des sensations tactiles, olfactives, auditives, gustatives. C’est une expérience originale, intense, excitante.
Je te suce comme un fou, je te suce pour te faire jouir comme un malade, et dans ma tête la bataille fait rage entre l’envie violente de te laisser jouir dans ma bouche, de goûter enfin à ton jus de mec, de t’avaler, et une crainte des plus rabat-joie, celle justement de recevoir tes jets par surprise, et de m’en inquiéter après coup.
Le conflit est sanglant, mais de courte durée. Je ne saurais jamais si je t’aurais avalé ou pas car, toi, p’tit con, tu as d'autres projets.
Tu t'allonges sur le lit, à plat ventre. Je sais ce que tu veux, tu veux que ma langue vienne encore te faire plaisir là où personne n’avait eu accès avant cet après-midi.
Je m’exécute avec un bonheur immense, je m’exécute pour te faire plaisir, pour me faire plaisir. Je m’exécute jusqu’à que tu me montres que tu as envie d’autre chose.
Je te regarde, p’tit con sexy, à quatre pattes sur le lit, les fesses cambrées, la casquette toujours vissée à l’envers sur ta tête, m’offrant ton cul sans vergogne.
T’as envie de te faire baiser, hein ? Est-ce la première fois pour toi, ou bien t’as déjà laissé un autre p’tit con de ton espèce être ton maître sexuel ? Est-ce que tu brûles d’envie d’aller à la découverte de l’inconnu ou bien tu sais exactement où tu t’aventures ? Est-ce que tu réclames de te faire mettre, en profitant d’avoir un pédé sous la main, et en toute connaissance de cause du plaisir que tu vas en retirer ?
P’tit con, est-ce que tu as déjà ressenti ce doute intérieur face à cette envie te demander si tu vas vraiment aimer, comment tu vas gérer le regard de l’autre, comment tu vas te sentir au plus profond de toi-même, après ? As-tu déjà ressenti la crainte de te faire happer par ce plaisir, d’en devenir dépendant à la première prise comme pour une drogue, la crainte de te laisser entraîner dans un tunnel sans retour ? Ou bien, ce doute c’est aujourd’hui que tu vas l’affronter ?
J’ai un peu de mal à venir en toi, je dois m’y prendre à plusieurs reprises, composer avec les réticences de ton trou, et tes grimaces de souffrance. La sodomie est un plaisir qui se mérite. Mais je finis par trouver le moyen de me glisser en toi.
A présent, ton corps tout entier ondule, frissonne, demande, aspire au contact d’une autre virilité que la tienne. Tu implores un plaisir que tu méprisais jusqu’à il y a peu, et que tu mépriseras peut-être à nouveau dans quelques minutes, un plaisir que tu regretteras, ou auquel tu auras pris goût. Ce qui est certain, dans l’instant présent, c’est que ce nouveau plaisir te rend tout simplement dingue.
Quant à moi, le simple fait de te voir dans cette position, dans cet état, de sentir ton trou enserré autour de ma queue, de réaliser qu’il m’est donné l’opportunité de posséder un p’tit con de ton espèce, tout ça me paraît tellement irréel !
Que de chemin parcouru, beau p’tit con, en à peine quelques heures, toi, le mec qui n’aime(ait) que les nanas !
Est-ce qu’on peut imaginer assister à quelque chose de plus dingue que cette image, ce genre de p’tit con, de p’tit mec sexy, macho, arrogant, fier de sa queue, à quatre pattes sur un lit, en train de se faire baiser ?
Mes coups de reins sont toujours en retenue, je te ménage bien sûr. J’ai envie de passer à la vitesse supérieure, mais je ressens quand même des sensations magiques en me stabilisant sur cette douce vitesse de croisière.
Une vitesse qui finit néanmoins par se révéler insuffisante, puisque à un moment je t’entends balancer sèchement, la voix étranglée par un mélange de plaisir et d’excitation, de frustration et d’agacement :
— Fuck me harder... go on, go on !
Ah, putain c’est bon de baiser avec l’audio en anglais, d’entendre de ta bouche quelque chose comme « Baise-moi plus fort, vas-y, vas-y ! » !
Tes mots m’encouragent, me donnent confiance. Là, je sais que je peux y aller franco, et je commence à te pilonner vigoureusement, de plus en plus vite, je te martèle sans ménagement. Mes cuisses claquent contre tes fesses, mes couilles frappent ton entrejambe.
Et toi, p’tit con, tu assumes, tu encaisses, et tu en redemandes.
— Harder, harder !
Tu en veux davantage, et je ne sais même pas si je pourrais te donner davantage. J’ai l’impression que je suis à fond, que je me donne à fond, je te cartonne avec toute la puissance dont je suis capable, m’approchant très vite de l’orgasme. Je te pilonne sans me retenir, je te pilonne sans plus m’occuper de toi, tout concentré sur mon plaisir qui monte, qui monte, qui monte…
— Je vais venir, je te préviens, alors que mon premier jet se love déjà dans la capote.
Ta seule réponse est un silence ponctué par tes halètements profonds et rapides.
Je viens de jouir et je me sens vidé de toute énergie. L’excitation me quitte rapidement et mon corps ne réclame désormais qu’un repos mérité. J’ai juste envie de me déboîter de toi et de m’allonger sur le lit pour retrouver mes esprits.
Mais c’est compter sans toi. Car tu vois les choses bien autrement.
Je n’ai pas le temps d’atterrir de mon orgasme, ni même de retirer ma capote, que déjà tes mains m’attrapent, me retournent, me plaquent sur le matelas à la place qui était la tienne une seconde auparavant. J’entends le bruit du déchirement d’un petit emballage. Un instant plus tard, tu t'enfonces en moi, et tu me baises comme un animal plus en rut que jamais, presque avec rage. Comme si tu te vengeais, comme si tu me punissais désormais pour t’avoir fait l’affront de te faire jouir du cul. Comme si tu voulais remettre les pendules à l’heure, et rétablir la primauté de ta virilité.
Regrettes-tu déjà ? Ta virulence est-elle une sorte de catharsis ? Ou bien, juste l’effet d’une excitation incontrôlable apportée par ce nouveau plaisir ?
Quoi qu’il en soit, j’adore cette saillie sauvage, rageuse, absolue, inouïe, féroce, furieuse. Une saillie qui ne dure, hélas, pas très longtemps, car tu ne tardes pas à venir, à te décharger en limant mon cul au fer rouge.
Jeudi 17 septembre 2015.
Lorsque je me réveille le lendemain matin, il est déjà presque 11 heures. Il fait un temps magnifique, et déjà depuis le couloir, je réalise que l’appart baigne dans une lumière presque aveuglante.
En tendant l’oreille, j’entends des bruits connus, des coups de feu, des cris, des ordres, des explosions, des bruits typiques de ce jeu vidéo à la con que toi, beau Justin, sembles affectionner tout particulièrement. Enfin, je devrais plutôt parler de ce jeu comme d’un chef d’œuvre. Depuis qu’il m’a permis d’accéder à ta magnifique queue du bogoss new-yorkais, je n’arrête pas de lui trouver des vertus insoupçonnées.
Je te rejoins dans le séjour. Je suis heureux de te retrouver, beau Justin.
— Morning ! je te lance, aveuglé autant par la clarté qui se déverse par les baies vitrées, que par la beauté ravageuse de ton torse toujours rigoureusement nu, par l’insolence de ta jolie petite gueule, par l’attitude nonchalante de ton corps affalé sur le canapé, par cette putain de casquette à l’envers qui décidemment ne te quitte jamais, et par le souvenir toujours bouillonnant de nos ébats de la veille. Ça me paraît toujours irréel, et pourtant !
— Hi ! tu me réponds, sans quitter l’écran des yeux, tout en me tendant une manette.
Euh… de bon matin, avant le petit déj… je ne suis pas sûr que ça va le faire…
Mais je joue quand même. Après tout, je te dois bien ça, beau p’tit con.
Au bout de quelques minutes, je me rends compte que je suis à la ramasse. Ton score est deux fois plus important que le mien. Il faut dire que tu ne joues pas franc jeu. Tu utilises des armes non conventionnelles pour distraire l’adversaire que je suis. Ton torse dénudé est une pure provocation, surtout après ce qui s’est passé la veille. Tu es vraiment un petit démon déguisé sous des allures de bogoss.
Comment veux-tu que je marque des points alors que je n’arrive pas à cesser de mater tes abdos, tes pecs, les poils de ton chemin du bonheur indiquant la direction de ce sexe que je rêve de reprendre en bouche ? Et je ne parle même pas de ton deo p’tit con qui se dégage insolemment de ta peau !
Je joue vraiment trop mal, j’enchaîne les erreurs, les ratés. La vie de mon avatar est désormais en danger. Je joue tellement mal, qu’à un moment tu finis par mettre le jeu en pause et par me balancer :
— But what the hell are you doing ?
Ton sourire ravageur et coquin au coin de l’œil, au bord des lèvres, me rend fou de désir.
— Qu’est-ce que je fais ? Je n’ai pas envie de jouer. J’ai juste envie de toi, mec.
Je balance ma manette sur le fauteuil à côté et je me glisse entre tes cuisses.
Dès que ton gland se présente devant mes yeux, à portée de ma bouche, je te suce. Je te suce avidement, je te suce alors que toi, p’tit con, tu as redémarré le jeu.
Ainsi, pendant que tu manies ta manette avec dextérité, moi c’est ta queue que j’essaie de manier avec dextérité. A chacun les jeux qui lui siéent le mieux.
Je te suce depuis un bon petit moment déjà, lorsque j’entends la machine annoncer : « Game Over », suivi par un : « Shit ! » sortant de ta bouche, sur un ton plutôt agacé.
— Tu m'as fait perdre, tu lâches, irrité.
— Plains-toi je tente de te décrisper, tout en obligeant mes lèvres à quitter momentanément leur bonheur.
— Tu m'as fait perdre ! je t’entends insister, sur un ton presque accusateur.
Baiser avec des petits cons, ça a aussi ses inconvénients.
— Peut-être, mais je pense pouvoir me rattraper en te faisant jouir à un point tel que tu vas oublier ton jeu à la con !
— T’as intérêt ! tu t’exclames, l’attitude du mec qui considère que son plaisir est un dû.
Tu as vraiment une sacrée tête à claques, mais tu es tellement, tellement, tellement bandant !
Vendredi 18 septembre 2015.
Le lendemain matin, à mon réveil, l’appart est plongé dans le silence le plus total. Pas de bruits de coups de feu, d’explosions, pas de cris venant d’un jeu vidéo « passionnant ».
En ce jour de mon départ de New York, l’appart semble désert. Ta présence me manque. Je te cherche. Tu n’es pas dans ta chambre, j’aperçois ton lit vide dans l’entrebâillement de la porte. Tu n’es ni aux toilettes, ni dans la salle de bain, ni dans le séjour. Tu es où mon beau p’tit con ?
La nuit dernière tu m’as encore baisé comme un Dieu, et je ressens l’écho de tes coups de reins à chaque pas. J’ai besoin de te dire au revoir, avant de partir à l’aéroport.
En attendant, je me fais couler un café et je profite longuement du spectacle qui s’offre à moi, et rien qu’à moi, cette vue imprenable sur la verticalité de la ville baignant dans la lumière du matin.
Mais l’heure tourne, et le moment vient où je suis vraiment obligé d’y aller, sous peine de rater mon avion.
Je ne peux pas m’imaginer partir sans te revoir une dernière fois, après tout le plaisir qu’on s’est donné. Mais au fond c’est peut-être bien ainsi. Peut-être que toi non plus tu n’avais pas envie de me dire au revoir. Tu as peut-être raison. Pas de toi à l’appart, pas d’au revoir, pas de situation gênante. Il est parfois moins douloureux d’arracher un pansement d’un seul coup que de tenter de le décoller par petits bouts.
Je laisserai un commentaire positif sur Airbnb, « Très bon concept que ce B&B, Bed&Bite ».
Je m’apprête à quitter l’appart, lorsque la grande porte d’entrée s’ouvre. Et toi, p’tit con, tu es là, devant moi, tu portes un t-shirt blanc qui te va comme un gant, à l’échancrure vertigineuse, un t-shirt ressemblant en tout et pour tout à celui du selfie dans l’annonce. Et, bien sûr, ta sempiternelle casquette à l'envers vissée très haut sur la tête.
Tu refermes la porte derrière toi. Tu ne me dis même pas bonjour. Moi non plus, d’ailleurs. On se regarde, on se comprend.
Dans tes yeux, toujours cette bonne flamme lubrique que tu n’avais pas à mon arrivée, et qui ne t’a plus quitté depuis 48 heures. Ta main caresse déjà ta queue par-dessus le short. Sacré petit allumeur qui a définitivement pris goût aux plaisirs entre garçons ! Tu bandes, mec, tu as envie d’un petit cadeau d’au revoir, d’une dernière bonne petite pipe.
Tu en as envie, et moi je ne peux pas résister, quitte à me mettre en retard pour l’avion.
Putain, tu me fais un effet, mec, ça fait tellement longtemps que je n’ai pas ressenti ça pour un garçon. Je crois que je n’ai ressenti cette envie furieuse, déraisonnable, ravageuse, qu’une seule autre fois dans ma vie.
Tes épaules appuyées contre la porte d’entrée, le bassin en avant, les jambes légèrement écartées. Et moi, à nouveau à genoux devant toi, engagé dans une dernière, intense, longue, mémorable pipe.
Putain, qu’est-ce que t’es sexy avec ce t-shirt blanc ! Ça décuple mon envie de te sucer. Et lorsque tu le soulèves et tu le coinces derrière ta nuque, là, je deviens dingue. A cet instant, il n’y a plus d’avion, il n’y a plus de vie ou de taf qui m’attendent à Toulouse. A cet instant précis, mon seul but est de te faire jouir.
I looked into your eyes/J'ai regardé dans tes yeux
And my world came tumbling down/Et mon monde s'est effondré
You're the devil in disguise/Tu es le démon déguisé
That's why I'm singing this song/Voilà pourquoi je chante cette chanson
Tes mains retiennent très fort ma tête, tu me cartonnes la bouche, ta queue m’étouffe. Quel plaisir de contribuer à faire de toi un petit macho fier de sa queue, et quel bonheur de sentir en toi ce nouveau feu que j’ai allumé de ma main, de ma bouche, de mes fesses, et même de ma queue.
— Putaaaaaaaaain de salope, tu vas m’avoir ! je t’entends aboyer.
Ton orgasme secoue ton beau corps de jeune mâle je me fais violence pour obliger mes lèvres à quitter ton manche avant que tes giclées jaillissent de ta queue. Je me fais violence, car ce que je désire plus que tout est de connaître le goût de ta virilité. Et je te fais violence, car je dois forcer pour arriver à me dégager de ton bassin qui ne veut pas reculer, à me dégager de tes mains qui ne veulent pas lâcher prise. Tu crèves d’envie de me voir avaler, je le sais, p’tit con.
Et lorsque ton jus jaillit enfin, de nombreux jets puissants et épais viennent tâcher mon t-shirt.
La puissance de tes assauts, ainsi que ton odeur de jeune mâle, ce sont les derniers souvenirs que je garderai de toi, Petit Dieu à l'insolente jeunesse et à l’impertinente sexytude.
Après avoir passé un nouveau t-shirt, je marche dans la 5th avenue, direction métro-JFK-CDG-Blagnac, tout en savourant une dernière fois la grisante sensation d’être dans cette ville à l’énergie folle. « New York is not a city, it’s a state of mind », glissait Madonna lors d’une précédente tournée.
Au revoir, Madonna, nous nous reverrons lors de ta prochaine tournée, dans un autre pays. Ne tarde pas trop, ok ?
Au revoir, New York, je ne sais pas si je te reverrai un jour. Tu es comme une ivresse qui cueille dès le premier verre, et qui monte à la tête très vite. Mais après t’avoir côtoyée pendant quelques jours, je crois pouvoir dire que si je t’aime, c’est uniquement en tant que touriste. Je crois bien que je ne pourrais pas t’adopter en tant qu’habitant. Ton énergie est bien trop surpuissante pour moi. La ville où je me sens bien est Toulouse, car elle et moi partageons un même rythme, une conception de l’existence plus apaisante et à taille humaine.
Et au revoir à toi aussi, beau Justin. Ou plutôt, adieu. Pour toi, c’est une quasi-certitude, je ne te reverrai plus. Mais je ne t’oublierai pas pour autant. Car ta jeunesse et ta sexytude m’ont bouleversé. Car le plaisir que tu m’as offert m’a ramené aux meilleurs moments de ma vie.
Et, par-dessus tout, car tu m'as rappelé que, où que j’aille, qui que je suce, qui que je baise, il était une fois une histoire qui s'appelait « Jérém et Nico ».Vos commentaires sont le carburant de mon écriture.
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par fab75du31 le 5 Novembre 2023 à 19:44
Martin, avril 2015.
Assis dans mon canapé devant un film sans intérêt, je fais défiler les photos dans l’appli. Mon geste est machinal, mon attention et mon intention absentes. En ce dimanche soir, les têtes sont toujours les mêmes, les conversations aussi. Je suis las de tout cela, j’envisage une nouvelle fois de tout arrêter, et de me consacrer à l’écriture pour de bon. Il n’y a qu’elle qui ne m’a encore jamais déçu.
Et puis, tu viens me parler. Je ne l’aurais pas fait de mon propre chef, car ton profil n’a pas de photo.
Tu me dis simplement que tu as envie de te faire sucer sur le champ. Tu ne tournes pas autour du pot, tu es clair, sans hypocrisie.
Lorsque je te demande une photo, je découvre un beau mec brun, les yeux clairs. Plutôt bogoss. Ça fait longtemps que je n’ai pas eu l’occasion d’approcher un mec aussi beau.
Je n’avais pas vraiment prévu de sortir ce soir, d’autant plus qu’il est déjà 21 h 30 et que demain je me lève de bonne heure.
Aussi, ça me fait bizarre de partir ce cette façon, à l’improviste, pour un plan. En fait, je ne sais même plus si j’ai encore envie d’en faire, des plans sans lendemain. Les plans, j’ai un peu donné depuis un an. J’ai connu quelques bons moments, mais aussi pas mal de déceptions, de frustrations, de malaises.
Mais tant pis, tu me fais de l’effet, ta belle petite gueule et tes quelques mots très directs ont su faire mouche ce soir.
Tu précises que tu t’appelles Martin, que tu as 27 ans, et que tu te fais sucer « mais avec capote ».
Ça me paraît bizarre comme exigence, mais je valide et je prends la route. Tu n’es pas en ville, il me faut une vingtaine de minutes pour me rendre chez toi.
Tu habites une grande maison entourée d’une solide clôture métallique.
Je sonne à l’interphone et les deux battants du portail s’ouvrent aussitôt. Tu te tiens sur le seuil, devant la porte d’entrée de la maison et me fais signe d’avancer ma voiture. Je me gare sur l’allée en gravier blanc, pendant que le portail se referme lentement derrière moi.
Tu es encore plus beau que sur la photo – pour une fois il n’y a pas tricherie sur la marchandise – et tu es très, très grand, un mètre quatre-vingt-dix à coup sûr. Même un peu trop grand à mon goût, mais bien bâti, bogoss au sourire ravageur.
Tu portes un polo bleu avec col en V bien ouvert d’où dépassent d’appétissants poils bruns. Tu as vraiment une jolie gueule de mec. Tes cheveux bruns remontent vers l’avant en une sorte de houppette insolente et plutôt sexy.
Je rentre dans la maison et je suis impressionné par la taille de la pièce de vie. Elle abrite une cuisine design, un coin télé avec un écran plat démesuré, une cheminée circulaire en son milieu. Je me dis que, vu le standing, tu dois bien gagner ta vie.
— Tu vis seul dans cette grande baraque ?
— Non, je vis en couple.
— Avec une nana ou un mec ?
— Un mec.
— Et il n’est pas là ce soir ?
— Non, il est en déplacement.
— Il ne risque pas de rentrer ?!
— Ne flippe pas, il ne va pas rentrer avant plusieurs jours.
— D’accord…
Je n’aime pas vraiment l’idée d’être le gars avec qui tu vas tromper ton mec.
Mais tu es vraiment un beau morceau, mon charmant Martin ! En plus, tu as l’air d’un garçon sympa, et ça contribue à me mettre à l’aise. Je sens mes réticences céder les unes après les autres. Je ne peux faire autrement que te suivre.
Tu me conduis dans une chambre. Tu n’allumes pas la lumière, laissant juste filtrer l’éclairage du couloir à travers l’entrebâillement de la porte.
Les instants d’impatience, de curiosité et d’excitation qui précèdent la découverte de la nudité et de la virilité d’un beau gars inconnu résonnent en moi avec la même intensité à chaque fois. Ainsi, chaque fois ressemble ainsi d’une certaine façon à une première fois, à une énième première fois. Ce sont des instants magiques, presque mystiques.
Tu ôtes ton polo en silence. Je me déshabille à mon tour. Mon regard est happé par ce torse interminable qui se dévoile dans la pénombre, par tes épaules solides, par tes pecs saillants et parsemés par une bonne pilosité mâle. Je me déshabille à mon tour et je ne peux résister plus longuement à la tentation de chercher le contact avec ce beau corps, de lécher et mordiller tes beaux tétons. Je me laisse enchanter par la légère note parfumée qui se dégage de ta peau.
Mais très vite, tu poses une main sur mon épaule pour m’inviter à me mettre à genoux.
Je me laisse faire, je laisse tes envies de mec diriger les choses. Mes genoux touchent le sol. Tu ouvres ta ceinture en cuir, ta braguette, tu descends ton jeans et ton boxer et tu libères ta queue encore au repos. En général, j’aime déballer le cadeau par moi-même, à mon rythme. Mais tes gestes sont tellement assurés et chargés d’érotisme que je ne regrette pas que tu m’aies privé de ce bonheur.
Ta queue est déjà belle même avant d’être au garde à vous. Ton gland aimante mon regard et mes lèvres. J’ai très envie de la prendre en bouche direct, de goûter à sa douceur, de la sentir raidir entre mes lèvres. Mais toi, t’as prévu autre chose.
— Lèche-moi les boules…
Pendant que je te lèche les couilles, tu te branles pour faire raidir ta queue. Il ne faut pas longtemps pour qu’elle montre toute sa superbe.
Tu attrapes une capote préalablement posée sur un meuble à portée de main et tu en déchires l’emballage.
Je suis bien excité, et j’ai vraiment envie de te sucer. Tes désirs sont des ordres. Mais la capote me semble vraiment de trop. Jamais un gars n’a voulu que je le suce avec capote. J’espère encore te faire changer d’avis.
— T’es vraiment sûr que tu veux mettre une capote juste pour te faire sucer ?
— Oui, je n’ai pas confiance.
— C’est juste une pipe, je suis clean, et c’est moi qui prends le plus de risques.
— J’ai eu des problèmes par le passé, je ne veux plus vivre ça.
Ah oui, j’aurais dû m’en douter, tu n’en es pas à ton coup d’essai.
Je te regarde dérouler la capote, devant mes yeux, devant mes lèvres.
— Vas-y suce !
Dans le ton de ta voix, j’entends l’appel péremptoire de ton envie de mec. Ma libido embrasée, je m’exécute pour le plus grand des bonheurs. Je te pompe, je te sens frissonner, et je kiffe ça. J’adore être à genoux devant toi, me sentir dominé par ta taille, par ta virilité, sentir ton regard sur moi pendant que je te fais plaisir.
A genoux devant toi, soumis à tes envies, comme devant Jérém, soumis à ses envies, lors de nos premières révisions dans le secret de l’appartement de la rue de la Colombette.
Je suis terriblement excité, mais je sais que mon excitation pourrait carrément crever le plafond si seulement tu t’occupais un peu de mes tétons. Mais tu ne me connais pas, et tu ne peux pas le deviner. Alors, sans cesser de te pomper, j’attrape tes mains et je les approche de mes tétons.
Tu comprends vite le message et commences à agacer mes boutons d’amour d’une façon très plaisante. Mon excitation grimpe au ciel, mon corps et mon esprit sont secoués par une douce folie sensuelle. Je te pompe avec de plus en plus d’entrain, bien décidé à te donner un plaisir géant.
Le goût du caoutchouc n’est pas désagréable, mais je sais que cette pipe serait tellement meilleure sans. Pour toi, comme pour moi. J’essaie de redoubler d’efforts et de dextérité pour essayer d’oublier cette mince mais encombrante barrière entre nous. Tu sembles bien apprécier.
Et alors que je te pompe de plus en plus vite pour appeler la venue de ton orgasme, tu retires ta queue de ma bouche. Tu m’attrapes par les épaules, je me laisse guider. Je me retrouve la tête calée entre le mur et ton bas ventre. J’adore sentir la prise ferme de tes mains sur mes épaules. Tandis qu’au gré de tes va-et-vient, ta queue s’enfonce profondément dans ma bouche.
— Je vais jouir… je t’entends soupirer entre deux ahanements bruyants, alors que tes mains se crispent sur mes épaules, alors que tu es déjà en train de perdre pied.
Je t’écoute soupirer bruyamment ton orgasme, douce musique pour mes oreilles. C’est beau, c’est bon. Avec mes lèvres et ma langue, je sens ton jus chaud jaillir de ta queue et se loger derrière le caoutchouc, sensation terriblement excitante et terriblement frustrante à la fois.
J’aurais quand-même bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais tant pis. Provoquer et assister à l’orgasme d’un beau mec est toujours un cadeau, même si ça vient plus vite qu’on ne l’aurait voulu. L’important c’est que tu aies kiffé ce moment.
Tu te dégages de moi et tu prends une profonde et longue inspiration. Tu as l’air essoré.
Tu enlèves ta capote, tu ramasses l’emballage et mets tout ça dans du sopalin que tu avais également préparé à l’avance. Tu es bien organisé, la procédure semble bien rodée.
Sans te préoccuper si j’ai envie de jouir à mon tour, tu passes un pantalon de jogging et un t-shirt blanc. Tu es foutrement sexy. Je n’ai toujours pas joui, et j’ai toujours autant envie de toi, de plus en plus envie de toi. Tu pars jeter la preuve de ton infidélité à la poubelle de la cuisine, me laissant seul dans la chambre plongée dans la pénombre.
Ça y est, c’est déjà fini. Comme pour les tours de manège de mon enfance, le bonheur paraît toujours trop court. Tu voulais juste que je te suce. Je t’ai sucé, tu as joui, et c’est fini. J’ai très envie de jouir aussi, mais je trouve très excitant d’y renoncer, d’avoir fait le bonheur d’un beau mâle brun et de repartir avec mon excitation intacte. Je me dis qu’à la maison je vais bien me branler en pensant à toi, beau Martin, qui as juste voulu te faire sucer, sans la moindre intention de t’occuper de moi, à aucun moment. Oui, je vais bien jouir en repensant à cette excitation teintée de frustration !
Il ne me reste qu’à me rhabiller. Et c’est ce que je fais, avant d’aller te rejoindre dans le séjour.
A ma surprise, tu me proposes un truc à boire.
— Désolé pour la capote, mais je ne veux pas prendre de risque. Je suis en couple…
— Je comprends et c’est une bonne chose que tu ne veuilles pas filer des trucs à ton mec.
— Je ne veux pas de problèmes. Je fais ça avec tous mes plans.
— Tu vois d’autres mecs ?
— J’ai quelques réguliers, mais ils ne sont pas toujours dispos… et quelques extras, comme toi, ce soir.
Ça y est, je viens d’avoir confirmation de ce que j’avais pressenti, à savoir que je ne suis pas ton seul amant, car tu es plutôt du genre queutard invétéré. Je ne t’ai rencontré que depuis quelques minutes, je ne t’ai rien fait d’autre qu’une simple pipe, et je ressens déjà en moi ce frisson désagréable qui ressemble à de la jalousie. C’est stupide, je sais. Mais je ne peux m’en empêcher. Et je me surprends à me dire que j’aimerais bien passer du statut d’« extra » à celui de « régulier ».
Nous discutons un peu. Au fil de la conversation j’apprends que c’est en réalité ton copain qui gagne bien sa vie et qui contribue grandement à ce train de vie, ce même gars que tu trompes à tout va. Quant à toi, tu alternes les boulots et les périodes de chômage par choix, pour profiter du système et bosser le moins possible. Ça y est, je me sens désormais coupable de t’avoir permis de tromper ton mec une fois de plus. T’es vraiment qu’un petit con, un parfait branleur sexy !
Mais mon excitation n’est pas retombée, bien au contraire. Et toi, le torse enveloppé par ce beau t-shirt blanc, tu me fais grave envie. Je ne peux me résoudre à rentrer chez moi et à terminer ma soirée avec une simple branlette.
— Ça te dit pas de recommencer ? je te demande
— Quand, là, maintenant ?
— Oui…
— Non, pas là… pas ce soir.
— D’accord, tant pis. Mais si tu veux recommencer un autre jour, je suis partant…
— Pourquoi pas…
— On échange nos numéros de portable ?
— (Tu hésites) Je te le donnerai tout à l’heure.
— Non, pas tout à l’heure…
— Quoi ?
— Je sais ce que « je te donnerai mon numéro tout à l’heure » veut dire après un plan…
— Et ça veut dire quoi ?
— Ça veut dire tu ne me le donneras pas.
— Si, je te le donnerai.
— Alors pourquoi pas maintenant ?
— D’accord.
Je suis très surpris que tu acceptes. Car, au fond de moi, j’étais en train de me dire que mon insistance entraînerait un refus irrévocable.
Je note ton numéro dans mon portable et je t’envoie un « Nico » par sms pour que tu aies le mien.
Je suis content que nous ayons échangé nos numéros. Même si je doute très fort que ça servira à quoi que ce soit. Dès que j’aurai passé la porte, tu retourneras illico sur l’appli et tu passeras à autre chose. Avec ta belle gueule, tu peux avoir plein d’autres gars, plein d’autres « extras », sans même parler des « réguliers ». C’est un beau cadeau que tu m’as fait ce soir, mais je doute fort que Noël revienne aussitôt.
C’est quelque peu humiliant de se rendre compte que l’intérêt que nous porte l’autre a une durée de vie qui ne dépasse pas celle d’une capote.
Non, je ne pense pas que tu te serviras de mon numéro. Parce que tu n’as sûrement pas envie de remettre ça avec moi.
Alors que moi j’en ai bien envie. Ta belle gueule, ton corps solide, ton torse interminable, ta bonne queue, ta belle petite gueule, ton insolence m’ont conquis. Tout comme ton côté branleur impénitent. Ton sourire a été comme un rayon de lumière dans la nuit noire de ma solitude affective. Un rayon de bogossitude, de Masculin, qui a touché en moi des cordes sensibles dont je ne me souvenais même plus de l’existence.
Je te quitte en te faisant la bise, en appuyant bien sur « à bientôt », en essayant de m’imprégner le plus profondément possible de ta bogossitude, tout en me disant que je ne te reverrai pas, trop beau et trop jeune pour moi.
Je repars avec ma solitude, en repensant au bonheur que j’ai perdu un soir d’automne d’il y a bientôt 8 ans.
Les jours suivants, je repense régulièrement à toi, beau Martin. Chaque jour qui passe je me languis un peu plus de te revoir. La frustration n’est pas l’antithèse du désir, mais son exhausteur. J’ai terriblement envie de te reprendre en bouche, j’ai envie de te mettre en confiance et de te convaincre à me laisser te sucer sans capote, et peut être à me prendre aussi. Ça, avec capote, bien entendu.
Jour après jour, je guette un message de ta part, sur l’appli ou en sms, je guette sans y croire. Mais rien ne vient. Je crève d’envie de te relancer, mais je ne veux pas paraître pressant. Je prends sur moi, je ronge mon frein. Je laisse s’écouler toute une semaine, et la moitié de la suivante, avant de céder à la tentation de t’envoyer un petit message, comme une bouteille à la mer. Un message lâché sans trop d’espoir, mais avec un peu d’espoir quand même.
Au fond de moi, j’ai la lucidité de me dire qu’un bogoss comme toi, si beau et si jeune, ce n’est pas pour moi, pas plus qu’une fois en tout cas. Je me dis que ce qui s’est passé l’autre soir c’était un « accident », un « extra », comme tu m’as appelé. Je me dis que j’ai « fait l’affaire » parce qu’à ce moment-là tu n’avais pas autre chose à te mettre sous la dent, ou plutôt une autre bouche à mettre autour de ta bite.
Et, pourtant, je ne peux renoncer.
Moi : Coucou toujours pas de créneau pour remettre ça ?
Martin : Salut. Non désolé pas de créneau en ce moment…
Eh ben voilà, je le savais, le scénario écrit à l’avance suit son cours. « Tu ne peux pas », autant me mettre le cœur en paix.
Martin : … mais dès que j’en ai un je te fais signe avec plaisir.
Je sais que tu me mènes en bateau. Les jours passent, et aucun message ne vient. Au fond de moi, je sais que c’est foutu, qu’il n’y aura jamais de créneau. J’ai envie de te relancer encore, mais j’y renonce. A quoi bon ?
Non, je ne te reverrai pas, mon bel amant d’un soir. C’est stupide, mais ça me fait chier.
Heureusement, le taf accapare à fond mes journées. Mon écriture accapare mes soirées, une partie de mes nuits et mes week-ends. Se plonger dans son propre passé, dans sa vie d’avant, est un exercice qui demande beaucoup d’énergie.
Peu à peu, le petit béguin, la petite déception de cette rencontre sans lendemain s’estompe. De toute façon, je savais que ça se finirait de cette façon. Les rencontres sur les applis, c’est éphémère comme une bulle de savon. Et à fortiori les plans avec des gars maqués.
Et pourtant, un lundi soir, trois semaines après notre premier plan, tu m’annonces par sms que tu peux te libérer le lendemain. Je suis vraiment très heureux que tu aies repris contact, alors que je m’y attendais vraiment plus.
Le rendez-vous est fixé à 16 heures, chez moi. L’idée de te revoir me met du baume au cœur. Et de la trique à la bite. Ce soir je me branle en m’imaginant à nouveau à genou devant toi, en train de te sucer.
Le lendemain, mardi, j’organise ma journée en fonction de ce rendez-vous, pour finir plus tôt. Je suis chez moi à 16 heures pétantes.
Tu débarques avec presque une heure de retard. Mais qu’importe si j’ai couru toute la journée en vain, je suis très heureux de te revoir.
Aujourd’hui, tu es habillé d’un polo gris bien ajusté à ton torse élancé et à tes biceps, tellement ajusté que tes tétons pointent derrière le tissu. Tu es vraiment très beau, encore plus que dans mon souvenir. Et tes yeux clairs, et ton sourire, aïe aïe aïe, je craque !
Je te propose à boire mais tu déclines poliment. Je vois dans son regard que tu n’es pas venu pour boire un coup, mais pour tirer un coup. Je te devance dans le couloir, tu me suis dans ma chambre. Un instant plus tard, je me déshabille tout en te regardant te déshabiller. Tes gestes nets et calmes dégagent une certaine assurance. Tu sais que tu plais et ça se voit que tu as l’habitude de se dessaper, que tu es à l’aise avec ta nudité.
Tu viens vers moi et là, à ma grande surprise, tu me serres très fort dans tes bras. Je te serre à mon tour contre moi. Ce contact de nos corps me fait un bien fou. Je capte l’odeur naturelle de ta peau. Tu me serres de plus en plus fort, je me hisse sur la pointe de mes pieds et j’arrive à plonger mon visage dans le creux de ton épaule.
Il n’y a que ça de vrai, dans la vie, la proximité avec le corps d’un garçon. Cette accolade est à la fois douce et sensuelle. Je ne peux m’empêcher de poser des bisous sur ta peau, de laisser mes doigts se glisser derrière ton cou puissant et dans tes cheveux.
Puis, lorsque tes bras cessent de m’attirer contre toi, je caresse fébrilement les poils de ton torse, je titille tes tétons avec ma langue, j’hume les poils qui relient ton nombril à ta toison pubienne. Ta braguette est tendue par une bosse conséquente. Tu bandes déjà.
Délicieux effet d’optique, la position à genoux rend la plastique masculine encore plus impressionnante. C’est cette position qui sait apporter parmi les plus intenses sensations de soumission à la domination virile.
A genoux devant toi, torse nu, je me laisse happer par la douce tiédeur de ta peau, et par toutes les délicieuses petites odeurs qui semblent se dégager de ton érection encore emprisonnée dans le boxer.
Je laisse mon regard s’attarder sur ta ceinture, sur ton nombril, sur ta pilosité mâle, sur tes pecs, tes tétons. J’adore suivre cet angle de vision du bas vers le haut, jusqu’à rencontrer ta belle petite gueule au regard triomphant, jusqu’à m’enivrer de la contemplation de ta virilité. Une contemplation qui est un irrépressible appel au bonheur sensuel.
Cette fois-ci, je prends les devants, je défais ta ceinture, puis ta braguette, je provoque la bête conquérante à travers le coton. Je la fais languir, j’attends un peu avant de descendre le boxer, dernier rempart avant de pouvoir la revoir et la toucher à nouveau.
Je la libère enfin. Je lèche tes couilles, je te branle brièvement, autre instant de bonheur avant que l’immanquable capote ne vienne me priver du contact direct avec cette belle érection.
C’est vraiment dommage de sucer un mec comme toi sans pouvoir vraiment goûter à sa belle queue. Mais le beau cadeau de me laisser l’accès à ta virilité me suffit, et je m’en estime heureux.
Je te pompe avec entrain, tout en aiguillant une nouvelle fois tes doigts vers mes tétons. Tu te laisses sucer avec bonheur, tout en guidant mes mains sur ses fesses, leur indiquant de bien les malaxer, geste qui visiblement te fait grimper au rideau.
Plus je travaille tes fesses, plus tu sembles prendre ton pied. Ta main se pose sur ma nuque, et tes coups de reins se font plus puissants. Ta respiration se fait plus rapide, saccadée, et cela semble annoncer l’arrivée imminente de ton orgasme.
Je me prépare à sentir tes giclées chaudes remplir la capote comme la dernière fois, lorsque tu te retires de ma bouche. Tu enlèves la capote, tu te finis à la main. Une bonne séquence de giclées puissantes vient percuter mon torse, mon cou, mon épaule. Tu m’en fous partout.
Je m’essuie de tes émois, beau Martin, tout en te regardant te rhabiller, toujours sans te soucier si j’ai envie de jouir à mon tour. C’est très beau de regarder un mec passer ses fringues après l’amour.
Je te propose à boire, mais tu refuses, car tu es pressé. Tu veux être rentré avant ton mec.
C’est un brin humiliant de regarder un bogoss quitter mon appart juste après avoir tiré son coup, et penser qu’il n’est venu que pour se vider les couilles. Mais ça a un côté bien excitant aussi.
C’était à nouveau un super moment de sensualité et de plaisir. J’ai aussi beaucoup aimé cette étreinte avant la pipe.
Est-ce que je te reverrai ?
Pour mon plus grand bonheur, après cette deuxième rencontre, nos rendez-vous deviennent plus suivis. Ça y est, j’ai gagné mon statut de « régulier ». Nous nous voyons une fois par semaine, ou tous les dix jours.
Ça se passe parfois chez moi, parfois chez toi. Nous passons dans une chambre à coucher, nous nous déshabillons, nous nous serrons très fort dans les bras l’un de l’autre pendant quelques instants. Ça fait un bien fou de sentir tes bras m’attirer très fort contre toi, sentir ton torse chaud contre le mien, humer la délicieuse tiédeur de ta peau, balader mes mains dans ton dos.
Je ne comprends pas vraiment la signification de cette accolade que tu as instaurée à notre deuxième plan et à laquelle tu n’as jamais dérogé depuis, sorte de rituel qui semble se prolonger de plus en plus longuement au fil de nos rencontres, rituel que j’accepte avec bonheur, que je seconde avec plaisir et que je laisse durer tant que tu ne prends par toi-même l’initiative d’y mettre fin.
Je serais enclin à me dire que cela exprime un besoin de tendresse de ta part. Je le serais, si cela ne jurait par avec la nature de nos rencontres et de tes envies purement sexuelles.
Je n’ai jamais osé chercher tes lèvres – je me dis que tu ne voudrais pas ça non plus, car le baiser peut lui aussi transmettre une MST et cela irait à l’encontre de tes précautions – et tu ne m’as jamais montré l’envie de découvrir les miennes.
Peut-être que tout simplement, cette envie, ce besoin de chercher le contact avec mon corps est pour toi une sorte de préliminaire qui éveille ton excitation. Ce dont je suis certain, c’est qu’après ces accolades, tu bandes dur, et que tu n’as plus qu’à passer une capote et à me présenter ta queue protégée pour que je la suce.
Alors, je me mets à genoux et je te pompe. Toi debout et moi à genoux devant toi, comme toujours. Jamais tu n’as voulu faire ça sur un lit. Tu aimes me regarder, me dominer de toute ta taille pendant que je te pompe. Je le sais car, à chaque fois que je cherche ton regard, il est au rendez-vous, et je lis dans ses yeux la satisfaction du mâle en train de se faire sucer.
Je me demande si ce que tu attends de moi ressemble à ce que tu fais dans ton couple ou si, au contraire, cela est exactement ce que tu n’as pas dans ton couple, raison pour laquelle tu le cherches ailleurs. Je me demande ce que tu aimes faire au pieu avec ton mec, je me demande si tu aimes plutôt baiser ton copain ou te faire baiser. Ou les deux. Es-tu dominant ou dominé, que ce soit au lit, ou dans la vie de couple en général ? Je me demande ce que ça fait de goûter à ton jus, à se sentir défoncé et rempli par ta queue.
Nos rencontres ne durent parfois que quelques minutes, mais c’est toujours aussi furieusement excitant pour moi. Leur côté clandestin, impromptu, ainsi que la frustration de ne pas pouvoir aller plus loin, n’y sont pas pour rien.
Ça évolue quand même un peu. Depuis quelques temps, une fois que tu as joui, je te garde en bouche et je me branle jusqu’à jouir à mon tour. Tu attends que je me finisse. Et ce sont parmi les meilleurs orgasmes qu’il m’a été donné de vivre depuis longtemps.
Aussi, tu prends de plus en plus le temps après le sexe. Nous nous allongeons sur le lit, tu me laisses te caresser. Nous passons de longues minutes à discuter, de ton couple, je te parle même de ma vie d’avant, de Jérém, et de tant d’autres sujets. Entre nous s’installe peu à peu une certaine complicité.
Me sentir désiré par un garçon aussi beau et sexy ça fait un bien fou au moral. Car tu n’es pas qu’un garçon beau et furieusement sexy, tu peux aussi être drôle et attachant. Je trouve ton insouciance fabuleusement rafraîchissante.
Ces rencontres impromptues sont pour moi une bouffée d’oxygène qui me maintient la tête hors de l’eau. Elles me permettent d’éloigner la morosité et d’enchanter mon quotidien.
Avec toi, beau Martin, je trouve un certain équilibre. Je sais que je n’ai pas le droit d’espérer quelque chose de toi, à part quelques instants de bonheur sensuel de temps à autre. Notre relation est légère, sans prise de tête. Et elle me suffit. Elle suffit pour me faire me sentir bien.
Entre deux rencontres, je n’ai pas besoin d’autres plans. Te voir une fois par semaine, ça me fait du bien, ça m’apaise. Et ça me laisse du temps et la sérénité nécessaire pour me consacrer sérieusement à l’écriture.
Justin, septembre 2015.
Mercredi 16 septembre 2015.
En ce milieu du mois de septembre 2015, pour fêter mes 33 ans, j’ai cassé ma tirelire et je me suis offert une petite folie. Un rendez-vous au Madison Square Garden à New York avec Madonna et 20.000 autres Rebel Hearts.
— Tu chanteras et tu danseras pour deux, mon Nico, m'a lancé Elodie, ma cousine adorée, qui n’a pas pu m’accompagner, préférant rester avec sa petite famille.
— Tu lui passeras le bonjour de ma part, m’a glissé Stéphane, mon pote adoré, qui n’a pas pu m’accompagner, préférant rester auprès de son chéri.
Pour mon séjour en solo aux USA, l'idée de loger chez l'habitant me paraît d’emblée agréable. Sur internet, je survole les annonces et je tombe sur une offre qui retient mon attention. Situé entre Lower Manhattan et East Village, un loft bordé par une immense baie vitrée avec vue imprenable sur le skyline de la Grande Pomme.
Je clique sur l'annonce. Entre la photo principale et la description du logement, un petit rond avec un selfie des proprios. Une petite brune, Betty. Mais, surtout, surtout, surtout, un très charmant Justin. Un petit con à casquette avec des airs de petit branleur sexy en diable.
Je clique sur la photo, ça l’agrandit un peu. Le mec a vraiment l'air grave bandant dans son t-shirt blanc avec une échancrure plutôt affolante.
Ce n'est pas le logement le plus abordable. Mais, entre la vue imprenable sur New York et la bonne petite gueule de Justin, mon choix est vite fait. J’ai envie de le voir de près, ce petit branleur.
Et encore, à cet instant précis, je ne peux même pas encore imaginer, même pas de loin, même dans mes rêves les plus fous, ce qui va se passer entre toi et moi, petit con.
Lien vers l’épisode 50 "Petit branleur sexy (version 2023)".Dans les rues de New York, le même soir.
L’heure du concert approche. Je me dirige vers le Madison Square Garden à grand pas. Dans mes écouteurs, les chansons de l’album « American Life ». Elles aussi me ramènent loin dans l’espace et dans le temps, elles me ramènent à Capbreton, pendant sa convalescence, après son accident au genou.
L’excitation monte en flèche lorsque j’aperçois la foule qui se presse devant les entrées. Et ça me fait chaud au cœur. Madonna a beau ne plus vendre autant de disques qu’à la grande époque, ne plus passer en radio, faire des choix artistiques qui ne font plus l’unanimité, changer d’apparence et pas toujours dans le bon sens, abuser du bistouri. Après trente ans de carrière, elle demeure néanmoins une bête de scène capable d’aligner en quelques mois plus de 80 dates sur quatre continents, une icône pop capable d’attirer à elle près de deux millions de fans disposés à engager des sommes considérables pour la voir en vrai.
Comme d’habitude, elle se fait attendre. Le public l’appelle, se chauffe tout seul. Entre agacement et impatience, les fans n’en peuvent plus.
Lorsque l’intro vidéo démarre enfin sur des percussions aux basses rutilantes, lorsque les danseurs déboulent sur scène avec des costumes qui semblent sortis tout droit de l’armée des soldats de terre cuite de l’empereur Qin, voilà, la salle est en délire.
Mais lorsqu’elle apparaît enfin, enfermée dans une cage à 20 mètres du sol, la salle s’embrase carrément. On la retrouve comme on retrouverait une amie qu’on ne voit que très rarement, mais avec qui la communion spirituelle demeure intacte, comme si on s’était quittés la veille. Une amie avec qui on aurait fait les quatre cents coups, avec qui on partage d’innombrables souvenirs. Des souvenirs communs, ses chansons, auxquels chacun d’entre nous en accroche d’autres plus personnels. Une amie à qui on pardonne tout ou presque, car elle ne nous a jamais laissé tomber.
Les nouvelles chansons se mélangent aux anciens tubes incontournables. La puissante « Iconic » fait l’ouverture du show, « La vie en rose » s’invite dans la playlist et l’incontournable « Holiday » clôt la grande messe, comme à chacune de ses tournées.
Ses tenues se sont rallongées, elles sont plus couvrantes que par le passé. Les années ont passé, la Star ne souhaite plus montrer autant d’elle qu’auparavant. Pour entretenir le mythe, il vaut mieux parfois se montrer discrète. Niveau danse, la souplesse est moindre, l’assurance d’antan vient un peu à manquer. Dans les précédentes tournées, on avait l’impression, car l’illusion était savamment entretenue, que tout ce qu’elle faisait, danse, présence scénique, n’était qu’un jeu d’enfant accompli presque sans effort, qu’elle en avait toujours sous le champignon, qu’elle aurait pu faire encore mieux si seulement elle l’avait voulu. Désormais, on a l’impression qu’elle est à fond sur le champignon, qu’elle atteint ses limites. On voit qu’elle donne tout, comme elle l’a toujours fait sur scène, mais qu’elle ne pourrait pas donner plus. Et, surtout, qu’elle ne peut plus donner autant qu’avant. Elle en devient touchante.
Pour son dernier album, elle nous a tous un peu perdus, fans de la première heure et grand public, avec ses nouvelles productions et sa promo en demi-teinte, mais le show qu’elle nous offre est fabuleux, elle se rattrape de façon grandiose.
Car sa plus grande force, c’est sa présence, cette présence qui traverse les décennies, et ma vie, et qui en constitue l’un des rares éléments de stabilité, comme un repère, au milieu des tempêtes, et même de la plus grandes de toutes, celle qui m’a mis à terre il y a désormais presque huit ans, lorsque Jérém est sorti de ma vie.
Je sors du Madison les yeux pleins d’étoiles.
Il n'est que minuit, et la nuit new-yorkaise semble si jeune et si pleine de promesses. Tout grouille autour de moi, les gens, les rues, les voitures, les bruits de la ville, les enseignes clignotantes et les écrans géants illuminant Times Square comme en plein jour.
Je regarde la foule circuler autour de moi et, une fois de plus, je suis comme étourdi par toutes ces occasions, toutes ces rencontres possibles, toutes ces vies qui se croisent, qui s'effleurent sans que les destins se rencontrent. C’est la foire des occasions, des occasions manquées. Je me dis que, peut-être, dans toute cette foule, deux êtres faits l’un pour l’autre passent à côté l’un de l’autre sans se voir, comme dans un Mahjong avec beaucoup trop de tuiles.
Je ressens comme un état d’ivresse, j’ai l’impression de percevoir toute l’énergie de vie de la foule, une énergie qui semble se propager à travers le sol, courir dans les rues, sur le bitume et irradier en moi, comme si j’étais connecté avec tout ce qui est vivant.
Je suis à New York et j’ai l’impression que je ne me suis jamais senti aussi vivant. Je suis cueilli par une espèce d’immense euphorie. Dans cette ville immense et étrangère, tout semble tellement possible, y compris apprendre à vivre avec un passé douloureux, avec le manque, le déchirement, le deuil impossible.
Oui, la nuit est jeune, et il y a plein d'endroits où je voudrais aller. Des bars, gays, ou pas. Une partie de moi a envie de savourer tout ce qu’est capable d’offrir la Grande Pomme.
Je marche pendant une heure, sans arriver à me décider à franchir l’une ou l’autre des entrées en dessous d’enseignes toutes plus clignotantes et criardes les unes que les autres.
Le fait est qu’une force irrépressible, irrésistible, violente m’entraîne vers toi, P’tit branleur sexy.
Et je viens à ta rencontre, beau Justin.
Lien vers l’épisode 50 "Petit branleur sexy (version 2023)".Martin, automne 2015.
De retour de mon escapade à New York, je reprends mon taf et mon train train de vie habituel. Pendant quelques jours encore, mes pieds sont à Toulouse, mais mon esprit demeure sur un petit nuage au-dessus de la Grande Pomme, en compagnie de Madonna et de Justin. Car, les deux, chacun à leur façon, m’ont offert des sensations inoubliables.
Heureusement, tu es là pour amortir la chute, beau Martin. Je t’envoie un message pour te dire que je suis rentré de New York, et tu rappliques le soir même. Apparemment, mes bras atour de ton torse et mes lèvres autour de ta queue t’ont bien manqué. Après t’avoir fait jouir, autour d’un verre, je te parle de mon voyage, et même de Justin. Ma manœuvre n’est pas innocente. Au fond de moi, j’aimerais que tu te comportes comme Justin, que tu te laisses te sucer sans capote comme l’a fait Justin, que tu me baises comme l’a fait Justin. Je sais que tu pourrais avoir le potentiel pour.
Tu écoutes attentivement mon récit, l’air émoustillé. Je ne crois pas que ce soit un hasard si, aujourd’hui, pour la première fois où tu me demandes de te pomper une deuxième fois. Je n’arrive pas à te faire jouir, tu enlèves la capote et tu me gicles sur le torse. Sacré Justin, capable de faire bander un gars à 10.000 bornes sans même l’avoir croisé…
Je ne sais jamais quand tu vas revenir vers moi, ni même si tu vas revenir. Tu ne reviens que quand tu en as envie, et je sais que chaque fois peut être la dernière.
Je n’ai pas le droit de t’envoyer des messages le soir ou le week-end, et ce pour éviter que des notifications impromptues ne suscitent des interrogations chez ton copain.
J’ai le droit de t’envoyer des messages en journée, la semaine, mais je n’ai pas vraiment le pouvoir de provoquer des rendez-vous. C’est toi, qui ne bosse pas, qui est le maître de nos rencontres.
Je ne vis pas vraiment dans l’attente du rendez-vous suivant, dans le sens où cela ne m’obsède pas, ou plus. Apparemment je te plais aussi, tu me l’as fait comprendre. Et ça me fait du bien de me dire que tu kiffes les gâteries que je te réserve, et que tu tiens à recommencer. Une belle « victoire » pour moi, pour mon égo, qui pensait ne jamais te revoir après le premier soir. Qui ne pensait pas pouvoir « fidéliser » un gars aussi jeune et sexy que toi.
Parfois, je reçois un message dans l’après-midi me proposant un « entre quatre et six » pour le jour même. Car même si toi, petit branleur, tu as infiniment plus de temps à disposition que moi – car tu es toujours au chômage tout en assumant de ne rien faire pour que cela change – tu ne prévois jamais rien à l’avance, laissant tes envies du moment guider tes sorties et tes plans, avec la nonchalance d’un vacancier.
Parfois je suis dispo, et tu n’as pas envie. Et le lendemain, alors que j’ai une journée hyper chargée, tu m’envoies un message pour me dire que tu peux être chez moi « le temps de faire la route ».
Je me débrouille toujours pour ne pas te rater. Je change mes plans, je m’adapte, y compris quand ça ne m’arrange pas vraiment. Et une fois de plus tu te ramènes, avec ton physique avantageux, avec ta bonne petite gueule de petit con insolent et ton sourire ravageur qui me fait craquer et qui m’oblige à tout te passer.
Depuis un certain temps, nous nous voyons surtout chez moi. Ton copain voyage moins, le risque est plus grand de se faire surprendre. Tu es plus détendu chez moi.
Sur ma suggestion, tu as peu à peu pris l’habitude de t’allonger sur mon lit après l’orgasme, pour récupérer tranquillement.
J’aime bien que tu restes un peu, j’aime m’allonger à côté de toi, me caler contre toi, te caresser. J’aime discuter avec toi, en apprendre un peu plus sur ta vie, sur ta personnalité.
Ton côté « petit-con-branleur-et-je-m’en-foutiste-pour-qui-il-n-y-en-a-que-pour-sa-gueule » te rend craquant. Insolent, un brin égoïste, mais craquant. Tu es le genre de gars « tête à claques » qui me donne à la fois envie de te gifler et de te sucer à fond.
Une petite complicité s’installe entre nous. J’aime beaucoup te faire rire, je ne me lasse pas de voir ton magnifique sourire jaillir sur ton beau visage. Finalement, j’aime bien cette relation où rien n’est prévu, planifié à l’avance, où nous profitons des rares moments ensemble, tellement brefs qui me laissent toujours sur ma faim, avec un désir jamais vraiment assouvi. Lorsque je suis avec toi, beau Martin, je profite de chaque instant, car je sais qu’il pourrait être le dernier.
J’aime bien ton style, tes polos, mais aussi tes t-shirts noirs avec col en V. J’ai adoré ta tenue sexy à mort, un jour de pluie, lorsque tu avais juste passé un blouson en cuir sur la peau. J’avais été scotché en te regardant ouvrir lentement le zip et dévoiler centimètre après centimètre la pilosité brune de ton torse interminable.
De temps à autre, j’essaie de te proposer de te sucer sans capote, mais il n’y a pas moyen.
La seule fois où j’ai pu obtenir une petite variante à nos habitudes sexuelles, c’est celle où je t’ai demandé de me prendre. Contre toute attente, tu n’avais pas dit non. Tu avais enlevé la capote que tu avais passé pour la pipe et tu en avais déroulé une autre. Tu avais mis du gel et tu étais venu en moi, tu m’avais pris en levrette. Tu m’avais limé pendant un bon petit moment, et j’avais vraiment kiffé. J’avais espéré que tu viennes de cette façon, mais ça n’avait pas été le cas. Tu étais sorti de moi et m’avais giclé sur le dos.
C’est la seule fois où je t’ai demandé de me prendre. Car j’ai bien senti que tu l’avais surtout fait pour me faire plaisir, mais que ce que tu kiffais vraiment c’était de te faire sucer, toi debout, moi à genoux.
Alors, par la suite, je me suis contenté de te sucer du mieux que je le pouvais, tout en malaxant bien tes fesses.
Parfois, tu me fais m’allonger sur le lit, la tête sur le bord, renversée vers l’arrière, tu me limes la bouche dans cette position, jusqu’à t’approcher de l’orgasme. Puis, tu quittes ma bouche, tu quittes la capote, et tu me gicles sur le torse. J’aime bien sentir ton jus chaud sur ma peau.
Parfois, après m’être branlé pendant que tu me limes la bouche, je jouis peu après toi.
Et après chacune de nos rencontres, une fois chez moi, je me tape quelques-unes de mes meilleures branlettes.
Parfois, après avoir joui, lors de nos « séances câlins » sur le lit, tu laisses échapper des petites allusions à tes autres réguliers. Et à chaque fois je ne peux m’empêcher de ressentir une sorte de jalousie et d’agacement vis-à-vis de toi, beau Martin, qui, grâce à un physique avantageux et une sacrée propension à ne rien foutre, as le temps et l’opportunité de te taper d’autres gars pendant que je bosse.
Ça me fait chier que tu ailles voir ailleurs, alors que tu es mon seul amant. Mais au fond, je me dis que l’important c’est d’être finalement devenu l’un de tes plans réguliers, de pouvoir accéder régulièrement à ta bogossitude, à ta virilité.
Je m’évertue à trouver des sujets de conversation pour te garder le plus longtemps possible auprès de moi. J’essaie de m’intéresser à ta vie, tout en faisant attention de ne pas me montrer envahissant. Car je redoute l’instant où je t’entendrai me dire « allez, j’y vais » avec ton sourire de malade. Je n’ai jamais envie de te laisser repartir. Car je ne me lasse pas de ta présence, de ton beau sourire, de ton rire si charmant.
J’aime bien ta compagnie, ta présence. J’aimerais te retenir, j’aimerais que tu restes une nuit. Ça me manque une présence de mec au quotidien. Et j’aimerais que cette place vide dans mon lit, dans ma vie, dans mon cœur, te revienne. Je sais que ce n’est pas possible, je sais que tu ne quitteras pas ton mec, et encore moins pour moi. Et je sais que ce n’est même pas souhaitable, car je te connais trop, je connais tes démons, l’envers de ton apparence de petit copain parfait en tout point. Je connais ton fonctionnement, ton infidélité chronique, et je sais pertinemment que je ne pourrais jamais te faire confiance. Non, tu n’es pas du tout le gars qu’il me faut. Je sais qu’avec toi ma vie serait un enfer. Mais je ne peux m’empêcher de ressentir quelque chose pour toi, quelque chose qui va au-delà du simple désir charnel.
Un samedi soir où tu es resté un peu après le sexe, tu m’as dit que tu étais seul tout le week-end. Je t’ai proposé de rester manger avec moi. Mais tu n’as pas voulu. J’en déduis que nous n’en sommes pas à ce niveau de complicité. Et que nous ne le serons certainement jamais.
Et quand tu m’écris, peu après mon départ de chez toi :
Martin : C’était un très bon moment^^
Ça me met du baume au cœur.
Mercredi 21 octobre 2015.
C’est aujourd’hui que le passé, le présent et le futur se rejoignent. La très célèbre trilogie de « Retour vers le futur » s’articulait en effet autour trois dates clés, le 21 octobre 1985 pour le présent, le 21 octobre 1955 pour le passé, et le 21 octobre 2015 pour le futur.
Et nous y sommes, le futur est arrivé. Et même s’il ne ressemble pas vraiment à l’anticipation imaginée dans le film, même s’il n’existe toujours pas de skate à lévitation, il est bon de retrouver la trilogie qui a marqué mon enfance. Dans une salle de cinéma, qui plus est, avec un son d’enfer, dans une nuit marathon, entouré de fans.
Le Temps est au cœur de l’intrigue de la trilogie. Le passé, le présent, le futur. Comme une parabole de toute existence, de mon existence.
Le passé, j’aimerais le retrouver, les cinq merveilleuses années de Jérém&Nico. Si seulement c’était possible, juste pour une heure, de revivre l’intensité des nuits de la rue de la Colombette, des retrouvailles à Campan ou à Paris !
Car, putain comment je me sentais vivant à cette période de ma vie !
J’aimerais retrouver la folie de ce premier amour, ces grands huit émotionnels que seul Jérém savait provoquer en moi. J’aimerais retrouver la folie, l’insouciance, la candeur, l’inconscience, la spontanéité, la naïveté face à la vie de mes 18 ans.
Comment tu me manques, mon « P’tit Loup » ! Comment j’aimerais te tenir à nouveau dans mes bras, sentir à nouveau ton amour, t’avoir en moi une dernière fois, avoir ton jus en moi, dans ma bouche, retrouver ton goût de mec.
Que deviens-tu ? Avec qui fais-tu l’amour ?
Quant au présent, je ne lui demande pas grand-chose. J’ai arrêté d’avoir trop d’attentes à son sujet. Moins d’attentes, moins de déceptions. Une pipe de temps à autre au beau Martin, et de longues séances d’écriture à la fois pour me libérer du passé et pour ne pas oublier le passé. L’écriture est un exercice délicat et souvent contradictoire.
Quant au futur, je préfère ne pas trop y penser. Quand j’aurai terminé d’écrire, et si un jour Martin décide de se passer de ma bouche, je me retrouverai bien seul. Heureusement, Galaak Le Labrador Noir est là pour me faire des papouilles et me faire rire dans les moments de doute et d’angoisse. Surtout dans ces moments, d’ailleurs, comme s’il percevait ma détresse dès qu’elle se manifeste, et qu’il se sentait missionné pour chasser la morosité de mon cœur. Ce chien, je l’aime vraiment. Dog of my life.
Il est près de cinq heures du matin lorsque le train de Doc et de sa petite famille quitte les rails et s’envole dans le ciel. Je suis fracassé, mais heureux d’avoir retrouvé ces trois « feel good movies ». Car il y a dans ces films une insouciance et une légèreté qui donnent la banane à chaque visionnage. Ces films sont une sorte d’antidépresseur à base de pop culture.
Vendredi 13 novembre 2015.
C’est peu après 21h30, que l’horreur s’invite à nouveau à Paris, pour la deuxième fois en moins d’un an. Elle se déchaîne aveuglément dans les rues et dans les bistrots où des innocents passent une soirée agréable. Au Bataclan, où d’autres innocents assistent à un concert. Au Stade de France, où d’autres encore assistent à un match. Le monde entier est sous le choc.
Le 10 décembre, après son concert à Bercy, Madonna se rend Place de la République pour entonner quelques chansons improvisées en hommage aux victimes et pour affirmer que le Monde ne cédera pas à la barbarie.
Martin, décembre 2015.
Ce soir, après le taf, je me suis rendu dans un célèbre magasin de produits culturels du centre-ville. Enfin, ce qui a été jadis un célèbre magasin de produits culturels. La vente du savoir et du divertissement se déroulant essentiellement dans des monopoles étrangers installés sur le Net de nos jours, cet endroit ressemble de plus en plus à une enseigne de produits hi-tech et babioles en tout genre.
C’en est fini du temps des interminables rayonnages de disque, de cassettes ou de CD, le temps où les chanteurs étaient classés par catégories, par ordre alphabétique, le temps où l’on pouvait regarder, toucher, contempler un support physique. Le temps où l’on pouvait apprécier la valeur de la musique, qui était celui de la rareté.
L’écoute de la musique a beaucoup changé depuis quelques années. Le streaming nous a précipités dans l’ère de l’abondance, de la boulimie de la consommation musicale, de la dispersion des écoutes et des écouteurs, de la saturation des esprits. Quand il y a trop à consommer, on ne fait que goûter et gaspiller, on ne prend plus le temps de découvrir et d’apprécier les choses et leurs créateurs à leur juste valeur.
Les streaming sont à la musique ce que l’application est aux rencontres. Le triomphe de la surconsommation, de la quantité sur la qualité, de la frénésie sur le plaisir.
D’ailleurs, en accord avec le présent, je me suis rendu dans ce magasin pour acheter un accessoire pour mon smartphone.
C’est au moment de passer en caisse que je reçois un sms de ta part, beau Martin.
J’aime ce bonheur qui m’envahit après l’attente, après l’angoisse que tout soit fini pour de bon, lorsque le contact est renoué et tout redevient soudainement possible.
Ce soir, tu as envie de te faire pomper. Mais, une fois de plus, tu as la flemme de sortir. Tu me demandes si je peux bouger.
Évidemment, que je peux. Pour toi, je peux. Je bande presque déjà en te répondant : Oui, je peux !
Dans le message suivant, tu m’expliques que tu es seul, car ton copain est à nouveau en déplacement.
Quelque part, ça me pose toujours problème d’être l’amant d’un gars qui se fait grandement entretenir par un petit copain qui ne fait que bosser et qu’il remercie de cette façon, en le trompant en son absence. Je me dis que je n’aimerais pas être à la place de cet autre gars.
Mais je finis par faire taire mes réticences en me disant, comme toujours, que si tu ne le trompais pas avec moi, tu le tromperais avec quelqu’un d’autre. Tout comme j’arrive à faire taire mes derniers scrupules en pensant que je vais encore me taper un très beau gars comme toi.
Ce soir, pour me rendre chez toi depuis le centre-ville, j’emprunte un itinéraire différent que celui que je pratique habituellement, que ce soit depuis chez moi ou depuis mon taf.
Ce soir, le vent d’Autan souffle très fort. Ma voiture accuse la puissance des rafales lorsque je glisse dans la circulation du boulevard Carnot. Il est 19 heures environ, et le trafic est assez dense, mais fluide.
Au bout des allées Verdier, le hasard des choses fait que je m’arrête en première position devant le feu qui vient de passer au rouge.
Je n’ai plus trop l’occasion de passer par cette partie de la ville qui a été jadis la scénographie de ma vie d’adolescent, d’étudiant, de garçon amoureux. En fait, je crois que depuis huit ans j’évite de passer par là. Alors, ce soir, en retrouvant ces lieux familiers mais longtemps désertés, j’ai l’impression de revenir chez moi après une très longue absence.
La grille massive et sombre du Grand Rond se dresse devant moi, imposante, austère. Mon regard est attiré par le lourd portail obstinément fermé.
Les souvenirs défilent dans ma tête. Je me revois marcher dans les allées en direction de l’appartement de la rue de la Colombette, vers ma première révision pour le bac, porté par les rafales du vent d’Autan.
Je me souviens avoir eu envie de faire demi-tour, de peur de ne pas me sentir à l’aise seul à seul avec le gars qui me rendait dingue depuis le premier jour du lycée. Je me souviens m’être arrêté précisément sur le seuil de cette grille, après avoir traversé le Grand Rond, venant en sens inverse, incapable d’aller plus loin. Je me souviens d’avoir eu envie de faire demi-tour et de rentrer chez moi.
Ce soir, devant les grilles du Grand Rond, la mélancolie s’empare de mon cœur et met mon moral à zéro. Mais je sais qu’au bout de mon chemin tu seras là, beau Martin, et que, pendant une heure, tu me feras oublier mes démons. Ces derniers mois, ta présence, nos rencontres m’ont fait un bien fou. Elles vont vraiment me manquer !
Car, comme je l’ai toujours pressenti, tu n’auras été qu’une comète dans le ciel de mon existence. Il y a quelques semaines tu m’as annoncé que tu vas déménager dans le nord de la France en début d’année prochaine. Ton mec change d’affectation, et toi, tu le suis. Ce sont donc les dernières fois que nous nous voyons, que nous nous prenons dans les bras l’un de l’autre, que je te suce, que nous passons un bon moment ensemble. Je veux en profiter, tant qu’il est encore temps.
L’annonce de ton départ m’a mis un sacré coup au moral. Je sais que lorsque tu seras parti, je retrouverai ma solitude, et je recommencerai à gaspiller mon temps sur l’application de rencontre. Dans mon avenir, je ne vois que ça, des rencontres furtives, des plans d’un soir, suivis d’une solitude de plus en plus grande.
Le feu semble figé sur le rouge. L’attente commence à me paraître interminable. Plus je regarde cette grille, plus je repense à l’été de mes 18 ans, à cette époque de ma vie déjà lointaine. Et plus je me dis que le bonheur est derrière moi.
Lorsque le feu passe enfin au vert, j’embraie aussitôt et je m’empresse de contourner le Grand Rond. Je m’empresse de laisser derrière moi cette vision qui m’a fait trop intensément revivre les frissons, les inquiétudes, les angoisses, la naïveté, l’énergie, les espoirs en l’avenir, la confiance en la vie et l’amour du Nico qui a cessé d’exister lorsque le garçon qu’il aimait est parti, il y a bien longtemps déjà.Vos commentaires, toujours bienvenus !
Merci !Fabien.
 13 commentaires
13 commentaires
-
Par fab75du31 le 12 Octobre 2023 à 23:39
Juillet 2009.
C’est en rentrant à Toulouse (après mes vacances sur la côte en compagnie de Stéphane) qu’un immense coup de tonnerre déchire mon horizon. Il s’annonce par le biais du vent d’Autan qui souffle dans les rues de Toulouse.
Toute la presse en parle. Rodney Williams vient d’annoncer son retrait définitif du rugby professionnel à la veille du coup d’envoi de la Currie Cup, le tournoi de rugby d’Afrique du Sud auquel il devait participer au sein des Sharks.
Mais la nouvelle de son retrait soudain et « inexplicable » de la scène rugbystique est totalement éclipsée par une autre info bien plus croustillante pour la presse à scandale. Rodney Williams vient de faire son coming out dans un talk-show sur une grande chaîne de télévision anglaise. Et, de ce fait, devant la Terre entière.
La photo par laquelle le « scandale » avait éclaté était parue dans un canard anglais à gros tirage. L’image, prise par téléobjectif et par ailleurs assez floue, montrait deux silhouettes masculines au bord d’une piscine, dans une attitude qui semblait de grande proximité. On y voyait Jérém de dos, je n’ai pas eu de mal à reconnaître son dos musclé et ses tatouages, et Rodney devant lui, à moitié caché. Les deux garçons semblaient en train de s’embrasser, ou en passe de s’embrasser. Une hypothèse promue par un titre écrit en gros caractères dégoulinants d’encre rouge et suggérant le « scandale » :
BOYS HAVE FUN !
Les noms de Rodney et de Jérém y étaient cités, avec une allusion malicieuse à la nature de leurs véritables relations.
A l’intérieur du canard, d’autres photos, moins explicites mais non moins sensuelles, affichant leur demi-nudités, les torses musclés sortant des maillots de bain, des sourires, une complicité visible.
L’« article », ou plutôt l’ensemble de ragots accompagnant les photos, parlaient d’amitié particulière, avec des allusions vaseuses.
Pendant plusieurs jours, il n’y avait eu aucune réaction de la part des intéressés. Puis, l’interview de Rodney, tombée par surprise, avait fait l’effet d’une bombe. Et elle avait été relayée par la plupart des médias.
Je n’ai pas eu de difficultés à retrouver ses propos sur Internet.
Ça démarre très fort, à partir du titre de l’article : « Il est temps que la honte change de camp ».
— Rodney Williams, comment avez-vous vécu la publication de ce fameux article ?
— Mal, très mal. Ma vie privée ne concerne que moi. J’étais dans un espace privé, j’ai tout fait pour rester discret.
— Mais vous êtes un personnage public, et votre vie intéresse le public…
— Je suis un rugbyman professionnel. Enfin, je l’étais, jusqu’à il y a peu de temps . Mes performances sportives concernaient le public. Je le répète, ma vie privée ne concerne que moi. Je n’ai jamais cherché à m’afficher, il aurait tout simplement fallu respecter cela.
— Comment ces « révélations » sur votre vie privée ont été accueillies autour de vous ?
— Cette histoire m’a attiré de la haine, de l’hostilité, mais aussi des soutiens. Ma famille me soutient. Les gens intelligents me soutiennent. Quant aux autres, je ne porte aucun intérêt à leur sujet.
— Pourquoi quitter le rugby alors que vous deviez participer à la Currie Cup ?
— Je sais qu’après cette histoire j’aurais trop de pression à gérer, et je ne pourrais pas être au top de ma forme. J’arrête avant le tournoi de trop. Et puis, j’ai passé l’âge de me faire emmerder.
— Si je comprends bien, votre retrait du rugby professionnel s’est fait sous la pression médiatique…
— Vous comprenez très bien. Dans l’absolu, c’est triste que cela se passe de cette façon. Mais cette histoire aura au moins permis d’attirer l’attention sur quelque chose d’important.
— Vous pensez à quoi ?
— Je pense au fait que l’orientation sexuelle n’a aucune influence sur ce qui définit l’individu par ailleurs.
— Expliquez-vous.
— Il me semble pouvoir dire, au vu de mon parcours dans le rugby, que j’ai eu une belle carrière, que j’ai de très bonnes statistiques. Je pense que j’ai été un bon joueur, sinon on ne m’aurait pas fait jouer dans l’équipe nationale, non ? J’ai joué dans le top du rugby anglais et international, et ce, malgré la pression que j’ai ressentie sur moi pendant toute ma carrière.
— De quelle pression voulez-vous parler ?
— La pression de l’homophobie dans le milieu sportif. J’ai dû mentir sur mon orientation depuis mon adolescence, pendant plus de vingt ans, pour avoir la paix et mener à bien ma carrière. Je sais qu’en venant ici ce soir je vais en prendre plein la gueule, mais je m’en fiche. Il est grand temps que les choses bougent, et il n’y a qu’en libérant la parole qu’elles peuvent bouger. J’affirme que tout sportif doué doit pouvoir trouver sa place dans le rugby, indépendamment de son orientation sexuelle.
Oh, Rodney, il me semble que j’ai déjà lu ces mots ailleurs, « regardless of their sexual orientation », dans un tract associé au livret d’un CD qui est précieux à mon cœur.
— J’affirme que ce qui compte est le résultat sportif d’un joueur, et que ce qui se passe dans son pieu ne concerne que lui et la personne qui accepte de le partager avec lui.
— Comment M. Tommasi a vécu toute cette histoire ?
— Mon coming-out ne concerne que moi. Je viens vous parler pour dire que oui, je suis gay, gay et fier de l’être, et pour demander qu’on arrête de me poursuivre avec des téléobjectifs et avec des micros. Je viens demander qu’on fiche la paix à ma famille. Je ne suis pas une bête de foire, je suis comme tout un chacun, j’ai besoin d’aimer et d’être aimé. Et le fait que je préfère aimer un garçon plutôt qu’une fille ce n’est qu’un détail. Fin de l’histoire, il n’y a rien d’autre à rajouter.
— Vous êtes le premier rugbyman connu à faire son coming-out. Mais vous n’êtes certainement pas le seul homosexuel dans le rugby professionnel.
— Non, je ne suis pas le seul. Il y a d’autres joueurs homosexuels dans le rugby et dans les autres sports, et ils se cachent pour avoir la paix et ça les mine. Vous n’avez pas idée de l’énergie que ça demande de faire semblant d’être celui qu’on n’est pas à longueur de temps, de mentir aux gens qu’on aime, qu’on admire, qu’on respecte. C’est un immense déchirement que de devoir choisir entre sa carrière sportive et son bonheur personnel.
Et maintenant il est grand temps que tout cela change, il est temps que la honte change de camp.
Il est temps que la honte change de camp. C’est le mot de la fin, un très joli mot de la fin. Par le biais de cette interview, Rodney fait un joli doigt d’honneur à ceux qui l’ont harcelé, et il le fait avec panache.
Mais pour un Rodney qui ose, combien de sportifs souffrent de devoir « choisir entre sa carrière sportive et son bonheur personnel » ?
Je sais que Jérém a toujours souffert de ce choix sans cesse posé dans sa vie de rugbyman. Et les mots clairs et percutants de Rodney m’ont ému, car ils m’ont fait prendre la mesure de l’ampleur de ce déchirement.
Dans les quelques photos illustrant l’article, l’ex-rugbyman est très élégant, très en valeur, très beau, l’air épanoui et bien dans ses baskets. Je comprends très bien que Jérém puisse être fou de ce garçon.
Lorsque Jérém a rencontré Rodney, il a probablement cru pouvoir enfin concilier les deux. Mais la réalité a fini par le rattraper.
Toute cette histoire m’a mis dans un état de fébrilité immense. Mille questions se bousculent dans ma tête. Où est donc passé Jérém ? Comment va-t-il ? Comment vit-il toute cette histoire ? Est-ce qu’il va poursuivre sa carrière dans le rugby ou pas ? Est-ce qu’il est revenu en France ou va revenir en France ? Est-ce qu’il est toujours avec Rodney ? Est-ce qu’il est entouré, soutenu ?
J’aimerais tellement être à côté de lui en ce moment difficile. Je ne peux rester les bras croisés sans rien faire, sans rien savoir.
— Oh Nico… il est reparti en Australie, m’annonce Maxime, d’entrée, en décrochant. Il n’est même pas passé nous voir, il est parti juste après la publication de l’article.
— Et le rugby ?
— Cette fois-ci, je crois que c’est fini pour de bon.
— Comment il va ?
— Je pense qu’il a besoin d’être loin de tout ce bordel et de se changer les idées.
— Seul ?
— Je ne sais pas…
— Tu sais pas si Rodney est allé le rejoindre ?
— Je crois que c’est prévu… il finit par admettre.
— On peut le joindre ?
— Non, pas vraiment.
— Il a un portable ?
— Pas pour l’instant. Je crois qu’il n’en veut pas. Il rappellera quand il sera prêt.
— Passe-lui le bonjour de ma part, je pleure, si tu en as l’occasion, et dis-lui que je l’aime toujours.
— J’aurais tellement aimé que tu demeures mon beau-frère, Nico !
La nouvelle du retrait définitif du rugby de Jérém et de sa nouvelle fuite en Australie me plonge dans un état de détresse et de frustration indicibles.
La vie de l’amour de ma vie a été traversée par un ouragan qui a tout emporté sur son passage et je ne peux rien faire pour l’aider. Je n’ai pas de mal à imaginer ce qu’il ressent, à quel point il doit se sentir humilié après ce nouvel outing si médiatique, face à cette photo à la une d’un tabloïd à la vue de tous.
Il doit être dans une colère noire, du fait que tout ce bordel l’oblige à renoncer à sa carrière au rugby. Il doit en vouloir à la Terre entière.
Je sais ce que le rugby représente pour lui, et j’imagine sans mal sa souffrance, son déchirement, le sentiment d’injustice et d’immense gâchis qu’il doit ressentir au fond de lui. Je suis moi aussi profondément en colère. Pour un scoop, pour une photo tapageuse à la une, on n’hésite pas à gâcher la vie de quelqu’un. C’est insupportable.
J’en viens à souhaiter que Rodney soit à ses côtés pour le soutenir et l’aider à surmonter cette épreuve. Au vu de l’interview que je viens de lire, je me dis que Rodney a l’air d’être un garçon mentalement très solide, et c’est tout ce dont Jérém a besoin en ce moment. Je me dis qu’il saura s’occuper de lui, peut-être mieux que je le pourrais dans une telle circonstance.
Je me demande également comment il a vécu le fait que Rodney fasse son coming-out…
Je suis super inquiet. J’espère vraiment que Rodney ne l’a pas laissé tomber.
Pendant quelques jours, mon esprit est traversé par l’idée d’acheter un billet d’avion et partir à sa recherche. Je suis prêt à cramer toute mon épargne, à traverser la moitié de la planète pour aller voir comment il va. Même si je dois me faire virer de mon travail, même si je devais trouver Rodney à ses côtés.
Mais comment faire, alors que je ne sais pas du tout dans quel coin de cette immense île-continent le chercher ?
Puis les jours passent, et je finis par me dire que s’il est reparti là-bas, c’est qu’il sait qu’il y sera bien. Il y a déjà passé plusieurs mois après notre agression, et il a dû penser qu’il y serait bien à nouveau. A 16 heures d’avion de ses emmerdes, il pourra redevenir un garçon anonyme, loin des ragots et de la pression médiatique. C’est sans doute ce qu’il souhaite désormais comme nouvelle vie.
Je te souhaite d’être heureux, mon Jérém !
Vendredi 16 octobre 2009.
Jérém a 28 ans.
Jérém, où es-tu, que fais-tu, mon Jérém ?
Jeudi 24 décembre 2009.
Jérém, où es-tu, que fais-tu, mon Jérém ?
Jeudi 31 décembre 2009.
Jérém, où es-tu, que fais-tu, mon Jérém ?
***
L’année 2010.
Janvier 2010.
C’est au début de la nouvelle année, lors d’une nuit au B-Machine, où je me suis rendu seul suite à un forfait de Stéphane, que je tombe sur Matthieu. Nous échangeons quelques regards, puis il vient me parler. Nous finissons la soirée chez lui, nous couchons ensemble.
Matthieu est un garçon doux et tendre. Il me propose de nous revoir. J’accepte son invitation et nous nous retrouvons une, deux, trois fois. Nous nous faisons un resto, un cinéma, une balade, nous recouchons ensemble.
Au fil des rencontres, je réalise qu’il s’attache à moi. Et, très vite, ça me fait peur. Moi qui me sens rejeté à chaque fois qu’un gars quitte mon appart ou que je quitte le sien avec la certitude que je ne le reverrai pas, pour une fois qu’un petit gars semble vouloir autre chose, ça me fait fuir.
Je me demande ce qui cloche chez moi. Pourtant, j’adore ce petit mec, il est touchant, câlin, et je le sens sincèrement amoureux. Le fait est que je ne me sens pas amoureux de lui. Je constate un décalage de plus en plus marqué entre nos attentes respectives, et je ne veux pas laisser les choses aller trop loin, jusqu’à ce qu’elles m’échappent des mains. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs que j’ai faites avec Ruben, je ne veux pas le laisser espérer et le blesser plus tard, quand il se rendra compte que ses sentiments ne sont pas réciproques. Et je sais que plus le temps passe, plus la mise au point sera douloureuse.
J’aimerais ressentir la même chose que Matthieu, avoir les yeux qui pétillent quand je le regarde, le cœur qui bat la chamade à chaque fois que je pense à lui, mais ce n’est pas le cas.
J’ai l’impression que je suis désormais incapable de retomber amoureux, comme si quelque chose avait cassé au fond de moi. Stéphane a raison, le problème c’est que je n’arrive plus à faire confiance, et je n’y arrive plus parce que j’ai trop peur de souffrir à nouveau, parce que j’ai une peur bleue de l’abandon.
Mais la raison est peut-être ailleurs. J’ai l’impression que mon cœur est comme ces enceintes sans fil qui ne supportent qu’une connexion à la fois et qui ne peuvent se connecter à un nouvel appareil sans être d’abord déconnectés de l’appareil auquel elles étaient connectés auparavant.
Comment me déconnecter de Jérém ? Lui, qui hante toujours mon cœur, mon esprit, mes souvenirs, jusqu’à mes baises ?
Mon regard n’a de cesse de rechercher les gars bruns, le corps dessiné, la peau mate, un brin macho et dominants. Dans chaque gars que je croise, dans chaque sourire, dans chaque braguette, je te cherche toi, mon Jérém.
J’ai fini par parler à Matthieu et lui dire que je ne suis pas prêt pour une relation suivie. Il m’a dit qu’il était prêt à m’attendre. Nous nous sommes revus encore une fois, mais j’ai dû me montrer tellement distant qu’il a fini par ne plus me rappeler.
Samedi 16 octobre 2010.
Jérém a 29 ans.
Jérém, où es-tu, que fais-tu, mon Jérém ?
***
L’année 2011.
L’année 2011 est jalonnée comme les précédentes par la complicité avec Stéphane, les sorties dans les bars et boîtes gays toulousaines, et la frustration de ne pas savoir aller au-delà de rencontres furtives.
Au printemps, une nouvelle série, « Glee », met en scène des personnages gays et lesbiens et remet au goût du jour des grands classiques de la musique contemporaine.
L’épisode 15 de la saison 1 achève de conquérir mon cœur. Titré « La puissance de Madonna », cet épisode est un hommage haut en couleur pour celle que j’admire toujours autant. La version de « Vogue » par Sue Sylvester est un petit chef d’œuvre à la fois fidèle à l’original et plein d’humour.
16 octobre 2011.
Jérém a eu 30 ans. 30 ans, c’est le changement de décennie, c’est une sorte de tournant dans la vie, c’est l’un de ces anniversaires que l’on fête tout particulièrement. Et c’est encore un anniversaire que nous ne fêterons pas ensemble.Avec qui le fêtes-tu, mon Jérém ?
***
L’année 2012.
L’année 2012 démarre fort. Début février, Madonna est la vedette de la mi-temps du Superbowl. Débarquant sur scène dans un char tiré par une légion de beaux mâles, elle donne un spectacle grandiose, accompagnée par le beau Brahim, son dernier toy-boy en date, et entouré par la troupe du Cirque du Soleil.
Ça laisse présager que du bien pour la tournée qui est annoncée pour l’été. Dès l’ouverture des préventes le lendemain du Superbowl, j’achète deux tickets pour Barcelone, en juin prochain. Deux tickets car, évidemment, Stéphane est partant à 200% pour partager ce moment avec moi.
Le nouvel album sort fin mars et il tourne en boucle dans mon lecteur. Coup de cœur pour la puissance du titre « Girl Gone Wild » accompagné d’un clip en noir et blanc très esthétique et très très gay.
À Saint-Pétersbourg, une loi réprimant « la propagande auprès des mineurs de la pédophilie, l'homosexualité, la bisexualité et du transsexualisme » est votée au printemps. En réponse à cette loi, Madonna déclare sur son site officiel : « Je viendrai à Saint-Pétersbourg pour soutenir la communauté gay […] et dénoncer cette atrocité ridicule ».
Juin 2012.
Le 20 juin, le Palau San Jordi à Barcelone est plein à craquer. Stéphane et moi attendions ce moment avec impatience. Et le spectacle va même au-delà de nos attentes. De celles de Stéphane encore plus que des miennes, car c’est la première fois qu’il assiste à un spectacle de Madonna.
Nous en prenons plein la vue et plein les oreilles. Le plaisir est toujours décuplé lorsqu’on se rend à un concert en compagnie de quelqu’un qui partage notre admiration pour l’artiste sur scène. Je repense au concert de 2001 à Londres avec Elodie. Je repense surtout au concert de 2006 avec Jérém. Et j’ai envie de pleurer.
Mais je ne veux pas laisser la nostalgie et la tristesse gâcher ce moment. Alors je danse un peu plus fou, je chante un peu plus fort.
Août 2012.
Elle a tenu parole. Lors de son concert du 9 août 2012 à Saint-Petersbourg, Madonna fait distribuer des bracelets roses au public. Des centaines de drapeaux arc-en-ciel avec l'inscription « No Fear » flottent dans la salle. Entre deux chansons, elle tient le discours suivant :
« Je suis ici pour dire que la communauté gay, les gays qui sont ici ce soir, et tous les gays du monde, ont le droit d'être traités avec respect, dignité, compassion et amour.
Pour tous ceux qui citent la Bible, qui utilisent Dieu pour stigmatiser la différence, je rappelle que Jésus-Christ, Mahomet, Bouddha et Moïse ont tous prêché : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! » Vous ne pouvez pas utiliser la religion ou le nom de Dieu pour maltraiter les autres ! ».
Je réitère l’expérience du MDNA Tour, en solo, le 21 août à Nice.
15 septembre 2012.
Aujourd’hui, j’ai 30 ans. Et je réalise que, contrairement à ce que j’avais voulu penser jusqu’ici, ça me fait quelque chose de changer de décennie. Je ne suis plus un gamin, et j’ai l’impression que le temps passe de plus en plus vite, qu’il me file entre les doigts.
Je me dis que je dois arrêter de vivre dans le passé, que je dois m’en déconnecter définitivement et résolument, que je dois aller de l’avant et réussir à aimer à nouveau. Car il n’y a que lorsqu’on aime vraiment qu’on est pleinement heureux. Mais je ne sais toujours pas par où commencer.
16 octobre 2012.
Aujourd’hui, Jérém a 31 ans. Ça va faire bientôt cinq ans qu’il a disparu de ma vie. Bientôt il aura passé plus de temps passé loin de moi qu'avec moi. Je n’ai pas de nouvelles de lui. Je n’ai pas vraiment cherché à en avoir. Tout ce que je sais de lui, c’est qu’il est reparti en Australie au lendemain du coming out de Rodney, que ce dernier l’a rejoint là-bas, et qu’ils sont toujours ensemble. Du moins, cela était vrai il y a trois ans. Si c’est toujours le cas à l’heure actuelle, il aura bientôt passé plus de temps avec lui qu'avec moi.
Novembre 2012.
Annoncé pendant la campagne du nouveau Président de la République, le projet de loi pour le « mariage pour tous » est enfin présenté en Conseil des Ministres. A l’instant où l’info paraît dans les médias, les passions se déchaînent.
Toujours en novembre 2012.
Un soir de novembre, chez Stéphane. En essayant de jouer avec Gabin, je constate que son allure est moins vive qu’auparavant, son pas plus lourd, que son envie de jouer est moins flagrante. Au cours des derniers mois, j’ai vu apparaître de plus en plus de poils blancs sur son menton et ses babines, et son attitude changer peu à peu.
Quatorze ans, le toutou, c’est un âge vénérable. Et il est toujours aussi mignon, un véritable aimant à câlins. Je profite de chaque occasion pour lui faire des papouilles, et Stéphane aussi.
Dans le regard de ce dernier, je vois toujours la même indéfectible affection, mélangée cependant à une tristesse qui ne le quitte plus. Je sais à quoi pense mon pote en regardant Gabin. Il pense aux bons moments passé avec le Labranoir, mais aussi au temps qu’il n’a pas pu lui consacrer car accaparé par le quotidien. Mais aussi, et surtout, à la grande inconnue, le temps qui lui reste à partager avec.
La mignonnerie de Gabin me donne envie d'avoir moi aussi un compagnon à quatre pattes. Je décide de sauter le pas et je passe commande à un élevage de la région. Ce sera un Labrador aussi, et il sera noir aussi. Une portée est annoncée pour la mi-décembre, pour une livraison en février.
A partir de là, l’attente est fébrile.
Décembre 2012.
C’est dans la nuit entre le 10 et le 11 décembre, vers deux heures du matin, que la portée de mon futur Labranoir vient au monde. Quelques jours après, je suis invité à voir la portée, et Stéphane m’accompagne. Devant cette débauche de minuscules boules de poil adorables, quatre noires et trois chocolat, mon pote craque et en commande un lui-aussi. Un noir, bien évidemment.
— Il tiendra compagnie à Gabin… il me dit, les yeux embués de larmes, et ça lui fera son stage de « labradorisation »…
Je sais qu’il pense surtout : « Il remplacera Gabin. Et au moins, il l’aura côtoyé pendant un certain temps ».
***
L’année 2013.
L’année 2013 en France commence de la même façon que s’est terminée la précédente, dans un climat de profonde division de l’opinion française au sujet d’une loi par laquelle en réalité la majorité de Français n’est pas du tout concernée. Chacun a son mot à dire, nombreux sont ceux qui s’occupent davantage du cul d’autrui que du leur. Ça manifeste dans tous les sens, pour et contre.
Manifester en soutien d’une loi ouvrant des droits, c’est chose honorable.
Manifester pour que les inégalités persistent, c’est une abomination.
Une illustration circulant sur Internet résume à elle seule l’absurdité de toute cette haine et ces clivages liberticides.
Devant tant d’hypocrisie et d’intolérance, j’adhère à la proposition de Stéphane de participer à l’une des manifestations de soutien à la loi Taubira.
— Même si on est différent des autres, on n’en est pas moins quelqu’un, il me glisse, pendant que nous défilons. Et à ce titre, nous devons avoir les mêmes droits que tout le monde .
Jeudi 14 février 2013.
C’est aujourd’hui que nos deux mini toutous nous sont livrés. Le mien s’appellera Galaak et celui de Stéphane, Gold. Les deux frères ont bien grandi depuis notre visite après leur naissance, et avec leur bidou bien rond et leurs yeux tristes et pleins d’amour, ils sont vraiment à craquer.
Les regarder jouer ensemble avec leur démarche pataude est un véritable régal. Et voir Gabin retrouver des attitudes de chiot en jouant avec les deux mini-labradors est particulièrement émouvant.
Printemps 2013.
La loi finit par passer malgré les immenses tensions l’entourant tout autant dans les institutions que dans la rue, et elle rentre en vigueur au printemps 2013.
Mardi 18 juin 2013.
Après quelques semaines difficiles, cette nuit Gabin est parti rejoindre les étoiles. Stéphane est inconsolable. Je reste dormir chez lui, j’essaie de lui apporter mon soutien. Tout comme nos chiots qui ressentent notre tristesse, tout en nous apportant des torrents de tendresse et de réconfort.
La vie n’est qu’un emprunt, on ne fait que passer.
Octobre 2013.
C’est peu de temps après mon anniversaire, lors d’une sortie au Shangay, que Stéphane fait la rencontre d’un très charmant Iban, beau garçon d’origine basque d’une quarantaine d’année, pâtissier de son métier. Entre les deux, l’étincelle est immédiate, ils deviennent très vite inséparables. Ils ont l’air si heureux, c’est beau à voir, et je suis très heureux pour eux.
Même si cela signifie que mon meilleur pote a désormais moins de temps pour moi. Et que je perds mon compagnon de sorties, mon mentor, mon conseiller, le phare qui m’a guidé pendant la longue nuit de bourrasque que j’ai traversé depuis ma séparation d’avec Jérém, et qui n’est pas tout à fait terminée.
Je sais bien qu’à 31 ans je ne peux pas continuer à compter sur les autres pour avancer dans ma vie. Depuis quelques années, Stéphane m’a été d’un grand soutien. Son nouveau bonheur est peut-être un signe du destin, le signe qu’il est peut-être temps que j’apprenne à avancer seul, sans la béquille d’un confident dédié.
N’empêche que le bonheur des deux tourtereaux et le changement soudain de ma relation avec mon meilleur pote me mettent un grand coup au moral.
Que vais-je devenir sans lui ?
Décembre 2013.
En réalité, Stéphane ne m’a pas totalement lâché. Je suis régulièrement invité à dîner chez lui, ou à partager des activités, comme des séances cinéma. Mais ce n’est plus pareil. Justement parce que la plupart du temps je revois Stéphane en compagnie de son Iban. Dès lors, notre complicité ne peut plus être la même qu’auparavant. Je revis ce que j’ai vécu avec ma cousine Élodie lorsqu’elle a rencontré son futur mari, je perds une partie de cette connivence qui faisait l’essentiel de notre relation.
Nos échanges quotidiens par messagerie ont été davantage épargnés, mais cela ne remplace pas la présence physique d’un ami.
Peu avant Noël, deux mois à peine après leur rencontre, le beau Basque emménage chez Stéphane. Mon meilleur pote est vraiment amoureux, et Iban semble bien le lui rendre.
Je donnerais cher pour tomber à nouveau amoureux, pour revivre des frissons comme en 2001, pour retrouver l’inconscience et l’innocence de mes dix-huit ans, pour me lancer tête la première dans une histoire folle, sans filet, sans peur, et aimer, totalement, avec les tripes et le cœur uniquement, sans que le cerveau oppose ses peurs à chaque rencontre, à chaque instant. Je donnerais cher pour arriver à lâcher prise, complémentent, pour me laisser transporter là où le cœur m’amènerait.
J’aimerais ressentir en moi le feu qui brûlait en moi en 2001, cette énergie inépuisable qui fait traverser des fleuves immenses et escalader les montagnes les plus imposantes. Mais cette force j’ai l’impression de l’avoir perdue, à tout jamais.
En vrai, ce ne sont pas des frissons « comme » en 2001 que je voudrais revivre, mais bel et bien « les mêmes » frissons qu’en 2001, ceux de la découverte de l’amour, du premier amour, et je voudrais surtout les revivre avec le même garçon.
Elle réside peut-être là la cause de mon incapacité à être à nouveau heureux. Malgré notre séparation, et les six années qui se sont écoulées depuis, Jérém n’a jamais cessé de hanter mon cœur, mon corps, mon désir.
Dans ma nouvelle solitude, je repense à nouveau plus souvent à lui. Je me demande comment il va, s’il est heureux. Je me demande si ça lui arrive de penser à moi, parfois.
Entre Noël 2013 et le Jour de l’An 2014.
Comme chaque année, Maxime m’appelle pour me souhaiter de bonnes fêtes. D’habitude, je fais tout ce que je peux pour ne pas avoir des nouvelles d’Australie. Et le jeune Tommasi a toujours respecté mon besoin de me protéger.
Mais cette année, je ne peux me retenir de lui demander des nouvelles de son grand frère. J’apprends ainsi qu’il est revenu au domaine viticole pendant le mois de juillet de cette année – seul – et qu’il y a passé quelques jours. Qu’il est ensuite parti à Campan pendant deux semaines. Qu’il est ensuite reparti en Australie. Qu’il n’est plus avec Rodney, car ce dernier est rentré en Angleterre un an plus tôt pour s’y installer définitivement.
Ça fait beaucoup de nouvelles d’un seul coup, ça me donne le tournis. Une fois le téléphone raccroché, j’ai l’impression de plonger dans un abîme sans fin.
Beaucoup de choses à digérer, ça va prendre du temps et ça va faire mal. Ça m’apprendra à demander. En attendant, le mal est fait. Je n’ai pas fini de cogiter dans tous les sens.
Jérém était donc dans la région cet été, et il était seul, car il n’est plus avec Rodney.
Finalement, leur histoire n’aura pas duré davantage que la nôtre. Mais la durée de notre séparation est désormais plus importante que celle de notre histoire.
Jérém était en Occitanie et il n’a pas eu l’idée de passer me voir. Ou bien, il n’a pas eu le cran. Ou alors, il n’a pas osé. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Maxime n’a pas eu l’idée de me dire que Jérém était au domaine. Tout comme Charlène n’a pas non plus eu l’idée de me dire que Jérém était à Campan. Ni Martine, ni Jean-Paul, ni Ginette, ni Daniel. Sur le coup, je me sens trahi. Si seulement j’avais su, j’aurais accouru sur le champ ! Aurions-nous pu nous retrouver ? Ou bien ça aurait été une immense déception ?
Au final, est-ce que ça aurait été une bonne chose de le revoir ? Se retrouver en ex, en potes, je crois que je ne suis toujours pas prêt. Mais est-ce que Jérém aurait eu seulement envie de me revoir ? S’il ne m’a pas fait signe, c’est que ce n’était pas le cas.
Quant à ses proches, je sais bien que je n’ai pas de raison de leur en vouloir. Je sais très bien que si personne ne m’a pas appelé, c’est que Jérém leur a demandé de ne pas le faire.
Ce que Maxime ne m’a pas dit, et que je n’ai pas eu la force de lui demander, c’est si Jérém avait à nouveau quelqu’un dans sa vie.
Pendant quelques temps après le coup de fil de Maxime, ça me démange, ça me brûle, ça me ravage les tripes de rappeler Maxime pour lui demander tous les renseignements au sujet de la localisation exacte de son grand frère. L’envie me chatouille à nouveau de tout plaquer pour aller rejoindre Jérém.
Mais à quoi bon, après toutes ces années ? A quoi ça rimerait de traverser la moitié de la planète pour revivre ce que j’ai vécu il y a quelques années en traversant la Manche ? Trouver un Jérém distant, déjà amoureux d’un autre, si ça se trouve ? Trouver un inconnu ? Je ne le supporterais pas. C’est au-dessus de mes forces.
Cette année se termine dans une tristesse sans fin. Et je n’ai même pas envie d’aller déranger Stéphane avec mes histoires, ni d’en parler à qui que ce soit. Au bout de toutes ces années de séparation, je n’ose plus saouler mes amis et ma famille avec le « dossier » Jérém, même si de nouvelles informations m’ont amené à le rouvrir. J’ai peur qu’on me trouve pathétique, ridicule. En six ans, j’aurais dû aller de l’avant, refaire ma vie. Et pourtant, je n’ai pas pu. J’aurais dû cesser d’avoir mal. Et pourtant, j’ai toujours mal. Je garde tout pour moi, et ça me mine.
Heureusement, Galaak est là. Il n’est encore qu’un très jeune chien, il vient tout juste de souffler sa première bougie, mais il sent quand je suis triste. En ces moments-là, il vient se coller à moi, il pose sa tête sur ma cuisse, il vient chercher les câlins, proposer les câlins. Il vient me faire sentir sa présence, m’apporter du réconfort.
Un Labrador est le meilleur anti-dépresseur au monde, et à ce titre il devrait être remboursé par la Sécurité Sociale.
***
L’année 2014.
Depuis que mon meilleur pote est en couple, je ne sors plus, car ça ne me dit rien de sortir seul. Aller poiroter dans un bar, ou dans une boîte, je trouve ça glauque.
Pour tromper ma solitude, j’ai installé une application de rencontres entre mecs. Il me suffit de l’ouvrir pour que des dizaines de photos apparaissent, et ça donne même la distance à laquelle le gars qui m’intéresse se trouve. C’est tentant et encourageant.
Au début, j’ai beaucoup de touches. Je suis le petit nouveau dans le paysage numérique, j’attire l’attention. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que dans cet espace, les échanges sont plutôt directs et réduits à l’essentiel.
Ça commence le plus souvent par un « Slt », même pas « Salut », on n’a pas le temps, je réalise très vite que la quantité des échanges et des rencontres potentielles prime sur la qualité. Et ça enchaîne direct avec des répliques du style :
« Tu cherches quoi », « actif / passif », « monté comment », « photo torse nu », « photo de ta bite ».
Bref, on peut faire plus classe comme techniques d'approche.
Une fois le contact établi, on commence à discuter. Il arrive régulièrement que, au bout de quelques échanges, le gars à l’autre bout du clic cesse de répondre de façon soudaine, quitte l’appli sans même dire « au revoir ». Il revient parfois discuter le lendemain sans le moindre « bonjour ». C’est décousu, irrégulier, frustrant. Il faut un temps d’adaptation à cette absence de formes de politesse, à cet espace où les échanges ont des codes et des rythmes propres et très prosaïques.
Des touches, il y en a beaucoup. Mais il est nécessaire de passer du temps, pas mal de temps, à échanger avec tous ces inconnus, avant une éventuelle rencontre réelle. Car tout le monde parle avec tout le monde, et tout le monde est dispersé et volatile. Quand il y a trop d’offre, on survole. On peut parler avec un gars pendant des jours, envisager un plan, et le voir disparaître des radars, cesser de répondre, juste avant l’aboutissement de semaines de drague. On peut se faire bloquer, parfois pour la simple et bonne raison de demander des nouvelles une fois de trop.
Je me connecte quand je me sens triste, anxieux ou seul. C'est-à-dire, assez souvent. Chercher un plan est un moyen d’anesthésier ses plaies et de tromper sa solitude, et le sexe est une parfaite distraction. Une distraction très provisoire. Bien souvent, je me sens encore plus mal après avoir couché avec un gars.
Parfois, le soir, seul dans mon lit, je me souviens de cette envie irrépressible, dévorante, que je ressentais de coucher avec Jérém, de faire l’amour avec lui, d’emboîter nos corps qui semblaient conçus exprès pour cela, comme une évidence, de mélanger nos plaisirs pour créer cette parfaite alchimie, une réaction explosive. Je me souviens de cette envie brûlante, jamais satisfaite, jamais rassasiée, de recommencer encore et encore. Et je me souviens du bonheur de savoir que je pouvais compter sur lui, jeune mâle insatiable, jeune mâle me faisant l’immense honneur de m’avoir choisi pour satisfaire ses envies, pour recommencer encore et encore.
Je me souviens de plusieurs fois où, après l’avoir longuement sucé, je lui disais à quel point j’avais envie de lui, à quel point j’avais envie qu’il vienne en moi, tous les orifices de mon corps réclamant sa présence avec la même furieuse intensité.
— Fais-moi jouir dans ta bouche d’abord, sinon je vais pas durer longtemps dans ton cul, était souvent sa réponse.
Et alors je m’exécutais, trop heureux de ces annonces de multiplications des plaisirs. Je le faisais jouir dans ma bouche, et lorsque son orgasme venait, lorsqu’il m’intimait de l’avaler, là encore je m’exécutais avec un bonheur plein et total.
Une cigarette plus tard, une poignée de minutes plus tard, il était en moi, ses va-et-vient étaient puissants, ses couilles frappaient vigoureusement les miennes ou mon entrejambe, suivant la position, il me défonçait comme s’il ne venait pas de tout juste jouir dans ma bouche. Et la venue de son nouvel orgasme était pour moi le plus intense des plaisirs.
Je me souviens des petites odeurs qui se dégageaient de sa peau, de ses aisselles, du creux de son cou et de ses pecs, de ses poils, après l’apothéose du plaisir. J’ai toujours adoré la sensation de porter son odeur sur moi, ce bouquet mâle sentant à la fois son parfum de mec mais aussi, et surtout, la transpiration, la queue, la baise, le foutre, l’orgasme consommé.
Je cherche toujours et encore le souvenir de ce bouquet dans le t-shirt blanc et les boxers que j’avais discrètement subtilisés de la salle de bain de l’appart de la rue de la Colombette. Je plonge mon nez dedans, en quête de mon Jérém. Hélas, toute ces délicieuses petites odeurs de jeune mâle ont disparu avec le temps. Et pourtant, je ne peux me résoudre à les jeter.
Je me souviens du bonheur d’avoir son jus partout en moi. La sensation de pouvoir lui faire confiance, le sexe insouciant, le meilleur, car c’est dans le lâcher prise total que réside le plaisir le plus pur.
Que ne donnerais-je pas pour refaire l’amour avec lui, une fois seulement. Et pour m’endormir dans ses bras, me sentir aimé, sentir sa présence, et savoir qu’il sera là demain matin, que nous pourrons nous réveiller ensemble à nouveau.
Que ne donnerais-je pas pour retourner dans la petite maison de Campan, de retrouver la cheminée allumée, et Jérém devant moi, en train de me sourire !
Été 2014.
Jour après jours, mois après mois, sans même m’en rendre compte, ou plutôt sans vouloir m’en rendre compte, je deviens addict à l’application. A chaque connexion, il est impossible de savoir sur qui on va tomber. Et on nourrit toujours l’espoir fou de décrocher le jackpot. Cette addiction à la « surprise » me pousse à me connecter de plus en plus souvent et à y consacrer de plus en plus de temps. J’y passe toutes mes soirées, une partie de mes nuits et de mon sommeil, tous mes week-ends et jours fériés, ainsi que chaque instant de mon temps libre.
L’application, c’est le diktat des muscles, des belles gueules, des corps parfaits. Je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, j’ai été moi aussi à fond dans ce fantasme, j’ai aimé, adoré, fantasmé le corps, les muscles, la belle petite gueule et la queue de Jérém.
Mais ici, dans le virtuel, le fantasme du gars parfait est omniprésent. Ici, les corps se mettent en scène, on choisit ce qu’on veut bien montrer et ce qu’on veut cacher. Les images d’hier peuvent très bien servir pour se « vendre » d’aujourd’hui. Parfois, entre le virtuel et le réel, il n’y a pas le compte, autant pour les années que pour les kilos. Parfois, il y a tromperie caractérisée sur la « marchandise ».
En attendant, cette image biaisée de l’idéal masculin devient le mètre-étalon de comparaison. Inconsciemment, je finis par me comparer à ceux qui plaisent au plus grand nombre.
Dans cette comparaison, on est souvent perdants. Et ça finit par faire perdre confiance en soi.
On commence à se dire que tel beau gosse ne vient jamais nous parler ou qu’il ne répond pas parce qu’on n’est pas assez beau, puis on en fait une généralité, on finit par se dire qu’on ne plait pas assez ou qu’on est insignifiant.
D’ailleurs, après des débuts sur les chapeaux de roues, au fur et à mesure que le temps passe, j’ai l’impression de me fondre dans le paysage et de perdre une grande partie de mon intérêt. Les touches sont moins nombreuses, et, après m’être pris pas mal de râteaux, j’ose moins aller vers les gars de peur de me prendre d’autres râteaux.
Lorsque j’arrive à trouver assez de force mentale pour arriver à décrocher des applications, je peux consacrer du temps à l’écriture. Mais ce n’est pas facile de m’y remettre après l’avoir abandonnée pendant un certain temps. L’écriture est une fleur qui se cultive au quotidien, et elle supporte mal l’inconstance. C’est une maîtresse exigeante. Elle est capable de donner beaucoup de plaisir, mais à la seule condition qu’on s’occupe bien d’elle. Lorsqu’on ne lui consacre pas assez de temps, elle boude pendant un certain temps pour nous le faire payer. L’écriture est une machine qui demande un certain temps pour chauffer.
Hélas, conséquence de mon travail décousu, beaucoup de notes s’entassent, des textes dans mon ordi, d’autres manuscrits rangés dans une boîte. Et lorsque je pense à toutes ces pages, ça me donne le tournis. Ça me décourage de m’y mettre. J’ai l’impression que je n’aurais jamais l’énergie et le temps nécessaires pour reprendre tout ça pour trier, organiser, structurer, pour en faire quelque chose de cohérent. Je devine que cela représente un travail colossal.
Il me faut énormément d’énergie pour me replonger dans le bain, après une longue pause.
Ça fait maintenant des années que j’écris au sujet de Jérém et Nico. J’écris pour garder une trace de cet immense bonheur passé, j’écris pour ne pas oublier, j’écris pour pouvoir à chaque instant de ma vie me dire « ça a bien existé ».
Cela ne m’empêche pas de me demander, parfois, à quoi bon, au fond, passer autant de temps devant mon ordi, pourquoi écrire au sujet d’anciens chapitres de ma vie au lieu d’en vivre de nouveaux.
La réponse à cette question est désormais évidente. C’est quand ça charbonne sec sur mon clavier que je suis le plus heureux. Lorsque j’arrive enfin à me réconcilier avec l’écriture, je prends beaucoup de plaisir à écrire. Devant mon écran, seul avec mes « personnages », j’oublie tout, ma tristesse, ma mélancolie, ma nostalgie, mes regrets, mes peurs, je m’enferme dans une bulle où je suis bien comme nulle part ailleurs.
Au début, j’avais du mal à écrire trop longtemps, car bien souvent les larmes venaient noyer mon clavier. Mais au fil du temps, j’ai réalisé que mes larmes, une fois que j’ai réussi à les retranscrire à l’écran, n’alourdissent plus mon cœur. C’est en ça que je considère que l’écriture est pour moi comme une thérapie. Et ça va même au-delà de ça, elle m’apporte carrément du bonheur.
Mais de nombreux obstacles se dressent entre l’écriture et moi. Le premier, c’est ma libido. Elle réclame régulièrement son « dû ». J’ouvre alors l’application avec l’intention d’y passer un court moment. J’y passe la soirée, et je n’écris pas. Le lendemain, je me reconnecte. Et ainsi de suite. Je finis par ferrer le poisson et faire un plan. Je remets le doigt dans l’engrenage infernal et je me fais happer à nouveau.
L’application est toujours présente sur mon téléphone, l’icône me nargue, la tentation me titille, la facilité me fait capituler.
Je devrais la désinstaller. Je l’ai fait une ou deux fois, mais j’ai fini par la réinstaller. Je suis comme un fumeur qui sait que la cigarette est nocive mais qui n’arrive pas à décrocher pour autant. Addiction, quand tu me tiens !
Les applications ont rendu les rencontres entre gars plus rapides et plus sûres, mais elles ont en même temps sapé les bases de la réussite d’une relation stable. Car elles poussent au papillonage, à la volatilité. Elles favorisent une sorte de consommation boulimique des corps couplée à une insatisfaction éternelle. Cela entraîne dans une course sans fin vers un mirage, celui de la rencontre parfaite.
Mais si on regarde constamment ailleurs, si on ne prend pas le temps de consacrer du temps à la personne, on passera à côté de bien des choses.
Sur Internet, les rencontres sont plus faciles, mais aussi plus précaires. Les applications rendent les gens plus fragiles, plus désenchantés, plus exigeants, plus dispersés, et plus méfiants.
Comment espérer trouver l’amour, comment faire confiance à quelqu’un rencontré sur l’application, alors que, tout autant que moi, il a l’habitude de chasser avec cette facilité ?
Comment espérer construire quelque chose avec des gars tenant au creux de leurs mains les innombrables occasions offertes par la technologie moderne ?
J’ai rencontré des gars qui, une fois consommé ce qui était consommable, n’avaient qu’une hâte, celle de partir et de ne plus jamais revenir. D’autres qui ne pouvaient jamais quitter leur portable des yeux, et qui n’avaient même pas la délicatesse de le mettre en sourdine, laissant la signature sonore des notifications de l’appli retentir à longueur de temps, y compris pendant notre rencontre, ou pendant nos ébats, la tête, la queue et le cul en permanence ailleurs.
J’ai l’impression d’être à la fois le client et le produit d’une sorte d’immense « supermarché » de la baise. Et pourtant, malgré ma frustration, je finis toujours par céder à la tentation, à la facilité. J’y cède pour tromper l’ennui, pour oublier ma solitude, pour essayer de calmer une blessure qui ne guérit pas, pour essayer de flatter mon égo.
Et le piège se referme sur moi. La facilité entraîne la banalisation des rencontres, mais aussi leur « désacralisation » et, par conséquent, la dévalorisation de l’autre. Et de soi-même, par ricochet.
Après l’addiction vient l’accoutumance, puis la désillusion et le dégoût.
16 octobre 2014.
Aujourd’hui, Jérém a 33 ans. Où es-tu, mon Jérém ? Es-tu heureux ? Mon p’tit Loup, est-ce qu’il t’arrive, parfois, d’avoir une pensée pour celui que tu as appelé un jour « ton Ourson » ?
Décembre 2014.
Parfois, le soir, dans mon lit, je me souviens que le seul autre garçon à qui j’ai fait un jour totalement confiance est Thibault. Nous ne nous voyons pas souvent, son engagement dans les Pompiers ne lui laisse pas beaucoup de temps libre. Mais à chaque fois que nous nous retrouvons tous les deux, je le trouve toujours aussi beau, charmant et désirable. A chaque fois, j’ai l’impression que, pour peu que je m’amuserais à forcer un peu le destin, ça pourrait facilement déraper entre nous. Que nous pourrions remettre ça, comme à Bordeaux.
Je sais qu’il ne fera pas le premier pas, Thibault est un garçon trop droit dans ses bottes pour cela. Il ne tromperait jamais son adorable Arthur de sa propre initiative.
Mais si ça venait de moi, qui sait.
Je me branle parfois en me remémorant la sensualité et la virilité du beau pompier. Et en me branlant, je me dis que je devrais oser, lui proposer de recommencer. J’ai tellement envie de faire l’amour avec un beau garçon ! Et je m’imagine que lui aussi il en a envie, qu’il n’attend que ça, en fait.
Mais une fois m’être soulagé, ma raison reprend aussitôt le contrôle sur le fantasme, et une certitude s’affiche dans mon esprit. Coucher avec Thibault ce ne serait pas du tout une bonne idée.
***
L’année 2015.
Elle commence mal, très mal. Le 7 janvier, au soir, les bougies se multiplient sur les rebords des fenêtres de la France entière pour montrer que nous sommes tous « Charlie Hebdo ».
Janvier 2015.
En ce début d’année, je prends la résolution de me consacrer davantage à l’écriture. J’ai besoin de me poser, de me retrouver. J’ai besoin de calme.
Mars 2015.
Le nouvel album de Madonna sort enfin dans les bacs. Malgré quelques chansons de qualité, à l’instar du single « Ghosttown », dont les notes mélancoliques épousent parfaitement ma tristesse de cette période, il connait hélas un succès beaucoup plus confidentiel que les précédents.
La sauce Madonna a plus de mal à prendre que par le passé. Tous les artifices du monde ont de plus en plus de mal à faire illusion, à concilier le mythe Madonna avec la réalité de ses bientôt 60 ans. Des titres hétérogènes, une silhouette qui s’alourdit, une chirurgie plastique désormais trop évidente, des pas de danse moins audacieux, des performances vocales peu convaincantes. Et, par-dessus tout, un refus obstiné d’accepter le temps qui passe. Elle n’est plus dans l’air du temps, les nouvelles générations sont passées à autre chose, les radios la blacklistent sans s’en cacher. Même avec MTV, avec qui la symbiose a été parfaite depuis le premier jour, le divorce semble définitivement consommé.
Heureusement, il reste la diffusion sur Internet.
Dans mes yeux de fan, bien sûr, le fait que Madonna ne soit plus aussi en forme, ni aussi populaire qu’à une certaine époque, ça ne change rien. Je suis conscient de tout ce qu’elle a représenté pour « les hommes de ma génération ». Elle est la Stella Spotlight de ma génération. Elle m’a tellement donné par le passé que je la suivrai jusqu’au bout, quoi qu’il arrive. Et puis, si elle vend beaucoup moins de disques, ses concerts se jouent à guichets fermés. Au fond, c’est le plus important.
Une nuit, je me réveille en sursaut. Je savais qu’elle devait performer le soir même un titre à la télé anglaise, et j’ai un mauvais pressentiment. J’ai besoin de savoir si tout s’est bien passé. Je vais voir sur Youtube.
Sa chute spectaculaire de la scène des British Award vient de se produire deux heures auparavant, les médias rapportent qu’elle serait à présent en observation à l’hôpital.
Elle a pourtant mené sa prestation jusqu’au bout avant de se faire secourir, je suis admiratif. Mais en même temps, cela me peine beaucoup. Pour la première fois, je me dis qu’elle aussi est faite de chair et de sang, et qu’elle est aussi en train de vieillir. Et que peut être le gros de sa carrière est désormais derrière elle.
Mars 2015.
Aujourd’hui, c’est une belle journée de printemps. Le vent d’Autan souffle depuis hier, vigoureux et insistant, et le ciel est bien dégagé.
Ce matin, je me rends dans un magasin de matériel électrique pour acheter une bricole pour la maison. Dès mon arrivée, je constate qu’il y a du monde au comptoir. Mais aujourd’hui je ne travaille pas, et je ne suis pas pressé.
Et je ne le suis d’autant pas que je viens de TE remarquer dans la file d’attente à côté de la mienne. Toi, beau jeune mâle brun au regard ténébreux et au physique avantageux. Mon regard et mon Être tout entier se figent sur toi, et tout disparaît autour.
A chaque fois que l’existence d’un beau garçon traverse ma rétine et mon esprit, je me retrouve comme plongé dans un état second. C’est une expérience presque mystique. Pendant quelques instants, j’assiste, incrédule, à une sorte de révélation repoussant à chaque fois les limites de la magnificence du Masculin.
Je suis percuté, submergé, envahi par un trop plein de sexytude, de mâlitude, de virilité, d’irrépressible désir. Ma conscience sature, bugge. Je me retrouve comme hébété, fixant avec insistance le Petit Dieu pour laquelle mon adoration est déjà totale, comme en étant d’hypnose, dans la tentative inconsciente et désespérée de capturer, de comprendre, d’admettre que tant de beauté, de mâlitude, de sexytude puissent être réunies en un seul garçon.
C’est une expérience à la fois délicieuse et frustrante, tant l’objet de mon désir est généralement inaccessible. Mais ça me met toujours de bonne humeur que de croiser un bel inconnu de bon matin.
Et toi, toi t’es vraiment beau, mec ! Tu es un garçon solide, un brun comme je les aime, pas très grand, un mètre 70 maximum. Il est à mes yeux une sexytude propre à ce genre de garçons, que j’appelle les « petits formats très bien proportionnés ». Tes cheveux sont ni trop courts, ni trop longs, arrangés un peu à l’arrache. Tu as la peau mate, une petite barbe de quelques jours, bien sexy. Tu te situes dans une plage d’âge entre 25 et 30 ans.
Tu es habillé plutôt simplement, tu portes un pantalon de travail à poches, des chaussures de sécurité.
Mais aussi un t-shirt gris avec un ballon ovale imprimé dans le dos, surmonté par le nom d’une petite ville des alentours. Tu es donc un rugbyman, ou du moins un passionné de rugby.
Le t-shirt épouse à la perfection tes épaules bien taillées, tes pecs, laissant même deviner tes tétons. Quelques petits poils tout mignons dépassent de l’arrondi du col. C’est un t-shirt de travail, et tu le portes avec un naturel désarmant, sans intention particulière de te mettre en valeur. Et pourtant, ça te met sacrement en valeur. Tu ne peux même pas imaginer à quel point. Tu n'es peut-être même pas conscient d’à quel point tu es sexy.
Première loi de la Bogossitude : un rien habille un bogoss.
Deuxième loi : un garçon n’est jamais autant sexy que lorsqu’il ne fait rien pour cela.
Troisième loi : le garçon le plus sexy qui soit est celui qui ignore à quel point il l’est.
Et c’est justement cette absence d’intention et de conscience qui font le charme de ta tenue, et de ta personne. Petit mec, tu es insupportablement sexy !
Tu rentres dans mon champ de vision et mon regard est à nouveau vierge, à nouveau enchanté. Et en te regardant, je ressens un bonheur tout aussi intense que la première fois de ma vie où j’ai été percuté par la beauté d’un beau garçon. Pour autant que je me souvienne, ça devait être au Cours Moyen, lors d’un cours de natation. L’un des moniteurs était très beau. C’était la première fois que je voyais un garçon aussi beau.
Petit brun, tu as l’air pressé. Tu dois avoir du travail qui t’attend, des clients à contenter. Tiens, d’ailleurs ton téléphone vient de sonner. Tu décroches. Et soudain, tes beaux traits virils se crispent. Ton regard brun et charmant prend un air désabusé et fatigué. A un moment, il croise le mien. Je te souris, l’air compatissant. Te montrer de l’empathie est ma façon de te faire remarquer mon existence. Mon sourire doit te faire plaisir car tu souris à ton tour. A cet instant, j’ai envie de pleurer tellement ton sourire m’emplit de bonheur.
Le premier client de ta file d’attente est parti et il ne reste qu’un autre type devant toi. Tu en as assez entendu, tu as l’air de vouloir mettre un terme à cette conversation qui commence visiblement à t’agacer.
— Ecoutez, Madame, je serai chez vous en début de semaine prochaine, mais pas avant. Je vous ai dépanné de ce qui était le plus urgent et j’en fais de même avec d’autres clients. Je dois vous laisser, j’ai beaucoup de travail. C’est pas la peine de me rappeler encore d’ici là. Je sais parfaitement ce qui me reste à faire. Je vous dis à lundi, passez un bon week-end.
Le ton de ta voix est ferme, et je décèle un bon petit accent toulousain plutôt marqué, plutôt craquant.
Tu viens de raccrocher et ton regard revient vers moi. Nous ne sommes pas très loin l’un de l’autre, moins de deux mètres nous séparent. Je te souris à nouveau. Tu souris à ton tour, mais pas longtemps. Ton portable sonne à nouveau. Cette fois-ci, tu ne réponds pas, tu appuies sur la touche rouge, l’air de plus en plus agacé. Finalement, le client devant toi prend beaucoup de temps, et tu commences à t’impatienter.
Tu as l’air fatigué, mon mignon. A en juger d’après la façon dont tu t’étires, il est évident que ton sommeil matinal a été coupé par un réveil qui a sonné trop tôt. Et maintenant, planté là à attendre, ta fatigue te rattrape. Tu aurais encore dormi, j’imagine, si le taf ne t'avait pas obligé à sortir de tes draps.
Tu es debout depuis quelle heure ? Est-ce que tu étais seul dans ton lit ? Est que tu étais avec ta copine ? Avec ta femme ? Est-ce que tu lui as fait l’amour hier soir ? Est-ce que tu t'es réveillé avec une bonne trique et tu t’es fait sucer ? Ou bien, est-ce que tu as pris le temps de te branler avant de sortir de ton lit ? Ou alors sous la douche ?
Tu bailles, tu t'étires à nouveau, tu frottes ta barbe brune, et je te trouve de plus en plus sexy à chaque seconde qui passe. Je sens mon ventre frémir, comme secoué par un tambour de machine à linge en mode essorage. J’ai déjà follement envie de toi.
— C'est long, ça n’avance pas… je te lance, comme la première pierre posée d’un pont que je voudrais bâtir entre nous.
Je suis le premier étonné de mon « audace ». Mais tu me fais vraiment trop d’effet, et j’ai besoin d’attirer ton attention, j’ai besoin que tu poses ton regard sur moi, j’ai besoin que tu saches que j’existe. Au moins pendant un instant.
En vrai, je tremble, j’ai le cœur qui bat à mille, j’ai le souffle coupé, les jambes en coton. J’ai peur que tu trouves ma remarque déplacée, que tu me trouves déplacé tout court, j’ai peur d’ajouter de l’agacement à ton esprit.
Mais, pour mon grand plaisir, tu me réponds, tu me secondes. Et tu n’as pas du tout l’air agacé par ma démarche.
— Ah, oui, j'en ai marre d'attendre. En plus, j’ai un taf monstre qui m’attend !
— Vous bossez dans quoi ?
— Je suis chauffagiste. Et vous ?
— Ingénieur et… bricoleur !
— Moi c’est Pierre.
— Moi c’est Nicolas, enchanté !
Le client devant toi a terminé et c’est désormais à ton tour de te faire servir. Ce qui met un terme prématuré à nos échanges. Tu approches du comptoir. Le petit mec qui vient vers toi est un brun à lunettes au physique élancé, pas mal du tout dans son genre non plus. Mais moi, je n’arrive pas à décrocher mon regard de toi, beau chauffagiste !
Je t’entends expliquer que tu as passé une commande et qu’on t’a appelé pour te dire qu’elle était arrivée. Le petit mec à lunettes cherche sur son ordi mais semble avoir du mal à retrouver la commande en question. Tu attends, les coudes appuyés sur le comptoir, le dos incliné, les fesses un brin cambrées. Mais putain qu’est-ce que tu es beau, ainsi négligemment appuyé au comptoir ! Tu l’ignores, mais cette position fait se soulever légèrement ton t-shirt à l’arrière, laissant ainsi découvrir un petit bout de peau proche de ta chute de reins. C’est beau, beau, beau !
Le petit mec à lunettes part dans le bureau à l’arrière du comptoir. On le voit discuter avec un autre type derrière la porte vitrée. Ce dernier passe un coup de fil. Entre temps, le client qui me précédait dans la file d’attente est parti et je me retrouve à mon tour devant le comptoir. A nouveau à un mètre de toi. J’annonce rapidement ma commande et le vendeur part dans l’arrière-boutique chercher la marchandise.
Mon regard revient aussitôt vers toi, beau chauffagiste. Mais je n’ai pas le bonheur de croiser le tien car le petit mec à lunettes revient t’expliquer qu’il y a eu une erreur, que ta commande est incomplète, qu’il manque juste… la pièce principale !
Tu sembles excédé. Je t’entends lancer, à bout de nerfs :
— Ça bousille ma journée. J’avais promis au client d’y aller aujourd’hui. Est-ce que je peux au moins savoir quand j’aurais cette pièce ?
Le jeune vendeur retourne dans l’arrière-boutique pour se renseigner. Et moi j’en profite pour te lancer :
— Ça ne s'arrange pas ici…
C’est une affirmation qui ne repose sur rien, car c’est la première fois que je viens dans ce magasin, c’est un bluff imaginé dans le seul et unique but d’essayer d’établir un début de complicité par l’empathie. Et ça marche !
— Non, pas du tout… tu confirmes.
En attendant, mes pièces sont arrivées sur le comptoir. Trop vite, pour une fois que je ne suis pas pressé ! C’est con, je vais avoir fini avant toi. Je vais partir avant toi. J’aurais bien voulu continuer à discuter avec toi, trouver le moyen de te parler d’autre chose que de taf et de taf.
Une fois que j’aurai réglé ma facture, je vais partir ! Et ce sera fini, je rentrerai dans ma voiture, je reprendrai ma route et ne te reverrai plus jamais.
Bien sûr, il y a toujours une raison qui fait que rien n’est jamais possible entre moi et un gars que je kiffe. Je peux toujours invoquer des conditions conjoncturelles défavorables pour tenter d’expliquer mon manque de cran, pour tenter de justifier à moi-même mon incapacité à aller vers l’autre, à briser le mur de verre qui me sépare d’une possible belle rencontre. Aujourd’hui, je peux me dire par exemple que ce beau chauffagiste est bien trop accaparé par ses soucis et bien trop pressé pour qu’il puisse être réceptif à mes approches.
Mais je sais pertinemment que ce ne sont que des excuses. Et ça n’apaise en rien la douloureuse déchirure provoquée au plus profond de moi par la dichotomie inconciliable entre mon désir et ma frustration.
La vérité est que je ne sais pas aller vers les garçons qui me font de l’effet. Je ne sais même pas y aller pas dans les endroits prévus pour cela, alors, dans la vie de tous les jours…
La peur du rejet, de l’humiliation et de la violence me tétanise. Aussi, la bogossitude m’impressionne, me fait me sentir comme un vilain petit canard honteux et me fait perdre tous mes moyens.
Mon vendeur me rend la carte bleue, me tend la facture et me colle mon carton dans les mains. Je me retourne vers toi, beau Pierre. Tu captes mon regard et tu y accroches le tien. Je voudrais te parler, trouver le moyen de prolonger nos échanges, mais je n’ai aucune idée de comment m’y prendre.
— Bon courage… tu me glisses, tout mignon.
— Oui, bon courage à vous aussi…
Et voilà, c’est comme ça que ça se termine, déjà. Je me mettrais des baffes, des baffes et encore des baffes.
J’avance vers le sas, le ventre ravagé par le regret et la frustration. Je me sens mal et pire, j’ai envie de hurler jusqu’à m’en casser les cordes vocales !
Lien vers la suite de l’épisode "Le mec du comptoir":http://www.jerem-nico.com/20-le-mec-du-comptoir-version-2023
Vos commentaires : toujours les bienvenus !

 4 commentaires
4 commentaires
-
Par fab75du31 le 18 Septembre 2023 à 07:08
Octobre 2008.
C’est à ce moment, lorsque je suis à nouveau au plus mal, qu’un ange tombé du ciel revient dans ma vie. Ce n’est pas dans le milieu que je le retrouve, mais dans une salle de cinéma du centre-ville. Le hasard a fait que tous deux avons choisi d’aller voir le même film, plusieurs semaines après sa sortie, dans la même salle de cinéma, et à la même séance.
C’est après deux heures passées à suivre les pérégrinations de Meryl Streep sur une île grecque tout en chantant du ABBA à tout va, après avoir attendu religieusement, lui comme moi, que le fondu au noir et le silence tombent après les titres de fin, et que les lumières se rallument, c’est au moment de quitter la salle que nous nous croisons, que nous tombons littéralement l’un sur l’autre. Je m’arrête pour le laisser passer, il insiste pour me laisser passer.
Il n’a pas changé, il est toujours aussi gentil garçon. Et soudain, mon cœur s’emplit de bonheur, comme lorsqu’on rencontre un visage familier après s’être longtemps égaré dans un désert ou dans une forêt.
Stéphane !!!!!!!!!
— Oh Nico ! il me lance, visiblement aussi surpris que je le suis.
— Stéphane ! Mais que fais-tu ici à Toulouse ?
— C’est une longue histoire. Mais viens-là, Nico !
Et ce disant, il vient vers moi, me serre fort dans ses bras et me claque deux bonnes bises bien sonores.
Sa démonstration d’affection si débordante me donne envie de pleurer.
— Ça me fait plaisir de te voir, Nico !
— Moi aussi, je suis super content de te voir !
— Tu as grandi, et très bien grandi ! T’es beau ! Ça te fait quel âge maintenant ?
— Vingt-six, depuis peu.
— Comment tu vas ?
— Ça va, ça va…
— Ça n’a pas l’air.
— Disons que j’ai déjà connu des jours meilleurs…
— Eh, ça te dit d’aller boire un verre ? On pourra discuter au calme, il enchaîne sans transition.
— Mais avec plaisir !
— T’as envie de marcher un peu ?
— Pourquoi pas.
— Alors je vais te montrer mon nouvel appart. Il est à quinze minutes de marche.
Si mes souvenirs sont bons, Stéphane avait 26 ans en 2001, il doit donc en avoir 33 aujourd’hui. Depuis notre dernière rencontre il y a sept ans, il s’est un peu épaissi, et quelques cheveux blancs se sont glissés au milieu de sa belle chevelure brune, notamment au niveau des tempes.
Mais il n’a rien perdu de son charme. Bien au contraire, ces quelques années lui ont apporté une virilité nouvelle, encore plus intense qu’auparavant. Stéphane est maintenant un homme très séduisant.
Le temps n’a pas changé sa profonde gentillesse, son sourire est toujours aussi attachant. Sept ans, et il n’a rien perdu de ce côté nounours tout doux qui m’a attiré vers lui en cette journée de printemps de 2001. Et ces lunettes qu’il porte désormais en permanence ajoutent un charme studieux à ses yeux toujours aussi charmants.
Nous remontons les allées Jean Jaurès, nous traversons le pont sur le Canal et nous longeons ce dernier.
— Je suis revenu à Toulouse il y a quelques semaines, il m’explique pendant que nous marchons. J’ai changé de job, maintenant je travaille à Blagnac, je suis gestionnaire de compte pour les clients allemands.
— Et tu t’y plais ?
— Je suis revenu chez moi, je suis content.
— Et Gabin ?
— Il est toujours là, avec quelques années de plus, mais toujours fidèle au poste.
— C’est cool !
— Voilà, c’est ici, il m’annonce, en s’arrêtant devant un immeuble à proximité de celui où habitait Thibault avant d’aller jouer au Stade Toulousain.
— Dès que j’ai été installé, j’ai eu envie de prendre de tes nouvelles, il continue pendant que nous traversons un couloir qui nous mène dans l’arrière-cour de l’immeuble. Mais je ne savais pas comment te retrouver. Je n’avais plus ton numéro. Et puis, je ne savais même pas si tu étais toujours à Toulouse…
— Je suis désolé de pas t’avoir donné de nouvelles pendant tout ce temps, je profite pour m’excuser.
— J’imagine que tu avais plein de choses à vivre, et tu as eu raison de les vivre. Et puis, moi non plus je ne t’en ai pas vraiment données. Mais maintenant, on va rattraper le temps perdu !
Stéphane tourne la clé dans la serrure et, dès la porte d’entrée ouverte, la fougue de Gabin nous déborde comme une tornade. Le labranoir a pris du poil blanc sous le menton et sur le bas des babines, il a un peu changé, la tête, le corps, mais sa mignonnerie naturelle demeure intacte, il est toujours ce puits à câlins que j’ai connu à l’époque de notre première rencontre sur la pelouse de la cathédrale de Saint Etienne. Et je jurerais, ou du moins j’ai envie d’y croire, qu’il m’a reconnu, malgré les années passées.
— Allez, rentre, tu vas te mettre à l’aise et tu vas me raconter ce que tu as fait pendant ces sept années !
— Tu as des RTT à poser ? je blague, car ça risque de prendre du temps !
— Je pense qu’on va faire ça par épisodes, il plaisante à son tour.
— Ça me va…
— Tu bois quoi ? Une bière blanche ? Il me semble que tu aimes la bière blanche…
— Tu te souviens de ça ?
— Je me trompe ?
— Non, pas du tout, quelle mémoire ! je lâche, passablement impressionné.
Pendant que Stéphane prépare les boissons, Gabin me souhaite la bienvenue à sa façon. Il bondit vers un coin de la pièce, il se saisit d’un « pouic pouic » en forme de ballon de rugby et il vient le laisser tomber sonorement à côté de moi comme pour me dire : « Ça fait des heures que je suis seul, maintenant, on joue ! ». Ou encore : « Ça fait des années que tu n’as pas daigné venir me voir, alors, maintenant, joue ! ».
Le Labranoir me fixe avec sa bonne bouille, avec son regard d’une douceur désarmante, il me toise avec insistance, l’air joueur, impatient.
J’attrape le jouet et je le lui lance à l’autre bout du couloir. Gabin détale aussitôt, si vite qu’il patine sur le carrelage, il glisse, puis il part enfin le récupérer en bondissant, avec une attitude de chiot fougueux qu’il n’a pas perdue malgré les années passées.
Lorsqu’il saisit le ballon, au bout d’un dernier bond très calculé, il commence à le mâchouiller vigoureusement, provoquant des « pouic pouic » d’intensité variable, comme volontairement modulés. On dirait qu’il essaie de communiquer, sa joie, son plaisir du jeu, son envie de continuer. Il est vraiment adorable et il dégage une tendresse, une innocence, une douceur qui me font fondre.
Gabin revient vers moi, mais il ne me tend pas la balle. Il me regarde avec un air canaille, prêt à démarrer pour m’empêcher de lui prendre son jouet, tout en me mettant au défi d’arriver à le lui attraper.
— Ce qu’il aime, c’est que tu lui coures après pour la récupérer ! m’explique Stéphane en déposant les boissons sur la table basse.
Stéphane se joint à nous, nous nous mettons à ses trousses. Nous finissons par le coincer en le cernant des deux côtés de la table. Je récupère enfin le ballon d’entre ses mâchoires et je le relance. Le contact avec son poil doux est comme une caresse, sa spontanéité est touchante.
Nous continuons à jouer pendant un petit moment, tous les trois, et c’est vraiment marrant. Gabin finit par se lasser et par se caler sur un grand tapis qui est son coin de repos dédié.
— Ce chien, est vraiment « le chien de ma vie », m’explique Stéphane. Quand je pense qu’il a déjà onze ans, j’ai un pincement au cœur. Chaque soir, au moment de me mettre au lit, je me dis que c’est un jour de plus qui me rapproche du jour où sa bonne bouille ne sera plus là pour m’apporter du bonheur. Car il m’apporte tellement de bonheur ! Alors que j’ai l’impression de lui consacrer si peu de temps !
Oui, Gabin est toujours aussi adorable. Tout comme son maître, adorable et touchant garçon.
Aussitôt installés sur le canapé, ce dernier me lance :
— Et maintenant, parle-moi de toi.
En quelques mots, je lui parle, de mes études à Bordeaux, de mon travail à Montaudran. En quelques autres mots, puis en quelques sanglots, je lui parle de mon histoire avec Jérém, de notre bonheur, de notre agression, de notre séparation, de ce garçon anglais qui a pris ma place dans son cœur. Je lui parle du fait que, malgré cette année écoulée depuis notre séparation, je l’aime toujours, j’attends toujours son retour. Je lui parle de ma difficulté à accepter cette rupture, à m’en faire une raison, à aller de l’avant.
— Une rupture est une épreuve difficile à endurer quand on est amoureux. Voir un autre prendre notre place, « voler » notre bonheur, ça, ça ne passe pas. Ça m’est arrivé aussi, quelques années avant que nous nous croisions. A vingt ans, j’ai rencontré un gars qui était animateur d’une radio locale. Il avait quelques années de plus que moi, et c’est lui qui m’a fait découvrir l’amour entre garçons. C’est lui qui m’a appris à m’aimer et à m’assumer. Ce garçon, je l’ai aimé comme un fou. Au bout de quelques mois de relation, il a rencontré un autre gars qui travaillait aussi dans la radio, il en est tombé amoureux et ils sont partis travailler pour une antenne nationale à Paris. Il m’a quitté presque du jour au lendemain. J’ai cru que j’allais en crever.
J’apprends ainsi que Stéphane a également connu l’abandon, la perte de l’être aimé, la séparation, il a vu l’être aimé partir avec un autre.
— Bref, je sais à quel point c’est dur, il enchaîne. On se retrouve seuls, désemparés, désorientés et on a l’impression que nous ne pourrons plus jamais faire confiance, plus jamais connaître la moindre joie, le moindre bonheur. La douleur qu’on ressent nous renferme dans une bulle qui nous éloigne des autres et des belles rencontres que nous pourrions faire. On a l’impression de vivre sous une chape de plomb qui ne se lèvera plus jamais.
— C’est tellement ça, tellement ça ! je sanglote.
— Et pourtant, il faut rebondir, il faut réapprendre à vivre, même si on a l’impression qu’on nous a arraché le cœur, et que, sans le cœur, on ne peut pas vivre.
Stéphane me prend dans ses bras. Sa présence bienveillante me fait un bien fou. Mes sanglots s’estompent peu à peu. Gabin, intrigué par la scène et/ou jaloux que son maître délivre des câlins ailleurs que sur son poil, approche en trottinant et vient chercher son dû de tendresse. C’est tellement mignon !
— Ça ne sert à rien de ressasser le passé, il continue, de rester coincé dans le souvenir du bonheur qui n’est plus. Hier n’est plus, et il ne reviendra pas. Et demain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Seul compte aujourd’hui, l’instant présent, le seul sur lequel on a une quelconque prise. La vie est trop courte, il ne faut pas la gâcher avec des regrets, il ne faut pas vivre dans le passé, et il ne faut surtout pas laisser le bonheur perdu nous empêcher d’en vivre d’autres !
Je suis profondément touché par ses mots, son vécu, sa maturité, son empathie. Nous continuons à discuter pendant une bonne partie de la nuit, de lui, de moi, de choses et d’autres. Je retrouve la complicité qui a été la nôtre dès le premier instant, celle que nous avons connue pendant les quelques rencontres avant son déménagement en Suisse, et que les années n’ont pas effacée. Il y a des Êtres comme ça, avec qui on est relié par un fil invisible qui traverse l’espace et le temps, des êtres avec lesquels on est connectés à tout jamais. Ça fait sept ans que nous ne sommes pas vus, que nous ne nous sommes pas donnés de nouvelles, et j’ai l’impression que nous nous sommes quittés la veille.
Novembre 2008.
Ces retrouvailles inattendues tombent à point nommé. Avec Stéphane, je retrouve un ami au moment où j’en ai le plus besoin.
Je le revois dès la semaine suivante. Nous allons prendre un verre, manger une pizza, nous balader sur la Garonne. Entre deux sorties, nous échangeons par SMS. Il n’y a pas un jour où je n’ai pas de ses nouvelles, où il ne prend pas de mes nouvelles. Peu à peu, nos échanges deviennent un rendez-vous incontournable du matin, et du soir, et à chaque fois que nous en avons envie.
La présence et l’écoute de Stéphane me font un bien fou. Nous avons des longues discussions sur les sujets les plus disparates, toujours dans la bienveillance et le respect mutuel. Nous partageons des moments de franche rigolade, d’autres plus profonds. Comme toujours, la maturité de Stéphane m’impressionne.
Puis, un soir, je manque de peu de tout faire capoter.
Nous passons un bon moment à discuter à bâtons rompus sur son canapé autour d’une bière.
Au fur et à mesure que la soirée avance, que la deuxième bière enivre mon esprit, et que la douce bienveillance de Stéphane cajole mon cœur meurtri, je repense à nos belles conversations d’il y a sept ans, à notre balade au Jardin des Plantes, à son risotto, au DVD d’Aladin.
Mais également à sa douceur pendant l’amour, à sa sensualité. Si Jérém est le garçon qui m’a dépucelé et qui m’a fait connaître le plaisir de baiser, Stéphane restera à tout jamais pour moi le garçon qui m’a montré ce que c’était de faire l’amour. A une époque où Jérém ne voulait que me baiser, me refusait le moindre geste de tendresse, et cachait notre relation à la Terre entière comme quelque chose de sale et honteux, Stéphane m’avait montré que le sexe ne devait pas forcément ressembler à un rapport de force entre soumis et dominant, qu’on pouvait s’assumer en tant qu’homo et être heureux, et que je n’avais pas à avoir honte de qui j’étais.
Je me souviens de son torse délicatement velu, tiède, doux.
Je me souviens de ses jambes poilues et plutôt musclées.
Je me souviens de ses caresses, de sa façon de m’apporter un plaisir fou et inconnu, de me faire découvrir une nouvelle sexualité.
Je me souviens de sa façon de me renvoyer une nouvelle image de moi, l’image d’un garçon désirable et non pas seulement d’un trou à bite, sensation qui était à ce moment-là totalement nouvelle pour moi, et si agréable.
Je me souviens de la douceur de son physique qui n’était pas façonné à la salle de sport, mais nature et assumé.
Plus la soirée avance, plus je le trouve séduisant, plus encore qu’il y a sept ans. Et je sens monter en moi une envie de plus en plus débordante de sensualité.
Je n’ai pas envie de rentrer, j’ai envie de me sentir désiré et aimé, compris et rassuré. J’ai envie de faire l’amour avec Stéphane comme au bon vieux temps. J’ai envie de cet amour des sens et de l’esprit, j’en ai furieusement envie cette nuit, avec Stéphane.
J’ai envie de penser que lui aussi se souvient de nos moments de sensualité. J’ai envie de tenter ma chance. Je m’approche de lui et je l’embrasse.
Ses lèvres sont toujours aussi douces, mais elles demeurent immobiles. Stéphane ne me repousse pas, mais son manque de réaction en dit long.
— Excuse-moi, je regrette à haute voix, soudain gêné par mon geste.
— Ne t’excuse pas.
— Je n’aurais pas dû.
— Ne te méprends pas, Nico. Tu es vraiment beau garçon, et je te trouve très attirant. Mais en ce moment, tu n’as pas besoin de ça. Tu n’es toujours pas guéri de ta séparation, et tant que tu ne te seras pas reconstruit, tu ne seras pas prêt, tu ne seras pas assez solide pour te lancer dans une nouvelle histoire. Et même le sexe, ça ne t’apporterait pas grand-chose. Aujourd’hui, tu n’as pas besoin d’un amant, mais plutôt d’un pote.
C’est difficile d’entendre ces mots lorsqu’on aspire plus que tout à retrouver au plus vite un amour et une sensualité que l’on croit, à tort, capables de nous faire oublier ce qu’on a perdu.
Lorsque le manque d’amour est déchirant, on a envie de brûler les étapes, de retrouver le bonheur d’avant, au plus vite. Mais Stéphane a raison, il a terriblement raison.
— Tu veux qu’on soit potes ? il me questionne.
— Je ne demande pas mieux.
— Je crois que ce sera plus simple d’être potes si on ne couche pas ensemble.
— C’est pas faux.
Un peu plus tard en novembre.
Depuis que nous sommes officiellement potes, un nouveau sujet de conversation et de débat s’est invité entre Stéphane et moi et occupe désormais une partie importante de nos échanges. Ce sujet, ce thème majeur de l’existence est, je vous le donne en mille, le Masculin. Assis à une terrasse ou en marchant dans la rue, nous partageons nos impressions au sujet des spécimens qui nous font nous retourner sur leur passage ou sur leur présence. C’est marrant, c’est libératoire, c’est jouissif.
Je n’ai jamais eu ce genre de partage et de complicité avec qui que ce soit, pas même avec Jérém. Je l’ai eu un peu avec Elodie, au bon vieux temps où nous avons fait « les quatre cents coups » ensemble, mais jamais à ce niveau de partage. Entre mon pote Stéphane et moi, il n’y a pas de place pour les tabous. Si on trouve un mec bandant, on se le dit, on se dit pourquoi et comment, et on se dit ce qu’on aurait envie de lui faire, ou de le laisser nous faire. On se raconte nos expériences, on revient sur nos erreurs, sur nos bonheurs, sur nos échecs.
Je découvre l’humour de Stéphane, souvent mordant, parfois égrillard, ou encore polisson, mais jamais vulgaire.
Une bonne blague, une glace place du Capitole, une balade avec Gabin le long du Canal, un resto, un bon film à regarder au cinéma ou en DVD, un bon CD à faire tourner en buvant du Jurançon frais et moelleux, un mot réconfortant toujours prêt à être dégainé lorsque, parfois, la mélancolie me saisit encore sans prévenir.
Tout ça, c’est mon pote Stéphane.
On a du mal à l’admettre quand on va mal et qu’on a qu’une envie, celle de se rouler en boule et de crever, mais l’amitié est vraiment l’un des rares remèdes contre les peines de cœur.
Un pote, un vrai, c’est un trésor inestimable.
Toujours en novembre 2008.
Un an déjà que Jérém m’a quitté. Il y a un an, je montais à Londres pour savoir. Il y a un an, je découvrais Jérém amoureux d’un autre garçon. Triste anniversaire. Heureusement, Stéphane est là pour me sortir et me changer les idées.
Toujours et encore en novembre 2008.
En cette fin d’année, quelque chose d’impensable se produit dans l’une des plus grandes nations du monde. Le premier président noir des Etats-Unis d’Amérique s’installe à la Maison Blanche, suscitant un engouement populaire sans précédent depuis Kennedy. Qui l’eût cru encore quelques mois plus tôt ?
Début décembre 2008.
Au fil des semaines, je vais mieux. Sans doute parce qu’il estime que je suis prêt, Stéphane me propose une sortie un peu différente de nos classiques resto/ciné.
— On se fait une sortie au B-Machine ce week-end ? il me propose un mercredi soir après m’avoir encore battu au Scrabble.
— Je ne sais pas si j’en ai envie. Je suis pas mal sorti cet été, et les coups d’un soir, j’ai donné. En ce moment, ça ne me botte pas vraiment.
— Je ne te parle pas d’aller lever un mec, je te parle d’aller boire un coup, danser, nous amuser. Le reste viendra en temps et en heure. No stress, mon pote !
Oui, no stress. Ça pourrait être la devise de Stéphane. Avec lui, tout semble si naturel, si simple, si apaisant. Alors, j’accepte sa proposition.
Le samedi suivant, je franchis une nouvelle fois le seuil de la boîte où j’ai retrouvé Romain quelques semaines plus tôt, et d’autres mecs par la suite, je retourne dans ce milieu par lequel j’ai été dégoûté à un moment. Je le franchis accompagné de Stéphane.
C’est bon d’aller en boîte avec un pote. C’est beaucoup moins glauque que d’y aller tout seul en espérant lever un type. On a quelqu’un à qui parler, avec qui partager un verre. Mais aussi des impressions, des commentaires, des avis, des classements, des blagues au sujet de la faune masculine circulant dans cet écosystème si particulier.
Stéphane ne rechigne pas non plus devant la « piste de danse ». Quand un morceau lui plaît, il n’hésite pas à se « jeter » dans le flow, et à y rester parfois des heures durant.
Décembre 2008.
Depuis mes retrouvailles avec Stéphane, je vais mieux, beaucoup mieux. Je retrouve le sourire, l’envie d’écouter de la musique, de sortir, je reprends goût à la vie.
Puis, la période de Noël arrive, les magasins et les rues se chargent de décorations, les chaînes de télé des films de Noël dont le seul intérêt est le bogoss de service au casting, et la morosité me cueille à nouveau. Noël, c’est une période chargée de souvenirs, notamment celui de 2003. Ça va faire déjà cinq ans que Jérém était venu me chercher à la maison de mes parents, qu’il m’avait amené à l’hôtel, qu’il m’avait fait l’amour, c’était un Noël magique.
Je sais qu’il ne viendra pas me chercher, mais au fond de moi, « All I want for Christmas » c’est toujours lui, lui, lui !
Heureusement Stéphane est là. Toujours et encore. Un jour, au détour d’une conversation, je lui ai dit que Tchaïkovski était l’un de mes compositeurs classiques préférés, si ce n’est carrément mon préféré. Et que le fait qu’il ait été du bon côté de la force à une époque et dans une nation où cela était sévèrement réprimé le rendait encore plus cher à mon cœur. Nous avons passé un vendredi soir à écouter du Tchaïkovski sur sa super sono, avec mes CD, tout en parlant de « Tribunal d’honneur », le livre de Dominique Fernandez épousant une théorie troublante autour de la mort prématurée du grand compositeur, théorie liée justement à son homosexualité.
Stéphane n’a ni oublié que j’aime la bière blanche, ni que j’aime Tchaïkovski. Quelques jours avant Noël, il m’annonce qu’il a acheté deux places pour le Casse-Noisette qui se joue au théâtre du Capitole. Si ce n’est pas adorable, ça !
Il ne me reste qu’à le remercier. Je ne peux me retenir de le prendre dans mes bras et de lui dire, venant du plus profond de mon cœur :
— Merci d’être là ! Je suis tellement chanceux de t’avoir comme ami !
— Moi aussi je suis content qu’on soit devenu de véritables amis.
— Et tu sais quoi ? il enchaîne sans transition, on va bien se saper… chemise, veste, cravate… on se fait beaux, ça te dit ?
Samedi 20 décembre 2008.
Ce soir, à quelques jours de Noël, la place du Capitole est animée par son traditionnel marché de Noël, et elle brille de mille feux. Le théâtre du même nom en impose à partir de sa façade, bâtie de pierre blanche et de briques rose. Ça continue dans l’entrée, tout y est précieux et solennel.
C’est la première fois que je mets les pieds dans ce théâtre. Et j’avoue que ça ne me serait jamais passé par la tête d’en franchir la porte si Stéphane ne m’y avait pas invité. Sacré Stéphane !
J’ai joué le jeu, j’ai sorti ma chemise blanche, ma cravate sur des tons de bleus, mon costume gris métal. J’ai voulu « innover » avec un jeans et des chaussures de ville.
Quant à Stéphane, il est super beau dans sa chemise bleu intense qui me rappelle celle de Jérém lorsqu’il était venu me voir à Bordeaux la première fois pour mon anniversaire, son nœud papillon bleu, et sa belle veste anthracite. Il est vraiment séduisant, et carrément sexy.
Parfois, il m’arrive quand même de regretter que notre statut de meilleurs potes du monde nous interdise de partager du plaisir sensuel.
Ce soir, je nous trouve très beaux, et je me sens bien, tellement bien.
Dès le premier regard, la grande salle m’en met plein la vue avec ses dorures, ses velours, son allure de théâtre à l’italienne.
Contrairement aux concerts auxquels je suis habitué, le spectacle commence pile à l’heure prévue. Et dès le lever le rideau, j’en prends encore et toujours plus plein la vue.
C’est la première fois que j’assiste à une grande représentation classique, la première fois que j’assiste à un ballet en bonne et due forme, la première fois que j’écoute du Tchaïkovski joué par un orchestre. Et j’en suis carrément enchanté. Je croyais connaître par cœur le Casse-Noisette, en fait je ne connais que la suite du Casse-Noisette. En fait, je découvre plein de musiques de raccord que je ne connais pas.
« Un conte féérique qui finit bien, une atmosphère de Noël dont on ne se lasse pas, des mélodies reconnaissables dès les premières notes » était écrit sur le programme du théâtre.
Casse-Noisette est avant tout du bonheur à l’état pur distillé sur une partition musicale. Quant à la danse et à la mise en scène, ce sont autant de sortilèges qui achèvent de nous faire basculer dans un monde où tout est grâce, harmonie, volupté.
Il est près de 23 heures lorsque la représentation prend fin. Je sors du théâtre avec des étoiles plein les yeux.
— Merci Stéphane, mille fois merci, j’ai passé une magnifique soirée.
Mercredi 24 décembre 2008.
Stéphane fête le réveillon dans sa famille, et moi dans la mienne. C’est le deuxième réveillon sans Jérém. Je sais qu’il n’y a aucun espoir qu’il vienne me chercher. Je me demande où il le passera, est-ce qu’il sera avec Rodney ? Est-ce qu’ils le fêteront chacun dans leur famille ou est-ce qu’ils en sont déjà au stade de faire des présentations et des réveillons officiels ? Ce ne serait pas impossible, car ça fait déjà plus d’un an qu’ils sont ensemble ! Et si c’est le cas, ce sera dans la famille de Rodney ou bien dans le domaine viticole Tommasi ?
Est-ce qu’ils vont faire l’amour cette nuit comme nous l’avions fait en cette fameuse nuit de réveillon que nous avions terminée à l’hôtel ? Est-ce que, de la même façon, ils vont partir à Campan dès demain ? Charlène m’avait dit que Jérém lui avait annoncé sa venue avec Rodney pendant la période de Noël…
Est-il toujours heureux avec Rodney ? J’espère que oui. En fait, non, j’espère que non. Au fond de moi, j’espère que Jérém va se raviser, que cette histoire abusive va se terminer comme un cauchemar, j’espère toujours que Jérém va revenir vers moi !
Mercredi 31 décembre 2008.
Pour le réveillon du 31, j’invite Stéphane chez mes parents. C’est l’occasion de leur présenter enfin mon nouveau grand pote, le garçon qui m’a enfin arraché de la morosité qui s’était emparée de moi depuis ma séparation d’avec Jérém. Depuis le temps que je leur parle de lui, ils sont heureux de mettre enfin un visage sur ce prénom.
L’apéro n’est pas terminé, qu’ils sont déjà sous son charme.
***
L’année 2009.
Janvier 2009.
En plus de nos sorties cinéma, resto, de nos soirées DVD/Musique/Scrabble, Stéphane et moi sortons dans le milieu presque tous les week-ends. Il nous arrive de nous faire mater, mais jamais aborder ou draguer ouvertement. Nous sommes tellement complices et tellement « tout le temps ensemble » que parfois on doit nous croire en couple. Mais ni Stéphane ni moi ne sommes pas particulièrement en quête d’aventures. Je crois que notre amitié nous est si précieuse que nous la préférons aux plans d’un soir. Je crois que nous nous faisons du bien mutuellement, et ça me fait chaud au cœur.
Stéphane est pour moi à la fois le pote et le grand frère qui m’ont fait défaut pendant mon enfance et mon adolescence.
Si j’ai envie de tirer un coup, il existe désormais des réseaux facilement accessibles depuis mon ordinateur. Je m’offre un plan de temps à autre. Parfois c’est sympa, du moins sur le moment, le plus souvent c’est décevant. Si le gars me plaît, j’ai envie de le revoir. Le plaisir des corps crée chez moi un attachement que les autres ne semblent pas ressentir. Bien au contraire, là où je ressens l’envie de remettre ça, la plupart des autres gars ressentent l’envie de surtout de ne pas remettre ça.
Au début, ça me faisait me questionner à mon sujet. Je me disais qu’ils devaient percevoir ma détresse et que ça devait les faire fuir, je me disais que je n’étais pas prêt, que mon cœur était toujours ailleurs, que mon corps ne réclamait toujours que le contact de celui qui n’est plus là, que mon plaisir, et celui que je peux offrir, était toujours verrouillé au Grand Absent.
Mais au fil du temps, j’ai réalisé que dans le milieu, les aventures sont la norme, l’attachement l’exception. La relation suivie est fuie à la faveur de la multiplication des conquêtes. D’ailleurs, Stéphane en fait lui aussi l’expérience.
Puis, ce qui devait arriver arriva. Il est arrivé qu’un gars se montre plus attaché que je ne l’étais. Et ça m’a effrayé. Je suis bizarrement constitué. J’ai envie de revoir certains gars qui ne veulent pas me revoir, et quand un gars veut me revoir, j’ai envie de prendre les jambes à mon cou.
Ce qui est bien dans tout cela, c’est d’avoir un pote avec qui parler de tout ça librement, de pouvoir recueillir son ressenti, ses impressions, ses conseils.
Stéphane avait bien raison, j’avais avant tout besoin d’un pote. Si je ne l’avais pas, je serais bien mal aujourd’hui.
Lorsque le spleen m’attrape parfois, je sais que je peux trouver en Stéphane une oreille attentive. Il m’écoute, avec bienveillance, il me questionne, à la fois avec tact mais aussi avec une pertinence redoutable, me mettant parfois devant mes contradictions, sans pour autant me faire la morale, et en me livrant des analyses très intéressantes.
— Je pense que ce garçon t’a aimé sincèrement, il considère un soir, alors que la mélancolie m’a amené à verbaliser mes éternels questionnements au sujet des raisons de l’éloignement de Jérém.
— Et visiblement tu lui as apporté beaucoup de bonheur, tout comme il t’en a apporté. Mais quand je t’entends parler de son attirance pour les garçons plus âgés, plus virils, pour des garçons appartenant à son monde, au monde du rugby, je ne peux m’empêcher de penser qu’il a toujours eu besoin de quelqu’un de plus fort que lui, plus fort mentalement, je veux dire. Pour le pousser à surmonter les difficultés, que ce soit dans le rugby ou dans la vie plus en général.
— Tu as fait du mieux que tu as pu, tu as essayé de le rassurer, tu l’as aidé à s’assumer et à être heureux. Et tu as réussi, pendant un temps. Mais l’agression dont vous avez été victimes a certainement ravivé ses peurs et sa honte. Ça l’a fait se sentir vulnérable. Quand il s’est senti outé dans le milieu du rugby, il a paniqué en pensant devoir renoncer à sa carrière. Tu m’as dit qu’il était parti en Australie. En général quand on part si loin et si longtemps, c’est qu’on est vraiment perdus.
— Tu as raison, je n’ai pas su le faire se sentir en sécurité, j’admets, les larmes aux yeux.
— Parfois, même si on aime comme des fous, on n’est pas en mesure d’apporter à l’Être aimé ce dont il a besoin. Parce que la vie ne nous a pas encore équipés pour cela, ou parce que notre nature profonde fait qu’…
— … fait qu’on a tous besoin d’être rassurés, de nous sentir protégés, je le coupe, en larmes.
— Je pense que c’est ça, tu as dit le mot. Protégé. Ce garçon se sent vulnérable et il a besoin de se sentir protégé.
— Mais s’il a si mal vécu le fait de se sentir outé dans le milieu du rugby français, pourquoi il s’est remis dans la même situation inconfortable dans le rugby anglais ? Et même dans une situation encore pire, se mettre avec un coéquipier, vivre ensemble…
— On ne peut pas savoir ce qui s’est passé dans sa tête. Ce Rodney appartient à son monde, et ça a dû probablement le faire se sentir conforté à la fois sur le plan sportif et personnel. Et ça, ça a pu conquérir son cœur. Et quand on tombe amoureux, quand on se sent protégés par l’amour de l’autre, on a tendance à prendre des risques. Parfois l’amour peut nous donner l’illusion que les mêmes ingrédients peuvent donner un résultant différent…
— Je le lui souhaite, je le lui souhaite de tout cœur. Car, s’il devait vivre une nouvelle fois ce qui s’est passé après notre agression, je crois qu’il ne le supporterait pas.
Toujours janvier 2009.
Plus le temps passe, plus je me dis qu’en tombant sur Stéphane en ce jour d’automne, j’ai vraiment trouvé le meilleur des potes. Un pote à qui je dois toute la sincérité qu’il mérite.
Un soir, j’ai envie de revenir sur un moment assez crucial dans ma vie, et de lui donner une explication que je lui dois depuis longtemps.
— Je suis désolé d’avoir annulé notre dernier rendez-vous il y a sept ans…
— Tu es allé voir Jérém, ce soir-là, n’est-ce pas ?
— Oui…
— Je m’en suis toujours douté. Mais tu sais, c’est pas grave. Ce garçon, tu l’avais tellement dans la peau !
— Tu m’en veux pas ?
— Non, pas du tout. J’ai apprécié chacun des moments que nous avons passés ensemble. Mais tu as bien fait d’aller le rejoindre. Ça t’a ouvert les portes de quelques années de bonheur avec lui. Et le bonheur, il ne faut jamais le laisser passer quand il se présente à nous.
Parfois, je me demande si en cette fameuse nuit où j’avais annulé le rendez-vous avec Stéphane – parce que Jérém m’avait sommé de le rejoindre à la salle de muscu du terrain de rugby pour une de ces sublimes séances de baise dont il avait le secret – j’ai fait le bon choix. Je me demande comment aurait été ma vie si ce soir-là j’avais laissé tomber Jérém et que j’avais décidé d’aller plutôt vers Stéphane. Est-ce que j’aurais été plus heureux, est-ce que j’aurais moins souffert ? Certes, Stéphane allait partir. Mais si ça n’avait pas été le cas ? Avec les si…
Et pourtant, l’idée me trotte parfois dans la tête.
Février 2009.
Le mois de février est marqué par une rencontre inattendue. Un dimanche matin, je reçois un coup de fil de Ulysse. Le beau blond est à Toulouse pour un match Stade contre Stade, et il me propose d’aller prendre un verre ensemble en fin d’après-midi. J’accepte avec plaisir.
— Je m’en suis tellement voulu pour ce qui vous est arrivé, il me glisse de façon un peu abrupte au détour d’une conversation, comme s’il avait besoin de se délivrer d’un poids qui écrasait son cœur depuis longtemps.
— Pourquoi tu t’en voudrais ? je m’étonne.
— Si je ne vous avais pas invités chez moi, vous n’auriez pas croisé cette bande de fumiers !
— Tu as voulu bien faire, tu as voulu fêter l’anniversaire de ton pote. C’était adorable.
— Tu tiens le coup, Nico ?
— Il me manque tellement…
— A moi aussi il me manque. Sans lui, l’équipe n’est plus la même. J’avais prévu de continuer jusqu’en 2010, mais je suis tellement dégoûté que finalement je vais raccrocher les crampons à la fin de cette saison.
— Et ton projet de resto avance comme tu le veux ?
— Il avance très bien. L’ouverture est prévue pour l’été.
— Je suis heureux pour toi.
— Tu as des nouvelles de Jérém ? je ne peux m’empêcher de le questionner. Mes bonnes résolutions de début d’année de ne plus chercher à avoir des nouvelles de Bobrun n’auront pas tenu longtemps.
— Je l’ai de temps en temps au téléphone.
— Il est parti en Afrique du Sud ?
— Il y est depuis deux mois. Le Super 14 commence dans un mois.
— Avec Rodney ?
— Oui, avec Rodney.
— Tu l’as rencontré, ce… Rodney ?
— Je le connais depuis des années, j’ai joué contre son équipe plusieurs fois, et nous nous sommes retrouvés parfois en soirée, après les matches…
— Je veux dire… tu l’as rencontré avec Jérém ?
— Je suis allé en Ecosse cet été, oui…
— En Ecosse ?
— Le frère de Rodney habite là-bas… il m’explique, l’air un brin embarrassé.
Alors, ça y est. Le temps des présentations familiales est venu. Jérém a été accepté par la famille de Rodney. J’ai l’impression qu’on arrache une nouvelle brique de mon cœur.
Quand apprendras-tu, Nico, que si tu ne veux pas avoir des réponses déplaisantes, il ne faut pas poser les questions qui sont susceptibles de les générer ?
Toujours en février 2009.
Je sais que le Super 14, ce tournoi entre équipes du Pacifique commence à cette période. Je choisis de l’ignorer. Jérém a disparu pour moi, alors il me semble que c’est inutile de tenter de suivre sa trace.
Mai 2009.
Mon amitié avec Stéphane ne connaît pas la crise. Lors de l’un des premiers ponts du mois de mai, nous allons à l’Océan, à Biscarrosse. C’est mon premier voyage de l’après Jérém.
Juin 2009.
— Cette année, j’ai envie d’aller à la Pride, m’annonce Stéphane un soir.
Sur le coup, je suis un brin réticent.
— Je ne suis pas certain de me reconnaître dans l’exubérance et la provocation de cette manifestation tape à l’œil… j’avance.
— Je te rassure, moi non plus je ne me sens pas prêt à passer une perruque et à monter sur un char les fesses à l’air. Mais il est important que cette manifestation vive, qu’elle soit nourrie, nous avons besoin de montrer que nous existons, et que nous avons des revendications, comme la lutte contre l’homophobie, les discriminations, la stigmatisation…
Samedi 20 juin 2009.
J’ai lu que cette année on célèbre le 40ème anniversaire des émeutes du « StoneWall Inn » à New York, le 28 juin 1969, une date clef dans l'histoire de la lutte contre toute forme de maltraitance liée à l'orientation sexuelle.
La marche des Fiertés démarre de la place Jeanne d'Arc à 14 heures. Il fait chaud, il y a un monde fou, c’est très coloré, c’est bruyant, c’est vivant, c’est beau. Une bande de percussions ouvre le cortège, les basses à fond la caisse, ça fait vibrer les tympans, les entrailles, la rue, jusqu’aux immeubles.
Des filles qui aiment des filles, des garçons qui aiment les garçons, des beaux, des moins beaux, des gros, des laids, des sexy, des efféminés, des vieux, des jeunes, des discrets, des démonstratifs – deux garçons qui se tiennent la main dans la rue, d’autres qui s’embrassent, comme c'est mignon – des décolorés, des maquillés, des solitaires, des bandes de potes, toutes les couleurs sont dans l’arc en ciel.
Je suis submergé par l’émotion de me trouver au milieu d’un événement important où chacun a le droit d’être celui qu’il veut, sans peur des regards, des jugements, des conséquences. Un droit qui n’a pas toujours existé et qui a été arraché il y a bien longtemps au terme d’une lutte parfois violente. A tous ceux qui ont manifesté en premier il y a quarante ans contre une police qui avait le droit de tabasser, j’ai envie de dire un immense MERCI.
Je suis heureux d’y être, et je suis heureux d’y être en compagnie de Stéphane.
Le défilé continue boulevard de Strasbourg, puis boulevard Carnot. Passer devant la rue de la Colombette éveille en moi des souvenirs et une blessure encore bien douloureux. Mais Stéphane me parle, et ça m’arrache à ma tristesse.
Les pancartes et les banderoles brandies par les manifestants sont nombreuses. Au milieu d’innombrables drapeaux arc en ciel se glissent des slogans contre les discriminations :
« Sous les paillettes, la rage ! ».
« Je suis un criminel dans 69 pays, car j’ose aimer ».
« Fatigay de se cacher ».
Certains choisissent l’humour pour toucher les esprits :
« Only Beyonce can judge me ».
D’autres encore, celle de la provocation des jeux de mots :
« Nos désirs font désordres ».
La fierté est un thème récurrent :
« Sois fier(e) de qui tu es »
« Je n’ai pas choisi d’être gay, mais putain, qu’est-ce que j’aime ça ! »
« J’ai le droit d’aimer qui je veux ».
L’homophobie en prend pour son grade :
« L’homophobie tue »
« La haine n’aura jamais le dernier mot »
« A quand le vaccin contre la haine ? ».
Et mon préféré :
Je suis de plus en plus content de participer à la Pride, j’emmerde mes agresseurs parisiens, ils ne sont que de pauvres gens. Des minables qui ont quand même réussi à détruire ma vie. Les souvenirs de cette horrible nuit remontent en flash, comme des lames qui transpercent mon cœur. Je revis les coups, la peur de ne pas nous en sortir, l’humiliation, le goût du sang dans ma bouche.
J’en ai le souffle coupé, j’ai la tête qui tourne, j’ai mal au cœur. Stéphane comprend que je ne me sens pas bien et me propose de faire une pause à l’ombre.
— C’est quoi l’homophobie ? j’entends éructer d’un mégaphone.
— Une façon de s’inscrire en faux vis-à-vis de celui qu’on ne veut pas être accusé d’être ? J’agresse les pédés, donc je n’en suis pas ?
— Une manière d’exorciser une part inacceptable de soi ? Quel hétéro ne s’est pas surpris un jour à douter un tant soit peu de l’inébranlabilité de son hétérosexualité ?
— L’homophobie est-elle un biais intellectuel qui tend à stigmatiser ou à dévaloriser celui qui est différent de soi pour affirmer par contraste sa propre « valeur » ?
— L’homophobie fait souvent appel à des valeurs religieuses. Combien d'atrocités ont été justifiées au nom des valeurs religieuses !
— Elle fait parfois appel à des valeurs morales. Est-ce que le respect de l’autre n’en est pas une ? La morale est très souvent un concept à géométrie variable, suivant comme ça arrange !
— Quels que soient les mécanismes psychologiques qui en sont à la base, l’homophobie est un marqueur incontestable de limitation intellectuelle, de faiblesse d’esprit, de mauvaise foi, d’incapacité à accepter la complexité de la Création.
— On emmerde les homophobes !
— On emmerde les homophobes !!!!!!!!!!!! reprend la foule d’une seule voix qui fait trembler la ville.
— Il est temps, il est temps, que la honte change de camp !
— Il est temps, il est temps, que la honte change de camp !!!!!!!!!!!!!!
Oui, il est temps, il est vraiment temps.
Parmi les pancartes brandies, on peut lire également des slogans au sujet des droits et de l’égalité :
« Mariage, parentalité, l’égalité, c’est pour quand ? ».
Nous sommes en 2009. Difficile d’imaginer à cet instant que dans quatre ans à peine la loi Taubira sera à l’ordre du jour, qu’elle cristallisera le débat citoyen à un niveau rarement atteint, qu’elle provoquera un immense tollé dans ce pays, qu’elle amènera des dizaines de milliers de gens dans la rue pour manifester pour voir ses droits reconnus, et des centaines de milliers pour manifester pour que les inégalités persistent.
C’est au Monument aux Morts que les chars font leur entrée en scène. Nous nous arrêtons pour les laisser passer, pour les observer. Au menu, des garçons qui dansent en petite tenue, des distributions de tracts, de capotes et de gel, et toute sorte de musique festive, de YMCA à Vogue, de Rasputine à Express Yourself, de Daddy cool à Dancing Queen, de Pokerface à Human Nature (celle de Madonna, la chanson où elle dit qu’elle ne regrette aucun de ses choix).
Tout est chaos, à côté…Partout autour de nous la fête est dans l’air et elle semble égayer la ville tout entière de ses couleurs, de ses sons, de sa fierté.
Depuis un char me parviennent les basses d’un tube iconique de Dalida, au rythme disco et fêtard.
Dalida, Dalida. Elle n’est pas seulement la chanteuse du disco ou de « Gigi l’amoroso », elle est aussi l’interprète de « Pour ne pas vivre seul »,
Et de « Depuis qu’il vient chez nous ».
Deux chansons qui traitent chacune à leur façon du sujet pour lequel nous tous sommes venus manifester dans la rue aujourd’hui.
J’ai toujours été très touché par Dalida. J’ai toujours aimé m’identifier à des personnalités qui, forgées par les épreuves, savent sublimer leurs blessures pour créer, et devenir des stars adulées.
Dalida s’inscrit dans la lignée de stars féminines à la fois glamour, sensuelles, sombres, amoureuses et malheureuses, sensibles, fatales, qui ont su faire de leur différence, de leur singularité, ne serait-ce que celle d’être des femmes dans un monde régi par les hommes, une force de la nature. Des stars qui renvoient à la fois une image de perfection et de fragilité, de courage et de panache aussi. Soit l'exact opposé de la peur, de la honte, de l’opprobre sociale, de la mésestime et du manque de confiance en soi dont on est souvent victimes en tant que gay.
De Dalida à Madonna, en passant par Mylène et tant d’autres, nos icônes sont nos poupées cathartiques, des saintes et des putains, qu’on adore, qu’on envie, elles sont des modèles, celles que l’on voudrait être (parfois) et celles que l’on voudrait comme amies, aussi.
Et nos « icônes », sont aujourd’hui toutes réunies à Toulouse. Sur un char haut en couleur, je repère une Madonna Ultra Low Cost, une Britney Spears de recup’, une Lady Gaga avec le contrôle technique largement périmé, une Cher plus refaite que nature, une Mylène aux cheveux sur le point de s’embraser, et même une Dalida à moustaches.
Ça m’amuse. Et même si je ne me reconnais pas dans toutes les nuances de l’arc en ciel, je suis conscient que les difficultés que nous devons affronter sont les mêmes, et que si nous voulons obtenir le respect de la part des « moldus » nous nous devons avant tout du respect mutuel, nous devons montrer l’exemple, être solidaires, nous serrer les coudes, nous montrer unis, car c’est de l’union que naît la force.
Un jeune photographe au t-shirt jaune et à la belle petite gueule barbue perché sur un échafaudage aimante mon regard. Le mec capte mon désir insistant, et ça a l’air de l’amuser. Il me sourit, il pointe l’appareil vers moi et fait mine de me prendre en photo.
Nous laissons passer les derniers chars et nous nous remettons dans le flux des Fiertés. Pendant que nous parcourons la rue de Metz, je pense à Esquirol, à cette brasserie où Jérém a bossé le temps d’un été, avant de rentrer dans le monde du rugby professionnel. Je me souviens des fois où je suis passé devant la terrasse juste pour le mater, je me souviens des pauses de l’après-midi lorsqu’il venait me baiser dans ma chambre, je me souviens de cette baise qu’il m’avait offerte dans l’arrière-boutique un jour où j’avais osé me pointer pour prendre un verre.
Les souvenirs remontent, la nostalgie avec, j’ai du mal à retenir mes larmes.
Le cortège emprunte la rue Alsace-Lorraine et la rue Lafayette pour arriver place du Capitole.
Pour le mot de la fin de cette belle journée, j’aime garder celui inscrit sur fond arc en ciel sur une pancarte qui dit :
« Soyons fiers d’aimer ! ».
Le soir même de la Pride, Stéphane me parle de son cheminement personnel pour apprendre à se connaître et à s’accepter.
— Dès l'enfance on ressent quelques signaux, on a quelques indices, mais on ne les comprend pas. On se sent différent, sans arriver à s’avouer pourquoi. Au fond, on sait, mais on ne veut pas savoir. Et avant qu’on arrive à faire la paix avec soi-même, les insultes et les humiliations commencent à pleuvoir. Quand on est gay, l’insulte précède la prise de conscience de qui on est. C’est dur de se construire dans la honte et l’humiliation.
— C’est à partir du collège que j'ai véritablement compris que je m'intéressais aux garçons. Pendant des années, je me suis dit que je devais changer, que je devais essayer d’aller vers les filles. J’ai un peu essayé, mais je n’y arrivais pas. De toute façon, j’étais déjà catalogué comme le « pédé de la classe », alors, à quoi bon essayer d’être autre chose ?
— J’avais déjà connu des picotements dans le ventre à cause de certains garçons, et à cette époque j’en pinçais pour un camarade qui s’appelait Jordan. Je me branlais chaque soir en pensant à lui dans mon lit. Mais je n’ai jamais osé aller vers lui. Je n’ai jamais osé parce que j’étais certain que si j’avais osé lui dire ce que je ressentais j’aurais ramassé une beigne et une honte dont je ne me serais pas remis. A 14 ans, j’étais un ado solitaire avec pour seuls compagnons mes bouquins et mes CD de musique classique.
— C’est là qu’une sorte de « coup de tonnerre » a traversé l’horizon de mon existence. C’était au printemps 1989, c’était la dernière année de collège, et j’étais en voyage scolaire à Londres. Sylvie, une camarade de classe, avait amené la cassette et elle l’avait donnée au chauffeur. Je me souviens qu’au gré de l’autoreverse, elle avait tournée en boucle dans les enceintes du bus. A ce moment-là, je n’accrochais pas à toutes les chansons, mais surtout à la chanson « Like a prayer » qui a donné le nom à l’album, que je connaissais déjà depuis quelque temps.
— Avant le voyage, il y avait eu la pub Pepsy, avec une Madonna rayonnante, souriante, effrontée, l’air d’oser. Et cet « air d’oser » m’a beaucoup ému, à une époque où, justement, je n’osais pas, ni aimer, ni être en phase avec moi-même, ni même être franc avec moi-même.
— Le deuxième extrait de l’album a été Express Yourself. Quand je l’entendais chanter qu’« on mérite tous le meilleur dans la vie », « qu’on ne doit jamais se résigner à être rabaissé », « qu’on doit pouvoir s’exprimer librement », j’en avais des frissons. Alors, oui, cette chanteuse si effrontée, avançant tout droit sur son chemin, l’air de dire « personne ne va me dire ce que je dois faire » forçait l’admiration chez moi.
— En plus, ce titre a été illustré par un clip bluffant, inspiré de l’ambiance du film « Metropolis ». On y voyait une flopée de mâles musclés bosser puis danser dans une grande usine. Madonna y était sublime.
— Cet album contenait également pas mal de ballades, et quelles ballades ! Des chansons aux mélodies empreintes de mélancolie. Une mélancolie qui épousait bien la mienne, une tristesse d’ado solitaire et mal dans sa peau.
— Et puis, il avait le tract…
— Ah, oui, celui au sujet du SIDA ! je réalise.
— Exact ! Je suis tombé dessus en feuilletant le livret, et ça a été un choc. Quand j’ai lu le mot « AIDS », j’ai été interpellé. A l’époque, on entendait de tout au sujet du Sida, mais en même temps pas assez, et surtout pas mal de choses inexactes, car cette nouvelle maladie était à la fois ignorance, tabous et stigmatisation. Alors, quand j’ai lu ces quatre mots :
« Regardless of sexual orientation »,
— Je crois bien que j’ai pleuré. J’ai pleuré parce que ces quatre mots me disaient qu’il y avait d’autres gars comme moi, que je n’étais pas le seul pédé de la planète. J’ai pleuré parce que dans ce texte il n’y avait pas de jugement, pas de condamnation, il y avait juste des faits. Ça peut paraître banal en 2009, mais en 1989, pour un garçon de 14 ans qui se découvrait différent, ces quelques mots sonnaient comme une révélation.
— Dans ce tract il était également question d’« anal sex », et de « putting on a condom ». Là non plus il n’y avait pas de jugement, juste un constat et du bon sens. Ce petit texte était d’une clarté exemplaire, et il a fait exister pour moi une réalité que je n’arrivais même pas à concevoir auparavant. AIDS is no party ! J’avais enfin l’impression que quelqu’un me parlait franchement, qu’il me mettait en garde avec une bienveillance qui me touchait immensément.
— A cette époque je ne suivais pas encore Madonna, je savais tout juste qu’elle existait. Cet album m’a carrément explosé à la figure, une chanson après l’autre. Il s’est étalé sur cette période de ma vie, il en a aimanté les souvenirs. Et il me les rend à chaque écoute.
Cet album est indissociablement lié à l’époque de mes 14 ans, l’époque de mes humiliations et de ma solitude au collège. Sa musique, sa « présence » me donnaient de la force de tenir bon, d’attendre que ça passe. Son impertinence, son effronterie m’inspiraient. Ses mélodies, sa voix et sa présence suffisaient à mon bonheur.
« Like a prayer » est l’album par lequel tout a commencé. Ma vie d’adolescent, ma prise de conscience de qui j’étais. Mon éveil à la vie.
C’est émouvant de découvrir à travers son récit que Stéphane n’a pas toujours été le garçon bien dans ses baskets que j’ai connu en 2001, qu’il a traversé des moments difficiles, que nous avons vécu les mêmes frustrations et les mêmes humiliations au collège. Et c’est bon de constater que malgré tout ça, il a su avancer la tête haute et devenir l’homme terriblement séduisant qu’il est aujourd’hui.
Je découvre également que nous partageons une admiration commune vis-à-vis de cette figure emblématique de la pop culture. Notre différence d’âge fait que son histoire de fan a commencé quelques années et quelques albums plus tôt que la mienne. Mais elle est jalonnée des mêmes ressentis, des mêmes frissons, des mêmes prises de conscience.
Jeudi 25 juin 2009.
Ça faisait longtemps qu’on le voyait dépérir dans les médias. Mais, perso, j’ai toujours cru, espéré qu’il rebondirait un jour. L’annonce de ses concerts londoniens semblait avoir relancé la machine après toutes les frasques des dernières années. Le destin et le propofol en ont décidé autrement.
Il est des événements qui nous marquent au fer rouge. Je me souviens parfaitement où j’étais et ce que je faisais lorsque j’ai appris que le 11 septembre était devenu à tout jamais le 11 septembre, ou lorsque le 21 septembre était devenu lui aussi une date marquée d’une pierre blanche pour la ville de Toulouse.
Et je me souviens très bien où j’étais et ce que je faisais lorsque ce jour-là, entre midi et deux, Stéphane m’a annoncé au téléphone que Michael Jackson n’était plus. La plus grande des stars contemporaines, l’un des piliers de la Trilogie Fantastique du cru 1958 avec Prince et Madonna, venait de disparaître.
J’ai toujours aimé sa musique, et ses sorties d’album, notamment celle de l’album « History », ont marqué mon adolescence. Il faisait partie du paysage de mon existence. Ainsi, un monde privé de Michael Jackson me paraît inconcevable.
Je ressors mon CD de « Dangerous », mon album préféré de Mickael, et je l’écoute en boucle.
Eté 2009.
En juillet, je pars deux semaines sur la côte méditerranéenne avec Stéphane. Du Cap d’Agde à Saint Tropez, nous changeons de camping presque chaque jour. Nous sortons dans une boîte gay et je me fais draguer. J’ai une aventure, et ça réveille mon envie d’aventure.
De retour à Toulouse, le vent d’Autan souffle sur les braises de mes envies de baises. Je recommence à chercher des garçons.
Je prends goût aux frissons de la séduction, aux regards d’abord timides et puis téméraires, aux frissons des manœuvres d’approche, à la surprise des premiers mots échangés, à la découverte du son d’une voix, des attitudes de l’autre, à la promesse de nouveaux bonheurs inscrite dans toute rencontre. J’adore cet instant entièrement empli par le désir inspiré par un parfait inconnu, sexy et mystérieux, un être dont on ne connaît pas les fêlures et que l’on peut encore croire différent de tous ceux que nous avons connus, un mystère mâle qui fait tout son attrait.
Ces rencontres m’apportent une certaine satisfaction sur le moment, mais elles me laissent toujours cet arrière-goût amer des baises sans tendresse et sans suite.
Toujours pendant l’été 2009.
C’est en rentrant à Toulouse qu’un immense coup de tonnerre déchire mon horizon. Il s’annonce par le biais du vent d’Autan qui souffle dans les rues de Toulouse.
Toute la presse en parle. Rodney Williams vient d’annoncer son retrait définitif du rugby professionnel à la veille du coup d’envoi de la Currie Cup, le tournoi de rugby d’Afrique du Sud auquel il devait participer au sein des Sharks.
Mais la nouvelle de son retrait soudain et « inexplicable » de la scène rugbystique est totalement éclipsée par une autre info bien plus croustillante pour la presse à scandale. Rodney Williams vient de faire son coming out dans un talk-show sur une grande chaîne de télévision anglaise. Et, de ce fait, devant la Terre entière. 5 commentaires
5 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Jérém&Nico - Saison 1