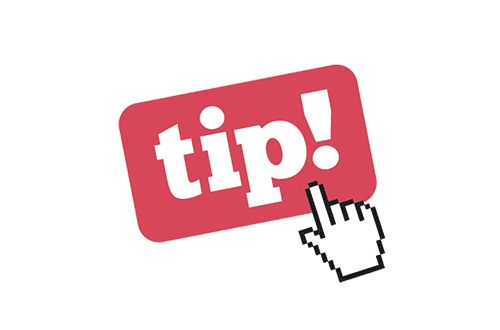-
Aujourd’hui, dans cette petite maison en pierre nichée dans les montagnes, mon Jérém m’a fait l’amour comme jamais, nos plaisirs se sont mélangés, enlacés, et ils ne sont devenus qu’un seul, un but commun que nous poursuivions « main dans la main ». J’ai pris du plaisir à lui faire plaisir, mais lui aussi il a pris du plaisir à me faire plaisir.
Jérém se glisse sous les draps, j’en fais de même ; il approche pour me prendre dans ses bras, je me retourne sur le flanc, de façon à ce que son corps puisse envelopper le mien ; nos corps se calent l’un contre l’autre, à la perfection. Jérém passe ses bras autour de mon torse, il me serre très fort contre lui, il enfonce son visage dans le creux de mon épaule, il pose d’innombrables bisous tout doux et tout fous dans mon cou, dans le bas de ma nuque, sur mes épaules.
Dehors, il fait froid, il pleut toujours, le vent ronfle sur le toit ; mais dans la petite maison en pierre, le feu crépite bruyamment dans la grande cheminée ; et sous ce draps doux qui sentent bon la lessive, son corps irradie une douce chaleur, et il dégage une délicieuse odeur de jeune mâle, un énivrant mélange d’odeur de gel douche, de déo, de sexe, mais pas que : car, ce soir, son corps sent également l’amour.
Son goût persistant dans ma bouche, mon ventre et mon entrejambe retentissant de l’écho des coups de reins puissants de mon mâle, je me sens envahi par une intense sensation de bien-être. Son jus en moi me fait du bien, je suis groggy de sa testostérone, de sa virilité.
Dans ces draps, je ressens un doux apaisement du corps et de l’esprit : c’est un bien-être absolu, fait de chaleur, de douceur, de complicité, de sensation que rien ne peut m’arriver dans les bras musclés du garçon que j’aime.
Oui, la maison est petite, le lit n'est pas grand, mais mon bonheur, notre bonheur, est tellement immense que ça en donne le tournis.
Jérém me serre un peu plus fort contre lui, me fait un dernier bisou dans le cou ; et alors qu’une petite larme de bonheur glisse sur ma joue, je m’assoupis comme un bébé.
Lorsque je rouvre les yeux, Jérém est debout, en train de s’habiller ; en fait, ce sont ses mouvements qui m’ont réveillé ; le contact chaud et rassurant de ses bras est venu à manquer, mon sommeil s’est évaporé. Je le regarde passer son boxer rouge et blanc, moulant ses cuisses, l’élastique tendu entre les plis de l’aine, juste en dessous de ses abdos, la bosse bien saillante, renfermant son bel engin ; magnifique vision, que celle de mon bobrun, torse nu, juste habillé d’un boxer.
Puis, Jérém se penche sur cette boite magique qu’est le grand sac de sport posé à côté du lit qui contient ses fringues ; il en extrait un t-shirt blanc propre, qu’il glisse sur son torse : vision divine, que celle de mon bobrun, boxer moulant et t-shirt tout aussi moulant sur sa plastique de fou.
« Ça va ? » je lui demande.
« J’ai faim… » il lance, en faisant claquer les syllabes, sur un ton qui a quelque chose d’enfantin, un petit regard fripon au fond des yeux.
« Tu veux aller faire des courses ? ».
« Naaan… t’as vu le temps ? Moi je ne sors plus… ».
« On mange quoi, alors ? ».
« Une pizza, ça te va ? ».
« Oui… il faut la commander ? ».
« C’est ça… et comment ils vont nous la livrer ? Par pigeon voyageur ? ».
« Je ne sais pas… ».
« Ce soir tu vas manger une pizza maison… » il me lance, l’air fier de lui, tout en ouvrant une porte du garde-manger et en sortant un plat couvert d’un chiffon ; un chiffon sous lequel se cache un pâton bien gonflé.
« Tu sais faire une pizza ? ».
« Oui, monsieur… je te rappelle que j’ai des origines napolitaines… ».
« C’est vrai… » j’admets. Mais je suis sur le cul quand-même. Décidemment, ce mec ne cessera jamais de m’étonner.
« J’ai fait la pâte tout à l’heure, il ne reste qu’à l’étaler et mettre la garniture… fromage râpé, champignons, jambon, oignons… ok pour toi ? ».
« Oh que oui….
« Alors, c’est parti ! » fait-il, tout guilleret.
Je le regarde jouer les pizzaiolos dans cette tenue sexy à mourir, t-shirt blanc et boxer, je le regarde étaler la pâte avec une bouteille vide en guise de rouleau à pâtisserie, avec des gestes rapides et assurés ; je le regarde monter la garniture, un produit après l’autre, avec des gestes amples, généreux. C’est beau de regarder l’homme qu’on aime en train de cuisiner.
« Je peux t’aider ? ».
« Ça devrait aller… merci… ».
A mon tour, je passe un boxer et un t-shirt ; et je ne peux m’empêcher d’aller le rejoindre, de me coller contre son dos, de l’enlacer, de le serrer très fort contre moi, et plonger mon nez dans ses cheveux bruns enfin sèches. La douceur et l’odeur de propre de son t-shirt me percute, m’étourdit, m’assomme.
Mes lèvres se posent plein de bisous à la lisière de ses beaux cheveux bruns, je passe la main sous son t-shirt blanc et je lui caresse les tétons.
Jérém frissonne, rigole, gigote.
« Je ne vais jamais pouvoir terminer ma pizza si tu me fais ça… » fait-il, sur un ton entré excité et amusé.
« J’ai trop envie de te faire des bisous… depuis que j’ai l’autorisation… ».
« Petit con… ».
« Tu m’excites trop, Jérém… ».
« C’est pas l’heure des galipettes, je fais à manger… quand j’ai faim, j’ai faim ! » fait-il, en se dégageant de mon étreinte, pour revenir claquer un bisou, un seul, rapide et furtif, presque volé, sur mes lèvres.
Le bogoss revient à son ouvrage, il en peaufine les détails en ajoutant un filet d’huile d’olive. Je le regarde travailler, de dos, je regarde la perfection avec laquelle le coton blanc moule ses épaules, ses biceps, les mouvements de ses muscles, je regarde la chaînette qui dépasse de la finition du col autour de son cou puissant : c’est beau à en pleurer.
« T’es tellement sexy en t-shirt blanc ! ».
« Ah oui, tu kiffes ça, je sais… ».
« T’as un corps de dingue, et le blanc, moulant, te va, un truc de fou… ça me rend dingue… quand tu te fous en t-shirt blanc, je me sens comme un taureau devant une muleta… ça me chauffe à bloc, ça me donne trop envie de toi… ».
« T’as tout le temps envie de moi… » il se marre.
« Ça c’est pas faux… mais là, encore plus… ».
« Je mettrai tout le temps un t-shirt blanc, alors… ».
« A ton risque et péril… tu vas devoir assurer, après… ».
« Tu sais bien que j’assure… ».
« C’est clair… t’es un sacré mec… ».
Jérém vient de terminer de garnir la pizza, et je la trouve magnifique. D’autant plus qu’elle est faite avec amour. Le bogoss l’attrape, et la pose sur le prolongement de la plaque en fonte sur laquelle est posé le foyer de la cheminée.
« Et voilà, il n’y a plus qu’à attendre… par contre, il va falloir la surveiller, il n’y a pas d’horloge sur ce genre de four… » il se marre, adorable.
Lorsque je regarde mon Jérém, ce nouveau adorable Jérém, posé dans ce nouveau décor, dans ce nouveau rôle qui va au délà de mes rêves les plus fous ; lorsque j’entends sa voix, ses mots, cette façon de me laisser rentrer dans sa vie, d’installer une complicité aussi soudaine qu’inattendue, j’ai encore du mal à croire que tout ça ce soit réel.
D’ailleurs, je crois que si je racontais tout ça à ma cousine – ou à n’importe qui, pour peu qu’il soit au courant des galères que j’ai traversées avec mon bobrun – pourrait croire qu’il s’agisse d’un rêve ; un rêve où, une fois de plus, je prendrais mes désirs pour des réalités. Pourtant, ce n’est pas le cas. Non, ce n’est pas un rêve, non, non, non, non, ça n’en est pas un !
Oui, j’ai encore du mal à croire que tout cela soit bien réel : et pourtant, il l’est.
« Tu sais que t’es un mec génial ? » je lui lance, touché par ce Jérém adroit et dégourdi qui se dévoile instant après instant devant mes yeux.
« Bah, je sais faire une pizza… il faut pas bac plus 10 pour ça… » il se marre.
« Peut-être… mais je ne sais pas faire moi… ».
« Je t’apprendrai… la seule difficulté, c’est de réussir la pâte… après, c’est un jeu d’enfants… ».
« Vraiment, tu m’impressionnes… ».
« Tu parles… ».
« Je te promets… ».
« Et pourquoi, donc ? ».
« Ici tu es tellement différent qu’à Toulouse… tellement simple, tellement débrouillard, tellement adorable… ».
Jérém sourit, visiblement touché.
« T’aimes le Jurançon ? » il me lance de but en blanc.
« C’est mon vin préféré… ».
« Je m’en doutais… ».
« Et comment tu t’en doutais ? ».
« Je t’ai vu en boire, le soir du repas de classe… ».
« T’as remarqué ça, toi… ».
« Bah oui… » fait-il, le plus naturellement du monde.
« T’es incroyable… » je lâche, alors que je me sens submergé par une émotion immense.
Le bogoss ouvre la porte d’entrée, sort sous le petit appentis et revient avec une bouteille doré. Pendant un instant, le vent et le froid s’insinuent dans la petite pièce, rappelant à quel point un toit et une source de chaleur sont les bases du bonheur.
Jérém ouvre la bouteille à l’aide d’un tirebouchon en T et de la force de ses muscles – son biceps gonfle sous l’effort, et maltraite un peu plus la manchette en coton blanc, vision d’une sensualité renversante : le bouchon finit par sauter, en produisant le claquement typique. Un instant plus tard, il remplit deux verre et m’en tend un ; puis, il approche son verre du mien ; lorsque nous trinquons, nous nous regardons droit dans les yeux, et Jérém en profite pour me lancer un clin d’œil qui me fait fondre.
Le bogoss pose son verre sur les briques de l’âtre, se penche sous le lit et il en extrait une vieille couverture qu’il étale devant la cheminée. Puis, il s’assoit devant le feu, pile face à la pizza en train de cuire. Je le regarde et je me sens amoureux comme jamais.
« Viens… » il me lance tout bas.
Je m’assois à mon tour, mes jambes autour des siennes, mon torse contre son dos, mon visage dans le creux de son épaule.
« Je suis bien là… » je l’entends dire.
« Moi aussi je suis bien… ».
La cheminée réchauffe, la pizza est en train de cuire ; je suis avec le garçon, l’homme que j’aime : notre entente, notre complicité sont à peine croyables, notre amour est si beau ; mon bonheur est parfait.
« Je n’y croyais plus… qu’on se retrouverait un jour, je veux dire… » je lâche, en retenant mes larmes de justesse.
« J’ai fait tellement de conneries… je m’en veux… t’es un gars super, Nico… t’es toujours là, malgré tout ce que je t’ai fait… ».
« Si tu savais à quel point tu comptes pour moi… ».
« Toi aussi tu comptes beaucoup pour moi, Nico… ».
Une fois de plus, je regarde la jolie pizza qui est en train de cuire devant le feu et je me sens aux anges.
Mes lèvres brûlent d’envie de prononcer les trois petits mots magiques, celles qui contiennent « un monde entier », celles que je lui ai dit la dernière fois qu’il est venu chez moi, juste avant qu’il me quitte. Oui, je brûle d’envie de lui dire « je t’aime » ; mais je me retiens, me disant que c’est peut-être trop tôt, que je ne veux pas prendre le moindre risque de « gâcher » cet instant parfait. Plus tard, Nico, plus tard.
« Tu me fais du bien, Nico… » enchaîne Jérém.
« J’ai bien fait de te proposer de réviser… » je le taquine.
« Oh, que oui, Nico… je crois que si tu ne l’avais pas fait, je t’en aurais voulu… ».
« T’aurais pu le faire aussi, tu sais ? ».
« Tu sais bien que j’étais bien trop con pour le faire… alors, merci Nico… ».
J’aime sa façon d’utiliser le prénom, mon prénom, de le placer dans chaque phrase ou presque. C’est important, le prénom, car c’est par lui que s’établit la relation. C'est par le prénom que la personne anonyme devient une connaissance. C’est par le prénom qu’on entre ou pas dans le cercle de quelqu'un. Enoncer le prénom de quelqu’un, c’est aussi le mettre en valeur, lui montrer de la considération. Le prénom rapproche. C’est encore par lui que passent toutes les nuances de la tendresse et de l’amour. Prononcer le prénom de l’autre avec douceur ou sensualité, c’est déjà lui faire un câlin, c’est déjà « embrasser » quelque chose de lui. C’est déjà lui envoyer un baiser.
Sa façon d’utiliser mon prénom, souvent, au détour d'une phrase, fait ressortir toute sa musicalité et sa couleur. When you call my name, is like a little prayer : oui, mon prénom sonne si bien, comme un accord de Chopin, lorsque c’est Jérém qui le prononce ; et d’autant plus de la façon où il le prononce ce nouveau Jérém.
« Toi aussi, tu me fais du bien, Jérém… ».
Une fois de plus, je plonge mon visage dans le creux de son cou et je m’enivre de la douceur, de la chaleur, de l’odeur frais de sa peau. Mais une autre fragrance vient chatouiller mes narines : c’est une odeur de four de boulanger : la cuisson de la pizza avance, et ça commence à sentir sacrement bon.
Jérém se penche sur le « dossier » et s’empresse de m’annoncer :
« La pizza est prête ! ».
Puis, il se lève, il part vers le garde-manger, il revient avec une grande assiette et un couteau ; avec des gestes assurés, il décolle la pizza de la plaque et la fait glisser dans l’assiette qu’il pose sur le rebord en briques de la cheminée. Elle est belle, bien cuite, fumante. Je n’aurais jamais cru que le parfum d’une pizza pouvait me donner envie de pleurer. Le fait est que cette pizza est un peu le symbole de nos retrouvailles, l’image de ce nouveau Jérém qui me fait fondre.
Mon bobrun s’assoit en face de moi et commence à découper le disque multicolore.
Je ne me lasse pas de regarder mon Jérém dans ce nouveau rôle de mec futé qui a l’air de savoir tout faire. Il me fascine, il me rend fou.
« Ah, mince… les assiettes… » je l’entends « pester », tout en rigolant et en se préparant à se lever à nouveau.
« Reste là, y a pas besoin d’assiettes… » je le rassure.
« C’est vrai, on est à la campagne ici… » fait-il, en souriant et en me balançant un nouveau clin d’œil au charme ravageur.
« On est au Paradis… ».
« Je ne sais pas si au Paradis il pleut autant… » il se marre.
« Je ne sais pas non plus… mais je suis sûr qu’au Paradis il doit y avoir une cheminée, une pizza et un gars comme toi… ».
Pour toute réponse, Jérém me tend une part de pizza.
« Attention, c’est chaud… j’espère qu’elle est bonne… ».
« Elle l’est forcément… ».
« Goute d’abord, tu me diras après… ».
La pizza, c’était une idée charmante quand elle n’était encore qu’un pâton ; elle était belle pendant la préparation, elle sentait bon pendant la cuisson ; et elle est délicieuse, vraiment délicieuse, à la dégustation. Elle a aussi le goût des choses faites avec amour. Un grand chef a dit : « le chemin du cœur passe aussi par le ventre ». Et cela est bien vrai.
« Alors ? » fait mon Jérém, tout en mâchant un bout de pizza, l’air impatient de savoir.
« Elle est très bonne ta pizza… ».
« Ah, ça fait plaisir… ».
« C’est la meilleure pizza que je n’ai jamais mangé de ma vie… ».
« T’exagères… ».
« Non, c’est vrai… ».
« C’est vrai qu’en dehors de l’Italie, la seule bonne façon pour manger une bonne pizza, c’est de se la faire… mais je te promets que mon cousin Carmelo à Naples, en fait de bien meilleures que moi… ».
« Elle est délicieuse… » je lui lance, submergé par l’émotion.
Chose qui ne passe pas inaperçue à mon Jérém.
« Ça va, Nico ? ».
« Oui, oui… » je fais, en essuyant mes joues.
« Qu’est-ce qu’il se passe ? ».
« C’est que tout ça c’est tellement beau que je n’arrive pas à y croire, c’est trop, ça me donne presque le tournis… ».
Jérém se déplace à côté de moi, il glisse son bras autour de mon cou et me fait un bisou dans le cou.
« Je suis tellement content que tu sois là… » il chuchote, tout en se serrant contre moi, et en passant sa main chaude derrière ma nuque.
Le bogoss me ressert du Jurançon et me passe une autre part de pizza. Nous mangeons en silence ; en fait, nous n’avons pas besoin des mots ; nous nous sommes tout dit, et ce que nous nous ne sommes pas dit, nous le savons quand même : car nos émotions sont là, elles flottent autour de nous, intenses, vibrantes, palpables.
Dans la petite maison, il n’y a pas de télé, pas de radio, pas de téléphone, même pas d’électricité. Est-ce que nous en avons besoin ? Je ne crois pas.
Le crépitement du feu dans la cheminée, le bruit de la pluie sur les ardoises, nos regards qui se cherchent, se caressent, nos sourires qui font tant de bien, les bruits légers d’un repas simple mais délicieux : voilà, dans la pénombre mouvante au gré des mouvements de la flamme, la douce musique de notre amour, de notre bonheur. Le seul fond sonore dont nous avons besoin. Quand l’amour est là, il se suffit à lui-même.
Jérém vient de terminer sa part et se relève pour aller chercher quelque chose dans le garde-manger. Il en revient avec un gros morceau de fromage et un pain massif.
« Tu vas goûter ce fromage et tu m’en diras des nouvelles… » il me lance, tout en me tendant un morceau généreux.
Dès la première mise en bouche, je découvre une saveur délicieuse.
« Mais il est super bon ! ».
« C’est du vache-brebis, il est un peu affiné » il m’explique, tout en découpant le pain avec un gros couteau « c’est un pote d’ici qui le fabrique… c’est le meilleur fromage du monde ! ».
Le pain aussi a une saveur délicieuse : sa croute croustille, sa mie est dense, c’est du vrai pain de campagne. Et de montagne.
Du fromage vache-brebis, avec ce vrai pain consistant et une gorgée de Jurançon, le tout dégusté en compagnie du gars que j’aime, il y a de quoi se damner !
Le bogoss s’allume une cigarette et la fume devant le feu.
« Pas d’électricité, pas de télé… » fait le bogoss, le regard fixe vers le feu « pas de voisins, pas de bruit… pas de réseau, pas de téléphone… il n’y a pas beaucoup de confort ici, mais je me sens bien comme nulle part ailleurs au monde… ».
Je comprends parfaitement ses mots : c’est vrai qu’on se sent bien dans cette petite maison, dans ce refuge spartiate mais douillet. Pourtant, je me dis que la contrepartie à la tranquillité, ça doit être la solitude.
« Mais depuis que tu es là, tu ne t’es pas senti seul ? ».
« Seul ? Non… enfin… si tu veux… de toute façon, j’avais besoin d’être seul… j’avais besoin de faire le point… et puis, j’ai quelques potes ici… depuis que je suis là, j’ai souvent été invité manger… ».
« Alors, ici c’est la maison de tes grands-parents ? ».
« Oui, du côté de ma mère… ils habitent Tarbes mais ils viennent ici l’été… du coup, jusqu’à mes quinze ans, je suis venu ici tous les étés… j’étais tellement bien ici, avec papi et mamie, tellement mieux qu’à Toulouse, chez mon père… mes grands-parents ont été très importants pour moi, surtout après le divorce de mes parents… ici, chez eux, c’était mon refuge… le cheval c’était mon refuge… je venais aussi pendant les vacances scolaires, mais comme mes grands-parents étaient à Tarbes, je créchais chez Charlène, une amie à eux qui tient un centre équestre pas loin d’ici… Charlène est comme une tante très rigolote… en fait, c’est presque une mère pour moi… dès que je pouvais, je venais ici, je faisais du cheval, je respirais… j’avais presque oublié à quel point c’est bon… ».
« Tu fais du cheval ? » je fais, surpris.
« Je t’ai pas dit ? ».
« Non, je ne sais rien de toi, Jérém… ».
« J’en fais depuis tout jeune… c’est mon grand père qui m’a mis sur un shetland quand j’avais 5 ans, et j’ai kiffé ; quand j’ai commencé à toucher des pieds par terre sur mon shetland, il m’a acheté une jument, Tequila, qu’on a fait pouliner… maintenant, je monte le fils de Tequila, Unico, un mâle entier… ».
« Mais ils sont où tous ces chevaux ? ».
« Il sont en demi-pension chez Charlène… ».
« C’est quoi un cheval en demi-pension ? » je me marre « est-ce que c’est un cheval qui ne broute qu’au petit dej et au diner et qui va bouffer chez le voisin à midi ? ».
« T’es con… » fait Jérém, mort de rire.
« Mais j’y connais rien, moi… ».
« Ah, oui, c’est vrai… en fait, les chevaux sont chez elle toute l’année, elle s’en occupe comme si c’était les siens… en contrepartie, elle peut s’en servir au besoin, les monter elle-même ou les faire monter par ses clients… elle fait pas mal de balades l’été, alors elle a besoin de chevaux… du coup, elle entretient mes chouchous sans me faire payer la pension… mais quand je suis là, je peux monter mon Unico quand je veux… ces derniers jours, j’ai bien profité de mon loulou… ».
Alors, ça… si je m’y étais attendu ! Jérém qui fait de l’équitation : c’est tellement inattendu, tellement original, exotique ; imaginer Jérém à cheval, sans même l’avoir vu, ça sonne déjà méga sexy. Cavalier, c’est un nouveau monde de Jérém qui s’ouvre à moi : et cela m’émeut déjà.
Question : pourquoi faut-il que les bogoss, en plus d’être beaux et sexy, aient aussi tout le temps un talent pour un ou plusieurs sport ? Rugbyman, footballeur, nageur, ou alors ils fréquentent les salles de sport, y’a toujours un truc qui les rend « spéciaux », « intéressants », qui rajoute du craquant au sexy, si ce n’est pas plusieurs trucs à la fois. Ce qui m’amène à la question existentielle suivante : est-ce que la bogossitude précède le talent, ou bien c’est le talent qui façonne petit à petit leur bogossitude ? Ça devrait être un sujet de dissertation philosophique. Un sujet pour le bac. Vous avez quatre heures…
« Tu fais quoi à cheval ? Des courses ? Des obstacles ? Du dressage ? » je lui demande, laissant parler mon ignorance, tout en reprenant à mon compte le fameux précepte : « Toujours faire parler un bogoss de ce qu’il fait, et surtout de ce qui le rend fier et heureux ».
« Naaaan… rien de tout ça… de la balade, juste de la balade de quelques heures… au plus de la rando de quelques jours… le cheval c’est une façon de me retrouver au calme, de me remettre les idées en place au milieu de la nature et de mes potes… ».
« Ton Unico, ça fait longtemps que tu le montes ? ».
« Je l’ai débourré il y a deux ans… ».
« Tu l’as quoi ? ».
« Débourré… c’est quand on apprend au cheval à être en contact avec l’homme… on lui apprend les trois allures, à réagir à la voix, à accepter la selle, le filet, un cavalier… ».
« Tu sais faire ça ? ».
« Oui, c’est papi qui m’a appris… il a toujours eu des chevaux, et je l’ai regardé faire… ».
Qu’est-ce qu’il est touchant mon Jérém quand il parle de son papi : il y a dans son regard une expression à la fois d’admiration, d’affection, de douceur, comme celle d’un gosse impressionné par un adulte particulièrement cher. Et ce regard, me fait fondre. Je ne peux résister à la tentation de le serrer contre moi, et de lui faire des bisous.
« Je n’aurai jamais imaginé que tu faisais du cheval… ».
« Ben, oui… et j’adore ça… d’ailleurs, ce dimanche, j’aimerais bien en faire… ».
« Ah bon ? Et moi je vais faire quoi pendant ce temps ? » je rigole.
« Tu vas venir faire du cheval avec moi ! » fait-il, comme une évidence.
« Mais je n’ai jamais fait du cheval, moi… ».
« Je vais t’apprendre ! ».
« Mais je n’ai pas de cheval… ».
« Je vais t’en prêter un… ».
« Mais je ne vais jamais tenir dessus ! Je vais tomber au premier virage ! » je me marre, tout en trouvant excessivement touchante sa proposition.
« Mais non, mais non… tu vas monter Tequila, la mère de mon entier… elle est calme, posée, elle est parfaite pour un débutant… avec elle, tu ne risques rien… ».
« T’es sûr ? ».
« Certain… ».
« J’adore l’idée de faire du cheval avec toi… ».
« Moi pareil… il faut juste qu’il arrête de pleuvoir… il faudrait juste que demain il fasse beau, pour que ça sèche un peu… ».
« Toi et moi à cheval… » je considère, tout guilleret.
« Ah, mais nous ne serons pas que tous les deux… ».
« Ah bon ? »
« Il y aura Charlène, car c’est elle qui organise, la balade démarre de son centre équestre… et il y aura aussi quelques autres cavaliers de l’asso… ».
« Quelle asso ? ».
« L’ABCR… »
« C’est quoi ça ? ».
« L’association Bigourdane Cavaliers Randonneurs… ».
« Ah… » je fais, surpris.
« Tu verras, ce sont des gens super sympa… et très patients avec les débutants… ».
Ce disant, Jérém se lève, remet une bûche dans le feu, et me tend la main ; je la saisis, il m’aide à me relever, en m’entraîne vers le lit.
« On sera mieux allongés… » il me lance, une petite étincelle coquine au fond de son regard brun.
Sur le lit, nos corps s’attirent l’un l’autre comme des aimants, nos mains et nos lèvres son insatiables de câlins. Une fois de plus, l’odeur de propre de son t-shirt blanc, mélangé à celui de sa peau me percute, m’étourdit, m’assomme, me rend ivre.
Je me retrouve allongé sur lui, nos bassins se pressent l’un contre l’autre, je sens son érection monter au travers le coton fin de son boxer. Je remonte son t-shirt blanc, j’agace ses tétons avec ma langue et le bout de mes doigts.
« Tu vas encore faire monter la bête… » il se marre, coquin et charmeur.
« La bête… » je me marre, en trouvant ce petit surnom bien rigolo.
« Ouaisss… la bête… ».
« Laisse-la monter… ».
« Tu vas devoir assurer, après… » il me taquine.
« Tu sais bien que j’assure… ».
« Suce… » il me lance, sur un ton de parfait petit con.
« Avec plaisir… ».
Non, ce n’est pas grave qu’il n’y ait pas d’électricité, ni de télé ; je dirais même que c’est un luxe : quand la télé est absente, c’est l’amour et la sensualité qui prennent la place. Toute la place.
Un instant plus tard, je suis penché sur le bassin de mon beau mâle brun ; après plusieurs jouissances, une odeur un peu forte mais délicieuse, s’échappe du coton fin et me rend fou. Je glisse mes doigts dans le boxer et j’en extrais sa queue à nouveau raide, magnifique, conquérante.
Un instant plus tard, le boxer a volé, mais le t-shirt n’a pas quitté son torse de malade ; j’ai tellement envie de le pomper jusqu’à le faire jouir !
La cheminée flambe et chauffe, et je suis en train de sucer le garçon, l’homme que j’aime, dans cette tenue sexy à mort, ce t-shirt blanc qui est comme une deuxième peau, avec une manchette qui tombe pile au-dessus de son brassard tatoué, alors que l’autre s’amuse à jouer à cache-cache avec son nouveau tatouage, avec cette chaînette de jeune mâle posée sur le coton ; et moi, je ne cesse de me répéter que c’est pas possible d’être sexy à ce point ; et aussi que j’en ai de la chance, putain, de pouvoir connaître l’amour et le plaisir avec cette bombasse de mâle !
Pendant que je m’emploie à lui procurer un maximum de plaisir, ses mains caressent mes épaules, mon cou, le bas de la nuque, ses doigts d’évertuent à agacer mes tétons, me poussant violemment vers le précipice de la folie.
Mon Jérém frissonne, souffle très fort, fou de plaisir ; sa queue bien raide me remplit la bouche et me remplit de bonheur ; je sens que je ne vais pas tarder à lui offrir un nouvel orgasme ; je devine que, dans pas longtemps, son jus de mâle va tapisser mon palais de ce goût enivrant qui me rend dingue.
Je ne me trompe pas.
« Je viens… » je l’entends lâcher, comme à bout de souffle.
Je kiffe à mort l’entendre m’annoncer l’arrivée de son plaisir ultime, j’adore l’entendre me l’annoncer sur ce ton, la voix cassée, débordée par le plaisir.
Les giclées qui percutent mon palais sont nombreuses, puissantes : et qu’est-ce qu’elle est bonne sa semence de jeune mâle !
« Tu veux ma peau… » fait-il, essoufflé.
« Non, juste te faire plaisir… ».
Je lui fais des bisous. Sa respiration est toujours très profonde, très rapide, elle ne semble pas vouloir se calmer. Le bogoss est en nage, il se débarrasse de son t-shirt blanc.
« Ça va ? » je lui demande.
« Oh, oui… c’est juste que quand j’enchaîne comme ça, à chaque fois c’est plus violent… ».
« Je veux te rendre fou de plaisir… ».
« T’as envie de jouir, toi ? » il me demande, le regard rivé sur mon boxer déformé par l’érection.
« Plus tard, Jérém, y a le temps… ».
Si tu savais, mon Jérém, à quel point je suis bien là ; j’ai adoré te sucer, sentir que tu prends ton pied, te faire jouir, recevoir tes giclées, les avaler : tu n’imagines même pas à quel point mon bonheur suprême réside dans le fait de te faire jouir, toi, à quel point ta jouissance est ma jouissance. T’as joui, ça me suffit, je n’ai besoin de rien de plus. Mon plaisir à moi commence et s’arrête avec celui de mon bomâle.
« T’es tellement sexy… alors, tu vas devoir assurer… ».
« Tu vois bien que j’assure… » il se marre, le coquin.
Puis, il se lève, s’approche de la cheminée, il s’assoit sur la vieille couette en position de trois quarts par rapport à moi, et s’allume une cigarette.
« Je croyais que tu voulais arrêter… » je le taquine.
« Je ralentis… mais il y a des cigarettes qui restent… obligées… après le café, après les repas, après le sexe… ».
« Dans ce cas, tu risques de fumer beaucoup ce week-end… ».
« J’ai été chercher une cartouche en Espagne, ça devrait aller… » il se marre.
Je le regarde en train de fumer en silence, assis devant la cheminée, les genoux repliés, le dos légèrement arrondi, ses pecs rebondis, son nouveau tatouage, courant depuis son biceps, glissant sur son épaule, remontant jusqu’à son cou, bien en vue ; et je regarde, à la fois fasciné, subjugué et ravagé de désir, ses abdos qui restent saillants malgré la position vraiment pas apte à les mettre en valeur : et là, il ne me reste qu’à constater, une fois de plus, à quel point la perfection de sa plastique est éblouissante.
Sur son visage, cet air un peu sonné, un air de mâle repu après l’amour, qui me rend fou. Le bogoss capte mon regard insistant et me sourit.
« Qu’est-ce qu’il y a ? » fait-il, adorable.
« Qu’est-ce que t’es beau… » je lâche, comme une nécessité, une évidence « parfois je n’arrive pas à croire qu’un mec comme toi ait envie de moi… ».
« Mais tu rigoles ? Toi aussi t’es beau ! ».
« Tu m’a jamais dit ça… ».
« Si je te l’ai dit… ».
« Non, jamais… ».
Le bogoss continue à fumer en silence.
« Depuis quand ? » je reviens à la charge.
« Depuis quand, quoi ? ».
« Depuis quand tu me trouves beau ? ».
« Je ne sais pas… » il balance, comme agacé.
« Allez, dis-moi… je vais pas le répéter… » je tente de l’amadouer.
« Tu me pompes l’air… » fait-il, tout autant amusé qu’agacé.
« Je préfère te pomper tout court… »
« Ah, ça je sais… » fait-il, avec un petit sourire coquin en pièce jointe, en expirant la dernière bouffée de fumée et en jetant son mégot dans le feu.
Puis, il revient au lit ; sa respiration s’est calmée, il repasse son t-shirt blanc, il s’allonge sur le dos, les coudes pliés, les mains croisées entre la nuque et l’oreiller, l’air songeur. Il est beau comme un Dieu.
Je me glisse sur lui, je le serre fort contre moi, je lui fais plein de bisous dans le creux du cou ; ses bras se déplient, m’enlacent, sa bouche cherche la mienne.
Je relève la tête, je le regarde droit dans les yeux : nos visages sont à vingt centimètres l’un de l’autre.
« Tu vas pas m’avoir comme ça… je veux savoir depuis quand tu me trouves beau… ».
« T’es rélou… » il rigole.
« Et toi, depuis quand tu savais que je te kiffais ? » je tente une autre approche.
« Depuis le premier jour du lycée, je dirais… » il me balance du tac-au-tac.
Oui, quand la télé est absente, c’est l’amour qui prend la place ; et quand l’amour est là, souvent après l’amour physique, sur l’oreiller, la conversation vient toute seule, inspirée par l’envie et le plaisir de découvrir l’autre. Ou de se laisser découvrir par l’autre.
« Ah bon… je me suis fait gauler si vite ? ».
Pour toute réponse, le bogoss m’assène un petit sourire malicieux, sexy à mourir. Avant d’enchaîner :
« Je me souviens de quand tu t’es pointé au lycée avec ton t-shirt jaune fluo… ».
« Tu te souviens de mon t-shirt jaune ? ».
« Oui, il était ridicule… ».
« C’est clair qu’il était ridicule… c’est la faute de ma mère… moi je ne voulais pas d’un truc pareil pour mon premier jour de lycée, mais elle m’a obligé à le porter… ».
« C'est de ton regard que je me souviens surtout… ».
« Mon regard ? ».
« Tu me matais grave… ».
« Quand je t’ai vu dans la cour du lycée avec tes potes, j’ai cru que j’allais me liquéfier sur place… je n’avais jamais vu un mec aussi beau de ma vie… ».
« Là, j’ai su que tu me kiffais grave… ».
« Et ça t’a fait quoi ? ».
« Sur le coup, ça m’a un peu énervé… mais ça m’a aussi flatté… c’était bizarre… ».
« Oui, je devais avoir l’air très con… ».
« Non…pas du tout… t’avais l’air tout timide, t’avais peur de te faire gauler… ».
« Dès l’instant où je t’ai vu, j’ai eu envie de tout savoir de toi, de te connaître, d’être avec toi, de te serrer dans mes bras… ».
« T’avais déjà envie de coucher avec moi ? ».
« Je ne sais pas… je crois que ce jour-là, j’étais tellement sous le choc que je ne savais même pas ce qu’il m’arrivait… quand je t’ai vu, j’ai ressenti comme une décharge électrique, un truc que je n’avais jamais ressenti avant… j’étais tout sens dessus dessous, et, franchement, je crois qu’à cet instant précis, il n’y avait encore rien de sexuel dans mes envies… je crois que j’étais amoureux ».
« Pourtant, tu t’es pas privé de me mater… ».
« C’est pendant les premier jours de lycée que j’ai commencé à réaliser que j’avais vraiment envie de toi… avant de te rencontrer, je me rendais déjà compte que je regardais les mecs et pas les nanas, mais ça restait vague, je n’arrivais pas encore à réaliser, à comprendre, à mettre des mots sur ce que je ressentais… mais quand je t’ai vu, ça été une évidence, une révélation… quand je t’ai vu, j’ai compris que je n’aimerai jamais les nanas, car il n’y avait que les mecs qui me touchaient… et toi, par-dessus tous… j’étais heureux de découvrir qui j’étais, mais ça me faisait peur aussi… mais c’était plus fort que moi, et te regarder me faisait du bien… je me disais que si je ressentais tellement de bonheur à regarder un mec comme toi, être gay ça ne pouvait pas être mal… ».
« Je me souviens de comment tu me matais au premier cours de sport, pendant que je me changeais dans les vestiaires… ».
« T’avais remarqué ça ? ».
« Bien sûr que j’avais remarqué… tu me matais de ouf… je t’ai gaulé, et tu étais si gêné… t’as vite baissé le regard… c’était mignon… ».
« J’avais tellement peur que tu te mettes en pétard… et encore plus que tu me traites de pd devant tout le monde… ».
« Je ne l’ai jamais fait… ».
« C’est vrai, mais les autres oui… ».
« Tu sais, il m’est arrivé de demander à certains potes d’arrêter de te faire chier… ».
« C’est vrai ? ».
« Oui, ça me mettait en rogne de voir des crétins s’acharner sur toi… ».
« C’est gentil ça… mais je ne m’en suis jamais rendu compte… ».
« Je le faisais discrètement… et à un moment j’ai même dû arrêter… je commençais à entendre des camarades dire que je prenais ton parti, ils commençaient à se moquer de moi aussi… je regrette de ne pas avoir su leur tenir davantage tête… ».
« Je me souviens d’une fois où tu m’avais sorti d’une rogne avec un con qui me taxait des cigarettes… ».
« Le voyage en Espagne… ».
« Tu t’en souviens aussi ? ».
« Bien sûr… ».
« T’as été super… ».
« Je ne supportais pas ce connard… il était trop rélou avec toi… ».
« C’est clair… »
« Mais rien ne t’obligeait à venir m’aider… ».
« J’avais envie de le faire, et j’avais aussi envie de t’impressionner au passage… ».
« C’était réussi… quand t’es réparti dans le couloir, j’avais tellement envie de toi… ».
Il me sourit, je lui fais des bisous.
« J’ai un autre très bon souvenir de ce voyage… » je relance, friand de cette « découverte de l’envers du décor » à laquelle j’ai enfin accès. Tant de questions se bousculent dans ma tête. Le train de souvenirs est lancé, ce serait dommage de ne pas profiter du voyage.
« Je parie que je sais duquel il s’agit… ».
« Vas-y, raconte… » je le mets au défi.
« Le soir du retour… ».
« Bingo… alors, dis-moi… pourquoi t’es venu t’installer à côté de moi, alors que tu m’as ignoré pendant tout le voyage ? ».
« Je ne sais pas, j’en avais envie… pendant tout le voyage, j’ai eu l’impression que tu m’évitais… alors, j’ai voulu savoir si tu étais vraiment fâché… alors, t’étais fâché ? ».
« Non… enfin… si, quand-même un peu… ».
« Et pourquoi ? ».
« Je t’en voulais d’avoir roulé des pelles à ma meilleure copine pendant tout le séjour… ».
« Ah, c’était ça… ».
« Oui, c’était ça… parce que je voulais être à sa place… je lui en voulais à elle aussi… c’est con, parce qu’elle ne pouvait pas savoir que j’étais fou de toi… mais pendant le voyage de retour, je t’avais déjà pardonné… e, fait, je t’avais pardonné à l’instant même où tu m’avais sauvé la mise avec l’autre connard… et surtout quand j’avais vu que t’avais arrêté de la peloter… ».
Il sourit, coquin.
« J’ai adoré me réveiller et te retrouver allongé sur mes genoux… mais j’avais tellement peur que tu te réveilles et que tu te mettes en rogne… » je continue.
« J’étais bien sur tes genoux… en plus, t’avais posé ta main sur mon torse… tu ne t’en es peut-être pas rendu compte, mais je bandais… ».
« J’étais tellement gêné… ».
« J’ai vu… »
« Quand j’ai croisé ton regard, j’ai eu la trouille… mais t’as refermé les yeux… ».
« J’avais envie de te balancer un sourire pour te montrer que je kiffais, mais je n’ai pas osé, j’ai préféré faire comme si j’étais à moitié endormi… ».
« Moi je me suis branlé en rentrant à la maison… ».
« Moi aussi… ».
« Quel dommage ! » je m’insurge.
« Pourquoi t’as été si froid en cours avec moi, après cette nuit ? ».
« Parce que je n’assumais pas ce qui c’était passé… »
« Il ne s’était rien passé… ».
« Je sais, mais même ce « rien », c’était trop pour moi, après coup… je savais désormais à quel point tu me kiffais… et je savais aussi que j’avais kiffé ce « petit rien »… j’avais bandé parce qu’un gars m’avait touché… j’avais honte, j’étais en colère contre moi… alors, je passais mes nerfs sur toi… je m’en voulais, et c’était plus simple de t’en vouloir à toi… alors, je jouais au con pour te tenir à distance… je voulais oublier ce que j’avais ressenti, et je ne voulais plus que ça arrive… quel con j’ai été… ».
« J’avais tellement envie de toi après ce moment… et ça a été la douche froide, après, en cours… ».
Son regard désolé est adorable et touchant, nous nous échangeons des bisous.
« Une autre fois où j’ai failli te sauter dessus, c’est lors du voyage en Italie… le jour du retour, quand on s’est arrêté déjeuner dans le Vaucluse… ».
« Il faisait une chaleur ce jour-là… ».
« Je me souviens de cette balade dans les vignes avec Nadia et Malik… je me souviens surtout quand ils sont partis se peloter et que je suis resté seul avec toi… je me souviens de toi, en train de fumer, appuyé à cet arbre, torse nu… et je me souviens de quand t’as ouvert les premiers boutons de ton jeans… je me souviens de l’élastique du boxer bien en vue, des poils en dessous de ton nombril humides de transpiration… je n’aime pas vraiment la chaleur, mais putain ! qu’est-ce que j’étais heureux qu’il fasse si chaud ce jour-là ! ».
« Oui, il faisait chaud… mais le coup d’ouvrir le jeans, c’était surtout pour te tester, pour voir à quel point tu me kiffais… et je n’ai pas été déçu… pendant un moment, j’ai cru que t’allais vraiment te jeter sur ma braguette… » fait-il souriant et coquin.
« Et tu m’aurais laissé faire ? ».
« Si on avait été que tous les deux, peut-être bien que oui… ».
« T’avais envie aussi, alors… ».
« C’est ton regard qui m’a donné envie… d’ailleurs, j’ai commencé à bander… c’est pour ça que j’avais voulu qu’on revienne vite au bus… ».
Nos souvenirs flottent sur quelques instants de silence, nous échangeons de nouveaux câlins.
« Je me souviens d’une autre fois où ton simple regard a failli me faire bander… » il relance. Ah, putain, qu’est-ce que j’aime cette conversation !
« Quand, ça ? ».
« Une fois, après le cours de sport… je t’ai gaulé pendant que tu me matais sous la douche… ».
« Ah putain… si je me souviens de ce jour-là… c’était la première fois que je te voyais à poil… j’étais trop gêné, j’avais toujours évité de prendre la douche en même temps que toi… et tu étais tellement beau, encore plus beau que ce que j’avais pu imaginer… je découvrais tes fesses d’enfer… j’avais tellement envie de voir comment tu étais monté… ».
« Tu voulais savoir si j’étais bien monté ? ».
« Je voulais juste savoir à quoi elle ressemblait… je voulais juste voir comment t’étais foutu… ».
« J’ai kiffé de te montrer ma queue… et de voir à quel point t’en avais envie… je savais que les nanas aimaient ma queue… mais toi… toi tu me regardais comme si j’étais un Dieu… ».
« J’ai cru que t’allais me taper sur la gueule, ou que t’allais te moquer de moi, pauvre pd qui n’avait aucune chance de coucher avec toi… ».
« En fait, je voulais juste t’allumer… mais t’as détalé comme un lapin… ».
« J’avais honte… je suis parti me changer, je voulais être parti avant que tu reviennes des douches… mais je n’ai pas été assez rapide… et quand t’es revenu, tu m’as balancé un regard de tueur… un regard, style… je sais que tu me kiffes, mais tu ne m’auras jamais… ».
« Je voulais juste t’allumer… ».
« T’avais vraiment envie ? ».
« Je crois bien, oui… ».
Un nouveau silence s’installe, pendant lequel je ne me lasse pas de caresser son torse musclé, avec cette douce, virile pilosité naturelle.
« Tu laisses pousser maintenant ? ».
« Tu aimes ? ».
« J’adore… ça me rend fou ! ».
« J’en avais marre de raser… ».
« Ne coupe plus jamais, t’es si beau comme ça… ».
Je plonge mon nez dans ses poils et je couvre son torse de bisous.
« J’ai aussi arrêté de couper parce que tu m’avais dit que tu kiffais… ».
« Je t’adore, Jérém… ».
« Tu te souviens de la soirée d’anniversaire chez Thomas ? » il me lance, de but en blanc.
« Oh, que oui… pourquoi ? ».
« Non, pour rien… laisse tomber… ».
« Allez, dis-moi… ».
« Laisse tomber, je te dis… ».
« T’étais vraiment jaloux que je matte Thomas ? ».
« Non… » fait-il, en rigolant sous la moustache.
« Menteur… ».
« Peut-être… ».
« Pourquoi tu me parles de cette soirée ? ».
« Parce que… parce queeee… parce que je crois… je crois que ce soir-là j’avais vraiment envie de coucher avec toi… ».
« Et pourquoi tu ne me l’as pas dit ? ».
« J’ai essayé… ».
« Ah bon ? ».
« Je t’ai posé une question ce soir-là, tu te souviens ? ».
« Si j’avais été une nana, si j’aurais préféré sucer Thomas ou toi… ».
« Exactement… ».
« J’ai cru que tu voulais te payer ma tête… »
« Non, je voulais vraiment savoir… ».
« Et moi je croyais que tu voulais te moquer de moi, me faire marcher… ».
« Pas du tout… si t’avais répondu à la question… ».
Puis, il marque une pause, comme s’il n’osait pas arriver au bout de son propos.
« Dis-moi… » je le presse.
« Si t’avais dit que tu préférais me sucer… j’allais te proposer de nous retrouver chez moi… ».
« T’avais bu… ».
« J’avais bu assez pour ne pas trop réfléchir mais je savais très bien ce que je faisais… ».
« Et on aurait commencé les révisions des mois plus tôt… » je raisonne à haute voix, tout en réalisant le nombre d’occasions manquées de nous retrouver, tout le temps que nous avons perdu.
« Oui, je crois… ».
« Quel gâchis… quand je pense que c’est exactement le fantasme que je me suis payé en rentrant, lorsque je me suis branlé dans mon lit… ».
« Quel fantasme ? ».
« Pendant que je me branlais, je me suis imaginé te dire que je voulais te sucer toi, et que tu m’aurais proposé de te suivre chez toi… ».
Il sourit.
« C’est dommage quand-même… » je considère.
« On s’est bien rattrapés depuis… ».
« C’est clair… ».
« Heureusement que t’as fait le premier pas, sinon on en serait encore à nous tourner autour… » il me lance.
« On se serait même perdus de vue déjà, après le bac… »
« C’es bien possible… »
« C’est l’approche du bac qui m’a poussé à faire ce premier pas… je trouvais horrible l’idée que la fin du lycée arrive, et qu’on parte chacun de notre côté, sans avoir tenté de t’approcher… après t’avoir kiffé comme un malade pendant trois ans… ».
« Moi aussi je trouvais ça dommage… mais je n’aurais pas eu le cran de te proposer de venir chez moi, comme ça, à jeun, même pour réviser les maths… et Dieu sait que j’en avais besoin… ».
« Si tu savais le nombre de branlettes que je me suis tapé en pensant à toi… ».
« Moi aussi je me suis branlé en pensant à toi… ».
« C’est vrai ? T’en avais pas assez de toutes les meufs que tu te tapais ? ».
« Non… » il fait, sur un ton sans ambiguïté ; puis, après une petite pause, il continue : « tu sais, ton petit cul je l’ai maté souvent, bien plus souvent que tu ne l’imagines… ».
Ses mots m’excitent. Je bande. Je sens que lui aussi il bande, je sens la « bête » se raidir le temps d’un éclair.
« Et tu lui ferais quoi, à mon petit cul, si tu l’avais là, à disposition, tout de suite ? ».
« Pourquoi, il est à ma disposition, là, tout de suite ? » il me cherche, l’air fripon.
« Il se pourrait bien… ».
« Tu veux vraiment savoir ? » fait-il, une étincelle très coquine dans le regard.
« Je crois bien, oui… ».
« Alors tu vas savoir… ».
Et ce disant, le bogoss me fait basculer ; je me retrouve allongé sur le ventre, son corps allongé sur le mien, son manche raide calé entre mes fesses.
« Tu la veux, hein ? ».
« Oh, que oui, je la veux… je te veux… ».
Ses mains empoignent mes fesses, les écartent, mettent mon petit trou en tension, le préparent à se faire envahir ; je sens tout le poids et la chaleur de son corps sur mes jambes, mes cuisses, mes fesses, mon dos ; son gland met mon trou en joue, sa queue glisse en moi, lentement ; le mouvement est précis, nos corps s’emboîtent comme deux pièces de puzzle contiguës, comme s’ils avaient été conçus exprès l’un pour l’autre.
Jérém me pilonne doucement, tout en caressant mon cou avec ses lèvres, tout en glissant ses mains entre le matelas et mon torse pour aller chatouiller mes tétons ; je prends appui sur mes coudes, je relève le haut de mon torse pour lui faciliter la tâche.
Mais déjà le bogoss pose ses mains à plat sur le matelas de part et d’autre de mes épaules, ses pieds crochètent mes chevilles ; son corps est en suspension au-dessus du mien, ses coups de reins se font de plus en plus puissants et rapides ; j’adore le sentir prendre son pied en moi, j’adore me sentir à lui.
« Ah, putain, qu’est-ce que c’est bon… » je l’entends chuchoter, la voix étouffée par l’excitation.
« Tu fais ça comme un Dieu… ».
Ses coups de reins ralentissent, il se déboîte de moi ; le petit con s’amuse à agacer mon trou avec son gland, il me fait languir : c’est à la fois un délice et une torture insupportable. Je frémis, je tremble d’excitation. Une excitation qui grimpe encore d’un cran lorsque je sens ses lèvres effleurer mon oreille, son souffle chaud chatouiller ma nuque, et sa voix excité me chuchoter :
« Qu’est-ce qu’il y a, elle te manque déjà ? ».
« Oh, putain, oui… ».
« Elle est bonne ma queue ? ».
« Elle est plus que bonne, elle me fait tellement de bien… ».
« Elle te fait bien jouir, hein ? ».
« C’est juste un truc de fou… ».
« T’as envie que je te défonce, hein ? ».
J’adore quand mon Jérém me fait l’amour, quand il est tout doux ; mais je kiffe tout autant quand son côté mâle dominant refait surface.
« J’ai envie que tu me secoues comme tu sais si bien le faire… ».
« Je vais te le secouer, t’inquiètes… ».
Et, ce disant, il s’enfonce bien profondément en moi, d’une seule traite. Ce qui me fait sursauter et gémir de bonheur.
« Qu’est-ce qu’il et bon ton cul… ».
« Tu l’aimes mon cul, hein ? » je le cherche à mon tour.
« Quand je le regarde, j’ai qu’une envie… ».
« Quelle envie ? ».
« De lui jouir dedans… ».
« Alors prends-le et remplis-le… ».
Et là, alors que je m’attends à que mon Jérém recommence à me pilonner direct avec un bouquet final de bons coups de reins, avant de me remplir de son jus brûlant, je sens sa queue me délaisser à nouveau, s’extirper de moi d’un geste rapide ; je sens son corps se dérober.
Instinctivement, je me retourne : qu’est-ce qu’il est sexy dans son t-shirt blanc, il me rend dingue !
Je croise son regard, je comprends son envie ; j’écarte mes jambes, il se glisse entre ; ses mains saisissent un oreiller, je soulève mon bassin ; il saisit mes fesses, j’ouvre un peu plus mes cuisses ; son gland vise juste, mon trou s’ouvre à lui, sans opposer la moindre résistance.
Oui, quand l’amour est là, les intentions des corps se comprennent sans mots, les gestes s’enchaînent avec une coordination parfaite, comme une chorégraphie millimétrée ; dans le sexe et la tendresse, c'est le désir (et l’amour) qui fait l'adresse.
Le feu crépite dans la cheminée et le bogoss revient en moi ; il recommence à me faire l’amour, toujours habillé de son t-shirt blanc ; j’allonge les bras pour aller agacer ses tétons par-dessus le coton fin ; je suis fou de plaisir.
« Qu’est-ce que t’es sexy… ».
« Tu me kiffes, hein ? ».
Mon Jérém aussi est fou de plaisir.
« Grave, j’ai tellement envie de toi… ».
« Tu la sens bien, là ? » fait-il, tout en cessant ses coups de reins et forçant avec son bassin pour s’enfoncer très loin en moi, pour me remplir, pour me posséder entièrement. Je suis assommé d’excitation et de plaisir.
« Ah, oui, je la sens très bien… et c’est tellement bon… ».
Il recommence à me pilonner, je recommence à agacer ses tétons par-dessus le coton blanc. Mais très vite le bogoss a l’air d’avoir chaud : il l’attrape le t-shirt par le bas, le relève jusqu’à le coincer au-dessus de ses pecs ; je suis toujours impressionné par cette rencontre magique, l’alchimie entre un t-shirt moulant et un torse sculpté : et puis, j’ai beau savoir pertinemment ce qui se cache sous le coton fin, à chaque fois c’est un choc.
Mes doigts se délectent désormais du contact direct avec ses pecs d’acier et des tétons saillants garnis de petits poils, un contact fait à la fois de fermeté, de puissance et de douceur.
Le bogoss continue de me pilonner, l’air d’avoir toujours aussi chaud : quelques instants plus tard, il remonte encore le t-shirt, il coince la partie avant derrière le cou, laissant juste ses épaules et ses biceps enveloppés par le coton blanc : geste qui me met carrément dans un état second. Je suis assommé par tant de sexytude.
« J’ai trop envie que tu me gicles dedans… » je ne peux m’empêcher de lâcher.
« Mais je vais bien te fourrer, oui… t’inquiètes… ».
« T’es vraiment un bon mâle, t’es bien monté, tu bandes tout le temps, tu fais l’amour comme un Dieu, tu me rends fou… ».
« Toi aussi tu me rends fou… ».
« Mon bel étalon toulousain… ».
« J’ai chaud… » fait le bogoss, tout en se libérant définitivement de son t-shirt blanc avec un geste très rapide, avant de le balancer nonchalamment quelque part dans la pièce ; geste qui dévoile au passage toute l’envergure de son torse de malade, ses tatouages sexy, sa chaînette de jeune mâle posée entre des pecs.
Puis, sans se déboîter, il s’allonge sur moi et me fait des bisous, à la fois fougueux et doux ; il recommence à envoyer des petits coups de reins, ses abdos chatouillent mon gland, sa langue agace mes tétons ; mon Jérém frissonne, il a l’air transporté comme jamais : mon Jérém est fou de plaisir, fou de moi !
Je suis tout aussi fébrile, je lui rends ses bisous, mes lèvres gourmandes embrassent tout ce qui leur arrivé à portée, joues, lèvres, oreilles, cou, épaules.
« C’est trop bon… » je l’entends susurrer, alors qu’il s’abandonne sur moi de tout son poids et que son visage se laisse glisser dans le creux de mon épaule.
« Pour moi aussi c’est trop bon… ».
Certes, le plaisir sexuel est à cet instant à son paroxysme ; mais ce qui est trop bon par-dessus tout c’est de me retrouver à la fois emboîté avec mon Jérém et dans les bras de ce nouveau Jérém ; d’être en train de mélanger mon plaisir avec ce Jérém qui a tout aussi bien envie de prendre son pied, de le prendre avec moi, de m’offrir du plaisir, me faire l’amour, de me baiser, et de m’offrir une immense tendresse.
Soudainement, le bogoss arrête ses va-et-vient ; son corps est secoué par des frissons qui ressemblent presque à des spasmes, il halète bruyamment.
« Ça va pas ? » je m’inquiète.
« Si… si… ».
« Tu respires très fort… ».
« Je ne vais pas tarder à venir… ».
« Vas-y, mon amour… ».
Un instant plus tard, Jérém se dresse devant moi, le torse bien en arrière, les pecs bien bombés ; il attrape mes chevilles, il les pose sur ses épaules ; et il recommence à me pilonner : vraiment, c’est beau un mâle qui s’envole vers son plaisir ultime.
Mais le mâle ne pense pas qu’à son propre plaisir : et alors que ses va-et-vient l’approchent à grands pas de l’orgasme, sa main me branle de plus en plus vite. C’est tellement bon que je ne tarde pas à me sentir perdre pied.
« Je viens… » je lui lance alors que j’ai déjà perdu le contrôle de mon corps.
« Moi aussi… » je l’entends siffler, le souffle coupé par l’orgasme.
Oui, quand l’amour est là, la jouissance de l’un entraîne souvent celle de l’autre.
Mes giclées s’enchaînent, décorant mon torse de longues traînées brillantes.
« Oh, Nico… » je l’entends soupirer, alors que ses coups de reins s’espacent ; son torse part encore un peu plus en arrière, ses pecs deviennent encore plus saillants, son visage se lève vers le ciel, sa bouche s’ouvre à la recherche d’air, sa pomme d’Adam s’agite nerveusement dans son cou faisant vibrer son grain de beauté et sa chainette sexy. Et alors que l’onde de choc de l’orgasme fait vibrer tout son être masculin, mon bel étalon brame son orgasme comme jamais je ne l’ai entendu faire auparavant.
Jérém vient de jouir en moi, il respire très fort, il est en nage ; il dégage lentement mes mollets de ses épaules, il a l’air vraiment épuisé. Pourtant, il me balance un sourire, un sourire de malade, de malade ! Qu’est-ce qu’il est beau et touchant ce sourire, juste après l’orgasme !
Puis, il amorce le mouvement pour s’allonger sur moi.
« Fais gaffe, j’en ai partout… » je tente de le prévenir.
« Je m’en fous… » fait-il, tout en collant son torse contre le mien, en enfonçant son visage dans le creux de mon épaule et en posant quelques bisous légers sur ma peau. J’adore, après l’amour, le voir assommé par l’orgasme ; j’adore me blottir entre les pattes chaudes, sentir le contact avec la toison douillette de mon mâle.
« C’est tellement bon avec toi… » je l’entends lâcher, alors que son souffle chaud caresse mon cou.
« Je suis un bon coup, hein ? » je le cherche.
« Grave… un super bon coup… ».
« Et toi, alors… ».
Comme à chaque fois que Jérém vient de gicler en moi, je suis ivre de lui, et j’ai envie de flatter son ego de mâle.
« T’es vraiment fait pour ça… ».
« Je suis fait pour quoi ? » fait-il, en relevant sa tête et en plantant ses yeux dans les miens. Je lui fais un bisou, avant de lui répondre :
« T’es un vrai mâle, t’es fait pour jouir et donner du plaisir avec ta queue… ».
« T’as vu comment tu me chauffes ? ».
« Et toi, donc ? T’es tellement bon au pieu... et tellement mec dans ta façon de prendre ton pied, de me toucher… putain, comment tu me fais vibrer… ».
« Comment ça ? ».
« Peut-être que tu ne t’en rends même pas compte, mais quand tu fais l’amour, t’as des gestes et des attitudes qui me rendent dingue… ton regard, tes mouvements, les positions de ton corps, ta respiration, ta transpiration, tout ce que tes muscles expriment, la façon dont tes mains me touchent, me guident, me parlent de tes envies… ta façon de foncer vers le plaisir… et aussi ta façon de me chauffer avec tes mots… j’adore quand t’es tellement excité que ton côté dominant ressort… je kiffe à mort… et j’aime jouir avec toi… ».
« Moi aussi j’aime jouir avec toi… ».
« Et en plus tu enchaînes, t’as toujours la trique… ».
« Tu sais, il n’y a qu’avec toi… ».
« De quoi ? » je fais, intrigué.
« Il n’y a qu’avec toi que j’enchaîne quatre, cinq fois dans une nuit… ».
« Avec personne d’autre ? ».
« Non, personne, jamais… ».
« C’est vraiment fou comment on se fait du bien… » je considère.
« Oh, que oui… ».
« J’aime jouir avec toi mais j’aime aussi être dans tes bras, après, comme maintenant… ».
« Moi aussi… » il lâche, après un instant de silence, en me regardant droit dans les yeux.
Dans sa voix, dans son regard, je le sens si heureux.
Son sourire doux et adorable, c’est le sourire d’un petit gars que se laisse enfin aller, le sourire d’un mec qui a un besoin immense de recevoir et de donner de l’amour.
« J’en ai faites des conneries, mais si j’ai fait une bonne chose, c’est de t’appeler… ».
« Merci Maxime… » je rigole.
« Je crois que je t’aurais appelé même si le frérot ne m’avait pas botté le cul… je ne pouvais pas partir à Paris de cette façon, après m’être comporté comme un salop… ».
A cet instant précis, j’ai envie de le caresser, de le serrer contre moi, de lui faire mille câlins, mille bisous. J’ai envie de ne plus jamais partir de cette maison, de ce lit, de cette étreinte avec mon adorable Jérém.
Sa chaînette effleure la peau entre mes pecs ; alors, je trouve marrant d’attraper quelques mailles pour l’attirer vers moi et lui faire un bisou.
« Ça vient d’où cette chainette ? » j’ai envie de lui demander.
« C’est un cadeau… ».
« Un cadeau de qui ? ».
« De ma mamie… elle me l’a offert à la rentrée de seconde… enfin, ma « première » seconde… j’y tiens beaucoup… ».
Qu’est-ce qu’il me touche, mon bel étalon, lorsqu’il redevient poulain en parlant de ses grands-parents.
« J’ai chaud… » il s’exclame, tout en relevant son torse et en se déboitant de moi.
Il attrape du sopalin, il m’en passe un bout ; je le regarde en train d’essuyer son torse, opération qui prend un certain temps, le relief de ses abdos ne facilitant pas les opérations de nettoyage…
Un instant plus tard, il s’allonge à côté de moi, sur le dos, il pose une main par-dessus son nombril, il ferme les yeux, il prend une inspiration profonde, puis il émet une expiration tout aussi longue.
« Ça va ? » je lui demande une nouvelle fois.
« Si si, ça va très bien… c’est juste que… je ressens une chaleur de ouf dans le ventre, comme s’il y avait du feu dedans… je crois que je n’ai jamais autant pris mon pied… ».
« Moi non plus je n’ai jamais autant pris mon pied… ».
Et, ce disant, je change de position, je m’allonge de façon à pouvoir poser ma tête sur ses abdos ; je me laisser bercer par la chaleur de sa peau, par sa respiration – qui se calme enfin –, je m’enivre de cette petite odeur si particulière que dégage son corps après l’amour : une odeur à la fois forte et douce, une odeur de transpiration, de sexe, une odeur de petit mâle, comme si son corps tout entier sentait l’amour.
La cheminée irradie sa chaleur rassurante, et la main puissante et chaude de Jérém vient se pose sur mes abdos, sur ce ventre que sa queue et sa semence viennent de chauffer à blanc.
Je tourne la tête pour le regarder : le feu de la cheminée illumine son beau visage. Jérém dort déjà.
Je le regarde longuement, inlassablement, jamais repu de sa beauté presque surnaturelle ; tout, chez mon Jérém, respire une sensualité de chaque instant, une sexualité débordante ; tout chez lui crie au sexe. Pourtant, à cet instant précis, une infinie tendresse se dégage de lui.
Je me lève, je passe à la salle de bain ; lorsque je reviens au lit, mon Jérém s’est glissé sous les draps ; il est toujours allongé sur le dos, l’air endormi comme un bébé. Je me glisse à mon tour sous les draps et je m’allonge contre lui ; et là, comme s’il avait ressenti ma présence et mon vœux le plus cher, il se tourne sur un flanc, dans la position idéale pour que je puisse le prendre dans mes bras : même dans le sommeil, les gestes et les intentions se combinent avec une perfection bouleversante.
Mes jambes épousent ses jambes, mes cuisses les siennes, mon torse son dos puissant, mon visage, le creux de son épaule, mon bras enserrent sa taille.
La chaleur de son corps contre le mien, son parfum léger qui enivre mes narines, sa respiration paisible, sa présence rassurante : je crois qu’il faudrait pouvoir capter tout mon ressenti à cet instant précis pour illustrer pleinement le mot « Bonheur ».
« Bonne nuit, mon amour… » je ne peux m’empêcher de lui chuchoter à l’oreille, tout en posant quelques bisous dans son cou.
Pour toute réponse, je n’obtiendrai qu’un petit grognement, que je trouve pourtant tout mignon. Mais alors que je crois que mon bonheur est parfait, quelque chose vient me rappeler que tout degré d’émotion, même celui qu’on croirait d’une intensité ultime, est en réalité tout à fait relatif : ainsi, lorsqu’un instant plus tard, sa main saisit la mienne et la pose sur ses pecs, mon bonheur atteint des sommets dont je ne soupçonnais même pas l’existence.
Oui, dans cette maison isolée au bout du monde, il s’est produit un petit miracle : entre ces quatre murs en pierre, j’ai trouvé le Jérém de mes rêves. Et il est pourtant bien réel. Je suis tellement heureux, que j’ai à nouveau envie de croire en l’amour, en Jérém et moi, en nous.
Je sais que le temps nous est compté, que dans quelques jours (je ne sais même pas quand, nous n’en avons même pas parlé), mon Jérém partira à Paris, et moi à Bordeaux ; mais depuis ce baiser sous la halle de Campan, voilà que ces montagnes, cette petite maison, cette cheminée qui dégage une chaleur douce et rassurante, sont le seul horizon dont j’ai besoin.
Car dans ces montagnes, dans cette maison, dans ce lit, dans cette accolade avec mon Jérém après l’amour, je me sens terriblement bien ; je me sens en sécurité, comme on se sent en sécurité quand on se sent aimés.
Alors, je me refuse de penser à demain : j’ai envie de lâcher prise, de vivre l’instant, chaque instant de ces quelques jours et nuits qu’il nous sera donné de passer ensemble ; j’ai envie de me laisser porter, de me laisser conduire vers l’inconnu, de perdre pied, si délicieusement, de découvrir autant que je le peux, ce nouveau, incroyable, adorable Jérém.
Le pluie a cessé de tomber, mais le vent souffle toujours ; dehors, il doit faire froid ; mais à l’abri dans cette petite maison, il fait chaud, il fait bon, il fait bonheur. Et cette masure sans électricité devient un château. Je voudrais que ce moment dure à tout jamais.
Bercé par le bruit léger de sa respiration, enivré par la chaleur, la douceur, l’odeur délicieuse de sa peau, je m’endors,.
Lorsque j’émerge de mon sommeil, je ne sais pas bien quelle heure il est, ni depuis quand je dors ; je ne suis réveillé qu’à moitié, je suis à moitié dans les vapes ; ainsi, il me faut un certain laps de temps pour me souvenir que je me suis endormi en tenant mon Jérém dans mes bras ; et pour réaliser que je me trouve désormais enlacé par ses bras puissants, enveloppé par son torse chaud, ma nuque chatouillée par son souffle brûlant, mes fesses et ma rondelle assiégées par sa queue à nouveau raide comme l’acier.
Dehors, le vent n’a pas cessé, la charpente grince toujours ; le feu dans la cheminée a un peu perdu de son intensité ; mais ce qui n’a pas perdu de son intensité, c’est l’érection de mon bel étalon.
Vraiment, ce mec est incroyable…
Oui, visiblement, mon Jérém a à nouveau envie ; et cela suffit pour réveiller illico la mienne. Ainsi, sans réfléchir, cédant à mon désir brûlant, j’entreprends à onduler légèrement mon bassin : la sensation du frottement de son gland autour de ma rondelle fait grimper mon envie de recommencer à faire l’amour ; et, apparemment, la sienne aussi. Le bogoss ne tarde pas à me chuchoter à l’oreille, la voix vibrante d’excitation :
« J’ai encore envie de toi… ».
« Oh, moi aussi j’ai encore envie de toi… » je lance, dans un état presque second.
« Tu me rends dingue… » je l’entends susurrer.
Si j’avais cru, lors de la première révision, entendre un jour ces mots de la bouche de mon Jérém ! Si mon excitation n’était pas si forte, je crois que je ne pourrais pas retenir mes larmes.
« Alors, fais-moi l’amour comme tout à l’heure… ».
« Oh, Nico… ».
Un instant plus tard, le bogoss se laisse glisser en moi et recommence à me faire l’amour, dans cette position, sur le flanc ; ses va-et-vient sont lents et réguliers, à chaque fois il s’enfonce en moi jusqu’à la garde ; ses doigts ne quittent jamais mes tétons, ils jouent avec, me rendent fou. Sentir mon Jérém coulisser en moi est un bonheur sans égal ; me faire tringler de cette façon impromptue, entre sommeil et veille, c’est juste un truc de fou.
Et lorsque je l’entends grommeler bruyamment son plaisir, je suis le gars le plus heureux de la Terre.
Le bogoss se blottit contre moi, la respiration haletante. Je sens sa main se poser sur ma queue.
« T’as envie de jouir ? » il me demande.
« Non, non, tu m’as déjà fait jouir comme un malade… demain… demain… ».
« T’es génial, Nico… ».
« Toi aussi, Jérém, toi aussi… ».
Blotti dans ses bras, enveloppé par la chaleur de son corps, par l’odeur de sa peau, rempli de sa virilité, bordé par sa tendresse et sa bienveillance, je m’endors à nouveau.
 6 commentaires
6 commentaires
-
Après un coup de fil inattendu et un voyage sous une pluie battante, je viens de retrouver mon Jérém sous la halle en pierre du petit village de Campan.
« Ça veut dire quoi MonNico ? » je lui balance de but en blanc, sans réfléchir.
« De quoi ? ».
« La fois où je t’ai appelé, quelques jours avant ton accident, j’ai entendu cette nana te demander : « C’est qui MonNico ? » ; alors, je te demande ce que ça veut dire MonNico… si toutefois ça veut dire quelque chose… ».
Jérém ne répond pas, il continue de fumer sa cigarette. C’en est trop pour moi.
« Va te faire voir, Jérém, je me tire ! » je lui balance, tout en me retournant pour repartir, en essayant de retenir mes larmes.
Je n’ai pas fait un pas que je sens sa main attraper mon avant-bras, m’obligeant à me retourner.
« Attends, Nico… ».
« Lâche-moi ! » je lui lance sèchement, tout en me dégageant de sa prise et en repartant vers la voiture.
Et là, Jérém m’attrape une nouvelle fois par l’avant-bras, la puissance de sa prise traduisant sa détermination ; une nouvelle fois, il m’oblige à m’arrêter, à me retourner ; et cette fois-ci, son mouvement m’attire vers lui.
Je me retrouve les épaules collées contre le mur en pierre, enveloppé par son parfum qui me met en orbite, ses yeux noirs pleins de feu plantés dans les miens, nos nez à vingt centimètres l’un de l’autre.
Sa pomme d’Adam s’agite nerveusement ; dans son regard, une étincelle que je lui connais bien, une flamme incandescente qui ressemble et tout et pour tout à celle qui brûlait dans son regard pendant la semaine magique ; la même, mais avec plus d’intensité, car mélangée à une sorte d’angoisse, de peur.
Le temps est comme suspendu, figé ; comme si plus rien n’existait au monde, à part nos regards qui se cherchent, s’aimantent.
Un grand homme disparu a dit : il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien ; et puis il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde.
Et ce monde, ce nouveau monde, je l’ai vu, à cet instant précis, dans son regard.
Sa main glisse doucement derrière ma nuque, sa paume est si chaude, si délicate, elle fait plier légèrement mon cou ; le sien se plie aussi, et nos visages se rapprochent : jusqu’à ce que ses lèvres tremblantes se posent sur les miennes. Puis, très vite, son baiser se fait plus appuyé, et sa langue s’insinue entre mes lèvres.
Jérém m’embrasse et dans ma tête c’est le blackout ; je l’embrasse à mon tour, heureux, en larmes.
Dans un coin de la halle de Campan, pendant que la pluie tombe dehors, voilà enfin le premier vrai baiser de Jérém, à la fois fougueux et presque désespéré.
Jérém m’embrasse longuement, le goût de ses lèvres est délicieux. Un instant plus tard, son nez, son souffle et ses lèvres effleurent la peau de mon cou : je vais devenir dingue.
« Ça te convient comme réponse ? ».
« Quelle réponse ? » je fais, perdu, désorienté.
« Tu voulais savoir ce que ça veut dire MonNico… »
« Ah, oui… c’est un bon début… ».
« Tu m’as manqué… » il me chuchote.
« Toi aussi tu m’as manqué… »
Je pleure.
« Ne pleure pas Nico… ».
Je le sens lui aussi au bord des larmes.
« Je suis content que tu sois là… » il me glisse à l’oreille, alors que la chaleur de son corps, la puissance de son étreinte, ses bisous dans le cou, son parfum m’étourdissent.
« Tu veux toujours repartir à Toulouse ? » il me nargue, adorable.
« Je crois que je vais attendre un peu… ».
Je ne peux résister à la tentation de chercher à nouveau le contact avec ses lèvres enfin accessibles, à l’envie brûlante de l’embrasser à nouveau, et de le serrer très fort contre moi. Nos baisers, nos caresses ont une intensité enflammée, fiévreuse : j’ai eu peur de le perdre à tout jamais et j’apprécie donc à sa juste valeur – immense valeur – le cadeau inouï de le retrouver. Et le plus beau dans tout ça, c’est que j’ai l’impression que c’est la même chose pour mon Jérém : que lui aussi a eu peur de me perdre, qu’il a eu peur que je ne vienne pas le rejoindre, malgré son invitation sincère ; et qu’il est on ne peut plus heureux de me retrouver.
Je ferme les yeux et dans ce déluge de baisers, je ressens la sensation de respirer enfin à pleins poumons, après avoir été en apnée pendant des semaines, depuis notre rupture ; avec, en même temps, la sensation que la chape de plomb qui, depuis le début de nos révisions, empêchait Jérém de se dévoiler et à nos sentiments réciproques de se rencontrer, s’est évaporée.
J’ai l’impression de me retrouver enfin face au (ou plutôt enlacé au) véritable Jérém ; j’ai envie de croire que ses bras puissants vont m’enserrer et me protéger à tout jamais ; j’ai envie de tout lui pardonner, j’ai envie de lui demander de tout me pardonner ; j’ai envie de me jeter âme et corps dans ce bonheur enfin possible, envie de profiter de cet instant magique. J’ai juste envie d’être heureux. Avec lui.
J’ai envie de pleurer et je pleure. Nos respirations profondes se mélangent, la chaleur de son corps réchauffe mon corps, mon cœur.
Quelle longue route, sinueuse et accidentée, combien de questionnements, de peurs, de souffrances, d’erreur, de larmes, avant de connaître ce bonheur. La route a été rude, mais la destination en vaut largement la peine.
Lorsque nos corps se séparent, nos regards se croisent, nos émotions respectives se découvrent, se comprennent. Mon bobrun aussi a les yeux humides. C’est beau et touchant un garçon qui se retient de justesse de pleurer de bonheur.
« Tu es garé où ? ».
« Sur… sur le… parking… de l’autre côté de la rue… » je tente de lui répondre, en essayant péniblement de ne pas sangloter, face à ce bonheur insoutenable.
Ses caresses, ses baisers – et, surtout, son tout premier, vrai baiser – m’ont mis ko : je suis comme lessivé, je me sens comme si un rouleau compresseur m’était passé dessus.
Jérém me tend une main, et je la saisis, comme une évidence ; nous traversons la halle, les doigts enlacés.
Nous n’avons pas parcouru la moitié de sa longueur, et déjà je ressens le besoin irrépressible de tourner la tête pour regarder mon bobrun, comme pour me convaincre que je ne suis pas en train de rêver ; la sienne se tourne au même instant, je rencontre son regard, son sourire ému ; je lui souris à mon tour, et le bobrun m’attire une nouvelle fois contre lui. Qu’est-ce que j’aime le goût de ses lèvres et de sa langue, qu’est-ce que j’aime sa fougue, sa passion, son ardeur ! Qu’est-ce que j’aime ce nouveau Jérém !
Nos lèvres sont toujours collées à la superglue lorsque, du coin de l’œil, je capte une présence sous la halle : une femme avec un gros sac est en train de profiter de l’abri pour traverser la petite place. Elle nous voit, elle nous toise, elle écarquille grand les yeux, l’air visiblement offusqué par ce qu’elle voit.
« Jérém, on est pas seuls… » je le préviens.
Quelques bisous plus tard, Jérém tourne la tête et capte la femme au gros sac et aux gros yeux qui n’arrête pas de nous mater ; et, loin de se sentir mal à l’aise, mon bobrun la fixe à son tour de façon directe et insistante.
« Qu’est-ce qu’il y a, t’as jamais embrassé personne ? » il la ramène, railleur.
La femme presse le pas, l’air décontenancé.
« On va y aller, Jérém… on peut nous voir ici… ».
« Je m’en bat les couilles… », fait-il, en posant un dernier bisou sur mes lèvres.
Nous arrivons sur le seuil de la halle ; un pas de plus, et ce sont des trompes d’eau qui nous attendent. Jérém rabat la capuche de son pull, prêt à se jeter dans le déluge : je me prépare à lui enjamber le pas, lorsque son bras m’interdit d’avancer.
Et là, je le vois rabattre à nouveau la capuche sur ses épaules, ouvrir le zip de son pull, avant de l’enlever carrément, dévoilant au passage le fameux maillot que je lui avais offert et qui lui va comme un gant – un gant sexy, redessinant à la perfection sa plastique de fou.
Je ne me suis pas trompé, ni de maillot, ni de taille ; ce bout de coton bien coupé, posé sur ses épaules, est un truc de fou : le V de son torse et ses biceps rebondis sont mis en valeur d’une façon qui donne le tournis ; le col épouse son cou puissant à la peau mate, les trois petits boutons ouverts dévoilent la naissance de ses pecs à la pilosité naissante, pecs que le tissu souligne d’une façon scandaleuse, jusqu’à laisser pointer les tétons ; chaînette, grain de beauté, brassard tatoué, le deuxième tatouage qui rentre par le biceps, ressort du col du maillot et remonte le long de son cou : chacun des ingrédients magiques de sa sexytude sont sublimés par ce maillot enchanté.
Enchanté parce que, une fois encore, un simple bout de coton donne l’impression d’avoir été coupé sur mesure sur sa plastique de fou ; enchanté, aussi, par ce que ce maillot représente – sa passion pour le rugby, son admiration pour un immense joueur – chose qui ajoute un aura, un supplément de sexytude à mon adorable Jérém.
Un instant plus tard, le pull gris atterrit sur mes épaules.
« Garde le, Jérém… » je ne peux m’empêcher de m’exclamer, en comprenant ses intentions.
Je suis profondément touché par son geste adorable ; j’ai de plus en plus envie de pleurer.
« Non… ».
« Tu vas te tremper… ».
« M’en fiche… ».
Je sais que je n’aurai pas gain de cause. Mon bonheur augmente encore d’un cran, à des sommets que je ne croyais même pas possibles. Non, je n’ai jamais été autant heureux de ma vie.
Je passe le pull par-dessus mon blouson, et Jérém rabat la capuche sur ma tête : je suis immédiatement envahi par son odeur et par sa chaleur. Et je suis bien, tellement bien.
Nos regards se croisent, nous sourires, nos bonheurs se mélangent : j’ai envie de le bouffer. Un clin d’œil de bobrun, et c’est le top départ : nous quittons la halle, nous fonçons sous la pluie en rigolant comme des gosses ; j’ai envie de lui faire un million de bisous, de le prendre dans mes bras et de le serrer très fort contre moi, j’ai envie de faire l’amour avec lui, brûlante envie, la même envie que je vois dans ses yeux, aussi incandescente que la mienne.
« Voilà ma voiture… » je le préviens lorsque nous arrivons à proximité de ma caisse.
« Tu m’amènes à la mienne ? ».
« Bien sûr… ».
Bien sûr que je vais l’y amener : juste, il faudrait d’abord que j’arrive à ouvrir ma caisse. Mes mains tremblent, j’essaie d’ouvrir la porte, je n’y arrive pas ; les clefs me tombent des mains, elles atterrissent dans un nid de poule rempli d’eau. Je les ramasse, elles sont glissantes, je tremble de plus en plus.
Pendant que je galère, je capte mon bobrun en train de se mouiller à vue d’œil, les cheveux bruns ruisselants d’eau, l’air pourtant amusée ; il est beau à en pleurer.
Je ne sais pas comment, mais j’arrive enfin à ouvrir la porte conducteur.
« Il était temps… » il se marre.
« Ne te moque pas… ».
Je rentre dans la voiture, j’ouvre la porte passager, le bogoss rentre comme une furie.
« Si j’avais su, je n’aurais pas pris ma douche… ».
« Petit con… » je lui balance, juste avant que nos lèvres s’attirent à nouveau. Nous nous embrassons longuement, pendant que les vitres dans le petit habitacle se couvrent de buée.
Je me fais violence pour quitter ses lèvres et démarrer la voiture. Je mets le désembuage à fond, j’ouvre la fenêtre de mon côté. Je tente de reculer pour sortir de la place de parking : je suis un conducteur peu expérimenté, l’opération s’avère laborieuse.
Je sens son regard sur moi, un brin taquin.
« Ne te moque pas… » j’insiste.
« Je ne me moque pas… ».
« Je le sais que je suis nul… ».
« Tu viens d’avoir ton permis… ».
C’est la première fois que quelqu’un monte en voiture avec moi, et le hasard a voulu que ce soit mon Jérém ; Jérém, qui a été parfois mon « chauffeur », Jérém par qui je me suis laissé conduire, complètement confiant, impressionné par son aisance – et parfois sa désinvolture – au volant, charmé par ce petit supplément de virilité que cette position peut conférer à un garçon.
Le fait de le voir désormais à la place de conducteur me fait un drôle d’effet ; et le voir me faire confiance avec un tel naturel me touche immensément. Pourtant, mon manque de confiance me joue des tours : sa présence m’impressionne, et me fait perdre mes moyens.
« Respire un bon coup, ça va aller… » il m’encourage, tout en passant sa main sur le parebrise et en baissant la vitre de son côté pour augmenter la visibilité.
« Vas-y, recule, il n’y a personne, tu n’accroches rien… » fait-il, en passant la tête dehors, malgré la pluie battante, tout en posant une main sur ma cuisse.
Je suis son conseil, je respire un bon coup ; aidé pas ses encouragements, j’arrive enfin à sortir de la place de parking.
« Dis-donc, t’as une voiture de bourge… » il se moque.
« N’importe quoi, elle ne voulait même pas démarrer tout à l’heure… ».
« C’est pour ça que t’es grave à la bourre… » il rigole.
« J’ai essayé de t’appeler, mais je n’arrivais pas à te joindre… ».
« Le portable ne passe pas ici… ».
« Mais hier tu m’as appelé… ».
« Hier je suis descendu à Bagnères pour t’appeler… ».
« Ah… ».
« Deux minutes de plus et j’allais partir… tu te serais retrouvé seul comme un con… ».
« Je ne serais pas reparti avant d’avoir retourné le village pour te retrouver… ».
Jérém rigole, mais je le sens touché par mes mots.
« Au stop, c’est à gauche… ».
« Ok… ».
« Vas-y doucement, c’est pas loin… la voilà… elle est garée là, cinquante mètres plus loin, sur la droite… ».
En voyant la 205 rouge, la voiture dans laquelle je suis plusieurs fois rentré de retour de boîte de nuit avec mon Jérém, direction les révisions nocturnes dans l’appart de la rue de la Colombette, je ressens un immense frisson dans le ventre.
« C’est bon, arrête-toi ici… tu vas me suivre… ».
« C’est loin ? ».
« Cinq petites minutes… au fait, si tu veux appeler chez toi, il faut le faire ici » fait-il en m’indiquant une cabine juste à côté « il n’y en a pas d’autres, et chez moi, le portable, c’est même pas la peine… ».
Submergé par le bonheur, je n’y pensais même plus : je trouve touchant qu’il y ait pensé à ma place.
« Ah oui… je vais appeler… ».
Je sors de la voiture et je cours à la cabine pour appeler maman.
Je lui explique que je suis bien arrivé, que le temps est pourri, que j’ai bien retrouvé Jérém. Elle me demande si tout se passe bien.
« Oui, maman, tout se passe très bien… ».
Si tu savais, maman, à quel point tout se passe bien, et d’une façon que je n’aurais même pas pu imaginer.
« Alors, elle est rassurée, ma-ma-n ? » fait-il, moqueur, lorsque je reviens à la voiture.
« Oui… ».
Le bogoss me sourit et me fait un bisou derrière l’oreille. Je frissonne, comme parcouru par une décharge électrique.
« Allez, on y va… ».
Jérém s’apprête à sortir de ma voiture, et l’idée de le quitter, ne serait-ce que le temps d’un court trajet, m’est insupportable ; j’ai envie de monter dans la 205 avec lui, j’ai envie de me laisser conduire, n’importe où.
Je ne peux m’empêcher de tâter son biceps pour me convaincre que tout cela est bien réel : lorsque mes doigts effleurent sa peau, j’ai l’impression que ce simple contact génère des étincelles. La peau est douce et soyeuse, et le muscle ferme et rebondi. Qu’est-ce qu’il est épais et ferme son biceps, un vrai biceps de beau mâle. Mon Jérém, ce magnifique animal.
« Allez, à toute… » fait-il, avant de claquer un dernier bisou sur mes lèvres et de quitter la voiture en vitesse.
Je le regarde se précipiter dans la 205 rouge, démarrer et prendre la route. Je suis tellement impatient de découvrir où elle va m’amener.
Le ciel est gris, lourd, le nuages très basses, opprimantes, le brouillard semble glisser le long des pentes, se nicher entre les reliefs ; il n’est pas tard mais la lumière est très faible ; le jour commence à mourir, le brouillard et le nuages se confondent ; nous avançons dans un décor de sinistre grisaille dont on ne voit pas le but.
Dans ce paysage terne et monotone, la 205 rouge de Jérém apparaît comme une note de couleur, unique et pourtant si intense : à cet instant précis, enveloppé dans la chaleur parfumée de son pull, la 205 rouge est mon Etoile Polaire.
Nous quittons le village de Campan et nous empruntons une route sur la droite qui monte et part dans la montagne. La route est étroite et sinueuse ; au fil des virages, nous traversons des endroits boisés, nous longeons des parois rocheuses. Le paysage se fait de plus en plus sauvages, le bois et la pierre sont partout autour de nous : la montagne nous entoure, avec son allure épurée, solennelle, immuable ; elle force le respect, et elle nous rappelle sans cesse que nous ne sommes que ses invités d’un instant.
Oui, tout, dans ce paysage sans couleur, semble parler de froid, d’humidité, d’hiver, de solitude, de tristesse : pourtant, lorsque je regarde la 205 rouge devant moi, voilà que ce décor devient pour moi la source d’une joie indescriptible. C’est incroyable comment un jour de pluie peut retrouver le soleil, et de si belles couleurs, grâce à un simple mot, à un simple baiser, à une simple présence. Quand la lumière est dans le cœur, toutes les choses semblent belles.
Les virages sont de plus en plus étroits ; Jérém avance de plus en plus lentement, et je l’entends même klaxonner pour annoncer sa présence avant de les emprunter. Puis, la 205 rouge ralentit encore, elle finit tourne une nouvelle fois à droite ; elle emprunte une sorte de rampe conduisant dans une cour en pente, au bout de laquelle se trouve une petite maison en pierre avec le toit en ardoise.
Posée dans un décor de nuages, de pluie et de brouillard, la petite maison semble installée au milieu de nulle part ; au gré des vents, le rideau de grisaille se déchire par moments et par endroits, dévoilant les flancs de montagne sombres et boisés. Avec sa cheminée plutôt massive qui laisse échapper une fumée claire, on dirait une masure sortie tout droit d’un conte pour enfants.
Jérém sort de sa voiture, et court se mettre à l’abri sous le petit auvent en façade de la petite maison ; je le vois faire de grands signes pour me faire avancer et me garer au plus près.
Lorsque j’ouvre la porte de la voiture, la pluie tombe violemment, le vent est fort et froid, encore plus qu’au village. La nature semble hostile, mais très vite, je suis charmé par un bouquet d’odeurs de sous-bois et de nature sauvage, auquel se mélange l’odeur du bois qui brûle ; ça sent à la fois le froid de l’hiver et la chaleur d’une pièce chauffée par une grande cheminée : bref, ça sent la montagne.
Je rejoins Jérém sous le petit auvent, alors qu’il est en train de passer et repasser sa main dans ses beaux cheveux bruns pour les rabattre en arrière et les essorer. Putain, qu’est-ce qu’il est sexy ! Avec ses cheveux mouillés et en bataille, son regard adouci, il me fait craquer comme jamais.
J’ai envie de l’embrasser à nouveau, et lui aussi en a envie : nous nous précipitons pour chercher les lèvres de l’autre au même instant, comme une évidence : quand l’amour est là, les gestes viennent avec un naturel, une coordination, une harmonie, une complicité étourdissantes.
Derrière la porte vitrée, les ombres du feu s'agitent dans la pièce sombre. Instinctivement, je sais qu’il suffit de passer cette porte, pour être au chaud, à l’abri, pour aller à la rencontre d’un bonheur magique. Et à ce bonheur, c’est Jérém qui va m’y amener.
« Viens, on rentre, il fait meilleur dedans… » fait le bobrun, tout en saisissant ma main, en ouvrant le battant porte et en m’entraînant à l’intérieur.
A l’instant où je rentre dans la petite maison, je suis immédiatement saisi, enveloppé, comme foudroyé par la chaleur des flammes, une chaleur intense, douce et rassurante ; et aussi par cette délicieuse odeur de bois, de feu, de rustique, de bonheur simple.
Un pièce à peine plus grande que le studio de la rue de la Colombette s’ouvre devant moi, dans la pénombre dansant au gré des mouvements des flammes : elle est dominée par la présence d’une grande cheminée ouverte ; à l’opposé de la cheminée, dans un coin, un petit lit ; un peu plus loin, une table et des chaises en bois brut, une vieille crédence ; et au milieu de ce petit espace sommairement équipé, le gars que j’aime comme un fou.
« Je n’ai pas d’électricité… » semble vouloir s’excuser le bogoss « mais il y a du bois, on ne va pas se les geler… ».
« C’est pas gra… » je tente de lui répondre.
Une tentative destinée à rester inaboutie ; car, avant que je n’aie pu terminer ma phrase, Jérém me plaque contre le mur et m’embrasse à nouveau, comme affamé, insatiable, comme si ce contact lui faisait le même bien, lui offrait le même bonheur, le même frisson qu’il m’offre à moi. Ce qui doit vraiment être le cas.
Lorsque nos lèvres se décollent, nos regards se croisent ; et dans le sien, je vois le regard d’un petit gars plein de tendresse et de bonheur. Mais déjà Jérém me serre très fort contre lui, ses lèvres me font des bisous tout doux dans le cou, en remontant vers mon oreille.
Le bobrun qui m’a dit un jour pas si lointain : « je fais pas de bisous, je baise », est en train de me couvrir de bisous. J’en suis ému, bouleversé.
Dehors, la tempête ne donne pas signe de vouloir se calmer, le froid et l’humidité sont partout, la nuit va bientôt tomber ; alors qu’à l’intérieur, le feu crépite dans la cheminée, et sa chaleur irradie sur mon visage, mes mains, dans mon cœur.
« Enlève le pull, tu es trempé… » fait-il, tout en me faisant pivoter pour m’en débarrasser par lui-même.
Puis, avec un geste assuré et très mec, il attrape son maillot par le bas, il le retourne le long de son torse ; comme un lever de rideau dévoilant une œuvre d’art tant attendue, le lever de maillot dévoile son magnifique torse musclé, ses abdos, ses pecs, ses tatouages en entier ; et après le choc de retrouver cette plastique divine qui m’a été inaccessible depuis un mois, cela me permet d’apprécier toute la beauté de ses adorables poils bruns en train de repousser.
« Qu’est-ce que c’est beau… ».
« Quoi, donc ? ».
« T’as laissé repousser… ».
Le petit coquin se contente de sourire.
Je ne peux m’empêcher de caresser sa peau et ses petits poils, et ce simple contact me donne des frissons géants ; je ne peux pas non plus m’empêcher de poser des bisous entre ses pecs, de laisser traîner mon nez à la poursuite de l’odeur de sa peau mate, tout laissant mes mains affamées se balader un peu partout sur sa plastique de fou.
C’est pendant ces errances que les bouts de mes doigts découvrent la surprise que me réserve sa demi-nudité.
Intrigué, je fais à mon tour pivoter mon bobrun ; non, je ne m’y suis pas trompé : un truc qui ressemble à un petit pansement est collé derrière son épaule.
« C’est quoi, ça ? ».
« C’est un patch… ».
« Un patch ? ».
« Oui… j’essaie d’arrêter les conneries… ».
« Ah bon… ».
Là, je suis vraiment sur le cul. Naaaaan, mais ce n’est pas possible, je me suis trompé d’adresse, je me suis trompé de gars !
« Tu veux arrêter la cigarette ? » je fais, encore incrédule, presque sonné.
« Le médecin qui m’a fait passer la visite pour le Racing m’a dit que sans cigarette je jouerais mieux et plus longtemps… ».
« Il t’a pas dit que ce serait mieux pour ta santé, surtout ? ».
Pour toute réponse, Jérém me plaque une nouvelle fois contre le mur, sa langue s’insinue entre mes lèvres, déchainée, insatiable. Puis, ses mains ouvrent le zip de mon blouson, se glissent sous mon t-shirt ; ses doigts trouvent mes tétons, les caressent, les excitent. Je sens sa bosse raide contre la mienne, je sens l’envie de le sucer monter en flèche.
Mais avant tout, j’ai envie de sentir ma peau contre la sienne, mon torse contre le sien. J’enlève mon blouson, que je laisse tomber par terre juste à côté ; la chaleur de la cheminée irradie sur mes bras, mon cou. Jérém a ôté son short et ses baskets et il est désormais torse nu et boxer.
J’enlève le t-shirt et la chaleur de la cheminée irradie désormais sur tout mon torse, m’offrant une sensation d’immense bonheur ; un bonheur qui devient exponentiel lorsque Jérém vient coller son torse contre le mien, m’offrant une autre chaleur, une chaleur de mec, chaleur qui fait tellement, mais tellement, tellement de bien, au corps et au cœur, chaleur qui rend heureux.
J’ai envie de lui, une envie si violente que ça me vrille les tripes ; et pourtant, j’ai tout autant envie que ces câlins, ces bisous, cette fougue, cette passion, ce bonheur ne s’arrêtent jamais. Comment choisir entre les deux ?
C’est Jérém qui va apporter la réponse à mon dilemme : nos langues se mélangent toujours et déjà ses mains défont ma ceinture, ma braguette, descendent mon pantalon et mon boxer ; ses gestes transpirent le désir, l’impatience, l’urgence. Puis, alors que l’une de ses mains empoigne ma queue et entreprend de la branler doucement, l’autre agace mes tétons à tour de rôle ; mon excitation devient insoutenable, je n’ai plus qu’une envie, celle de lui offrir du plaisir, de n’importe quelle façon il le souhaite.
Je ne sais pas encore de quoi il a envie, la, tout de suite ; mais ce que je sais, c’est que j’ai envie de lui offrir. S’il veut que je le suce, ce sera avec un immense bonheur ; et s’il veut me prendre direct, tant pis pour mon envie de l’avoir dans la bouche, ça attendra, j’ai aussi grave envie de l’avoir en moi.
Ce que j’ignore, c’est le fait que je me trompe lourdement quant à ses intentions : peu après, le bogoss cesse soudainement de me branler et d’agacer mes tétons.
Comme dans une image au ralenti, je croise son regard une dernière fois, avant que ses lèvres atterrissent dans le creux de mon cou et qu’elles commencent à déposer des bisous en descendant le long de la ligne médiane de mon torse ; peu à peu, ses épaules se dérobent lentement devant mes yeux, jusqu’à m’offrir une vue inédite, « aérienne », de ses beaux cheveux bruns en bataille.
Ses lèvres contournent désormais mon nombril, et ne cessent de descendre, encore et encore ; sa main a saisi ma queue une nouvelle fois, elle la branle doucement ; ses lèvres ont atteint mon pubis.
C’est là que l’impensable se produit : un frisson inattendu, bouleversant, affolant, troublant, me secoue de fond en comble, tout aussi bien dans le corps que dans l’esprit ; lorsque je suis surpris, percuté, assommé par un bonheur sexuel que je n’ai pas éprouvé souvent encore dans ma vie, celui provoqué par deux lèvres qui enserrent ma queue et d’une langue qui s’enroule autour de mon gland.
Je sens ses mains saisir fermement mes cuisses ; je baisse mes yeux et je regarde ma queue disparaître partiellement dans sa bouche et réapparaitre au gré des va-et-vient de ses beaux cheveux bruns.
L’étalon Jérémie Tommasi, qui ne prend son pied que par sa queue, est en train de me sucer, moi, le petit pd qui jusqu’à là n’avait que le droit de lui offrir ma bouche et mon cul pour son plaisir de mâle alpha.
Une nouvelle fois, j’ai besoin de tâter ses épaules et ses biceps pour me convaincre que je ne suis pas en train de rêver : c’est bien ça, Jérém est en train de me sucer, moi debout contre le mur à côté de la porte d’entrée, lui à genoux devant moi, comme je l’ai tant de fois été devant lui.
La chaleur de la cheminée réchauffe mon torse, mes bras, mon visage, sa bouche réchauffe ma queue, mon ventre. Je respire profondément, je sens l’air circuler dans me bronches, je sens le plaisir m’envahir, se diffuser dans chaque cellule de mon corps, envahir mon cerveau et mon esprit.
J’ai eu beau me dire par le passé que mon plaisir « de mec » était secondaire face au plaisir d’offrir du plaisir à mon bel étalon : il n’empêche que je prends un plaisir fou à me faire sucer par le même étalon.
Ce changement de position, de rôle, de plaisir, de point de vue, me bouleverse. Ce n’est pas la première fois que je me fais sucer : Stéphane m’a offert ce bonheur en premier, et Martin m’a fait une piqure de rappel le soir ou l’on a couché ensemble : mais là, là ça n’a rien à voir ; car – putain ! – là, c’est mon Jérém qui est en train de me sucer, mon Jérém, mon Jérém, mon Jérém !!! Et le bonheur est autant dans le plaisir purement sexuel que dans le fait que ce soit le gars que j’aime à le faire, tout en semblant prendre du plaisir à ce geste que je pensais impossible.
Certes, pendant la semaine magique, j’avais eu l’impression que déjà il avait voulu s’y lancer, avant de faire marche arrière, surpris et indisposé par mon regard : j’en étais même venu à penser que ce petit « incident » avait été le début de la fin de cette semaine magique ; mais là, j’ai vraiment l’impression que nos seulement il a vraiment envie de me faire plaisir, mais qu’il se laisse aller à ses envies, qu’il les assume, qu’il assume qui il est, enfin.
Ses va-et-vient, d’abord lentes, et d’une ampleur limitée, se font de plus en plus rapides, de plus en plus affirmés ; ma queue disparaît désormais complètement dans sa bouche et mon plaisir monte à grand pas ; un plaisir qui franchit un palier dangereux lorsque ses doigts viennent chercher mes tétons et les titillent de façon appuyée.
Submergé par le bonheur sexuel, j’ai envie de lui faire plaisir à mon tour, d’encourager son geste, de lui montrer à quel point ça me fait du bien. Mes doigts s’enfoncent dans ses cheveux bruns et humides, ils caressent son visage, son cou, arpentent ses épaules, ses pecs, jouent avec ses tétons ; je courbe le dos pour poser des bisous, en plus des caresses, sur ses beaux cheveux bruns.
Jérém me suce avec entrain, et c’est sacrement bon ; tellement bon que, pendant un court instant, je me surprends à me demander si ce talent est complètement inné ou bien s’il est le fruit d’une certaine pratique. Au fond, je sais qu’il a couché avec Thibault et il aurait bien pu découvrir ça avec son meilleur pote ; et puis, il y a les autres mecs, les inconnus qu’il a fait « couiner », comme il me l’a balancé lors de la dernière fois qu’il est venu chez moi, avant que je lui mette mon poing dans la gueule.
Est-ce que, entre une pipe et une baise avec l’un ou l’autre des bomecs qu’il a pu se taper, il aurait eu envie de goûter à cela, de découvrir la sensation de tenir le plaisir d’un gars dans la bouche ?
L’idée qu’il ait pu coucher avec un autre garçon, qu’il ait pu faire ça avec un autre garçon, m’est particulièrement insupportable, bien plus insupportable que l’idée de l’imaginer avec une fille.
Mais le plaisir que mon bobrun est en train de m’offrir est si bouleversant que j’oublie très vite mes états d’âme ; j’enferme ma jalousie dans une pièce de mon cerveau pour profiter du bonheur présent, tout en me disant que j’aurai le temps plus tard pour me poser des questions et pour poser des questions.
Mais pour l’instant, je décide – car, de toute façon, je ne peux faire autrement – de m’abandonner pleinement au bonheur des sens. Et mon abandon est si total que je sens très vite monter les signes annonciateurs de l’orgasme.
« Attend, Jérém… » je tente de le prévenir.
« Tu aimes ? » fait-il en se dégageant de ma queue. Je capte son regard, le bobrun a l’air bien émoustillé.
« Grave… et… toi ? » je balance, fou d’excitation.
Décidemment, le fait de voir mon Jérém à genoux devant moi, en train de me branler, est quelque chose qui me fait halluciner.
Pour toute réponse, le bobrun recommence à me sucer de plus belle.
« Attend, Jérém… si tu continues, je vais jouir… ».
Mais le bobrun ne semble pas faire cas de mes mots, il continue à me pomper comme s’il voulait que ça arrive. Mon corps a envie de jouir, mais me tête s’y oppose ; j’ai envie de le sucer à mon tour, j’ai trop envie de le sucer. Mais en même temps, j’ai tellement envie de jouir : sacré nouveau dilemme…
Finalement, l’envie de l’avoir en bouche se révèle plus violente que celle de jouir dans la sienne ; aussi, même si mon Jérém semble tout à fait devenu un autre Jérém, au fond de moi j’ai toujours peur qu’il n’assume pas à postériori ce que, dans l’excitation d’un instant, il semble pourtant prêt à s’autoriser. Mais avant tout, le fait est que j’ai rudement envie de l’avoir dans ma bouche…
Je glisse mes mains sous ses aisselles et j’amorce le mouvement pour le faire relever. Le bogoss oppose d’abord une petite résistance, mais finit par céder face à ma détermination. Il se relève, il me regarde droit dans les yeux ; je l’embrasse, avide de profiter de ce bonheur, alors que j’ai toujours du mal à croire que cela soit enfin possible.
Un instant plus tard, je l’attrape par la main, je l’entraine en direction du lit ; d’un simple geste de la main, je l’invite à s’y allonger : le bogoss se laisse tomber lourdement sur le matelas, le regard fripon, canaille. Il est beau à en perdre la raison.
Un mois, un mois entier que je n’ai pas eu mon Jérém dans la bouche ; et ce Jérém, à fortiori ce nouveau Jérém qui me montre à quel point je compte pour lui, j’ai besoin de le pomper pour le faire jouir : c’est un besoin impérieux, presque vital.
Je monte sur le lit à mon tour, je m’allonge sur lui, le contact avec son corps – torse contre torse, bassin contre bassin, sexe contre sexe – me fait un bien fou : je sens sa queue frémir au contact avec la mienne à travers le tissu fin de son boxer, je tente de glisser le long de son torse pour aller honorer sa virilité ; mais ses mains m’en empêchent ; elles attrapent mes hanches, me font basculer sur le flanc : et je me retrouve ainsi allongé sur le matelas à la place de Jérém.
Le bogoss est désormais allongé sur moi, nos visages sont à tout juste dix centimètres l’un de l’autre, je sens son souffle sur mes joues, sur mes yeux ; Jérém ne parle pas, je ne parle pas non plus ; il me regarde et je le regarde, son désir est palpable, le mien est brûlant. Sa beauté masculine et son parfum me font vaciller. J’ai envie de l’embrasser. Je plie mon cou, j’avance mon visage pour approcher mes lèvres des siens, mais le bogoss me plaque contre le matelas, il relève sa tête, il sourit, il se dérobe. Petit con, va ! Sexy, adorable, amoureux, joueur, petit con !
Ma respiration est de plus en plus rapide, mon excitation de plus en plus insoutenable, mon désir ravageur : j’ai envie de lui, et plus rien d’autre ne compte.
Jérém baisse lentement la tête, jusqu’à ce que sa chaînette effleure la peau de mon cou ; je ne peux résister à la tentation d’attraper quelques mailles et de m’en servir pour l’attirer vers moi, pour rapprocher nos visages. Le bobrun se laisse faire et lorsque nos lèvres se rencontrent, il m'embrasse comme fou, comme ivre, ivre de moi ; tout comme je le suis, ivre de lui.
Ses bras m’enlacent et m’enserrent très fort contre lui ; je l’enlace et l’enserre très fort à mon tour, enivré par son parfum, fou de lui. Plus rien n’a d’importance à présent, ni la frustration de quatre mois de révision où souvent je me suis senti rien de plus que son vide-couilles, ni la violence de ses mots et de ses actes des dernières fois qu’on s’est vus avant l’accident, ni ma souffrance depuis un mois, ni ma peur panique de le perdre pour de bon lorsqu’il était dans le coma. Définitivement, je n’ai jamais été si heureux de ma vie.
Voir un petit macho comme Jérém, jusque-là si retranché derrière ses tabous, ses interdits, ses conditionnements, le voir laisser enfin tomber ses barrières, se débarrasser de sa carapace ; le voir faire non pas un pas, mais des dizaines de pas vers moi, et tous en même temps ; le voir faire ces pas après m’avoir laissé désespérer que cela puisse arriver un jour : à mes yeux, cela ressemble à un miracle, à un bonheur qui n’a pas d’égal.
Lorsque Jérém relâche son étreinte, j’arrive à le faire basculer sur le flanc à mon tour, et à me retrouver à nouveau allongé sur lui. Je suce ses tétons, je lèche chaque millimètre carré de la peau de son torse, je descends vers ses abdos, je trace en direction de sa queue ; son bassin est toujours habillé de ce magnifique boxer rouge et blanc, boxer outrageusement déformé par une érection imposante ; je glisse mon nez sur le coton tendu et je retrouve cette odeur délicieuse et familière, son odeur de jeune mâle.
Jérém est désormais installé dans cette position que je trouve sexy par-dessus toutes, la position accoudée, le buste légèrement relevé ; le bogoss est en train de mater mes mouvements, l’air visiblement impatient de me mater en train de le sucer.
Un instant plus tard, mes lèvres, ma langue se relaient pour agacer son gland par-dessus le coton fin du boxer. Un mois, que je ne l’ai pas dans la bouche ; alors, c’est presque une nouvelle, première fois. Ainsi, j’ai à la fois envie de découvrir au plus vite sa queue magnifique et de prolonger cet instant le plus longtemps possible.
Le bobrun frissonne d’excitation. C’est à la fois avec impatience et avec une douceur extrême que je libère la bête tapie sous le coton doux.
Putain, qu’est-ce qu’elle est belle ! Ces retrouvailles sont d’autant plus intenses que, pendant un mois, et jusqu’à encore 24 heures plus tôt, j’avais désespéré qu’elles arriveraient un jour.
Alors, je commence à le pomper avec un bonheur indescriptible. Sous les assauts de ma langue et de mes lèvres, je sens mon Jérém vibrer de plaisir.
J’ai envie de lui faire plaisir comme jamais, j’ai envie de marquer le coup pour fêter nos retrouvailles, et pour fêter ce nouveau, merveilleux Jérém : j’avale sa queue bien au fond de ma gorge, car je sais à quel point il aime ça. Je l’entends respirer de plus en plus profondément ; je veux le faire jouir, j’ai envie de sentir se giclées puissantes et chaudes dans ma bouche.
Pourquoi ce mec m’inspire cette furieuse et violente envie de le pomper jusqu’à le faire jouir dans ma bouche ? Peut-être parce que c’est une bombasse de chez bombasse, un petit con sexy à mourir ; ou bien parce que je l’aime, et que le fait de le faire jouir, est désormais moins une façon de jouir moi-même qu’une façon de penser à son bonheur à lui.
Très vite, je sens que je ne vais pas tarder à avoir son jus de mâle dans ma bouche. Mais le bogoss a d’autres projets en tête : ses mains saisissent mes épaules, m’invitent à changer de position ; je me laisse faire, impatient de découvrir ce dont il a envie.
Oui, quand l’amour est là, les gestes s’enchainent avec un naturel, une coordination, une harmonie, une complicité étourdissantes.
C’est ainsi que je me retrouve tête bêche avec mon bobrun. A nouveau il me prend dans sa bouche et il entreprend de me sucer ; alors, c’est tout naturellement que je recommence à la pomper à mon tour.
La pluie tombe dehors, le feu crépite dans la cheminée, et je suis en train de faire un 69 avec mon Jérém, notre premier 69 : à cet instant précis, il n’y a plus d’actif ou de passif, de soumis ou du dominant ; il n’y a que deux mecs qui ont envie de faire plaisir à l’autre, de se faire du bien, parce que le plaisir de l’autre décuple leurs plaisirs respectifs.
Là encore, c’est tellement bon que, très vite, je sens approcher le point de non-retour de ma jouissance.
« Attends Jérém… ».
« Tu aimes ? ».
Qu’est-ce que j’aime cette façon de me demander si j’aime, comme pour se rassurer.
« Oh, que oui… ».
Et le bogoss recommence à me pomper.
Mais qui est donc ce beau garçon déguisé en Jérémie ? C’est qui cet inconnu qui s’est glissé dans sa peau et qui est en train de me faire un truc de dingue, un truc que le Jérém que je connaissais auparavant serait bien incapable de me faire ?
« Je vais pas pouvoir me retenir longtemps… ».
« Moi non plus… ».
« T’as pas fait le con depuis un mois ? » je ne peux m’empêcher de lui demander, tout en continuant à le branler.
« J’ai toujours mis une capote… et… t… » fait-il, tout en continuant à me branler.
« Moi aussi, j’ai toujours mis une capote… » je le devance.
Je me sens rassuré, et j’ai envie de le rassurer à mon tour. J’ai envie d’aller au bout et j’ai envie qu’il aille au bout aussi, puisqu’il en a envie.
Je recommence à le pomper, et le bogoss en fait de même. Très vite, alors que je me sens perdre pied, j’ai l’impression d’être sur le point de partir vers des sommets de jouissance dont jusque-là je n’avais même pas soupçonné l’existence.
« Ah… ça vient… » je le préviens une dernière fois, moins pour le retenir que pour le prévenir, alors que ma jouissance échappe désormais à mon contrôle.
Lorsque mon orgasme explose, c’est tellement intense que ça en est presque douloureux ; et mon bonheur sensuel va s’envoler encore, pour atteindre des summums vertigineux, lorsque je ressens des giclées bien lourdes, chaudes, denses, nombreuses percuter ma langue, lorsque son jus remplit copieusement ma bouche, lorsque je ressens son goût de jeune mâle se répandre dans mon palais.
C’est une sensation qui me rend raide dingue, ce bonheur indescriptible de sentir qu’un peu de lui vient en moi, la sensation d’être envahi, fécondé par sa virilité, le bonheur de pouvoir goûter au nectar de sa jouissance, ce nectar exquis que j’avale par toutes petites gorgés, le savourant comme la plus précieuse des boissons. Qu’est-ce qu’il est bon ce jus de petit mâle, surtout après en avoir été privé pendant un mois !
Je n’arrive toujours pas à réaliser que Jérém vient de jouir dans ma bouche en même temps que je viens de gicler dans la sienne. Mais alors que je continue de lécher son gland pour capter la moindre trace de son goût de mec, Jérém se penche per dessus le bord du lit, il attrape un t-shirt qui traîne, le porte à la bouche et s’empresse de recracher mon jus.
Lorsque je me résous enfin à lâcher sa queue, Jérém s’allonge sur le lit, les bras pliés, les mains croisées entre sa nuque et l’oreiller, position dévoilant ses aisselles légèrement poilues ; des aisselles dégageant désormais, après l’orgasme, un bonne, intense odeur de mâle.
Je m’enivre des bonnes odeurs que dégage sa peau et je me blottis contre lui, je lui fais des bisous dans le cou, sur l’oreille. Sa main se pose sur mon torse et elle le caresse tout doucement ; par moments, nos lèvres se rencontrent, des bisous s’échangent.
Nous restons ainsi en silence pendant un petit moment, en train de récupérer de nos émotions.
« T’as aimé ? » fait Jérém à un moment.
« Oh oui, grave… et toi ? ».
« C’est fort… » il lâche spontanément.
« Le tien aussi, tu sais… » je fais, en rigolant.
Dans la cheminée, le feu a perdu d’intensité. Sans ajouter un mot, Jérém se lève et, dans son plus simple appareil, il part rajouter une bûche dans l’âtre. Puis, il s’accroupit devant le feu, il allume une cigarette, qu’il entreprend de fumer en silence.
Je ne peux résister à la tentation de le rejoindre, de m’accroupir à mon tour et de le serrer très fort dans mes bras.
« Ça faisait un moment que j’en avais envie… » il finit par lâcher entre deux taffes « pendant cette semaine où l’on se voyait chez toi, une fois j’ai failli… ».
« Je sais… »
« Quand j’ai croisé ton regard, je n’ai pas pu… ».
« Putain, j’aurais dû regarder ailleurs… » je tente de rigoler.
Mais le bogoss continue tout droit sur sa lancée :
« J’avais envie de savoir ce que ça fait… tu sembles prendre tellement de plaisir… ».
« Ah, oui, je prends un plaisir de fou… ».
« J’avais aussi envie de te faire plaisir… ».
Je suis touché, je le serre un peu plus fort dans mes bras.
« Et du coup, t’as aimé ? ».
« Je… je crois… oui… je crois que oui… » et, il ajoute : « c’est la première fois, tu sais… ».
Le feu commence à mordre dans la bûche que Jérém vient de rajouter, les flammes reprennent de la vigueur. Je ressens la respiration de Jérém par ma peau, elle est ample et régulière.
Il balance son mégot de cigarette dans le feu, il se retourne, il me prend dans ses bras, il pose de tendres bisous dans mon cou, avant d’envoyer ses lèvres à la recherche de miennes. Nous nous échangeons des de bisous doux et pleins de promesses.
« Je vais chercher du bois… » fait le bogoss, en se levant après m’avoir fait un dernier bisou.
Pendant que je le regarde s’habiller – passer le maillot des Falcons, le boxer, le short, le pull gris à capuche, les chaussures – sa dernière phrase retentit dans ma tête : « je vais chercher du bois » ; je le regarde sortir dans la nuit tombante, sous la pluie, et j’ai l’impression de vivre un instant dans la vie d’un couple qui serait le mien, le nôtre, avec un mec qui s’occupe de moi, de mon confort, un mec dont je pourrais m’occuper à mon tour.
Jérém revient avec les bras chargés de bûches fendues qu’il dépose dans un coin de la cheminée pour le faire sécher ; puis, dans la foulée, il ôte ses chaussures, se déshabille à nouveau, sa plastique de fou se dévoile ainsi comme un nouveau et assommant coup de gifle. Il me rejoint au lit, me prend dans ses bras, et me fait plein de bisous dans le cou. Sa barbe me chatouille un peu, mais c’est tellement bon.
« Tu as dit quoi chez toi, pour venir ici ? » il me lance, de but en blanc.
« Que je venais te voir… ».
« Ils… savent… ? ».
« Oui, ma mère sait tout… le soir où elle t’a vu, je lui ai tout dit… ».
« Je n’ai pas dû faire une très bonne impression l’autre jour… ».
« Elle se souvenait de toi… ».
« Ah, oui, du mec à moitié à poil qui a mis du sang partout sur son carrelage… ».
« C’est clair que c’est pas vraiment de cette façon que j’avais imaginé mon coming out… mais peu importe, c’est fait, et c’est une bonne chose… en plus, ça s’est très bien passé… ».
« T’as de la chance… ».
« Oui, j’ai une mère géniale… ».
« Moi, la mienne, je ne sais même pas où elle est… ».
Ses mots, et encore plus l’écho de la note de tristesse avec laquelle il vient de les prononcer, résonnent en moi et me rendent triste pour lui.
« Ça fait longtemps que tu ne l’as pas vue ? ».
« Oui, très longtemps… ni vue, ni même des nouvelles… je pense qu’elle a oublié qu’elle a deux fils… ».
« Et ton père ? ».
« Je crois qu’il me cracherait dessus s’il savait… ».
« T’es vraiment sûr ? ».
« Oh, oui, sûr et certain… déjà que rien de ce que je fais trouve grâce à ses yeux… ».
« Mais quand-même… tu es un champion au rugby, tu as eu ton bac, tu as commencé à bosser… ».
« Il s’en tape… on s’est tellement pris la tête à cause de sa pouffe… on n’a plus rien à se dire… ».
« Il doit quand même être fier de toi maintenant que tu pars à Paris en pro… ».
« Je ne sais pas… ».
« Moi je crois que oui… ».
« Pourquoi tu dis ça ? ».
« Le jour de l’accident, je suis venu à l’hôpital… ».
« Tu es venu le dimanche ? ».
« Oui, Thibault m’a appelé… ».
« Ah, ok… ».
« Et ton père parlait de ta future carrière à Paris… il disait que tu avais tout pour être heureux… ».
« Il n’en sait rien de ce qui me rend heureux… je n’ai pas eu le moindre coup de fil ou le moindre sms avant l’accident… et même à l’hôpital, il ne m’en a pas parlé… par contre, il ne s’est pas privé de me balancer dans la tronche des réflexions sur le fait que je me suis fait taper sur la gueule… ».
« Ah, quand-même… ».
« Mon père est quelqu’un de très rude… ».
« Et ton frère ? ».
« Maxime est un petit gars génial… ».
« Il faut que je te dise un truc, Jérém… ».
« De quoi ? ».
« A propos de Maxime… ».
« C'est-à-dire ? ».
« Je suis revenu à l’hôpital dans la semaine… j’étais tellement mal de te voir sur ce lit, branché de partout, j’avais la peur au ventre que tu ne te réveilles pas… je me suis assis à côté de toi, j’ai attrapé ta main et j’ai commencé à te parler… ».
« Je crois que je me suis rendu compte que tu étais là… ».
« Tu as entendu ce que je t’ai dit ? ».
« Je ne sais pas… je n’ai pas de souvenirs précis, juste des sensations… mais je sais que tu es venu, je le savais dès mon réveil… ».
« Ce jour-là, ton frère est arrivé lui aussi dans la chambre… mais avant que je me rende compte qu’il était là, je crois bien qu’il a eu le temps de voir que je tenais ta main… et même d’entendre ce que je te disais… il a vu que j’étais vraiment pas bien, et il été super gentil… après, il m’a posé des questions… je crois qu’il sait… pour nous… ».
« Oui, il sait… » fait Jérém, l’air sûr de lui.
« Il sait ? ».
« Après t’avoir quitté, j’ai tout foiré… j’allais mal, je déconnais méchamment… un soir, Maxime est venu me voir à la brasserie, à la fermeture… nous avons passé la nuit à discuter… ».
« Tu lui as dit quoi ? ».
« Je lui ai dit que j’étais perdu, que je ne savais plus où j’en étais… il a insisté pour savoir ce qui se passait… je lui ai dit que depuis quelques mois il se passait un truc avec un camarade de classe, mais que je n’arrivais pas à l’assumer… alors, quand il t’a vu à l’hôpital, il a dû faire le lien, et il a compris que ce camarade, c’était toi… ».
« Il t’en a parlé, après ? ».
« Oui, quand je suis sorti de l’hôpital… il m’a dit « texto » que si je t’appelais pas, j’étais vraiment très con… ».
« Ah, oui, il est vraiment génial ton frérot… ».
« Je te le fais pas dire… parfois, j’ai l’impression que c’est lui l’ainé… il a une vision tellement positive de la vie… il est tellement cool… ».
« Pas tout le temps, quand-même… ».
« Pourquoi tu dis ça ? ».
« Si tu l’avais vu comment il était inquiet pour toi, le dimanche à Purpan… ».
« Mon petit frérot… il a dû avoir la trouille… ».
« On avait tous très peur, mais Maxime était au bout de sa vie… ».
« Il est vraiment adorable… ce qui me fait chier dans le fait de partir à Paris, c’est que je le verrai beaucoup moins… ».
« Ce qui me fait chier, dans le fait que tu pars à Paris, c’est que je te verrai beaucoup moins… ».
« Je sais, moi c’est pareil… ».
Je suis touché, je ne peux résister à la tentation de lui faire à nouveau des bisous.
« Je suis désolé pour tout le mal que je t’ai fait… ».
« Si c’était le prix pour se retrouver ici, de cette façon, ça en valait le coup… ».
« Je me suis vraiment, vraiment comporté comme un con… ».
« Peut-être un peu, oui… » je tente de rigoler.
« Je suis désolé de t’avoir cogné… » il continue sur sa lancée, me faisant plein de bisous sur le visage.
« Je t’ai cogné en premier… ».
« Mais moi, je l’ai bien mérité… ».
« Je suis désolé quand-même… ».
« Tu peux » fait-il, en changeant radicalement de ton, en devenant soudainement taquin « et tu m’as pas raté… tu m’as décroché un putain de droit, je ne te raconte même pas… ».
« J’ai été nul… ».
« Ah, non, justement… je me suis battu quelque fois, j’ai donnée des coups et j’en ai reçus… mais putain, le tien c’était pas un droit de pd… enfin… si… mais c’était vraiment puissant ! Je ne pensais pas que tu avais tant de force… et surtout, je ne croyais pas que tu aurais le cran… ».
« J’aurais dû me maitriser… ».
« Non, au contraire… je crois que j’avais envie de te pousser au bout, de voir ce que tu avais dans le ventre… et je n’ai pas été déçu… ».
« T’es vraiment qu’un petit con… ».
Pour toute réponse, il me balance l’un de ses sourires incendiaires au charme incandescent ; un instant plus tard, il se glisse sous les draps, il me fait plein de bisous sur le torse.
Lorsqu’il en ressort, il est tout ébouriffé, souriant, heureux ; il est beau, il est adorable, il a l’air d’un chiot qui a envie de jouer, de câlins, de tendresse, d’un petit gars avec un immense besoin de douceur.
Mais, très vite, je me rends compte que le petit gars bande, tout comme je bande : nos désirs, nos corps et nos regards font des étincelles, lorsqu'il se frôlent, tout simplement. Alors, faire plaisir à mon bomâle brun devient un besoin presque vital.
Un instant plus tard, Jérém est allongé sur le dos ; et pendant que je le suce à nouveau, ses mains saisissent et caressent tour à tour mes bras, mes épaules, mes cheveux ; ses doigts chatouillent mes tétons, et il m’excite à mort. Plus je lui fais plaisir, plus il me fait plaisir ; plus il me fait plaisir, plus j’ai envie de lui faire encore davantage plaisir. Je me fais violence pour quitter sa queue, mais je retrouve un nouveau bonheur en allant lécher ses couilles ; une petite digression que le bogoss semble toujours autant apprécier, si je m’en tiens à la façon dont il me demande de continuer, d’insister, tout en se branlant.
Jérém est fou de plaisir, et cela me donne envie d’utiliser la dernière carte, le Joker ultime pour le rendre fou ; j’écarte ses fesses et j’envoie ma langue donner l’assaut sa rondelle. Jérém frissonne de plaisir, il kiffe à mort ; il se branle de plus en plus vite et je suis fou à l’idée qu’il ne va pas tarder à jouir, et que sa jouissance va être délirante.
Mais là encore, le bogoss a d’autres projets : un instant plus tard, nos corps se remélangent, nos envies se recombinent, nos gestes s’enchaînent comme dans une sorte de ballet d’amour.
Notre complicité sensuelle est totale : les gestes, la joie des corps et des esprits, le plaisir, le bonheur, tout est si naturel, en harmonie parfaite, lorsque l’amour est là.
Me voilà allongé sur le ventre, vibrant sous l’effet de ses mains qui empoignent et écartent mes fesses, me voilà frémissant sous les assauts pleins de fougue que sa langue donne à ma rondelle.
Et lorsque cette même langue remonte le long de ma colonne vertebrale, et que ses baisers dessinent un lent chemin de plaisir depuis mes reins jusqu’à mon cou, puis à mes oreilles, voilà que ma peau devient la source de mille frissons qui font vibrer mon corps et mon esprit à l’unisson.
Jérém est désormais complètement allongé sur moi : son corps chaud et musclé m’enveloppe, sa queue raide se cale entre mes fesses, son gland envahit ma raie, comble mon trou excité ; ses lèvres, sa langue chatouillent mon oreille, je ressens son souffle brûlant sur ma peau, chargé de testostérone et d’envies de mâle.
Ses doigts se sont glissés sous mon torse pour aller exciter mes tétons. Le bogoss connaît toutes les touches de plaisir de mon corps, et il s’en sert pour jouer une mélodie du plaisir envoutante.
Je suis dans un état d’excitation dément, j’ai l’impression que je pourrais jouir d’un moment à l’autre. Mais je ne le veux pas : ce que je veux, c’est qu’il vienne en moi ; ce que je veux, c’est de le voir, le sentir, l’entendre prendre son pied en moi ; ce que je veux, c’est le savoir jouir en moi.
J’ai envie, j’ai besoin qu’il me remplisse de son jus de mâle ; c’est une envie qui n’a jamais été aussi intense qu’à cet instant précis ; car, si j’ai longtemps eu envie que le « petit con Jérém » me remplisse de sa semence, aujourd’hui, j’ai 100, 1000 fois plus envie encore de m’offrir à ce nouveau Jérém, si adorable, si touchant.
« T’en veux encore ? ».
Je ne sais pas exactement de quoi il parle, lorsqu’il le demande si j’en veux encore, mais je suis prêt à lui signer un chèque en blanc, tant tout ce qu’il vient de me faire, alors qu’il n’est même pas encore venu en moi, est délirant :
« Oui… oh, oui… ».
Un instant plus tard, je sens ses pecs glisser lentement et délicatement le long de mon dos, ses lèvres et sa langue redescendre le long de ma colonne vertébrale, ses mains puissantes empoigner et écarter à nouveau mes fesses. Sa langue retourne titiller mon petit trou, elle alterne des assauts pleins de fougue et d’autres plus en douceur, il me fait languir, il me rend fou.
Jusqu’à ce que, brûlant à la fois de plaisir et de désir encore inassouvi, j’entende chacune de mes fibres, chacune de mes pensées crier :
« J’ai envie de toi, Jérém, prends-moi ! ».
Un cri qui est au bout de mes lèvres, mais que le bogoss ne me laisse pas le loisir de lancer : soudainement, il délaisse ma rondelle, il s’allonge à nouveau sur moi de tout son poids, et il cale à nouveau sa queue raide entre mes fesses.
« J’ai envie de toi » je l’entends chuchoter dans un état second, la voix saturée d’excitation et de désir.
C’est la première fois que je l’entends me dire ces mots. J’ai envie de pleurer de bonheur, bonheur des sens, du corps, de l’esprit, de l’amour.
« Moi aussi j’ai envie de toi ! » je ne peux plus m’empêcher de lui lancer, ivre de lui.
Lorsque je sens à nouveau ses mains saisir et écarter mes fesses, je suis fou ; lorsque je ses ses lèvres enduire ses doigts de salive, puis ces derniers venir en déposer à l’entrée de mon trou, je ne reponds plus de moi-même ; lorsque je sens son gland viser ma rondelle, se presser doucement mais inéxorablement dessus, je suis déja dans une autre dimension ; lorsque je le sens glisser lentement en moi, me pénétrer tout en douceur, tout en me faisant des bisous dans le cou et en caressant mes tétons, je perds ma raison.
Et lorsque je sens le bogoss s’arrêter bien au fond de moi, enfoncé jusqu’à la garde, lorsque je le sens frémir de plaisir, avant de commencer à me faire l’amour, je me sens rempli, comblé, possédé. Et aimé.
« Ce petit cul… » je l’entends chuchoter, la voix frémissante d’excitation et de bonheur palpable.
« Cette queue d’enfer… tu me fais un effet de fou… ».
« Toi aussi tu me fais un effet de dingue… ».
Et, ce disant, le bogoss commence à coulisser en moi, tout en douceur. Peu à peu, ses va-et-vient gagnent en puissance, sans pour autant perdre en douceur ; tour à tour, il saisit hanches, puis mes épaules, son torse enveloppe mon dos, ses doigts agacent mes tétons.
Jérém respire fort, il ahane de plaisir ; je couine mon plaisir, sans ménagement. Nous n’avons pas de voisins, nous pouvons nous lâcher.
« Tu prends ton pied ? ».
« Oh, oui, Jérém, je prends mon pied, j’adore ce que tu me fais, tu me rends dingue… ».
« Toi aussi tu me rends dingue… » il chuchote, la voix déformée par le plaisir montant.
Et là, il arrête net ses va-et-vient, il se déboite doucement de moi ; ses mains saisissent mes hanches, elles amorcent le mouvement pour me retourner ; je me laisse faire, je seconde son intention, impatient de le suivre n’importe où ses envies veuillent bien m’amener.
Jérém s’allonge sur moi, il me regarde dans les yeux, le regard tendre, adorable ; et il me balance, la voix calme, douce :
« J’ai envie de te regarder pendant que je te fais l’amour… ».
J’ai envie de pleurer tellement ce qu’il vient de dire est beau.
« Moi aussi j’ai envie de te regarder pendant que tu me fais l’amour, j’en ai eu envie le premier jour où je t’ai vu… ».
Jérém me fait un bisou, puis il relève son buste ; son torse – pecs saillants, abdos sculptés, carrure, musculature – se dresse devant moi dans toute sa puissance, et me donne le tournis.
A chaque fois que j’ai eu la chance de coucher avec cette méga bombasse, je me suis toujours demandé comment je pouvais avoir une telle chance ; et cette sensation je la retrouve aujourd’hui, plus forte que jamais, après un mois où je n’ai pas pu l’avoir en moi, après que j’aie cru que plus jamais je ne l’aurai en moi.
Jérém glisse un oreiller sous mes fesses ; puis, il saisit mes cuisses, il m’attire contre son manche tendu, et il revient doucement mais inexorablement en moi. Lorsqu’il reprend ses va-et-vient, mon plaisir devient délirant.
Le plaisir de le sentir coulisser entre mes fesses se combine avec le plaisir de l’odorat – l’odeur de sa peau et de son déo, l’odeur de sa virilité.
Mais il a aussi avec le plaisir de la vue : mon regard tente d’absorber chaque détail de cette bogossitude renversante qui est la sienne – cheveux bruns en bataille et encore humides, peau mate, traits beaux et virils, brassard tatoué, motif tribal le long de l’épaule remontant le long de son cou jusqu’à son oreille, chaînette de mâle ondulant au gré de ses coups de rein, petit grain de beauté dans la creux de son cou puissant ; je le regarde, les yeux aimantés sur les abdos animés par ses coups de reins puissants, la tête et les épaules légèrement en arriéré ; la position, les mouvements, combinés à la lumière mouvante de la flamme, font ressortir d’une façon encore plus spectaculaire le relief de ses pecs, l’envergure de ses épaules, le dessin de sa carrure, la puissance de sa musculature.
Oui, pendant qu’il me fait l’amour, sa plastique, tout comme sa virilité, sont plus impressionnant que jamais ; je suis en train de faire l’amour avec un mâle à la fois doux et viril, c’est un mélange explosif, un mélange qui va me rendre dingue. Un mélange qui me rappelle Stéphane. Et Thibault. Pourtant, c’est mon Jérém à moi…
Combien de chemin parcouru depuis la première « révision » en mode macho qui veut juste se vider les couilles, qui ne pense qu’à son plaisir – une attitude de petit macho certes hyper excitante – mais qui n’est pas grand-chose au final en comparaison avec celle du nouveau Jérém qui ne veut plus juste prendre son pied en moi, mais prendre son pied avec moi.
Le bogoss ahane de plus en plus fort, son regard semble se perdre de plus en plus loin dans cette dimension à part qu’est la montée du plaisir masculin. Je sens, je sais qu’il ne va pas tarder à jouir, en moi.
Pourtant, à un moment, contre toute attente Jérém arrête net ses va-et-vient et, sans se dégager de moi, il s'allonge sur mon torse, la respiration profonde, bruyante, le corps frissonnant, presque tremblant.
« T’as joui ? ».
« Non… je me retiens… ».
« Tu veux pas jouir ? ».
« J’ai le droit ? ».
« Mais bien sûr, vas-y… j’en ai tellement envie… »
« Moi aussi j’ai très envie… ».
« Vas-y alors… ».
« Je veux juste te faire plaisir… encore un peu… ».
« Si tu savais à quel point tu m’as déjà fait plaisir… tu m’as jamais fait l’amour comme ça… jamais… lâche-toi, Jérém, fais-toi plaisir… ».
« C’est tellement bon… » il susurre.
« Ah, oui, grave ! ».
Puis, le bogoss soulève son torse, il me regarde dans les yeux, il passe sa main dans mes cheveux ; il revient me faire un dernier bisou, juste avant de se relever, d’offrir une nouvelle fois à mon regard ébahi la vision spectaculaire de son torse de malade, la vision d’un jeune mâle s’envolant tout seul, vers les sommets de son plaisir de mec. Jérém recommence à envoyer ses coups de reins, tout en me branlant en même temps. Je vibre de plaisir et de bonheur, je vibre avec mon Jérém. Je voudrais que cet instant ne s’arrête jamais.
Mais mon corps n’est pas aussi fort que mon esprit.
« Je vais jouir… » je le préviens en sentant arriver le point de non-retour.
« Moi aussi… » fait-il, la voix et sa belle petite gueule déformées par la montée de l’orgasme.
Un instant plus tard, je jouis, une première giclée atterrit dans le creux de mon cou ; et pendant que mes jets s’enchaînent, atterrissent partout sur mon torse, et même à côté, je vois ses abdos se contracter, je vois tout son corps secoué par la vague de plaisir. Se coups de reins ralentissent, et à chaque fois il s’enfonce en moi jusqu’à la garde ; sa bouche entrouverte émet une succession de râles puissant de mâle, chacun d’entre eux étant la notification d’une giclée brûlante qu’il est en train d’envoyer en moi.
Nous venons de faire l’amour et de jouir ensemble ; ainsi, nos jouissances s’éteignent au même moment. Jérém s’abandonne sur moi, tremblant, la respiration agitée. Quant à moi, j’ai l’impression que je n’ai jamais joui aussi fort.
Depuis que j’ai commencé à réviser avec Jérém, j’ai toujours considéré que la jouissance de ma queue était un détail insignifiant de nos rencontres sexuelles ; un détail tellement insignifiant qu’on pouvait très bien ne pas le prendre en compte ; le peu de fois que j’ai joui avec ma queue en me faisant baiser par Jérém, j’ai toujours considéré que ma vraie jouissance avait été avant, dans le fait de l’avoir en moi, de le voir et de le sentir jouir en moi. Son plaisir à lui devenait mon plaisir à moi ; il jouissait comme un mec, je me donnais à lui pour qu’il puisse exprimer toute la puissance de sa virilité, car j’avais envie de voir s’exprimer le mâle, le lion qui était en lui. Je voulais qu’il se rende compte à quel point il me faisait jouir avec sa queue, juste en visant son propre plaisir de mec ; je voulais le savoir fier de me faire jouir ainsi, fier de sa queue.
Mais aujourd’hui, dans cette petite maison en pierre nichée dans les montagnes, tout cela a changé : mon Jérém m’a fait l’amour comme jamais, nos plaisirs se sont mélangés, enlacés, et ils ne sont devenus qu’un seul, un but commun que nous poursuivions « main dans la main ». J’ai pris du plaisir à lui faire plaisir, mais lui aussi il a pris du plaisir à me faire plaisir.
Jérém se retire de moi, se penche sur le bord du lit, il attrape un t-shirt, le même que tout à l’heure, et m’essuie le torse ; puis, il me fait un bisou, il balance le t-shirt et se glisse sous les draps ; j’en fais de même ; le bobrun s’approche pour me prendre dans ses bras, je me retourne sur le flanc, de façon à ce que son corps puisse envelopper le mien ; nos corps se calent l’un contre l’autre, à la perfection. Jérém passe ses bras autour de mon torse, me serre très fort contre lui, il enfonce son visage dans le creux de mon épaule, il pose d’innombrables bisous tout doux et tout fous dans mon cou, dans le bas de ma nuque, sur mes épaules.
Dehors, il fait froid, il pleut toujours, le vent ronfle sur le toit ; mais dans la petite maison en pierre, le feu crépite bruyamment dans la grande cheminée ; et sous ce draps doux qui sentent bon la lessive, son corps irradie une douce chaleur, et il dégage une délicieuse odeur de jeune mâle, un énivrant mélange d’odeur de gel douche, de déo, de sexe, mais pas que : car, ce soir, son corps sent également l’amour.
Son goût persistant dans ma bouche, mon ventre et mon entrejambe retentissant de l’écho des coups de reins puissants de mon mâle, je me sens envahi par une intense sensation de bien-être. Son jus en moi me fait du bien, je suis groggy de sa testostérone, de sa virilité.
Dans ces draps, je ressens un doux apaisement du corps et de l’esprit : c’est un bien-être absolu, fait de chaleur, de douceur, de complicité, de sensation que rien ne peut m’arriver dans les bras musclés du garçon que j’aime.
Oui, la maison est petite, le lit n'est pas grand, mais mon bonheur, notre bonheur, est tellement immense que ça en donne le tournis.
Jérém me serre un peu plus fort contre lui, me fait un dernier bisou dans le cou ; et alors qu’une petite larme de bonheur glisse sur ma joue, je m’assoupis comme un bébé.
Joyeuses fêtes à vous tous !
 11 commentaires
11 commentaires
-
JN0203 Une route longue et sinueuse.
« Hey, mon pote, comment vas-tu ? ».
Le sms de Julien arrive à point nommé : peu après le coup de fil de Jérém, alors que je marche sur les Berges de Garonne, la tête et le cœur en vrac, incapable de trouver le chemin de la maison.
Inattendu. Bouleversant. Ce coup de fil m’a fait l’effet d’une bombe ayant explosé dans ma poitrine. Mon cœur s’est emballé dès l’instant où j’ai vu son numéro s’afficher à l’écran ; pendant la durée de nos échanges, j’ai été comme en apnée, les jambes tremblantes, une sorte de vertige altérant mes sens et mes perceptions.
Je viens de raccrocher et je me sens secoué, assommé, retourné comme une chaussette. J’ai chaud, j’ai froid, j’ai des sueurs, j’ai des frissons, j’ai l’impression de trembler, de flotter. J’ai beau marcher, je n’arrive pas à me calmer : sa voix, ses mots me suivent où que j’aille, ils me hantent.
Car chacun de ses mots m’a fait vibrer ; la vibration masculine et sensuelle de sa voix a fait remonter des souvenirs, des ressentis, des émotions, des sentiments, des images, des odeurs, des sensations : ce coup de fil a fait rejaillir en moi toutes les couleurs dont étaient composés mes espoirs de bonheur, tout un monde, un Paradis perdu.
Alors, oui, le sms de Julien est plus que bienvenu : un sms auquel je m’empresse de répondre, comme une bouée de sauvetage à laquelle je m’empresse de m’accrocher :
« Salut, dispo pour un verre maintenant ? ».
« Ds 15 min au Quinquina ».
Un quart d’heure plus tard, je suis installé à une table du Quinquina ; et je viens de réaliser que le Quinquina, c’est un bar gay. Je me demande si Julien est au courant de ce petit détail. Je regarde à nouveau son sms, et c’est bien marqué « au Quinquina ».
C’est la première fois que je mets les pieds dans un bar gay après la soirée au B-Machine. Définitivement, je ne suis toujours pas à l’aise avec ce genre d’endroit : j’ai toujours l’impression de ne pas être à ma place, l’impression qu’on me regarde comme un OVNI, l’impression de ne pas être « assez » : assez bien sapé (d’autant plus ce soir, où je n’avais pas du tout prévu de « sortir »), assez stylé, assez pd tout court. J’ai à la fois l’impression qu’on m’observe comme une bête rare, mais sans intérêt, ou qu’on me matte comme un nouveau gibier tout fraîchement découvert ; je redoute à la fois qu’on puisse m’ignorer, se moquer de moi, ou bien qu’on me propose un plan « à la Mourad », un coup sans lendemain, merci et « au revoir ». Je ne veux pas revivre ça.
Je croise quelques regards, mais je n’essaie pas de les accrocher. Je n’ai pas envie de tenter de savoir ce que ma présence inspire : c’est suffisamment le bordel dans ma tête, à cause du coup de fil de Jérém.
De toute façon je ne suis pas là pour tenter de draguer ; je suis là pour prendre un verre avec un pote, et pour me confier à lui. Mais qu’est-ce qu’il fiche Julien ?
C’est moins pour étancher ma soif que pour tenter de me donner une contenance, que je commande une bière blanche ; en attendant Julien, je commence à feuilleter une publication posée sur la table, une sorte de brochure détaillant le Toulouse Gay ; page après page, elle recense les lieux où sortir, les évènements gay friendly du moment ou à venir ; on y trouve également des appels à la sensibilisation pour la prévention de MST, avec les lieux où se faire dépister, ainsi que des petites annonces de rencontre entre garçons.
Quelques instants plus tard, l’arrivée de Julien ne passe pas inaperçue, pas du tout, car elle a des allures d’entrée en scène de rockstar : le boblond est habillé d’un t-shirt blanc de marque, un petit bout de coton fin bien ajusté à son torse musclé ; il porte un short bleu mettant en valeur son magnifique fessier ; il arbore un brushing canaille, les cheveux courts autour de la nuque, beaucoup plus longs au-dessus, rabattus vers l’arrière et fixés avec une profusion de gel, une barbe blonde de plusieurs jours ; et, touche de maître, il porte l’accessoire qui tue et qui séduit : des grandes lunettes de soleil (il faut un sacré culot pour oser les lunettes noires, alors qu’il fait nuit).
Mais aussi, et surtout, il débarque, il avance, il fonce vers moi avec sa dégaine, sa démarche, son allure, son attitude de mec très sûr de lui et de son charme, il fonce en mode conquérant, se mouvant avec aisance dans l’épais faisceaux de regards et de désirs qui essaient de le retenir comme autant de fils invisibles.
Oui, l’arrivée de Julien au Quinquina est du genre plutôt remarquée, car le bogoss dégage un charme et une sexytude presque palpables : sa présence attire et aimante les regards, et les têtes se tournent sur son passage. L’arrivée de Julien me fait penser à l’arrivée de Jérém au On Off, le soir où il m’y avait embarqué, le même soir où il avait également embarqué le bobarbu Romain.
Lorsqu’il arrive près de moi, il relève les lunettes au-dessus de la tête, il dégaine un sourire à faire fondre la banquise en 10 secondes chrono, et se penche pour me faire la bise. Son parfum de mec percute mes narines comme un coup de fouet : ah, putain, qu’est-ce qu’il sent bon ! Quand je pense que j’ai fait toutes mes leçons de conduite assommé par ce parfum, et par ce sourire : je ne sais pas vraiment comment j’ai réussi à me concentrer sur les cours.
« Alors, c’était quoi cette urgence de prendre un verre ? » il me lance à la cantonade.
« T’es au courant qu’ici c’est un bar gay ? ».
« Oui, monsieur… ».
« Tu vas attirer l’attention… ».
« C’est déjà le cas… ».
« C’est la première fois que tu viens dans un bar gay ? ».
« Non, je viens trois fois par semaine… » il se moque.
« Je croyais que t’étais hétéro… ».
« Et tu as raison de continuer à le croire… mais oui, c’est la première fois… j’avais envie d’avoir un nouveau public… ».
« T’as pas peur de te faire draguer… ? ».
« Je me suis dit que tu surveillerais mes arrières… ».
« Je pense que tu vas savoir faire tout seul… ».
« Bon, si tu me racontais ce qui t’arrive ? ».
En quelques mots, je lui raconte le coup de fil de Jérém, ses « presque excuses » vis-à-vis de son comportement à mon égard, son invitation à le rejoindre dans les Pyrénées, dès le lendemain ; et aussi mes réticences à envisager ces retrouvailles, après tout ce qui s’est passé, ma peur d’entendre ce qu’il a à m’annoncer, la peur de souffrir encore, la peur de rouvrir une plaie qui a déjà tant de mal à cicatriser.
Julien me laisse parler, sans m’interrompre, impassible, ses yeux coquins plantés dans les miens ; puis, après avoir bu une bonne gorgée de la bière qu’on vient de lui apporter, il me balance, les yeux dans les yeux :
« Mais ta gueule, Nico ! ».
« Quoi, ma gueule ? ».
« Mais putain, tu meurs d’envie d’y aller, ça crève les yeux ! ».
« C’est vrai… ».
« Alors, vas-y, putain ! Fonce ! ».
« Je ne peux pas, j’ai la visite pour l’appart à Bordeaux ce week-end… ».
« Tu t’en bats les couilles, tu appelles le proprio, tu inventes un bobard, et tu files voir ton rugbyman… ».
« Je ne peux pas faire ça… ».
« Putain, Nico… bien sur que tu peux faire ça ! Si tu es fou de ce mec comme tu le prétends, tu peux faire ça ! Tu dois y aller, tu DOIS y ALLER ! La vie, t’offre une occasion unique, ton mec te tend une perche monumentale, tu ne peux pas la laisser passer ! Parfois, il faut savoir forcer le destin, bon sang ! ».
Je sais que Julien a raison. Je savais ce qu’il allait me dire avant même qu’il ne débarque. Mais ça fait du bien de l’entendre.
« Attention, on va avoir de la visite… » me prévient discrètement Julien, les sourcils en chapeau, une étincelle bien coquine dans le regard.
« Bonsoir beau mec… ».
Sans que je l’aie vu venir, un mec vient d’approcher de notre table. Il est brun, plutôt fin, il a un beau visage, avec le charme intense de son âge, la vingtaine, un regard qui dévisage, ce petit con de Julien.
« Bonsoir » fait ce dernier, un sourire ravageur au coin des yeux, au coin des lèvres.
« Bonsoir… » je lâche à mon tour, juste pour signaler ma présence.
« Ah, oui, bonsoir… » il se rattrape maladroitement ; puis, il s’adresse à nouveau à Julien « t’as pas arrêté de me mater depuis que t’es arrivé… ».
« Tu veux dire plutôt que c’est toi qui n’a pas arrêté de me mater depuis que je suis arrivé… ».
« C’est exact… » avoue l’inconnu, tout en affichant un petit sourire fripon.
« Normal, je suis bogoss… » fait Julien, bomec et fier de l’être.
« Tu ne te la pètes pas un peu, avec tes airs de bogoss ? ».
« Oui, je me kiffe, je n’y peux rien… ».
« Moi aussi je te kiffe… ».
« Ça, j’avais compris… ».
« Alors, si tu veux qu’on aille faire un tour là-bas (l’inconnu plie la tête en direction de la porte des toilettes dans un coin de la salle), tu vas pas le regretter… ».
« Ça a le mérite d’être clair… ».
« Alors, tu en dis quoi ? ».
« Je dis non… désolé mon pote… je ne cherche pas des aventures avec des mecs… ».
« T’es qu’un allumeur, alors… ».
« Va voir ailleurs… » fait Julien.
« Ok, allez vous faire voir tous les deux ! » nous balance le mec, en repartant bredouille et un tantinet agacé.
« Tu l’avais vu venir ? » je demande à Julien.
« Il a commencé à me mater dès que je suis arrivé… mais je n’aurais jamais pensé qu’il aurait le cran de venir me brancher… surtout que je suis avec toi… ».
« Et toi, tu ne l’as pas un peu cherché ? ».
« Non, pas du tout… ».
« Tu parles… tu savais très bien en venant ici que tu ne serais pas passé inaperçu… ».
« Nico, promets-moi d’aller voir ton rugbyman… » il change de sujet « tu crèves d’envie d’y aller et tu as surtout besoin d’entendre ce qu’il a à te dire… ».
Définitivement, avec Julien, j’ai gagné un pote. Ses mots me portent pendant le trajet de retour vers la maison, alors que le vent d’Autan a repris à souffler de plus belle, secouant les cimes des arbres, brassant les feuilles mortes au sol.
Je me sens léger, j’ai envie d’envoyer un sms à Jérém pour lui confirmer ma venue ; pourtant, quelque chose m’en empêche : car, au fur et à mesure que je m’éloigne de Julien, une sorte de bataille commence à faire rage dans mon cœur.
D’un côté, il y a mon amour, cet amour qui fait que j’ai une envie folle de le revoir, de croire à la sincérité de ses mots, de croire aux promesses de cette voix privée de toute arrogance, de cette attitude si différente de celle que je lui connais, ponctuée par de touchantes hésitations ; de l’autre côté, il y a mon amour propre, celui qui a peur de replonger, celui qui ne veut retomber dans le piège de se créer de nouveaux espoirs, de nouvelles attentes que Jérém pourrait briser à la première occasion ; cet amour propre qui veut me protéger.
Lorsque je me réveille le lendemain matin, vendredi, le tiraillement entre mon amour et mon amour propre est toujours là, je ne sais toujours pas si je vais partir.
Il est 7h30 lorsque j’ouvre les yeux, puis les volets, et je découvre une journée grise et froide, un ciel de plomb d’où tombent des cordes.
Je reste longuement à regarder la pluie incessante, je passe la matinée à ressasser les mots de Julien, ainsi que les échanges, les émotions et les frissons provoqués par le coup de fil de Jérém.
Il est 11h37, lorsque la seule décision possible s’impose à mon esprit : je passe un coup de fil à Bordeaux, j’invente un bobard ; lorsque je raccroche, je prends mon courage à deux mains et je vais voir maman.
« Un pote m’a invité à aller le rejoindre chez lui ce week-end… » j’attaque droit au but.
« Mais il y a la visite de ton appart demain matin ! ».
« Je n’ai pas oublié, maman… j’ai appelé le proprio, et il accepte de me rencontrer vendredi prochain… ».
« Vendredi prochain, je ne sais pas si je pourrai t’amener… ».
« C’est pas grave, j’irai en train… ».
« C’est qui ce pote ? ».
« Un camarade de lycée… ».
« C’est celui que j’ai vu l’autre jour ? ».
« Oui, c’est lui… ».
« Jérémie, c’est ça ? ».
« Oui, c’est ça… ».
« Vous n’allez pas encore vous battre ? ».
« Non, j’espère pas… ».
« Et il est où ton pote ? ».
« A Campan… dans les Pyrénées… ».
« Je sais bien où est Campan… et c’est loin… et en plus, t’as vu le temps qu’il fait ? ».
« Je sais, je sais… mais je dois y aller… ».
« Tu n’as le permis que depuis quelques jours… tu te vois rouler pendant des heures sous la flotte ? ».
« Je roulerai doucement, je ferai attention… ».
« Tu es vraiment le fils de ton père, tu as le gène de l’imprudence bien développé quand il s’agit d’amour ! Mais tu as raison, tu dois y aller, autrement tu vas le regretter… tu pars quand ? ».
« Tout à l’heure, vers 15 h… je prévois large… ».
« On a bien fait de changer les pneus à ta voiture ! ».
« Merci maman… tu le diras à papa ? ».
« Oui, oui, je lui dirai… ».
« Merci ! ».
« Tu es vraiment fou de ce garçon, n’est-ce pas ? ».
« Oui, je crois… ».
« C’est un beau garçon… ».
« Oui… ».
Ma décision est prise, j’ai la bénédiction de maman, et dans 6 heures je vais retrouver Jérém ; je me sens soulagé, je me sens tellement « léger » que j’ai l’impression de flotter à un mètre au-dessus du sol.
Une heure plus tard, maman part travailler. Il est 13 heures, j’ai deux heures pour décider comment m’habiller pour aller retrouver le gars qui me fait tourner la tête et que je n’ai pas vu depuis un mois.
Je frémis, je bouillonne, je tremble, je ne tiens plus en place ; j’ai le ventre comme un tambour de machine en mode essorage, j’ai l’impression que tous mes sens sont en état d’hyper-sensibilité. Mon corps tout entier est parcouru par une sorte d’excitation insoutenable qui me donne des ailes et m’assomme tout à la fois.
Je me douche et je me rase, je passe un t-shirt blanc, puis une veste que j’ai achetée quelques jours plus tôt : c’est un blouson d’étudiant américain bleu foncé, avec les manches blanches ; je passe mon plus beau jeans, ainsi que des baskets noires qui remontent bien sur la cheville ; et je mets du gel dans les cheveux, comme ma cousine m’a appris à le faire.
Je me regarde dans le miroir, habillé sur mon 31, le brushing soigné, et je me trouve presque pas mal.
Je mets quelques affaires dans un sac et je descends dans le séjour : il est tout juste 14h30, j’attrape mon téléphone et j’envoie un sms à Jérém pour lui confirmer ma venue :
« Salut, c’est ok pour le week-end, je serai à Campan à 18h ».
Je n’arrive pas encore à croire que je vais rejoindre Jérém à 200 bornes de là, car il m’y a invité.
Mais les minutes passent et mon sms reste sans réponse. Est-ce qu’il capte, là-haut ?
15 heures : il est temps de partir. Je ferme la maison, je glisse mon sac dans la voiture, je m’installe devant le volant et je tourne la clef. Et là…
Et là, le bruit étouffé du démarreur envoie un message très clair : la batterie est à plat.
Ah, non, je ne vais pas louper mon Jérém à cause d’une putain de batterie déchargée !
Et alors que la panique commence à s’emparer de moi, j’essaie de réfléchir pour trouver une solution : papa, maman sont au travail, je ne peux pas les déranger ; la voisine non plus n’est pas là, je ne peux appeler personne ; je retourne dans la maison pour chercher le numéro d’un dépanneur.
Je suis en train de feuilleter nerveusement l’annuaire, lorsque je reçois un sms.
« Alors, t’es parti ? ».
Non, ce n’est pas le sms que j’attends, celui de Jérém, mais c’est le sms qu’il me faut à ce moment précis, celui de Julien.
« Non, la voiture démarre pas ! » je m’empresse de lui répondre.
« Batterie à plat ? ».
« Oui… ».
« Bouge pas, j’arrive dans 10 minutes »
C’est exactement ce que j’avais besoin de m’entendre dire à cet instant précis.
« Tu veux que j’aille où avec la batterie à plat ? » je fais de l’humour, soudainement soulagé de mon angoisse de ne pas pouvoir partir.
« Ah oui, bien vu lol ».
L’attente me paraît interminable : à chaque minute qui passe, je vois mon retard se cumuler. Je regarde mon portable trois fois par minute, toujours pas de nouvelles de Jérém, toujours pas de réponse à mon message.
Je décide de l’appeler pour le prévenir que j’aurai un peu de retard, mais je tombe direct sur son répondeur :
« Vous êtes sur le répondeur de Jérémie, vous pouvez me laisser un message, mais il se peut que je ne l’écoute pas tout de suite, car je suis dans un bled où ça ne passe pas partout, pas toujours ! ».
Je m’en doutais, je n’ai aucun moyen de le joindre. Donc, je n’ai pas de droit à l’erreur : si je n’arrive pas à l’heure, il sera reparti et je l’aurai loupé.
Julien débarque 20 minutes plus tard : il est 15h35 et il pleut toujours. Il débarque en dégainant son plus beau sourire, un véritable rayon de soleil dans cette journée maussade.
« Dis-donc, tu t’es fait beau mon salop, t’as envie qu’il te fasse ta fête, hein ? ».
« Arrête de te moquer ! ».
« Je ne me moque pas, tu es tout en beauté, Nico… ».
« Merci Julien… ».
« Je croyais que tu n’avais pas envie d’aller voir ce mec, et patati et patata… » il se moque vraiment, ce coup-ci.
« La ferme, Julien et aide-moi à démarrer ! ».
« Allez, rigole un peu… détends-toi… t’es tendu comme un string… ».
« Alleeeeeez, je suis pressé… on va rigoler une autre fois… ».
Pendant un instant, le bogoss me regarde fixement, sans prêter attention à la pluie qui tombe sans discontinuer, qui défait peu à peu son brushing de bogoss, qui mouille son t-shirt noir ; puis, avec des gestes bien assurés, très « mec », il ouvre le capot de sa voiture, puis celui de la mienne ; il ouvre sa malle, il en extrait deux câbles épais, l’un rouge, l’autre noir, avec des grosses pinces au bout et il les branche sans hésiter.
Le bogoss revient à son volant et me lance :
« Allez, vas-y, essaie de démarrer… ».
Je reviens devant mon volant, je tourne la clef ; et alors que Julien appuie sur l’accélérateur pour envoyer le jus, ma voiture démarre comme par enchantement.
« Ne cale pas au premier stop comme tu faisais pendant les cours… tu ne repartirais pas… » il se paie ma tête une fois de plus, pendant qu’il range les câbles de démarrage.
« J’ai eu mon permis depuis… ».
« On se demande comment… ».
« C’est clair, avec un instructeur aussi naze… ».
« Allez, casse-toi et fais gaffe sur la route ! ».
« Merci pour tout Julien… ».
« Merci de quoi ? C’est à ça que servent les amis ! ».
« Alors merci d’être mon ami ! ».
« Tu es un bon gars, Nico… ».
« Toi aussi tu es en bon gars… ».
« Non, moi je suis une bombasse… ».
« Aussi… » j’admets sans difficulté.
Julien me prend dans ses bras, il me serre contre lui. Lorsqu’il relâche son accolade, je le sens touché ; moi aussi je suis touché.
« J’y vais, alors… ».
« Attends une seconde… ».
Le boblond plonge dans la voiture, il trifouille dans le vide poches ; un instant plus tard, il en ressort avec une petite bouteille de parfum à la main, il s’approche de moi et il m’asperge plusieurs fois dans le cou.
« C’est quoi ça ? » je feins de m’étonner, en reconnaissant illico la fragrance de bogoss qui a failli m’étourdir à chaque fois dans le petit espace de l’habitacle pendant les cours de conduite. Ah, putain, qu’est-ce que ça sent bon son parfum !
« C’est ton assurance-baise…» il me balance, tout en approchant le nez de mon cou ; avant de continuer, railleur : « hummmmm… tu sens bon… comment il va te démonter le gars ! ».
« Mais la ferme ! ».
« Tu m’en donneras des nouvelles ! ».
« Tu m’énerves… ».
« Allez, file, Nico ! » il lâche, en m’adressant un petit clin d’œil en guise d’encouragement.
Lorsque je « décolle », il est 15h45 ; je viens de quitter ma rue pour affronter un voyage somme toute assez long, sous un pluie battante, vers une destination que je ne connais pas ; je viens de quitter Julien et sa présence rassurante : je n’ai pas encore quitté la ville que je suis à nouveau assailli par l’angoisse, le doute, la peur ; je ressens à la fois l’envie d’appuyer sur un bouton pour arriver à destination dans la seconde et la peur au ventre d’y être trop vite.
Comme tous les vendredi en fin d’après-midi, il y a de la circulation en ville, et également sur le périphérique ; la pluie ralentit encore le mouvement : résultat de courses, je ne serai jamais à Campan à 18h00 ; si tout va bien, j’aurai au moins une demi-heure de retard.
Je profite de l’arrêt à un feu rouge pour tenter d’appeler Jérém une nouvelle fois, mais je tombe à nouveau sur son répondeur ; rien que le fait d’entendre sa voix enregistrée me fait frissonner. Qu’est-ce que ça va être de me retrouver devant lui !
Je retente au feu suivant, et au suivant encore, puis lorsque je suis dans la file d’attente au péage de Muret : et je retombe toujours et encore sur son répondeur.
A hauteur de Cazères, après une dizaine de tentatives, je me dis que je ne vais jamais pouvoir le joindre : je me dis également que, s’il le faut, j’arriverai trop tard, lorsqu’il sera déjà parti, et que je vais faire toute cette route sous la pluie pour rien. Mais désormais je suis parti, et je ne peux plus faire marche arrière.
Je prends sur moi et je continue à rouler ; je viens de passer le péage et je repense au coup de fil de Jérém de la veille, au frisson inouï qui m’a foudroyé lorsque j’ai vu son numéro s’afficher sur mon portable.
Jamais je n’aurais imaginé qu’il fasse ce pas ; jamais je n’aurais imaginé entendre à nouveau sa voix, cette vibration sensuelle et virile. Et encore moins, j’aurais cru que cette voix, d’habitude si assurée, puisse être traversée par une sorte d’hésitation, presque un malaise : comme s’il avait vraiment pris conscience de s’être mal comporté avec moi, comme s’il avait peur que ça puisse être « trop tard » pour rattraper le coup, comme s’il craignait que je l’envoie balader.
« Je voulais savoir comment tu allais… ».
Je n’ai pas été commode avec lui, je suis resté tout le temps sur la défensive : pourtant, ça m’a pas drôlement fait plaisir de l’entendre demander de mes nouvelles.
Le mauvais temps rend la circulation difficile : la pluie tombe à seau, et le vent s’en mêle lui aussi ; l’eau réduit la visibilité, les rafales me surprennent, me déstabilisent ; je roule doucement, vraiment doucement, je ne quitte pas la voie de droite ; tout le monde me double, y compris les poids lourds ; ces derniers projettent d’importantes quantités d’eau, ce qui rend la conduite encore plus pénible ; ils provoquent également des appels d’air qui se combinent avec le vent et semblent aspirer ma voiture ; j’ai du mal à garder le contrôle du volant, j’ai l’impression de déraper, c’est stressant, c’est fatiguant.
Je ne peux pas continuer à rouler comme ça, la peur au ventre : alors, même si je sais que ça va me mettre encore plus en retard, tant pis, je vais quitter l’autoroute.
La sortie de Martres Tolosane ne tarde pas à se dresser devant mes yeux. Je l’emprunte et je m’arrête sur le bas-côté pour regarder mon plan. Verdict : il faut suivre la direction St Gaudens.
J’ai toujours autant de mal à me dire que je suis en train de rouler pour aller voir mon Jérém. Son coup de fil, son invitation, mon départ, tout arrive si vite. C’est tellement inespéré, tellement soudain ; alors que je m’étais tellement fait à l’idée que je ne le reverrai jamais !
Et à chaque fois que j’essaie d’imaginer nos retrouvailles de plus en plus proches, un frisson géant surgit de mon ventre, se propage dans mon corps, sur ma peau toute entière ; tout mon être frémit, des pieds jusqu’au cuir chevelu, tous mes poils se dressent.
J’arrive à Martres Tolosane depuis l’autoroute et je rentre directement sur son « périphérique intérieur » : en effet, le village n’est pas structuré le long d’un axe principal, mais plutôt en forme de bastide circulaire ; l’« hypercentre », avec son église et ses vieilles bâtisses, constitue une sorte d’immense rond-point situé à l’intérieur de la boucle de circulation.
A partir de cette dernière, un certain nombre de routes partent dans différentes directions, l’ensemble dessinant autant de points d’interrogation géants posés à plat : une structure urbaine qui semble faire écho à mon état d’esprit, rempli d’interrogations.
« Je me disais que si tu avais ton permis… et une voiture… ».
J’ai été très touché par sa façon d’essayer de me tirer les vers du nez, tout en douceur, comme s’il « avait peur » de ma réaction.
« Ça me ferait plaisir de… de te voir ce week-end… ».
« T’es sérieux ? ».
« Oui, Nico… ».
Mon prénom paraît si beau, lorsqu’il sort de la bouche de Jérém.
« T’es où ? ».
« A Campan… dans la maison de mon papi… ».
Dans sa façon de dire « mon papi », j’ai ressenti chez mon Jérém un côté choupinou qui le rend à mes yeux terriblement touchant ; et j’ai réalisé que le serial baiseur musclé et viril a conservé une âme d’enfant : j’ai eu envie de le serrer dans mes bras et de le couvrir de bisous.
« Viens me rejoindre, Nico… ».
L’entendre insister m’a fait un drôle d’effet ; c’est la première fois qu’il me montre qu’il a vraiment envie de me voir ; et son attitude semble bien loin de celle du petit con qui encore il y a pas longtemps m’envoyait des sms bourrés de fautes lorsque l’envie de me baiser lui prenait.
« Je ne t’ai jamais remercié de m’avoir aidé à avoir mon bac… ».
C’est gentil quand même…
« Nico… ».
« When you call my name, it’s like a little prayer
« Like a prayer » de Madonna et je me sens bien.
« Je t’attendrai sur la place du village demain à 18 heures… ».
Il m’a vraiment ému ce petit con…
« Je sais que je me suis comporté comme un con avec toi… ».
… ému aux larmes, même si je luttais pour ne pas pleurer.
« Les chanceux c’est nous, c’est toi qui me l’as dit une fois… ».
Il s’est même souvenu de cette phrase que je lui avais lancée, comme un cri de désespoir, comme une façon de le supplier de ne pas me quitter, la dernière fois qu’il était venu chez moi.
« Si tu viens, fais gaffe sur la route, ils annoncent de la flotte dans les heures à venir… »
Il s’inquiète pour moi…
« Salut Nico… ».
J’ai ressenti beaucoup de tendresse dans ses dernier mots, et notamment dans sa façon de prononcer « Nico » : définitivement, mon prénom est musique pure lorsque c’est Jérém qui le prononce.
En arrivant à St Martory, je me fais la réflexion qu’au fil des kilomètres la typologie constructive du bâti change de façon perceptible : la brique et la tuile toulousaines cèdent la place à la pierre et l’ardoise ; la chaleur des bâtisses de la plaine cède la place à la sobriété des constructions de la montagne.
Je regarde ces façades grises, ces rues sans couleurs, et j’ai l’impression que l’hiver est déjà là, alors que nous ne sommes qu’en septembre, et qu’il va commencer à neiger d’un moment à l’autre ; et là, je suis saisi par une intense envie de me calfeutrer bien au chaud, devant un bon feu de cheminée, avec mon Jérém à moi.
Porté par la monotonie d’un temps pluvieux, par la mélancolie d’un paysage empreint de solitude, mon esprit divague ; certains souvenirs viennent à moi, si beaux et pleins de jolies couleurs qu’ils arriveraient presque à réchauffer cette journée froide et maussade.
Le souvenir du premier jour du lycée, une chaude journée de septembre, la cour bondée de têtes inconnues ; souvenir du choc que j’ai ressenti la première fois que j’ai aperçu ce petit brun au sourire ravageur : c’était comme recevoir un coup de poing dans le ventre, comme ramasser une gifle capable de me faire tomber à la renverse ; nouveau choc, souvenir de son regard qui soutient le mien, la crainte de me faire capter, la peur de le vexer. Souvenir de ce tout premier instant où tout a commencé, cet instant où « être amoureux » a pris un véritable sens dans mon esprit et dans mon cœur.
Un autre souvenir, rappel d’un moment magique dans une vigne du Vaucluse, le dernier jour du voyage en Italie, vers la fin de l’année de seconde.
Nadia et Malik étaient parti se rouler des pelles, et je me suis retrouvé seul avec Jérém. Le bogoss fumait debout, un pied appuyé à un grand arbre, et moi j’étais assis sur une pierre juste à côté.
J’avais essayé de lui faire un peu la conversation, il n’avait pas été très bavard, le silence me pesait.
Il faisait très chaud et le bogoss était torse nu, il avait même défait sa ceinture et les deux premiers boutons de son jeans.
Les départs des plis de l’aine, bien saillants, se dévoilaient sous mes yeux ; les poils au-dessus de l’élastique bleu de son boxer étaient trempés : son boxer devait être bien humide.
J’avais l’impression de deviner, de sentir l’odeur de sa transpiration, et même l’odeur de sa queue. Je n’arrivais même pas à imaginer le bonheur de poser mon nez sur ce tissu imbibé de ses petites odeurs de jeune mâle ! J’étais fou de désir…
Mais à cet instant précis, j’étais persuadé que je n’aurai jamais ce gars, je pensais que je n’existais même pas pour lui ; je n’aurais jamais imaginé qu’un jour j’aurais le cran de lui proposer de réviser, et encore moins que ce même jour, il aurait envie de me faire goûter à sa queue.
Mais, putain, qu'est-ce qu’il était beau, Jérémie, en ce beau jour de printemps, dans cette vigne du Vaucluse ! *
La route de contournement de St Gaudens m’offre une vue rapprochée avec un paysage vallonné et boisé. Les Pyrénées approchent, je suis à peu près à mi-chemin, j’approche de Jérém ; mon ventre tourbillonne, je trépigne d’impatience, la peur au ventre.
En première, il y avait eu un voyage en Espagne. Un voyage dont le premier souvenir est ma jalousie vis-à-vis de ma copine Valérie, que j’avais surnommée « la fille qui ne perd pas de temps », lorsque je l’avais surprise en train de rouler des pelles à Jérém dès le matin du premier jour.
Un autre souvenir de ce voyage, était Laurent, un gros con d’une autre classe, un type franchement trop chiant qui avait commencé à me taxer de l’argent pour s’acheter des clopes. Je lui en avais donné une fois, pour qu’il arrête de me faire chier. Il avait fumé son paquet et il était revenu à la charge ; il m’avait coincé un soir, dans un couloir de l’hôtel où nous séjournions. Je ne voulais plus lui donner d’argent et le type me menaçait pour me faire céder.
Et là, Jérém avait débarqué, lui avait filé des clopes et il lui avait bien mis les points sur les « I » :
« Demain tu t’achètes des clopes et tu arrêtes de lui casser les couilles, c’est compris ?! ».
« Ok, ok, t’énerves pas… ».
Sur ce, Laurent s’était tiré, tout comme Jérém. Je l’avais regardé s’éloigner dans le couloir alors que j’avais tellement envie de le retenir.
« Merci, Jérémie ! » je lui avais lancé, le cœur qui battait à tout rompre.
Le bogoss ne s’était même pas retourné, se limitant à me lancer un geste de la main qui semblait signifier : « c’est rien, laisse tomber », juste avant de disparaître au tournant du couloir.
Le dernier souvenir de ce voyage est celui du trajet retour, de nuit, le souvenir de Jérém endormi, avec la tête posée sur mes cuisses !
Et c’est à la fois un moment de pur bonheur et d’immense angoisse.
Tout s’emmêle dans ma tête, j’ai peur de mes sentiments.
Malgré cela, j’ai hâte de retrouver Jérémie en cours… **
Je suis tellement happé par mes souvenirs que je finis par me tromper de route : sans vraiment savoir comment, je me retrouve dans un bled du nom de Ponlat Taillebourg.
Au village, je dois m’arrêter à un passage piéton : une femme blonde, tenant d’une main un gosse de 4-5 ans, blond et aux grand yeux clairs, et de l’autre main la laisse d’un gros labrador chocolat tout mouillé, est en train de traverser la route.
Je profite de l’arrêt pour ouvrir la vitre et prendre un peu l’air, tout en suivant le petit sketch qui se joue devant mes yeux.
La scène est assez hilarante car, tout autant le gosse que le labrador semblent se démener pour tenter d’échapper au contrôle de la femme, pour sauter de flaque en flaque ; le gosse pousse des cris aigus pour exciter le labrador, ce qui a l’air de bien marcher.
« Jordan, arrête d’embêter Attila… et toi, Attila, avance ! » je l’entends la femme tenter de maîtriser à la fois l’enfant et l’animal, l’air à la fois débordée et amusée par cette petite mutinerie.
Je quitte le petit village et je mets le cap sur Montréjeau. Campan approche à grand pas, j’ai l’impression que mon cœur a des ratés.
Désormais, la montagne s’annonce aussi par le changement des cultures : le maïs de la plaine de Garonne laisse la place aux prairies posées sur des pente de plus en plus prononcées ; par endroits, des vaches ou des brebis paissent sans même calculer la pluie qui ne cesse de tomber.
Plus j’approche de ma destination, plus je me sens agité, fiévreux, tendu : heureusement, les souvenirs occupent mon esprit.
Je repense à ce fameux soir à l’Esméralda où, une fois encore, Jérém était venu à mon secours, alors qu’un type bourré dans les chiottes exigeait une pipe, sans quoi il allait certainement me frapper. Jérém avait débarqué et avait joué de ses gros bras pour faire dégager le type. Putain, qu’est-ce qu’il était furieusement sexy !
Cette nuit-là avait été la nuit des « premières fois » : la première fois que j’avais ressenti sa jalousie, la première fois que j’avais eu l’impression qu’il m’avait fait l’amour ; mais aussi la première fois qu’il m’avait demandé de rester dormir chez lui, la première fois que j’avais pu le prendre dans mes bras, la première fois que je m’étais retrouvé dans les siens, bien au chaud ; la première fois que j’avais ressenti cette sensation qui m’avait submergé de bonheur, la sensation que rien ne puisse m’arriver, une sensation de bonheur intense et ultime.
En arrivant à Montréjeau, c’est le souvenir d’une autre nuit magique qui remonte à mon esprit : celle qui avait suivi le plan avec Romain, le bobarbu que Jérém avait levé au On Off ; cette nuit-là, alors que Jérém essayait de jouer au mec détaché, en baisant avec le bobarbu et en me laissant baiser avec lui, sa jalousie s’était manifestée une nouvelle fois ; cette nuit-là aussi, il m’avait demandé de rester dormir. Et ça avait été une nouvelle nuit de bonheur.
A l’approche de Lannemezan, je repense à cette semaine magique, un mois plus tôt ; je repense à tous ces après-midi chez moi, à faire l’amour avec un bobrun souriant, ouvert, bien dans sa peau ; je repense à la complicité qu’il y avait entre nous à ce moment-là, au bonheur de notre entente, sexuelle mais aussi sur tous les autres plans ; je repense aux câlins ; et je repense aux attentes que cette semaine avait fait naître en moi : l’espoir que notre relation était en train évoluer, que l’on puisse surmonter la distance et n’importe quel obstacle qui se dresserait entre nous, parce que nous le voudrions tous les deux.
Puis, je repense à Thibault ; Thibault qui avait l’air si fuyant lorsque je l’ai eu au téléphone la veille ; Thibault que je dois recontacter et essayer d’aller voir dès mon retour sur Toulouse ; Thibault, que je regrette de ne pas avoir été voir plus tôt, pour lui permette de s’expliquer, pour savoir ce qui s’était vraiment passé, et pour quelles raisons ça s’était passé, entre Jérém et lui. Et pour savoir comment il le vivait, ce qui se passait dans sa tête, dans son cœur.
Quand je repense à qui s’est passé entre Jérém et lui, je ressens à chaque fois une flambée de jalousie remonter violemment en moi et me brûler de l’intérieur.
Pourtant, si quelqu’un est bien placé pour comprendre ce qu’a pu vivre Thibault, c’est bien moi. Oui, je peux comprendre ces envies déchirantes, et la frustration qui s’y accompagne, pour un garçon à la fois si proche mais si inaccessible. Et cette frustration, Thibault l’a vécue pendant des années, depuis l’adolescence, il l’a vécue avec une acuité, une proximité que moi-même ne connaîtrai pas.
Comment alors ne pas comprendre que Thibault ait pu céder à l’occasion qui s’est présentée, sans penser à faire du mal à qui que ce soit et au contraire à penser à se faire du bien à lui, à lui et à Jérém ?
Je ne peux pas affirmer que je n’aurais pas agi de la même façon à sa place, probablement j’aurais agi de la même façon. Comment aurait-il pu agir autrement ?
Quand je repense à cette nuit que nous avions passée tous les trois chez Jérém, j’y repense souvent comme à une erreur : pendant cette nuit, j’avais cru déceler une sorte d’attirance entre les deux potes, attirance à laquelle eux-mêmes avaient été confrontés peut-être pour la première fois, et qui pourrait réveiller des désirs et des envies jusque-là latents. Dès le lendemain, je m’étais dit que cette nuit pouvait faire des dégâts dans les relations entre nous trois, et dans chacun de nous.
Erreur ou pas, cette nuit a eu des conséquences sur tous les trois.
Sur Jérém, car il a été une fois de plus déstabilisé et jaloux de me voir coucher avec un autre gars, même si c’est lui qui avait provoqué ce plan pour me prouver, pour se prouver qu’il n’en avait rien à faire de moi ; jaloux de le même façon que lors du plan avec le bobarbu Romain, jaloux de me voir coucher avec son pote de toujours, alors qu’il l’avait lui-même invité à participer à nos ébats.
Cette nuit a eu des conséquences sur moi, car j’ai découvert la rassurance douceur de Thibault ; une découverte qui a contribué à me faire prendre conscience que je ne devais pas tout accepter de Jérém.
Et sur Thibault aussi, car cette nuit l’a certainement remué de fond en comble, lui qui aimait secrètement son pote depuis si longuement ; cette nuit a certainement réveillé en lui des désirs qu’il essayait de maîtriser, non sans peine ; cette nuit a été l’étincelle qui les a fait flamber jusqu’à les rendre insupportables.
Dès lors, ces désirs ne l’ont plus quitté, et lui ont échappé des mains : jusqu’à ce fameux soir où il a fini par coucher avec Jérém.
Au fond, j’ai moins du mal à accepter que Jérém ait couché avec Thibault qu’avec d’autres gars, des inconnus.
A Tournay, je repense à cet adorable Maxime : est-ce que Jérém sait que son frérot m’a vu le caresser sur son lit d’hôpital, qu’il m’a posé des questions, et qu’il a certainement tout compris de ce qu’il y a entre lui et moi, sans que ça semble lui poser de problème ?
En arrivant à Bagnères de Bigorre, je me sens comme une casserole de lait en pleine ébullition, prête à déborder : les retrouvailles approchent à grand pas, j’en ai mal au ventre.
« Tu pars quand à Paris ? ».
« Quand le médecin me donnera le feu vert… je dois passer des visites médicales à la fin du mois… ».
Il va partir de toute façon, il va partir bientôt : alors, à quoi ça rime son initiative de reprendre contact avec moi ? A quoi ça rime cette invitation ? Est-ce qu’il veut me voir pour me dire « adieu » ? Mais à quoi bon se revoir, si c’est pour se quitter à nouveau de suite après ? Pourquoi ne pas laisser les choses se tasser, laisser au Temps le temps de faire le deuil, le temps de nous oublier ?
Comment ça va se passer cette rencontre ? Je marche vers l’inconnu, et cet inconnu me fait peur.
En sortant de Bagnères, la montagne est là, devant moi, tout autour de moi ; le ciel est très gris, très lourd ; il pleut de façon insistante et l’humidité remonte les pentes sous forme de brouillard, jusqu’à cacher les sommets.
Un panneau routier indique : « Campan 10 km ».
Dix kilomètres, dix minutes. Dans dix minutes, je serai arrivé à destination ; dans dix minutes, je saurai s’il m’a attendu, malgré ma demi-heure de retard : s’il n’est plus là, j’aurai fait toute cette route, longue, sinueuse et difficile, pour rien, une route qui m’a amené de Toulouse à Campan, une route qui démarre le premier jour de lycée et qui me mène ici, dans les Pyrénées, le cœur en vrac.
Mais s’il est là, et j’espère encore et malgré tout qu’il est là, je vais devoir affronter son regard, endurer sa présence, maîtriser les battements de mon cœur qui, je le sens, vont encore s’accélérer, qui vont taper tellement fort dans ma poitrine que j’aurai du mal à tenir debout ; s’il est là, et lorsque je serai devant lui, je vais devoir essayer de maîtriser mes émotions, garder mes moyens, ne pas pleurer, ne pas m’énerver. Et ne pas céder au désir brûlant, à cette envie de lui, de son corps, de son odeur, de sa proximité, de cette sensualité qui va me happer à coup sûr.
Je ne sais pas comment je vais faire, je ressens tellement d’émotions à la fois puissantes et contrastantes vis-à-vis de ce mec…
Quelle attitude adopter ? Comment me comporter avec lui ? Comment ne pas craquer ?
Un panneau routier indique : « Campan 3 km ».
A l’approche de Campan, je repense au moment où j’ai appris pour son accident, à ces trois jour pendant lesquels j’ai eu la peur de ma vie : la peur qu’il ne se réveille pas, la peur de le perdre, pour toujours ; et quand je pense au soulagement que j’ai ressenti lorsque Thibault m’a annoncé qu’il s’était réveillé de son coma, je me sens prêt à tout lui pardonner ; je crois que de toute façon, rien qu’en le revoyant, je vais fondre.
Je ressens une soudaine et folle envie de le serrer contre moi, de le couvrir de bisous ; je me sens prêt à tout recommencer, à prendre tous les risques ; à lui dire et lui redire clairement qu’il est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, que je ne peux pas renoncer à le voir, que je ferai tout ce qu’il faut pour continuer à le voir, que j’irai le voir à Paris, que je serai discret, que je ne lui demanderai pas plus qu’il ne peut me donner.
Ma playlist sur cassette accompagne mes pensées, avec l’une des dernières chansons, et certainement l’une des plus poignantes, signées Beatles :
The long and winding road that leads to your door/La longue et sinueuse route qui mène à ta porte
Will never disappear, I've seen that road before/Ne disparaîtra jamais, j'ai déjà vu cette route.
It always leads me here/Elle me conduit toujours ici,
Leads me to your door/Elle me conduit à ta porte.
L’instant « T » approche à grand pas, tout se bouscule dans ma tête, je n’arrive plus à me focaliser sur quoique ce soit, et encore moins à me fixer sur l’attitude à adopter vis-à-vis de Jérém : désormais il n’est plus temps de prendre des résolutions.
Alors, ma seule « résolution », ce sera celle de me laisser porter par les évènements, d’écouter ce qu’il a à me dire et de me comporter en fonction ; inutile de prévoir ce que je vais lui dire, ou de me fixer une attitude plutôt qu’une autre ; inutile d’envisager qu’il va se comporter de telle ou telle façon, qu’il va dire ceci ou cela : de toute façon, rien ne se passera comme je pourrais l’imaginer. Et surtout pas avec Jérém. Et, au fond, c’est bien ainsi : c’est cet inconnu qui fait battre si fort mon cœur : ça fait mal parfois, mais ça me fait me sentir tellement, tellement, tellement vivant.
« CAMPAN ».
Lorsque le panneau d’entrée d’agglomération rentre dans mon champ de vision, les six lettres me percutent comme une gifle puissante : je ressens une intense chaleur se propager dans mon ventre, tout se brouille dans ma tête, j’ai l’impression de planer.
Le ciel lourd se combine à merveille avec les nuances de gris de la pierre des murs, de l’ardoise des toitures pentues ; je suis sous le charme de cet environnement tout en pierre et sobriété, de ce paysage comme en « noir et blanc », qui semble tout droit sorti d’une ancienne carte postale ; le village a l’air d’un bijou posé sur un coussin de nuages gris, et tout autour de moi semble parler de l’hiver, de journées froides, humides, d’une nature hostile jusqu’au printemps.
Voilà la halle en pierre, avec ses pentes très inclinées couvertes d’ardoises, ses piliers en pierre, ronds et massifs mais pas très hauts, empêchant la lumière de pénétrer à l’intérieur, notamment par une journée aussi grise ; je ralentis, et je regarde vite fait si je vois mon Jérém quelque part dans la pénombre, mais je ne vois rien. Pourvu qu’il soit encore là.
Je m’engage dans le petit boulevard juste en face, là où il semble y avoir des parkings.
18h38. Presque 40 minutes de retard. Je sors de la voiture sans attendre, alors qu’il tombe toujours des cordes. Pourvu qu’il ne soit pas déjà reparti ! Car, s’il n’est plus là, et comme je n’arrive pas à le joindre, je vais devoir le retrouver : non, je ne repartirai pas à Toulouse sans l’avoir vu, ou sans avoir retourné le village tout entier pour le débusquer.
Je remonte le petit boulevard, je me hâte en direction de la halle en pierre : je me « hâte » comme je peux, alors que j’ai les jambes en coton, le souffle coupé, le cœur dans la gorge, les mains moites, la tête qui tourne.
Je n’ai plus que la route à traverser pour atteindre mon but : et c’est là que j’aperçois une présence dans la pénombre, une carrure et une attitude de mec qui pourraient bien être les siennes. Je vois un mec de dos, l’épaule appuyée contre le pilier d’angle du bâtiment, habillé d’un pull gris dont la capuche est remontée sur la tête, et d’un short en jeans assez long. Le mec semble regarder la pluie tomber, mais dans la direction opposée.
C’est lui, je suis sûr et certain que c’est lui.
J’ai le tournis, puis le vertige, ma vue se brouille ; je traverse la route mais je ne me sens pas le courage d’aller directement vers lui : alors, je me cache derrière l’angle de la maison jouxtant la halle.
Je viens tout juste de l’apercevoir, et tellement de choses remontent en moi, c’est insoutenable, insupportable, j’ai envie de pleurer, j’ai envie de faire demi-tour et de repartir.
Je reste ainsi, comme tétanisé, mes larmes se mélangeant à la flotte qui tombe sur ma tête et sur mes épaules, pendant quelques longs instants.
Jusqu’à ce qu’une voix au fond de moi se lève pour crier :
« VAS-Y ! ».
Je reconnais cette voix, c’est la même qui s’était levée le jour de la première révision, pendant mon trajet à pied vers l’appart de la rue de la Colombette ; elle s’était fait entendre alors que je traversais le Grand Rond à Toulouse, et que j’hésitais à faire demi-tour, là aussi. Malgré tout, je me dis que cette voix avait eu raison, et que j’avais eu raison de l’écouter. Et si cette voix a eu raison hier, je ne vois pas pourquoi il n’en serait pas de même aujourd’hui.
J’essuie mes larmes, je prends une profonde inspiration et je franchis le seuil de la halle, laissant à nouveau le garçon que j’aime pénétrer à son insu dans mon champ de vision, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes.
J’avance doucement et j’ai vraiment l’impression de planer, le bruit de mes pas est couvert par le son de la pluie qui tombe sur les ardoises et qui résonne dans le grand espace à la lourde charpente de bois.
Et à chaque pas, j’ai l’impression de sentir un peu plus fort sa présence, comme une radiation qui se dégage de lui, comme quelque chose de palpable, comme une sorte de brouillard épais qui m’enveloppe, comme quelque chose d'électrique qui perturbe toutes les fibres de mon corps et de mon cœur.
Alors même qu’il n’est que de dos, qu’il ne s’est même pas rendu compte de ma présence.
Sa présence irradie, mon amour et mon désir amplifie. Ce mec me fait un effet de dingue.
J’ai envie de faire durer cet instant le plus longtemps possible, cet instant où tout est possible, où je ne connais pas encore ses intentions, où je n’ai pas encore croisé son regard de braise, où je n’ai pas encore entendu sa voix, ni ses mots, cet instant où il m’attend encore, où il se demande peut-être si je vais venir ou pas, où il est peut-être déçu de ne pas me voir ; oui, j’ai envie de faire durer le plus longtemps possible la perfection de cet instant où tous les espoirs sont encore possibles.
Le pull à capuche souligne le V de son dos, le short laisse dépasser ses mollets, c’est sexy à tomber. Il est en train de fumer.
Je ne suis désormais qu’à cinq mètres de lui ; et alors que le bruit de la pluie couvre toujours le bruit de mes pas, le bogoss se retourne soudainement, comme si je l’avais appelé.
Sous l’ample capuche, les traits et le regard de mon Jérém me frappent comme un poing en plein ventre.
Il écrase son mégot contre le pilier, il le glisse dans sa poche et il bascule sa capuche : ses cheveux bruns apparaissent et, surprise, ils sont laissés en bataille, sans aucune fixation, ils sont même un peu plus longs que d’habitude, magnifique crinière virile de beau mâle brun ; sa barbe aussi est plus longue que d’habitude, d’une semaine je dirais, et elle habille à merveille la peau mate de son visage ; visage qui porte des marques de coups, qui ne sont pas celles provoquées par ma main, mais certainement les suites de la bagarre qui l’a conduit dans le coma pendant trois jours. Je fonds.
« Salut… » il me lance en s’efforçant d’afficher un beau sourire.
« Salut… » je lui réponds, en m’efforçant de ne pas bégayer, en prenant sur moi pour le regarder dans les yeux.
« Ça va ? » il enchaîne.
« Oui… et toi ? ».
« Ça va… ».
Et là, au bout de deux échanges de politesses, le silence s’installe entre nous. Je suis mal à l’aise et j’ai l’impression que Jérém n’est pas plus à l’aise que moi, comme si son assurance de petit con qui n’a peur de rien s’était soudainement envolée.
J’aurais envie de trouver un moyen de briser la glace, je n’y arrive pas. Je suis perdu, troublé par sa présence : je ne sais pas où nous en sommes vraiment, j’ai l’impression qu’après tout ce qui s’est passé, après un mois sans se voir, une nouvelle distance s’est glissée entre nous. Comme si nos existences jadis synchronisées étaient désormais en décalage.
Les secondes s’enchaînent et le bruit de la pluie devient presque assourdissant.
« T’es beau, dis-donc… » il finit par me balancer, après avoir allumé une nouvelle clope.
C’est la première fois que Jérém me fait un vrai compliment. Je suis à la fois flatté et déstabilisé.
« Tu parles… ».
« Si, si, tu es très beau, t’es très bien sapé… ».
« Oui, ce sont les fringues qui font tout… ».
« Oui… enfin… non… c’est pas ce que je voulais dire… euh… t’es vraiment pas mal, Nico… ».
« Arrête ton baratin… ».
« C’est pas du baratin… ».
« Si… ».
« T’as mis un parfum… ».
« Non… enfin… si… ».
« Tu sens bon… ».
« Merci… ».
Nos regards se croisent, nos silences s’additionnent, nos malaises s’amplifient mutuellement.
Puis, un détail attire mon attention : le zip du pull à capuche est légèrement ouvert et un bout de tissu plié dépasse ; on dirait un col de maillot de rugby, mais pas n’importe lequel. Du blanc, du rouge : on dirait bien le maillot que je lui avais acheté à Londres et qui avait désormais une longue histoire : ce maillot que j’avais gardé longtemps chez moi avant de me décider à lui offrir, ce maillot qu’il m’avait balancé à la figure lorsque j’avais enfin voulu le lui donner, ce maillot que j’avais laissé à son patron, à la brasserie, ce même maillot qu’il m’avait crié avoir jeté à la poubelle : c’était la nuit avant son accident, lors de cette rencontre houleuse en présence de Martin.
Sans vraiment réfléchir, je m'approche de lui, j'ouvre un peu plus le zip. Mes gestes sont déterminés, et le bogoss se laisse faire : oui, c'est bien le maillot que je lui avais offert. Mes doigts effleurent au passage sa peau mate, douce et tiède ; mille frissons se dégagent de ce simple contact, comme des étincelles qui se propagent dans tout mon corps, m’approchant dangereusement de la surcharge et du court-circuit émotionnel.
« Je croyais que tu l’avais jeté… ».
« Tu crois que je pourrais jeter le maillot de Johnny ? ».
« Non, bien sûr… le maillot de Johnny… ».
« Et puis, c’était un beau cadeau… ».
« Je voulais te faire plaisir… ».
« Et c’est réussi… »
Le silence s’installe à nouveau entre nous ; le bruit incessant de la pluie a quelque chose d’hypnotique, et j’ai l’impression de perdre pied.
« Tu es vraiment un gars adorable… » il me lance.
« Si tu le dis… ».
« … et je me suis vraiment comporté comme un con avec toi… ».
« Tu m'as fait trop mal… ».
« Je sais… ».
Je pleure.
Jérém s’approche de moi et il me prend dans ses bras.
« Je suis vraiment, vraiment désolé… ».
Je me dégage de son étreinte, je lui fais face, je plante mon regard dans le sien.
« Je t’aime, Jérém, je t’aime comme un fou, je n’ai pas arrêté de penser à toi un seul instant depuis le premier jour du lycée… quand j’ai su pour ton accident, j’ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir ! J’ai réalisé à quel point tout est si fragile, et que tout peut finir sans prévenir… j’ai envie qu’on soit ensemble, j’ai envie de passer du temps avec toi, pas seulement pour le sexe, même si c’est génial avec toi comme avec personne d’autre ; j’ai envie d’être là pour toi, et que tu sois là pour moi, j’ai envie de te dire à quel point tu es quelqu’un de spécial pour moi… ».
Silence de sa part, il fume. Les secondes s’enchaînent.
« Tu ne dis rien, Jérém ? ».
« Nico… je te l’ai déjà dit, je ne peux pas t’offrir une vie de couple comme tu le voudrais… c’est très dur pour moi… ».
« Qu’est-ce qui est trop dur ? ».
« De vivre « ce truc » qu’il y a entre nous… toi t’as envie de le vivre à fond, moi ça me fait peur… ».
« Pourquoi ? ».
« Je ne peux pas t’expliquer pourquoi… je n’y arrive pas, c’est tout… ».
« C’est pour ça que tu m’as fait venir ? Je viens de me taper 200 bornes sous la flotte et tout ce que t’as à me dire que tu n’as pas les couilles pour nous donner une chance ? ».
« Non, je t’ai demandé de venir parce que j’avais envie de te voir, et parce que je te devais des explications… ».
« Elles sont nulles tes explications… ».
Jérém se tait à nouveau, il se réfugie derrière sa cigarette.
« Alors on fait quoi, maintenant ? On reste potes ? » je tente de le secouer.
« J’aimerais qu’on y arrive… ».
« Et ça te suffirait, à toi, qu’on reste potes ? ».
« Il va falloir… ».
« Je m’en fiche de ce qu’il faut, je veux savoir si à toi ça te suffirait… ».
« Je n’ai pas le choix, Nico… Paris c’est loin, et là-bas ça va être impossible de vivre ça… ».
« Oui ou non ? Réponds à ma question ! » je m’emporte.
« Il n’y a pas de solution… ».
« OUI ou NON ??? ».
« Non ! » il finit par lâcher, un « NON ! » claquant, définitif.
Un nouveau silence suit ce petit coup de tonnerre, cet éclair qui vient de me foudroyer.
« Non, ça me suffit pas… » il reprend, le regard fuyant, l’air remué comme jamais « mais c’est comme ça, je n’y peux rien, Nico… ».
« En gros, tu m’as fait venir pour me dire adieu… ».
« Je voulais m’excuser pour mes mots et mon comportement des dernières fois qu’on s’est vus… je suis désolé de t’avoir frappé… ».
« Je t’ai frappé en premier… ».
« Je l’avais bien cherché… je suis aussi désolé de t’avoir foutu la honte avec ce gars la dernière fois… tu as le droit de voir qui tu veux, bien sûr, et je n’ai pas le droit de te demander des comptes… ».
« Ce gars n’est personne pour moi ! Si je suis sorti ce soir-là, si je me suis laissé embarquer par ce mec, c’était pour ne pas rester seul, pour essayer d’arrêter de ressasser ce qui s’était passé entre nous… j’étais tellement malade quand tu m’as quitté… je pensais que tu étais passé à autre chose, je croyais que je ne te reverrais jamais… et pourtant, quand je t’ai croisé sur les allées, je n’avais qu’une envie… ».
Je suis à nouveau submergé par l’émotion, mes mots se coincent dans ma gorge.
« Quelle envie ? ».
« Celle de laisser tomber Martin et de repartir avec toi… mais t’as été tellement relou, tellement mauvais… ».
« J’ai été nul… ».
Ses excuses tardives, ce sentiment de gâchis, de nous être ratés tant de fois, sa façon de baisser les bras face aux obstacles que la vie est en train de mettre entre nous : je suis dégoûté, j’ai envie de pleurer et de m’enfuir ; je ne sais plus quoi lui retorquer, je me sens désemparé, aucun mot me vient à l’esprit : j’ai juste envie de repartir et de m’enfermer dans ma chambre pour pleurer.
Je regarde Jérém et j’ai impression qu’il est dégoûté tout autant que moi : il respire bruyamment, il ne tient pas en place, il semble trépigner, on dirait qu’il tape du sabot comme un petit taureau dans l’arène, mais un petit taureau plutôt nerveux qu’énervé ; comme s’il avait des trucs à me dire et qu’il se faisait violence pour ne pas les lâcher.
J’ai terriblement envie de l’embrasser : alors, sans plus réfléchir, j’avance vers lui et je l’embrasse. Et à l’instant même où je retrouve la chaleur et la douceur de ses lèvres, une décharge électrique parcourt ma colonne vertébrale, j’ai l’impression de changer de dimension, d’être soudainement projeté dans un monde de bonheur absolu où nous serions plus que tous les deux, où tout serait simple et beau.
Hélas, la décharge de bonheur est de courte durée : elle est stoppée net par l’attitude de Jérém, qui fait un pas en arrière pour se dérober à mes lèvres.
Je sens ma colère monter, colère fille de frustration face à cette barrière invisible infranchissable qui nous sépare.
« On n’y arrivera vraiment jamais, alors… ».
« Je ne peux pas Nico, je ne peux pas… ».
« Tu m’énerves Jérém » je finis par lui balancer « … je ne sais même pas pourquoi je suis là… je n’aurais pas dû venir… ».
« Ne dis pas ça… ».
« Tu ne veux pas d’une relation, mais je crois surtout que tu n’es pas prêt à assumer qui tu es et ce dont tu as envie… alors, ça rime à quoi tout ça ? Pourquoi tu m’as fait venir, pourquoi ??? Tu ne m’as pas fait assez de mal ?!?! ».
Nouveau silence de sa part. J’ai envie de lui dire tant de choses et pourtant tous les mots du monde me semblent impuissants à le toucher, à le convaincre à vaincre ses peurs, à lui donner confiance en « nous ».
« Ça veut dire quoi MonNico ? » je lui balance de but en blanc, sans réfléchir.
« De quoi ? ».
« La fois où je t’ai appelé, quelques jours avant ton accident, j’ai entendu cette nana te demander : « C’est qui MonNico ? » ; alors, je te demande ce que ça veut dire MonNico… si toutefois ça veut dire quelque chose… ».
Jérém ne répond pas, il continue de fumer sa cigarette. C’en est trop pour moi.
« Va te faire voir, Jérém, je me tire ! » je lui balance, tout en me retournant pour repartir, en essayant de retenir mes larmes.
Je n’ai pas fait un pas que je sens sa main attraper mon avant-bras, m’obligeant à me retourner.
« Attends, Nico… ».
« Lâche-moi ! » je lui lance sèchement, tout en me dégageant de sa prise et en repartant vers la voiture.
Et là, Jérém m’attrape une nouvelle fois par l’avant-bras, la puissance de sa prise traduisant sa détermination ; une nouvelle fois, il m’oblige à m’arrêter, à me retourner ; et cette fois-ci, son mouvement m’attire vers lui.
Je me retrouve les épaules collées contre le mur en pierre, enveloppé par son parfum qui me met en orbite, ses yeux noirs pleins de feu plantés dans les miens, nos nez à vingt centimètres l’un de l’autre.
Sa pomme d’Adam s’agite nerveusement ; dans son regard, une étincelle que je lui connais bien, une flamme incandescente qui ressemble et tout et pour tout à celle qui brûlait dans son regard pendant la semaine magique ; la même, mais avec plus d’intensité, car mélangée à une sorte d’angoisse, de peur.
Le temps est comme suspendu, figé ; comme si plus rien n’existait au monde, à part nos regards qui se cherchent, s’aimantent.
Un grand homme disparu a dit : il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien ; et puis il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde.
Et ce monde, ce nouveau monde, je l’ai vu, à cet instant précis, dans son regard.
Sa main glisse doucement derrière ma nuque, sa paume est si chaude, si délicate, elle fait plier légèrement mon cou ; le sien se plie aussi, et nos visages se rapprochent : jusqu’à ce que ses lèvres tremblantes se posent sur les miennes. Puis, très vite, son baiser se fait plus appuyé, et sa langue s’insinue entre mes lèvres.
Jérém m’embrasse et dans ma tête c’est le blackout ; je l’embrasse à mon tour, heureux, en larmes.
Dans un coin de la halle de Campan, pendant que la pluie tombe dehors, voilà enfin le premier vrai baiser de Jérém, à la fois fougueux et presque désespéré.
Jérém m’embrasse longuement, le goût de ses lèvres est délicieux. Un instant plus tard, son nez, son souffle et ses lèvres effleurent la peau de mon cou : je vais devenir dingue.
« Ça te convient comme réponse ? ».
« Quelle réponse ? » je fais, perdu, désorienté.
« Tu voulais savoir ce que ça veut dire MonNico… »
« Ah, oui… c’est un bon début… ».
« Tu m’as manqué… » il me chuchote.
« Toi aussi tu m’as manqué… »
Je pleure.
« Ne pleure pas Nico… ».
Je le sens lui aussi au bord des larmes.
« J’ai eu tellement peur… ».
« Je suis là, je suis là… ».
« Je suis content que tu sois là… » il me glisse à l’oreille, alors que la chaleur de son corps, la puissance de son étreinte, ses bisous dans le cou, son parfum m’étourdissent.
« Tu veux toujours repartir à Toulouse ? » il me nargue, adorable.
« Je crois que je vais attendre un peu… ».
The long and winding road that leads to your door/La longue et sinueuse route qui mène à ta porte
Will never disappear, I've seen that road before/Ne disparaîtra jamais, j'ai déjà vu cette route.
It always leads me here/Elle me conduit toujours ici,
Leads me to your door/Elle me conduit à ta porte.
* et ** : retrouvez les épisodes inédits des souvenirs des voyages en Italie et en Espagne de Jérém et Nico, ainsi que d’autres surprises inédites, dans le livre « Jérém, qui est-il ce garçon ? » disponible en pdf dès maintenant ou en version papier en précommande (parution décembre 2018).
 12 commentaires
12 commentaires
-
Jeudi 6 septembre 2001
Des abdos, des pectoraux qui se frôlent, des lèvres qui se touchent, des langues qui se mélangent. Les pectoraux bien dessiné s'attirent, les corps nus s’enlacent. Une main enserre les deux sexes tendus dans la même étreinte, puis elle démarre des mouvements de va-et-vient. Deux garçons frissonnent à l’unisson.
Le plaisir monte et explose, jusqu’à ce que les deux potes, repus de plaisir, libérés de leurs tensions sexuelles, le bas ventre irradiant cette chaleur qui est l’arrière-goût d’un orgasme intense, s’abandonnent l’un dans les bras de l’autre, trouvant doux et rassurant ce contact avec le corps de l’autre, semblable au sien.
Depuis presque deux semaines, depuis que Thibault m’a raconté ce qui s’est passé avec Jérém, il ne s’est écoulé une heure sans que ce genre d’images viennent me hanter, à la fois excitantes et blessantes, piquant ma jalousie à vif. Pas une heure sans que j’essaie d’imaginer Jérém et Thibault dans un lit, en train de se donner du plaisir.
Pas une heure, sans que je ne me pose les mêmes questions : comment se donnent du plaisir deux mecs comme Jérém et Thibault ? Jusqu’où sont-ils allés ? Qui a fait quoi? Est-ce qu’ils ont recommencé depuis ?
Et presqu’à chaque fois, je remonte jusqu’à cette nuit d'il y a quelques mois où nous avions couché tous les trois ensemble. Je repense à cette attirance que j’avais cru deviner entre eux et qui m’avait pas mal inquiété à ce moment-là. Et je me dis qu'au fond je m'attendais à ce que Jérém et Thibault couchent ensemble un jour.
Mais ce n’est pas pour autant que cela est plus facile à accepter.
J’essaie de ne pas y penser, mais plus j’essaie, plus j’échoue, plus j’y pense. Et à chaque fois, je suis happé par une nouvelle flambée de jalousie, tout aussi violente que la précédente : les jours s’enchaînent, et ma jalousie ne s’apaise pas.
Ce jeudi, la météo est grise sur Toulouse, tout comme elle l’est dans mon cœur : lorsque j’ouvre la fenêtre de ma chambre, je suis surpris par la caresse du vent d’Autan, cette caresse désormais fraîche, qui glisse sur ma peau et m’apporte des frissons qui annoncent les prémices de l’automne.
La fin de l’été nous surprend toujours : depuis des mois, on s’est habitué à vivre avec la chaleur de l’été, avec des journées interminables ; et puis on se réveille un matin, on ouvre la fenêtre, il fait gris, humide, la pluie menace ; et dans la fraîcheur du vent qui fait frissonner la peau, on sent l’odeur des feuilles mortes et de sous-bois, cette odeur qui nous rappelle à la conscience du temps qui passe, qui nous parle des choses laissées derrière nous, des souvenirs déjà lointains, et de l’inconnu qui s’ouvre devant nous.
Oui, on a beau s’être plaints pendant des mois des affres de la chaleur ; lorsque l’automne se manifeste, on regrette instantanément ce qu’on a déploré quelques semaines plus tôt. Ou même juste la veille.
L’estate sta finendo, lo sai che non mi va/L’été est en train de mourir, et tu sais que je n’aime pas ça
C’est le refrain d’un vieux 45 tours italien qu’écoutait maman quand j’étais enfant et dans lequel je retrouve toute la morosité de ces premiers jours de septembre.
L’été est en train de partir et l’automne arrive ; une page se tourne, en emportant avec elle les souvenirs d’un été déjà lointain dans mon esprit, les souvenirs de ce qui était et qui n’est plus, de ce qui est désormais – et à tout jamais – derrière moi.
Et le souvenir que je regrette par-dessous tout de laisser derrière moi est bien évidemment celui de cette semaine magique où, chaque jour pendant sa pause, Jérém était venu chez moi ; cette semaine où il semblait si détendu, si touchant, si différent ; cette semaine où il avait enfin accepté un peu de tendresse, quelques caresses, quelques bisous ; cette semaine où il m’avait fait l’amour et non pas juste la baise ; cette semaine où j’avais cru qu’un lien spécial était enfin en train de se tisser entre nous, un lien qui aurait résisté à la distance et au temps.
Pendant une poignée de jours, j’ai cru que quelque chose était possible avec Jérém, quelque chose au-delà du sexe, à condition que je sache attendre ; j’ai cru qu’on trouverait le moyen, car on l’aurait voulu tous les deux, de continuer à se voir, à s’aimer malgré la distance qu’allait s’installer entre nous. J’ai cru que notre relation allait évoluer, parce que Jérém était en train de réaliser que j’étais spécial à ses yeux. Désormais, je sais que ce ne sera pas le cas.
Lorsque je pense à cette semaine magique et aux espoirs qu’elle avait fait naître en moi, avant qu’ils ne soient anéantis, je me sens perdu, malheureux, plein de désespoir ; j’ai l’impression que je ne pourrai plus jamais ressentir des sensations positives. Je voudrais trouver le moyen d’aller de l’avant, de me ressaisir, de me soustraire à cette dérive vers une tristesse sans fin : je n’y arrive pas.
Il y a bien une chose à laquelle je m’accroche pour essayer de relativiser mon chagrin, toujours la même, comme le seul pansement possible sur une blessure qui ne guérit pas : Jérém s’est réveillé du coma, il est vivant, et c’est le plus important.
Oui, Jérém est vivant, mais je l’ai perdu à tout jamais. C’est dur de l’accepter, mais je dois m’y faire.
J’essaie de me convaincre que c’était mon destin, que je ne peux rien contre ce destin, que nous n’étions pas faits pour être ensemble, car nous sommes très différents, trop différents ; que, de toute façon, désormais nos planètes nous séparent ; qu’au fond, c’est une bonne chose que Jérém n’ait plus à se prendre la tête avec moi et avec ce côté de lui qu’il n’arrive pas à assumer, surtout en ce moment où il a besoin de toute son énergie pour se lancer dans l’aventure du rugby pro parisien.
Renoncer à celui qu’on aime, c’est très dur : pourtant, il y a dans le renoncement comme une forme de soulagement, comme un dernier rempart contre une souffrance insupportable, pour l’empêcher de nous rendre fous.
Ce matin, contrairement aux jours précédents, j’ai envie d’aller courir sur le Canal. Non pas que mon humeur se soit vraiment améliorée, c’est surtout que je n’en peux plus de rester enfermé entre les quatre murs de ma chambre, allongé sur mon lit : mon corps étouffe, il réclame, exige de l’activité physique.
Mais alors que je m’apprête à quitter la maison, le ciel est toujours gris, le vent d’Autan toujours aussi mordant, et mon moral tout autant dans mes chaussettes.
« Nico, tu penses à rassembler les papiers pour la visite de samedi ? ».
« Oui maman, j’y pense… ».
Comment je pourrais oublier ces quelques papiers à réunir, ce premier pas vers ma nouvelle vie, cette virée à Bordeaux pour signer les papiers de mon futur studio ?
Maman me demande à quelle heure je vais rentrer. Je regarde mon téléphone, il affiche 10h13. Je lui réponds que je serai de retour avant midi.
A cet instant précis, j’ignore encore à quel point cette journée va être riche en événements ; qu’avant la fin de l’après-midi, mon état d’esprit va changer de façon plutôt radicale ; et, surtout, à cet instant précis, je suis à mille années-lumière d’imaginer que, dans 8 heures et 12 minutes exactement, à 18h25, un événement inattendu et bouleversant va définitivement me secouer de ma torpeur, de ma morosité, de ma rancœur.
Mais revenons aux faits, dans l’ordre naturel où ils se sont déroulés en cette journée si particulière du jeudi 06 septembre 2001.
Sur le Canal, il n’y a pas grand monde : la rentrée est bien là, la plupart des Toulousains ont repris le travail. Pendant de longs moments, j’ai carrément l’impression d’être seul avec les platanes, seul avec l’eau en contrebas, et avec les quelques péniches ; une sensation qui s’accentue encore lorsque les immeubles de la ville laissent progressivement la place aux résidences, puis à des maisons, puis à un paysage plus campagnard ; lorsque le bruit de la circulation se fait de plus en plus faible, de plus en plus éloigné, et que peu à peu le bruit des feuillages caressés par le vent devient le seul à accompagner mes foulées.
Ce matin, je n’ai même pas pris mon baladeur mp3 : je suis parti dans la précipitation, comme si j’avais été longtemps la tête sous l’eau et qu’il y avait urgence vitale à remonter au plus vite à la surface.
Au fil de l’activité physique, je sens que le mouvement procure une sensation de bien-être d’abord dans le corps, puis dans l’esprit.
Platane après platane, je sens mes poumons se remplir et se vider, de plus en plus profondément ; comme si mon corps était en train de se nettoyer, de se réveiller d’une longue léthargie ; peu à peu, je sens mes muscles s’échauffer, certaines tensions se libérer, ma tête se vider. L’exercice physique éclaircit l’esprit.
Plus j’avance, plus je me sens apaisé : jusqu’au moment où je me sens comme un tableau enfin nettoyé de toute inscription et rature enchevêtrées et désormais incompréhensibles, je me sens comme libéré des pensées qui m’oppressaient depuis trop de temps.
Oui, pour la première fois depuis des semaines, je ressens l’envie de tout reprendre depuis le début, tout ce qui s’est passé depuis la rupture avec Jérém, de l’afficher dans mon esprit comme sur une page blanche, et d’essayer d’y jeter un nouveau regard.
Constat : il s’est déjà écoulé presque quatre semaines, presqu’un mois depuis ce vendredi noir, depuis cette triste date du 10 août, cette date qui me hante, ce jour où j’ai dit « je t’aime » à Jérém, le jour où il m’a quitté, en me balançant que je n’étais pas le seul mec avec qui il avait couché et que je ne représentais rien de plus à ses yeux qu’un cul à baiser ; le jour où je lui ai mis mon poing dans la gueule, avant qu’il ne me mette le sien dans la mienne ; le jour où maman nous a surpris le nez en sang, le jour où elle a su pour moi.
Bientôt deux semaines depuis la dernière fois que je l’ai croisé, alors que j’étais en compagnie de Martin, depuis cette dernière prise de tête, depuis la violence de ses mots ; bientôt deux semaines depuis son accident, depuis l’« aveu » de Thibault, cet aveu qui m’a projeté dans un nouvel univers de souffrance, s’ajoutant et dépassant même la souffrance de la séparation de Jérém.
Oui, dans les ruptures, le plus dur à supporter ce sont les « anniversaires » : le plus dur c’est de se dire « il y a une semaine, un mois, j’étais avec lui, on faisait ceci et cela, j’étais heureux avec lui, et c’est fini ».
Pourtant, au fur et à mesure que mon corps s’échauffe et que je m’éloigne de la ville, je sens quelque chose d’inattendu se produire en moi ; j’ai l’impression de prendre de la distance et du recul, de la hauteur par rapport au brouillard qui me bouchait la vue depuis des semaines.
Soudainement, je me rends compte que je suis trop longtemps resté bloqué sur une série d’équations qui m’avaient jusque-là parues imparables, mais dont les enchaînements m’apparaissaient désormais comme étant grossièrement inexacts.
Mes équations étaient les suivantes :
(Je dis « je t’aime » à Jérém) + (Il me quitte) + (Il me dit qu’il baise ailleurs, et pas qu’avec des filles, et que je ne suis rien pour lui) =
= (je lui tape dans la gueule) + (il me tape dans la gueule à son tour) =
= (je me dis que rien n’est possible avec lui, qu’il m’a fait trop mal) + (Je sors dans une boîte gay, je tente de l’oublier en cédant à la proposition de Martin de le suivre chez lui) + (Je le croise sur les boulevards, il est saoul, il est méchant, agressif, je pars avec Martin) =
= (Il y a l’accident, le coma, la peur qu’il ne se réveille pas) + (Thibault m’avoue ce qui s’est passé entre eux) = (J’ai peur, pourvu que Jérém se réveille…).
(Jérém se réveille) = (La peur laisse la place à la jalousie, à la rancœur envers Jérém et Thibault) + (Je veux tout oublier, tout laisser derrière moi).
Une succession d’équations qui m’a semblé évidente et limpide jusqu’à ce matin, au réveil ; mais qui, foulée après foulée, semble désormais montrer de sérieux problèmes de structuration. Mes certitudes vacillent. Ma jalousie est-elle vraiment totalement justifiée ? Et ma colère ?
Je suis perdu, j’ai besoin d’aide pour y voir clair.
Par chance, ma cousine Elodie est libre entre midi et deux ; je lui propose de déjeuner en ville.
« Comment ça va mon cousin ? ».
« Bof… ».
« Tu as des nouvelles de ton bobrun ? ».
Cash. Son uppercut est franc, direct, à brûle pourpoint.
« Non… ».
« T’as essayé de l’appeler ? ».
« Pour quoi faire ? ».
« Pour savoir comment il va… pour lui dire que ça a été une connerie de ta part de te casser avec l’autre mec, pour lui dire que tu as eu la trouille de ta vie après son accident, et pour lui dire aussi que tu l’aimes… ».
« Je lui ai dit, et il m’a quitté ! ».
« On s’en fout de ça… il ne sait pas ce qu’il veut… il attend que tu lui dises… ».
« Que je lui dise quoi… ».
« Ce que tu veux, toi… ».
« C’est tellement simple à dire… essaie, toi, de parler avec un mur… ».
« Essaie… ça pourrait l’être… ».
« J’ai essayé, je me suis cassé les dents… c’est pas simple, non… ».
« Essai encore, ça pourrait le devenir… il ne faut pas avoir peur de l’échec… il faut partir confiant… ».
« Si seulement je savais pourquoi Jérém avait autant du mal à assumer ce qu’il y avait entre nous… si seulement je connaissais la raison de ce refus si violent de s’accepter… ».
« Tu sais, même s’il se la joue kéké très sûr de lui, au fond Jérém n’a que 19 ans… ce qui pourrait expliquer qu’il n’agit pas forcément « logiquement », car au plus profond de lui, il a peur… souvent, la violence n’est que la réaction visible et virilement acceptable de la peur… ».
Je me tais, pensif.
« Tu tournes encore en rond sur ce qui s’est passé entre lui et son pote ? » elle enchaîne, de but en blanc. Elodie ou l’art de mettre les pieds dans le plat. Au temps pour moi, je lui ai raconté.
« Oui, toujours… ».
« Tu ne m’enlèveras pas de la tête que tout irait mieux pour toi si tu ne leur en tenais pas autant rigueur… ».
« Ah ouaisss… tu crois… comment tu te sentirais si le mec que tu kiffes, avec qui tu couches, qui te rabâche sans cesse qu’il n’est pas pd, couchait avec son meilleur pote, qui est aussi ton pote, et qui semblait jusque-là vouloir t'aider à te rapprocher de son pote à lui, c'est-à-dire le mec que tu kiffes ? Tu ne serais pas en colère ? Tu ne te sentirais pas trahie ? ».
« A mon sens, ce qui s’est passé entre eux n’est qu’un dérapage entre deux mec perdus… ton Jérém était au bout du rouleau, et il a trouvé réconfortant de se laisser aller dans les bras de la personne qui le connaît et le comprend le plus que toute autre au monde… quant à Thibault, s’il est amoureux de son pote depuis longtemps, comment aurait-il pu résister ? Tu ne t’es jamais demandé comment tu aurais réagi à sa place ? ».
« Non, pas vraiment… » je réalise à haute voix.
« Moi je trouve que cette situation est très dure pour lui… » enchaîne Elodie « et je trouve que tu es assez dur avec lui… Thibault est un garçon exceptionnel, qui a toujours été adorable avec toi, tu me l’as dit plein de fois… si cette situation s’était produite avec un autre gars, je comprendrais… mais là, c’est Thibault… et je ne pense pas que Thibault ait voulu profiter de la détresse de son pote pour laisser libre cours à son désir longtemps refoulé… Thibault n’est pas un mec à te planter un couteau dans le dos, c’est pour ça que je crois que ce qui s’est passé avec ton bobrun ce n’est pas une tromperie « ordinaire »… ».
« Alors, tu réagirais comment à ma place ? ».
« Je pense que je serai un peu secouée c’est certain, mais je pense aussi que je n’aurais pas pu refuser d’entendre les raisons de Thibault, je crois que je n’aurais pas pu rester insensible à la détresse d’un garçon comme lui au moment où il avoue ce qui s’est passé… je serai peut-être en colère, oui, mais je ne refuserai pas de dialoguer avec lui, je pense que je voudrais comprendre… je pense que tu devrais laisser une chance à Thibault de s’expliquer… ».
« Je n’ai pas envie de reparler de cette histoire avec lui … ».
« Alors tu vas renoncer à son amitié ? ».
Je ne sais pas vraiment quoi répondre à cette question.
« Mais merde, c’est Thibault quand même ! » enchaîne Elodie « le même mec que tu admirais quelques minutes à peine avant ses aveux, en qui tu voyais un modèle de droiture, un roc solide sur lequel t’appuyer… ».
« C’est justement ça qui fait le plus mal… lui avoir fait confiance et apprendre ce qui s’est passé… ».
« J’imagine ce que tu peux ressentir, et je crois que c’est pour ça aussi que tu es si choqué. Mais en même temps, je me dis que pour qu’un garçon comme Thibault agisse ainsi, il y a forcément une raison ; d’autant plus qu’il t’a lui-même avoué ce qui s’est passé, alors qu’il aurait pu se taire.
Je ne dis pas que je pardonnerai sans hésitation, je dis juste que je ne serai pas aussi distant que tu l’as été… d’autant plus que, dans l’histoire, c’est lui à mon sens le grand perdant… oui, il a couché avec son pote… mais qu’est-il arrivé par la suite ? Jérém est parti de chez lui, et il ne l’a plus revu, jusqu’à l’accident… ce mec doit se sentir très mal… et, en plus, toi non plus tu ne lui parles plus… ».
« Je ne sais vraiment pas quoi penser… et encore moins quoi faire… ».
« Je suis sûre que tu sais parfaitement… ».
En marchant vers la maison, après avoir quitté Elodie, je reprends une fois de plus la série d’équations avec lesquelles j’ai tenté de gérer les événements récents.
Et là, soudainement, la réponse à mes doutes au sujet de leur pertinence se présente à moi comme une évidence. Le problème est là, devant mes yeux : l’« aveu » de Thibault, dernière variable arrivée dans l’équation, accapare toute mon attention, et fausse le résultat final, mon jugement ; elle génère des perturbations – une insupportable jalousie, un sentiment de trahison – qui invalident tout le process.
La solution est tout aussi évidente : il faut à tout prix sortir cette dernière variable de l’équation.
Allons-y.
Ainsi, dès que j’essaie à mettre de côté ce qui s’est passé entre Jérém et Thibault, je retrouve presque instantanément mon état d’esprit juste avant l’accident : un état d’esprit rempli de regrets et de remords.
Le remord de lui avoir proposé les révisions, l’entraînant de fait dans un énorme problème d’acceptation de soi, l’entraînant dans cette spirale destructrice ; peut-être qu’un jour il aurait de toute façon « révisé » avec un autre mec, mais je n’aurais pas été responsable de l’enchaînement d’évènements, d’états d’esprit négatifs et destructeurs qui ont mené à cet accident.
Le regret de ne pas avoir su (ou voulu) voir son immense solitude et son désespoir derrière la violence de ses propos, de ses agissements, de ses attitudes.
Le remord de ne pas avoir écouté les personnes qui m’entouraient, Thibault en premier, m’encourageant à tenir bon, à être patient mais persévérant avec Jérém.
Le remord de ne pas avoir su veiller sur Jérém alors qu’il était en danger, et alors que, là aussi, j’en avais été alerté par Thibault.
Le regret de ne pas avoir planté Martin une fois de plus – et qu’importe s’il en aurait été vexé – pour montrer à Jérém à quel point non, je n’étais pas « à nouveau amoureux », car je l’étais toujours de lui, et de lui seulement, comme un fou.
Le regret de ne pas avoir su lui dire à quel point il était la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie ; à quel point mon cœur n’aspirait qu’à le retrouver, lui ; le regret de ne pas avoir su le prendre dans mes bras, le serrer très fort contre moi, et lui dire et lui redire à quel point je l’aimais comme un fou.
Le regret de ne pas avoir su trouver les bons mots pour le retenir, sans même avoir essayé de les chercher, considérant que tout était foutu entre nous.
Le regret de ne pas lui avoir proposé de rentrer avec lui.
(Est-ce qu’il se serait laissé faire ? Ça, malheureusement, je ne le saurai jamais : mais qui ne tente rien…).
Le remord d’avoir montré à Jérém que je m’éloignais de lui, le regret de ne pas m’être assez battu pour le garçon que j’aime.
Au fond, je ne lui ai dit qu’une seule fois « Je t’aime ». Certes, sa réaction a été tout l’inverse de ce qu’on s’attendrait lorsqu’on se met autant à nu devant la personne aimée : me faire quitter, voir une capote voler de son jeans, m’entendre dire que je ne suis pour lui qu’un coup parmi tant d’autres, avec des nanas et des mec, se taper sur la gueule : vivre tout cela à la suite d’un « je t’aime », c’est horrible.
Mais peut-être que je me suis mal pris depuis le début avec lui : peut-être que je l’ai trop facilement cru lorsqu’il me certifiait qu’entre nous ce n’était que de la baise ; peut-être que je n’ai pas su lire entre les lignes et autour des signes qu’il m’a parfois envoyés ; je n’ai pas fait assez confiance aux conseils avisés de Thibault, me certifiant que, malgré ses attitudes et ses mauvais mots, j’étais quelqu’un de spécial à ses yeux.
Je voulais que les choses évoluent avec Jérém, je voulais que notre relation avance, j’ai voulu forcer les choses avec mon « je t’aime », tombé peut-être au mauvais moment. Oui, je voulais que les choses évoluent entre nous : mais est-ce que je me suis vraiment demandé comment il envisageait lui, vraiment, notre relation ? Je n’ai pas vraiment le souvenir de lui avoir posé calmement la question. Je me suis contenté d’imaginer ce qui se passait dans sa tête, sans jamais essayer de savoir vraiment. J’avais certainement peur de savoir.
La nuit de l’accident, j’ai cru bon partir avec Martin pour « enfin penser à moi au lieu de penser à Jérém » : peut-être qu’en fin de compte je pensais un petit peu trop à moi depuis le début, alors que je prétendais le contraire.
Est-ce aimer, que de se contenter d’attendre que l’autre soit tel qu’on le voudrait ? Aimer n’est pas plutôt savoir comprendre ce que rend l’autre heureux, où se situe son bonheur, avant de tout faire pour lui apporter ce bonheur ?
Peut-être qu’il y a davantage d’amour dans l’abnégation et la bienveillance sans faille de Thibault que dans tous mes efforts de construire une relation avec Jérém, y compris dans mon « je t’aime » ; car le véritable amour est davantage dans l’écoute, dans nos mots et dans nos actes que dans l’attente des mots et des actes de l’autre. Aussi, l’amour, est dans la persévérance.
Oui, je ne lui ai dit « je t’aime » qu’une seule et unique fois ; et même si cela s’est mal passé, est-ce que je n’ai pas renoncé un peu trop vite à me battre pour… nous ?
Pourquoi je n’ai pas su aller plus loin, pourquoi je n’ai pas su tenter autre chose ?
Pour me protéger, certainement : et d’un autre côté, aurait-il été utile et raisonnable de ramper une nouvelle fois à ses pieds en espérant le toucher, alors que j’avais échoué tant de fois ?
Mais quand on est vraiment amoureux, vraiment fou amoureux, on est prêt à tout, même à l’irraisonnable…
Suis-je donc véritablement amoureux ? Où se situe la frontière entre aimer sans conditions, se laisser happer par une relation destructrice et le besoin de se protéger ?
Je ne le sais pas vraiment… mais est-ce que je n’aurais pas dû tenter autre chose avant de baisser les bras ?
Car même si le « je t’aime » avait été balayé par un revers de main (ou plutôt par un coup de poing), il avait été dit et entendu. Et peut-être il avait fait du chemin dans sa tête.
Soudainement, je repense au petit échange avec Maxime, lorsqu’il m’avait surpris en train de tenir la main de son frérot inconscient sur le lit d’hôpital.
« Tu kiffes mon frangin ? ». « Et lui, il te kiffe aussi ? ». « Je crois qu’il te kiffe aussi ».
Trois phrases, comme la story d’une prise de conscience qui venait peut-être tout juste de lui sauter aux yeux ; le jeune Maxime venait peut-être tout simplement de faire le lien entre le malaise de son frère dont il avait été témoin pendant la semaine avant l’accident, et ma présence, mon attitude, ma tristesse.
Même son jeune frère, celui qui doit le connaître le mieux en dehors de Thibault, semble avoir compris que Jérém m’a dans la peau… mais putain, Nico, qu’est-ce qu’il te faut de plus ?
Et je repense à « MonNico »… « C’est qui, « MonNico » ? » avait demandé une greluche la dernière fois que j’avais composé son numéro… « C’est personne… » avait répondu Jérém, sur le coup de la colère, juste avant de me raccrocher au nez. Pourtant, ce n’est pas rien, « MonNico »…
Est-ce que je suis encore dans les temps pour tenter de le retrouver, de le rattraper ? Si seulement je savais où il est en ce moment…si seulement je n’avais pas si peur de composer les dix chiffres de son portable…
Et alors que je traverse le pont St Michel, un autre sujet me tracasse : mon attitude vis-à-vis de Thibault après l’accident de Jérém, après ses « aveux ».
Car, si j’enlève cette fameuse variable de l’équation de mon état d’esprit, je n’ai aucun mal à retrouver ce que représentait Thibault à mes yeux auparavant : un gars pour qui j’avais une immense admiration et un estime sans failles, un gars adorable sous tout point de vue ; le mec le plus droit, honnête et irréprochable que je connaisse ; un gars pour lequel je ressentais une profonde amitié, réciproque qui plus est. Oui, Thibault était un véritable ami, dont le soutien a été précieux, dont la présence a été un véritable encouragement.
Alors, est-ce que ce qui s’est passé entre les deux potes est si grave au point de lui en vouloir autant ? Est-ce que je n’ai pas été trop dur avec lui ? Est-ce que je n’ai pas coupé les ponts trop vite ? Est-ce que j’aurais dû lui laisser une chance de s’expliquer ?
Je crois qu’Elodie a raison, une fois de plus. Soudainement, je me rends compte que je n’ai pas été cool du tout avec le bomécano : au lieu de le réconforter comme lui l’a toujours fait avec moi, j’ai laissé ma colère et ma jalousie dévorantes m’envahir ; je me suis éloigné de lui, je lui ai laissé entrevoir ma colère, le laissant seul avec son fardeau, en lui rajoutant même le poids de ma rancœur à son égard.
Le pire, c’est que j’avais été profondément touché par la détresse de Thibault, d’abord au téléphone, puis, lorsque je l’avais retrouvé à l’hôpital, jusqu’à ses « aveux » à la cafétéria.
Je repense à ce moment, à ses mots me racontent ce qui s’était passé avec Jérém ; et je revois un Thibault plus que jamais effondré, lui aussi submergé par les remords et les regrets, cherchant désespérément à me faire comprendre qu’il s’en voulait pour ce qui s’était passé, parce que cela avait éloigné son pote de lui, parce qu’il savait qu’il m’avait fait du mal.
C’était un Thibault en détresse, une détresse qui était pourtant la même qu’avant ses « aveux » : le « roc » était à genoux, et je n’ai pas su lui tendre une main pour l’aider à se relever. Je m’en veux horriblement.
Je me rends compte que dans cette histoire, Thibault a tout perdu, et même cette nuit passée avec Jérém ne lui aura rien apporté, que des remords et de la culpabilité. Finalement, dans cette histoire, Thibault a plus perdu que moi.
Elodie a certainement raison, là encore. Si cette nuit-là Jéjé et Thib se sont donnés du plaisir, c’est parce qu’ils en avaient besoin, plus qu’une envie c’était un besoin : parce que Jérém était paumé, perdu, et parce que Thibault voulait le protéger ; se donner du plaisir, c’est probablement la seule solution qu’ils avaient trouvée pour tenter d’apaiser leur mal-être.
Je réalise que j’ai été profondément injuste avec Thibault : car, au fond, ma colère est moins dans le fait que les deux potes aient couché ensemble, que dans le fait de ne pas avoir su retenir Jérém, d’avoir capitulé devant la difficulté, d’avoir baissé les bras trop tôt. C’est à moi que j’en veux, et c’est contre Thibault que je reporte ma colère.
Oui, définitivement, Thibault est un garçon adorable, quelqu’un de vraiment spécial : je ne peux pas lui en vouloir éternellement à cause d’un moment de faiblesse, surtout en sachant ce qu’il a enduré pendant toutes ces années de complicité, de proximité, d’attirance latente, cachée, ambiguë vis-à-vis de Jérém.
D’autant plus que je devine très bien sa frustration, car j’ai connu la même pendant les trois années du lycée ; une frustration qui a été encore plus importante que la mienne, car elle s’est étirée sur tant d’années ; une frustration encore plus dure à supporter, en raison du fait que Thibault a été amené à côtoyer régulièrement, et dans tant de situations, ce pote dont il était amoureux et à qui il ne pouvait pas avouer ses sentiments.
Oui, là encore, la cousine a raison : qu’est-ce que j’aurais fait, moi, à la place de Thibault ?
Soudainement, je me rends compte qu’en l’espace de quelques heures, en reprenant toutes mes équations, je suis passé de l’ancien résultat : (Tout oublier, tout laisser derrière moi) au nouveau résultat : (Maîtriser ma colère au plus vite et faire un pas vers Thibault… et un autre vers Jérém…).
Je réalise que, s’il est vrai qu’il y a dans le renoncement une forme de soulagement, il est tout aussi vrai que renoncer c’est aussi la voie de la facilité, de la faiblesse ; renoncer, c’est se rendre devant quelque chose qui est hors de notre portée. Et qu’il le sera d’autant plus du fait de notre renoncement.
Quand on aime vraiment, on tente tout, vraiment : on essaie, on échoue, on essaie encore, et encore, et encore ; quand on aime vraiment, il n’y a pas d’obstacles insurmontables, « no mountains too high, no river too wide ».
Jérém n’est pas hors de ma portée. Je peux rattraper le coup. La tâche peut paraître dure, elle peut sembler démentielle. Les mots d’un prof de philo me reviennent à l’esprit : lorsque la montagne parait trop haute, il ne faut pas regarder le sommet ; il faut regarder le bosquet qui se situe à quelques heures de marche, il faut avancer vers lui, comme si c’était le but ultime ; une fois atteint ce but, il faut se féliciter du chemin parcouru ; le lendemain, il faut chercher un autre bosquet, une roche, un pont : bref, un nouvel objectif réalisable, le poursuivre, l’atteindre, se féliciter à nouveau ; ainsi le lendemain et le sur lendemain. Au bout de quelques jours, lorsqu’on se retournera pour contempler le chemin parcouru, on sera étonnés et fiers de nos efforts ; et le sommet ne semblera plus si lointain, il sera à notre portée.
A 17h38 ce jeudi 6 septembre, le renoncement que j’avais envisagé une fois encore le matin même, n’est plus à l’ordre du jour.
Premier objectif, le « bosquet » : chercher à contacter Thibault.
Je reviens sur mes pas, je traverse la moitié de la ville pour me rendre au garage à côté de la gare Matabiau, je traîne à proximité pendant un petit moment en faisant mine d’être au téléphone : mais le bomécano n’est pas là. Sur le coup, je trouve cela étonnant ; du moins jusqu’à ce que je réalise que très probablement Thibault a commencé sa préparation physique et les entraînements au Stade et qu’il ne travaille plus au garage.
Je sors mon téléphone de ma poche, mais mon élan s’arrête vite, s’arrête net : j’ai à la fois envie de l’appeler et peur de le déranger, car je l’imagine bien occupé ; aussi, j’ai à la fois envie de l’appeler et peur de le faire, peur d’avoir trop attendu avant de revenir vers lui ; oui, au fond de moi, j’ai peur qu’il n’ait plus envie de me parler.
Appelle, Nico ! Demande-lui comment il va, pour commencer, ça ne pourra que lui faire plaisir. Appelle, ne te pose pas plus de questions : quand on s’inquiète pour un ami, il n’y a pas d’heure, il n’y a pas d’excuse, il n’y a pas de peur qui tienne pour ne pas prendre de ses nouvelles.
Un instant plus tard, je compose son numéro ; ça sonne une, deux, trois, quatre fois : j’ai le cœur qui tape à mille à l’heure, j’ai peur de ne pas trouver les mots…
J’éprouve un certain soulagement en me disant que je vais tomber sur le répondeur, que je vais pouvoir lui laisser un message sans avoir besoin de lui parler directement, sans avoir besoin de connaître son état d’esprit vis-à-vis de moi.
Mais ça finit par décrocher.
« Salut, Nico… ».
Le ton est calme, neutre, mais il n’y a pas l’emphase que je lui connais d’habitude.
« Salut Thibault… comment ça va ? ».
« Ca va, ça va… et toi ? ».
« Ca va aussi… ».
Thibault n’enchaîne pas tout de suite, je cherche mes mots aussi. Il y a visiblement un malaise.
« Tu as commencé les entraînements au Stade ? » je trouve enfin.
« Oui, il y a deux semaines… ».
« Ça se passe bien ? ».
« Nico… ».
« Oui… ? ».
« Je ne peux pas te parler là, je pars en mission… ».
« Tu es toujours pompier… ».
« Oui, bien sûr… ».
« Tu es un gars incroyable… ».
Silence de sa part.
« Je dois y aller… » il finit par lâcher.
« Thibault… ».
« Oui ? ».
« Je suis deso… ».
« Non, Nico » il me coupe net « c’est pas toi qui dois l’être… ».
« Je peux te rappeler demain ? ».
« Je ne sais pas trop… j’ai plein de trucs à régler… je te rappellerai moi, un de ces quatre… ».
« Ok, Thibault… ».
« Salut, Nico… ».
« Salut, Thibault… ».
Je raccroche, les larmes aux yeux. Vraiment, ce mec me touche profondément ; j’ai senti de la tristesse dans sa voix ; j’ai senti du malaise, de la distance entre nous : et ça m’arrache le cœur.
Thibault a coupé court à mon coup de fil et je ne peux m’empêcher de me demander s’il était juste pressé, ou s’il n’y a pas autre chose à retenir dans sa façon de m’expédier.
Est-ce qu’il essaie de se protéger de tout ce qui le ramène aux événements récents et douloureux, est-ce qu’il essaie de prendre de la distance et d’oublier comme j’ai voulu le faire moi aussi encore il y a quelques heures ?
Ou bien, est-ce qu’il m’en veut ? Est-ce que j’ai vraiment trop attendu longtemps pour revenir vers lui ?
Est-ce qu’il va vraiment me rappeler ? « Un de ces quatre », il a dit : une formule qui est souvent synonyme de « probablement jamais ».
18h01. Lorsque je rentre à la maison, maman me demande comment je vais. Elle me demande si j’avais eu des nouvelles de mon camarade après qu’il était sorti de l’hôpital. Lorsque je lui réponds que non, sa question est la même que celle d’Elodie :
« Tu as essayé de l’appeler ? ».
Une fois de plus, je me rends compte de la chance que j’ai d’être aussi bien entouré.
« Non… ».
« Il compte vraiment beaucoup pour toi, ce garçon ? ».
« Oui, beaucoup… ».
« Alors tu devrais essayer de l’appeler… ».
18h19, je monte dans ma chambre, bien décidé à envisager une nouvelle étape vers le sommet, une étape qui me fait particulièrement peur, celle du « pont suspendu sur la falaise » : appeler Jérém pour lui demander aussi « comment il va ».
Je m’allonge sur le lit, les yeux fermés, le cœur qui tape dans ma poitrine comme s’il voulait la défoncer.
Envie dévorante de le faire, d’entendre sa voix ; mais aussi peur de le faire, peur qu’il soit encore en colère contre moi, qu’il m’en veuille toujours d’être parti avec Martin, devant ses yeux ; peur de me faire jeter comme un malpropre ; peur qu’il me balance de nouvelles horreurs ; peur qu’il décroche, et qu’il soit froid, distant ; peur qu’il décroche et qu’il me dise de lui foutre la paix ; peur que ça décroche et de tomber une fois de plus sur une pouffe ; peur qu’il me raccroche au nez, comme la dernière fois ; peur qu’il ne décroche même pas.
Tant de peurs et quelques espoirs également : l’espoir que, depuis le soir de l’accident, les choses se soient tassées, que sa colère se soit apaisée ; l’espoir que, depuis le jour de notre rupture, il ait entendu mon « je t’aime » et que vraiment cela ait fait son chemin dans sa tête.
Où est-il, Jérém à cet instant précis ? Que fait-il ? De quoi et de qui sont remplies ses journées ? Quel est le bon moment pour l’appeler sans le déranger ?
18h24. J’ai décidé que la bonne heure, c’est maintenant. J’attrape mon portable, je le passe nerveusement, fébrilement d’une main à l’autre, cherchant le courage pour composer son numéro. Je le pose sur le lit, je respire profondément. Je n’ai encore rien fait et je suis déjà ko.
Il est 18h25 lorsque la sonnerie du téléphone retentit dans la chambre, un peu étouffée par le contact avec les draps. C’est certainement Elodie qui veut savoir comment je vais depuis tout à l’heure.
J’attrape l’appareil, plutôt sûr de mon intuition ; une intuition pourtant destinée à être démentie, car le petit écran n’affiche pas du tout ce à quoi je m’attendais : il n’y a pas de nom, ce n’est qu’une succession de dix chiffres, c’est un numéro qui n’est pas dans mon répertoire.
Enfin, il ne l’est plus ; oui, mon cœur a des ratés lorsque je reconnais le contact que j’avais effacé de la mémoire du tel quelques semaines plus tôt (avec tous les échanges d’sms liés), mais certainement pas effacé de la mienne, de mémoire.
Dix chiffres si familiers, dix chiffres qui m’assomment comme un coup de massue, qui ravivent un chagrin toujours si vif.
Je reconnais le numéro de Jérém et tout remonte en moi, un désir violent de le revoir, accompagné d’une nouvelle flambée de colère et de jalousie tout aussi violente.
J’ai envie de répondre, mais je n’ai pas le cran de répondre. Je suis comme tétanisé.
La sonnerie finit par s’arrêter. J’ai l’impression que je vais faire un malaise. Que mon cœur va exploser, et mes poumons avec. Je suis en nage, j’ai du mal à respirer. Je reste allongé, immobile pendant un long moment. J’attends de voir s’il laisse un message, partagé entre l’envie et la crainte d’entendre sa voix. J’attends une minute, deux minutes dix minutes : aucun message ne vient.
J’ai besoin d’ouvrir la liste des appels récents pour me convaincre que je n’ai pas rêvé : non, je n’ai pas rêvé, c’est bien son numéro.
Pendant un instant, j’envisage la possibilité de le rappeler. Je n’y arrive pas.
Pourquoi il m’appelle ?
Après le dîner, je sors faire un tour en ville pour me changer les idées. J’ai envie de le rappeler, mais je n’y arrive toujours pas.
20h15. Je marche sur les quais du côté de la Daurade, lorsque le portable vibre dans ma poche. J’ai des sueurs froides à l’idée de lire le message qui vient d’arriver.
« Coucou mon cousin, je pense très fort à toi ! ».
Si Elodie n’existait pas, il faudrait l’inventer.
« Merci ma cousine, tu es adorable ».
Je range mon téléphone dans ma poche et je reprends ma respiration.
Je descends à la Garonne et je marche au bord de l’eau. L’automne est bien là, il n’est même pas 20h30 et le jour commence à décliner ; l’air est frais, et il y a beaucoup moins de monde sur les quais que pendant les chaudes soirées estivales.
Je n’ai pas fait cent mètres, que je sens à nouveau mon téléphone vibrer dans ma poche. C’est une vibration répétée, c’est le signal d’un coup de fil.
Je prends une bonne inspiration et je me saisis de l’appareil. Je regarde le petit écran et je suis assommé. La même séquence de chiffres que deux heures plus tôt, la même panique dans ma tête et dans mon cœur. Je laisse vibrer. J’ai l’impression que tout mon corps vibre avec.
Puis, certainement à la toute dernière secousse, je finis par décrocher, le cœur dans la gorge, le souffle coupé.
« A… a… allo ? » je bégaie, dans un état presque second.
« Nico… ».
Sa voix. Sa voix de mec. Cette vibration sensuelle et virile. Accompagné d’un petite hésitation inédite.
« Oui… » je lui réponds.
« C’est moi… ».
C’est la première fois qu’il m’appelle, et je crois que je ne vais pas survivre à cela.
« Je sais… ».
J’ai envie de pleurer. Pourtant, même si le geste de Jérém me touche infinimment, je ne peux m’empêcher de me montrer distant. Je suis heureux d’entendre sa voix, mais sa voix me renvoie aussi à de mauvais souvenirs, une capote qui vole, un poing dans la gueule, des mots blessants comme des lames.
J’entends sa voix et tout remonte, le bon et le mauvais. Et le mauvais, ça fait un mal de chien.
« Tu vas bien ? ».
« Oui… » je lâche, le cœur qui secoue ma poitrine de fond en comble.
« Ça me fait plaisir… ».
Silence assourdissant. Je regarde la silhouette massive du Pont Neuf qui se dresse devant moi, et je me demande si j’ai bien fait à décrocher. Je me sens comme en apnée, dans ma tête tout se bouscule, c’est un bazar monstre.
« Je voulais savoir comment tu allais…
« Je vais bien, je vais bien… et toi ? ».
« Je vais bien moi aussi… ».
Nouveau silence de part et d’autre.
C’est désormais sur l’ancien Hôpital Militaire de la Grave avec son dôme imposant que je laisse de poser mon regard, tout en me demandant si je vais craquer ou pas.
« T’as eu ton permis ? » il me lance de but en blanc.
« Oui, je l’ai eu la semaine dernière… ».
« T’as une voiture ? ».
« Pourquoi ? ».
Décidemment, je n’arrive pas à me sortir de cette attitude sur la défensive.
« Je me disais que si tu avais ton permis… et une voiture… » il hésite.
« Quoi ? » je m’impatiente.
« Ça me ferait plaisir de… » il hésite à nouveau.
« De quoi ? ».
« De te voir ce week-end… ».
« T’es sérieux ? ».
« Oui, Nico… ».
« T’es où ? ».
« A Campan… dans la maison de mon papi… ».
Silence de ma part, le cœur va exploser. Ou alors, il a déjà explosé. Je marche sur le bord du quai, je regarde l’eau du fleuve dans lesquelles les lumières du soir commencent à se réfléchir. J’a besoin de m’arrêter, de m’asseoir.
Ce coup de fil est tellement soudain, inattendu que j’en tremble, j’en perds tous mes moyens ; et cette proposition est, elle aussi, trop soudaine, trop rapide : je n’ai pas le temps de réaliser ce que je suis en train de vivre, je me sens comme un lapin pris dans les phares d’une voiture.
« Nico… ».
« C’est où ça ? » j’essaie de gagner du temps.
« Dans les Hautes-Pyrénées, à côté de Bagnères-de-Bigorre… ».
« Qu’est-ce que tu fous là-bas ? ».
« Je traîne, je récupère… ».
« Tu t’es remis de ton accident ? ».
« Moi je pense que oui… ».
« Tu pars quand à Paris ? ».
« Quand le médecin me donnera le feu vert… je dois passer des visites médicales à la fin du mois… ».
Nouveau silence.
« Tu es toujours sur Toulouse ? » il finit par me relancer.
« Oui… ».
« Tu pars quand à Bordeaux ? ».
« Dans 10 jours… ».
« Tu as une voiture, alors ? » il revient à la charge.
« J’ai une vieille Clio… ».
« Alors viens me rejoindre, Nico… ».
« Je ne peux pas ce week-end… » je lui réponds, en pensant à la visite de mon futur studio à Bordeaux.
Encore un blanc dans la conversation.
« Viens me rejoindre, Nico… c’est certainement le dernier week-end que je passe ici… ».
« Pourquoi tu veux me voir ? ».
« Je ne t’ai jamais remercié de m’avoir aidé à avoir mon bac… ».
« Je n’ai rien fait… ».
« Allez, Nico, viens passer le week-end avec moi… ».
Je suis de plus en plus submergé par l’émotion, je n’arrive toujours pas à décrocher un mot.
« Si tu ne te sens pas bien, tu repars aussitôt… » il essaie de me mettre à l’aise
« J’ai un truc de prévu ce week-end… ».
« Nico… ».
« Quoi ? ».
« Je t’attendrai sur la place du village demain à 18 heures… ».
Je commence vraiment à être ému.
« Je ne viendrai pas… je ne peux pas… ».
« Je sais que je me suis comporté comme un con avec toi… ».
Là, je suis ému aux larmes.
« Demain à 18 heures, je serai sur la place à Campan… » il continue « et j’espère que tu y seras aussi… ».
« Je dois y aller… » je coupe court, tout en essayant de maîtriser et de dissimuler mon émotion.
Un nouveau silence s’installe dans la conversation.
« Les chanceux c’est nous… » fait Jérém au bout d’un moment.
« De quoi ? ».
« Les chanceux c’est nous, c’est toi qui me l’as dit une fois… ».
« Je dois vraiment y aller… » j’insiste, comme un réflexe de survie ; je suis tellement assommé par son coup de fil que je n’arrive même plus à respirer.
« Si tu viens, fais gaffe sur la route, ils annoncent de la flotte dans les heures à venir… salut Nico… ».
« Salut… ».
 7 commentaires
7 commentaires
-
EPISODES version livre.
Vous pouvez laisser vos commentaires au fond de cette page. Merci d'avance !
01 Le t-shirt de Jérémie/Jérém ôte son t-shirt.
03 Souvenir de Jérém : 3 septembre 1998, là où tout a commencé (3 ans avant « première révision »).
04 Envie de Jérém pendant les cours
05 Souvenir de Jérémie : octobre 1998 (3 ans avant « première révision »).
06 Nouvelle révision Rue de la Colombette (mai 2001).
07 Souvenir de Jérémie. Voyage en Italie (deux ans avant "première révision").
La suite, dans un livre pdf et epub, à 7 euros, en cliquant ici.
Disponible maintenant !
Livre format numérique, première partie (pdf+epub, 250 pages) CLIQUEZ ICI
Livre complet, format numérique (pdf + epub, 500 pages, à paraître en décembre 2018) CLIQUEZ ICI
Livre papier (à paraître en décembre 2018) CLIQUEZ ICI
 votre commentaire
votre commentaire
Jérém&Nico - Saison 1