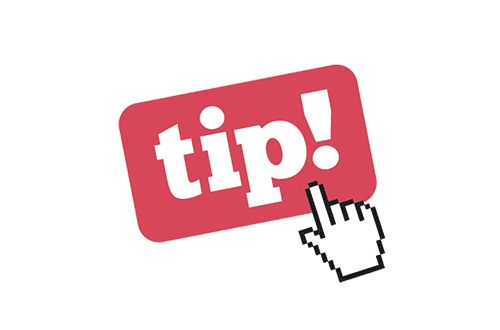-
Toulouse, le samedi 04 novembre 2017.
Hier soir, je suis retourné à Toulouse pour passer une partie du week-end avec mes parents. Et ce matin, après le petit-déjeuner, j’ai envie de faire un tour en ville.
Je me promène du côté des Carmes sans but précis, si ce n’est celui de prendre l’air, lorsque soudain, dans cette matinée grise et froide, dans mon horizon bouché par une intense mélancolie, un rayon de soleil apparaît. Il est intense, il est lumineux, il est aveuglant.
Une fraction de seconde, une image incomplète de toi captée du coin de l’œil, et je suis complètement subjugué. Car tu viens de m’arracher de ma morosité, tu viens de remettre des couleurs dans mon horizon terne.
Tu es rentré dans mon champ de vision, ton existence vient de m’être révélée. Et dès la toute première seconde, mon regard s’est trouvé comme verrouillé sur ta personne. Et plus rien n’existe autour de toi, et en dehors de toi.
Alors, je pile net. Tellement net que je manque de peu de me faire renverser par la nana qui me suit sur le trottoir, les yeux rivés sur son portable, ce qui lui la rend tout autant fautive que moi.
Ce matin, je n’avais pas prévu de faire une pause-café. Et pourtant, me voilà avec une soudaine envie de cappuccino.
Alors, sans te quitter des yeux, j’avance vers toi par le chemin le plus court. Je ne peux pas ne pas venir vers toi, j’ai besoin de voir ta belle petite gueule de plus près. J’ai besoin de capter tous les détails de ta beauté. J’ai besoin de comprendre si tu es réel ou bien si je n’ai fait que rêver de cette sublime beauté.
Je m’approche de l’entrée du café et, pendant un instant, je te contemple à travers la baie vitrée. Et là, en te regardant d’un peu plus près, le constat se confirme. Tu es vraiment, vraiment splendide.
Tu as des cheveux châtains très clairs, avec des reflets dorés comme le blé au mois de juin, et tu les as façonnés avec une petite crête impertinente à la Cristiano Ronaldo des premières années. Tu as des yeux gris sublimes qui semblent capturer, refléter et décupler toute la beauté du monde. Tu portes un t-shirt blanc bien ajusté à ton torse élancé, avec un col en V qui laisse dépasser quelques poils bien virils, ainsi que des portions d’une chaînette de mec aux mailles épaisses.
En rentrant dans le café, je suis saisi par une folle envie de faire un truc dingue. J’ai envie de venir te voir direct, j’ai envie de te parler en toute simplicité et en toute honnêteté, j’ai envie de te parler de l’Evidence. J’ai envie de te dire, tout simplement : « Tu vas me prendre pour un taré, mais il faut vraiment que je te dise que tu es incroyablement beau ».
Evidemment, je n’ose pas le faire. Tout ce que j’arrive à faire, c’est m’installer à une table vide, dans un coin du café, en attendant que tu viennes me voir pour prendre ma commande.
Je te regarde sortir de derrière ton comptoir, un plateau à la main, je te regarde traverser la salle et partir servir une table éloignée de la mienne.
Mon regard te suit à la trace, et finit par croiser le tien. J’ai l’impression de me liquéfier.
Ça ne fait pas plus d’une minute que j’ai découvert ton existence, et je suis déjà complètement sous ton charme.
Lorsque je te vois enfin approcher de moi, j’en ai instantanément le souffle coupé. Je ne te donne pas plus que 22, 24 ans au plus. J’en ai déjà 35. Et, pourtant, tu m’impressionnes. J’ai du mal à soutenir ton regard que je viens de croiser pour la deuxième fois et qui me donne toujours autant de frissons.
Avec un sourire à faire tomber des remparts de citadelle fortifiée, avec un entrain charmant, tu me lances :
— Bonjour !
— Bonjour, je te salue à mon tour.
— Qu’est-ce que je vous sers ?
J’aime ta voix un peu nasale, une voix jeune, avec un accent du sud assez marqué. Une voix qui m’apporte d’autres frissons encore.
J’aimerais qu’on me « serve » le serveur ! je manque de peu de te répondre.
— Je voudrais un cappuccino, s’il vous plaît, je finis par te répondre.
— Chantilly ou mousse de lait ? tu m’interroges.
— Un cappuccino à la Chantilly, ce n’est pas un cappuccino, je pontifie.
— C’est bien vrai, ça, tu me réponds du tac-au-tac, en me faisant une nouvelle fois le sublime cadeau de ton sourire magnifique.
Seule ombre au tableau, ce vouvoiement qui est une forme de politesse réciproque, mais qui instaure d’entrée une double distance entre nous. Celle qu’il y a entre le professionnel et le client. Mais aussi celle qui subsiste entre tes vingt ans et mes trente-cinq ans.
Toulouse, le samedi 11 novembre 2017.
Ce matin je me suis levé en pensant à toi. C’est dingue comme tu habites mes pensées depuis une semaine, depuis le premier instant où je t’ai aperçu à travers la baie vitrée d’un café en ville.
Alors j’ai pris ma voiture et je suis allé à Toulouse pour prendre un cappuccino à la mousse de lait.
Faire plus de soixante bornes pour boire un cappuccino, ça peut paraître dingue. Comme si chez moi, à Martres Tolosane, il n’y avait pas de café…
Mais le fait est que j’ai envie de TON cappuccino. Et, surtout, j’ai vraiment envie de te revoir. Non pas que je me fasse la moindre illusion que je puisse te plaire, ou qu’il puisse se passer quoi que ce soit entre nous. Je suis bien trop lucide et pas assez téméraire pour imaginer ça.
Car, déjà, tu dois être hétéro. Et puis, de toute façon, si tu décidais d’essayer autre chose que les nanas, ce n’est pas vers moi que tu te tournerais.
Mais cela ne m’empêche pas de revenir te voir. Le fait est que samedi dernier tu m’as offert un instant de beauté, de lumière, un instant hors du Temps. Car tu as su m’apporter ce petit frisson que je n’avais pas ressenti depuis un long moment, le frisson que seul sait m’inspirer un jeune, beau et charmant garçon. Un garçon touchant. Le genre de frisson qui est bien plus que du désir charnel.
Et, de ce petit frisson qui chatouille au fond du ventre et qui redonne des couleurs à la vie, j’en redemande !
Alors qu’importe les bornes. Ce qui m’importe, c’est de t’approcher, de vivre un autre moment de grâce dès que ta présence emplira mon horizon, et me laisser irradier par ta beauté et ta jeunesse de la même façon qu’on se laisse bronzer au soleil sur la plage. J’ai besoin de retrouver ton sourire, de le laisser réchauffer mon cœur. Car ce sourire est un véritable cadeau du ciel.
Lorsque j’arrive devant la baie vitrée du café, tu es en train de t’affairer derrière ton comptoir, dans ton « uniforme » de petit barman charmant, un autre t-shirt blanc avec col en V bien tendu sur ton torse élancé.
Je passe la porte d’entrée, j’approche du comptoir et je lance un « Bonjour ! » bien appuyé.
Tu lèves à peine les yeux, tu lances à ton tour un « Bonjour » rapide, sans même lever la tête du presse-agrumes avec lequel tu es en train de transformer des oranges en jus de fruit.
— Quand vous aurez terminé, je pourrais avoir un cappuccino, s’il vous plaît ? je tente d’attirer ton attention, tout en essayant de ne pas t’importuner.
— Avec mousse de lait, sinon ce n’est pas un cappuccino ! tu me lances, railleur, en levant enfin la tête, ton beau sourire au coin des lèvres, m’aveuglant de ce regard clair et profond dans lequel j’ai envie de me noyer.
Comment seraient doux, les baisers que je poserais sur ton front, sur tes yeux, sur tes lèvres !
— C’est ça ! je me réjouis de cette petite complicité inattendue entre nous.
Ainsi, tu te souviens de moi, et de ma petite « pédanterie » de samedi dernier. Je suis très flatté. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est un petit rien qui me met du baume au cœur.
— Vous désirez autre chose ? tu me demandes.
— Une chocolatine, s’il vous plaît !
— Je vous amène tout ça dans une seconde ! tu me réponds, toujours souriant et serviable.
Ta gentillesse et ton amabilité en rajoutent encore à ton charme naturel. Et à ce frisson qui ne cesse de grandir dans mon ventre.
Dans l’attente que tu viennes m’apporter mon petit déj, je me régale des fragrances qui saturent l’air de la salle. L’arôme de café et des viennoiseries, la douce senteur des réveils en douceur.
Quelques instants plus tard, tu approches de ma table avec ton plateau à la main.
— Monsieur est servi ! tu me lances, gai comme un pinson.
Si je fais abstraction du « Monsieur » qui ajoute encore de la distance entre toi et moi, tu me fais vraiment craquer. Et l’une des raisons à cela réside tout simplement dans le fait que tu as toujours l’air d’être de bonne humeur, que tu es toujours pétillant, plein d’énergie, animé par cette joie de vivre qu’est l’apanage d’une jeunesse insouciante.
Tu es un véritable rayon de soleil. Et qu’est-ce que c’est délicieux juste pouvoir te regarder travailler, sourire, exister !
Car tout semble couler de source pour toi. Tes tâches de barman que tu exécutes avec aisance, tout comme cette jeunesse que tu promènes sur toi sans avoir probablement conscience du « bien » inestimable et fragile qu’elle représente.
A 20 ans, tout paraît simple, tout paraît possible. A 20 ans, tout est simple et possible.
Adorable petit barman, qu’aimes-tu dans la vie ? Qui sont tes potes ? Que partages-tu avec eux, avec ces veinards à qui le destin à offert la chance de pouvoir te côtoyer ?
Qu’est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu’est-ce qui te rend heureux ? Qu’est-ce qui, au contraire, te met en colère ? Quel est le truc le plus dingue que tu n’aies jamais fait ? Quel est le truc le plus dingue que tu aurais envie de faire aujourd’hui, si tu en avais la possibilité ?
Est-ce que tu as une copine ? Est-ce que tu es fidèle ? Est-ce que, au contraire, tu papillonnes ?
Qui es-tu vraiment, petite Gueule d’Ange ?
J’avoue que, parfois, j’ai un peu de mal à te cerner. Tantôt, tu affiches un regard enfantin qui me donne envie de te prendre dans mes bras, de te couvrir de bisous, de te faire les câlins les plus doux, de te dire à quel point tu me touches.
Puis, d’autre fois, et parfois juste un instant plus tard, juste avec un(e) autre client(e), j’ai l’impression de déceler chez toi un délicieux mélange de malice et de coquinerie qui me donne envie de te faire et de me laisser faire les trucs les plus torrides.
Oui, parfois, tu as l’air d’un garçon sage à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Et parfois tu as l’air d’un petit fripon à qui on donnerait la bonne pipe sans hésitation.
Tu es mi-ange, mi-démon. Ange, parce que tu as l’air tout gentil. Démon, parce que, sous tes airs « angéliques », je crois bien que tu es parfaitement conscient de l’effet que tu fais sur le plus grand nombre.
Peut-être bien que tu es les deux à la fois. Ou bien, tour à tour, l’un ou l’autre.
Hélas, ce matin, le « danger » rôde autour de toi. Il se présente sous les traits d’une nana sapée et maquillée qui rentre dans le café et s’installe direct sur l’une des chaises hautes devant le comptoir, juste devant toi. Elle te parle, elle te sourit. Tu lui parles, tu lui souris à ton tour, vous avez l’air complices. Tu la connais d’où, cette poufiasse ?
Je trouve ton attitude à son égard bien différente de celle que tu affiches avec d’autres clients. Ton sourire charmant semble soudainement s’être mué en sourire charmeur. Tu lui fais de l’effet, c’est certain. Mais elle te fait de l’effet, aussi, hein ?
Je me doute bien que les nanas doivent te tourner autour. Tu es trop mignon pour qu’il en soit autrement. Toute la journée derrière ton comptoir, tu vois défiler un bon paquet du monde. Derrière ton comptoir, tu es comme sur un podium, tous les regards convergent vers toi. Dans ce café, on ne voit que ta Gueule d’Ange !
Et les garçons, alors ? Il doit certainement y en avoir qui te matent aussi. Tu as forcément dû à un moment ou à un autre capter des regards de mecs qui s’accrochent à ton sourire, à ton regard, qui caressent ton corps, qui contemplent ta mâlitude.
As-tu déjà senti sur toi un regard qui s’attarde, qui se dérobe en rencontrant le tien, mais qui revient sans cesse à toi ? As-tu déjà ressenti sur toi un regard comme le mien ? Es-tu déjà tombé sur un regard plus couillu, plus affirmé, un regard qui ne s’est pas démonté en croisant le tien, un regard troublant dans lequel tu as pu lire clairement un désir brûlant ?
Qu’est-ce que ça te fait, ce genre de regard ? Est-ce que ça te met mal à l’aise ? Est-ce que ça te laisse indifférent ? Est-ce que tu le tolères uniquement de la part d’un client, justement pour la seule et unique raison que c’est un client et qu’il faut amadouer le client ?
Est-ce qu’au contraire, cela t’agace ? Est-ce que ça te dégoûte, même ?
Comment réagirais-tu si un mec s’approchait de toi et te disait, comme j’ai failli le faire la première fois que je t’ai vu :
« Tu vas me prendre pour un taré, mais il faut vraiment que je te dise que tu es incroyablement beau » ?
Est-ce qu’un jour quelqu’un a osé venir t’interpeller de cette façon, avec cette justesse ?
Est-ce que si un mec te matait dans un autre contexte, tu serais moins conciliant ? Ou carrément hostile ? J’ai du mal à penser à toi comme à autre chose qu’un gentil garçon. Mais, au fond, je ne te connais pas. Dans ce café, je ne vois que le serveur, pas l’« homme » sous-jacent.
Comment j’aimerais connaître cet « homme » !
Est-ce que tu n’as jamais ressenti un frisson en croisant le regard d’un autre garçon ? Ne t’es-tu jamais dit : « putain, ce mec qui vient de rentrer dans le café me fait de l’effet ! » ?
Et si cela n’est pas arrivé au café, est-ce que ça t’est déjà arrivé ailleurs ?
Lundi 13 novembre 2017, 23h41.
La porte d’entrée de ton appartement vient de claquer derrière nous. Je te colle contre le mur, je t’embrasse fougueusement. Oui, petit con, tu me fais un effet dingue.
Ton t-shirt blanc bien coupé est un pur bonheur. J’ai envie de caresser et d’exciter tes tétons à travers le coton doux. Mais l’envie la plus forte est celle de découvrir ton physique de petit con.
Alors, très vite, j’attrape le bas, je le soulève. Tu secondes mon mouvement en levant les bras. Ton torse dénudé se dresse devant mes yeux, je suis vraiment dingue de toi.
Ah, oui, tu as carrément un beau physique de petit con, conforme à ce que j’imaginais. Elancé, bien proportionné, dessiné juste ce qu’il faut pour me donner une envie déraisonnable de t’offrir un plaisir inouï.
Je plonge mon visage – bouche, langue, nez, front, joues – dans la peau velue et douce entre tes pecs, je mordille tes tétons. Et tu ahanes de bonheur.
Pendant que je parcours fébrilement ton corps avec mes mains et avec ma langue, je repense à toutes ces fois où je t’ai maté en attendant mon cappuccino, à tous ces matins où je me suis levé en pensant à toi, à toutes les fois où je me suis branlé en pensant à toi.
J’ai vraiment, furieusement envie de toi. J’ai envie de tout avec toi, j’ai envie de tout ce dont tu as envie.
Je te pompe comme un fou. Et tu jouis copieusement dans ma bouche. Et j’avale jusqu’à la dernière goutte.
Voilà un scénario bien sympathique que j’appelle à la rescousse à chacun de mes plaisirs solitaires depuis que j’ai découvert ton existence.
Toulouse, le samedi 18 novembre 2017.
Je viens te revoir dès le samedi suivant.
Lorsque j’arrive au café, tu es en train de discuter avec un petit brun assis au comptoir, un petit mec plutôt mignon qui doit avoir à peu près ton âge. Tu portes ton sempiternel t-shirt blanc avec col en V délicieusement ajusté à ta plastique élancée, il porte un maillot aux couleurs du TFC. Un footeux, donc. Tu es beau et sexy, il est sexy et beau.
Je suis instantanément fasciné et intrigué par votre amitié, touché par votre complicité, jaloux de votre proximité.
Je m’installe donc à une table pas trop éloignée du comptoir, en espérant pouvoir capter votre conversation et en apprendre un peu plus sur toi, sur vous.
Et ma petite manigance ne manque pas de porter ses fruits. En captant vos échanges, j’apprends que toi aussi tu joues au foot, et que ce petit brun est l’un de tes co-équipiers. Mais aussi un pote, et depuis assez longtemps. Peut-être même ton meilleur pote.
Et à cet instant précis, le fantasme prend le pas sur la fascination et la curiosité. Et d’autres questions se superposent à celles qui me hantaient déjà à ton sujet.
Est-ce que, vestiaire après vestiaire, douche après douche, la promiscuité des corps et des regards n’a pas fini par faire germer en toi des questions, des doutes, des envies ? Est-ce que tu ne t’es pas dit, au sujet de ce sublime petit brun, « j’ai bien envie de tenter un truc avec lui » ?
Soudain, je vous imagine dans un vestiaire, dans la pénombre, dans le silence, rien que tous les deux, après que tout le monde est parti.
Je vous imagine hésitants, j’imagine vos respirations rapides, les regards à la fois aimantés et fuyants. J’imagine vos doutes, vos peurs, vos désirs encore inavoués et pourtant si intenses, si palpables.
Et puis, j’imagine l’instant où vos attirances réciproques ont eu raison des barrières qui les empêchaient depuis longtemps déjà de se manifester et de se rencontrer. J’imagine l’instant où vos envies ont déboulé en force, comme une rivière en crue, comme un ressort tendu jusqu’à la limite de la rupture et enfin relâché.
J’imagine l’instant magique où vos deux désirs se sont rencontrés, et se sont réciproquement compris, rassurés, encouragés.
J’imagine le plaisir partagé, comme un feu d’artifice. J’imagine vos orgasmes, vos giclées chaudes qui jaillissent, qui aspergent la peau, le palais, qui dépucèlent.
J’imagine tout ça. Je le fantasme.
Ce que je ne fantasme pas, c’est ton prénom. Ce prénom que ton pote brun m’apprend en partant.
Toulouse, le samedi 25 novembre 2017.
Après m’être branlé à plusieurs reprises dans la semaine en t’imaginant en train de jouir dans le cul de ton pote, ou bien ton pote en train de jouir dans le tien, je ne manque pas de revenir te voir le samedi suivant.
Aujourd’hui, ton pote brun n’est pas là. Je suis plus serein, j’ai l’impression de t’avoir « un peu plus pour moi ». Et je n’ai surtout pas à supporter les piqûres d’un début de jalousie qui m’a cueilli en te voyant si complice avec ton pote samedi dernier.
Je savoure mon cappuccino tout en te regardant voltiger entre les tables, beau comme un Dieu. Et je me dis que tu es tout à fait le genre de mec qui a pu faire tomber amoureux de toi ce camarade timide et maladroit et qui ne regardait pas les filles.
Tu as tout à fait le profil pour avoir été le protagoniste de l’énième réécriture du scénario infiniment joué sur les bancs du collège ou du lycée, celui de l’amour impossible d’un jeune homo pour un mec à nanas. Une histoire qui se répète de façon immuable, à chaque génération, chaque année, chaque jour, dans presque chaque classe.
Petit barman, as-tu remarqué un jour ce camarade de classe qui n’osait pas de parler et qui baissait les yeux quand il croisait ton regard ?
Sais-tu à quel point le fait de ne pas oser aller vers toi, de peur de se faire jeter, le meurtrissait ?
Sais-tu qu’aujourd’hui encore, il lui arrive de repenser à toi, comme à l’une des plus grosses frustrations de sa jeunesse ?
Sais-tu à quel point il t’avait dans la peau, à quel point il avait envie de toi ?
Peut-être que ça ne t’a jamais percuté. Ou alors, bien au contraire, tu l’as bien remarqué, ça t’a flatté. Et tu en as un peu joué, mais sans aller plus loin. Car, au fond de toi, ça te plaisait de sentir le désir que tu lui inspirais. Et de savoir que si tu avais voulu aller plus loin, il t’aurait suffi d’un mot, d’un geste. Ça te donnait un sentiment de toute puissance.
Mais ce mot, ce geste, tu ne les as jamais employés. Car, même si tu y as pensé quelques fois, ça ne t’a jamais vraiment branché. Ou alors, tu n’as tout simplement pas eu le cran.
Puis, le bac est arrivé, et vos chemins se sont séparés. Tu es parti dans ta vie et lui dans la sienne, tu ne l’as plus jamais revu, et tu n’as plus jamais pensé à lui.
Ou bien, peut-être qu’au fond de toi tu te souviens de ses regards amoureux. Peut-être que tu es parfaitement conscient que plus jamais personne depuis ne t’a regardé de cette façon. Avec cette intensité, avec cette passion, avec cet amour éperdu. Peut-être que plus jamais personne n’a été aussi amoureux de toi que lui il l’était à ce moment-là.
Peut-être que rien de cela ne s’est passé dans ta vie. Ou que si ce camarade a vraiment existé, tu n’as jamais rien su de ce qu’il ressentait pour toi.
Il est temps pour moi de partir. Mais, avant cela, un dernier instant de bonheur, celui de m’approcher une dernière fois de toi pour régler ma consommation. J’attends que tu reviennes derrière ton comptoir. A cet instant, tout le monde semble servi, et tu t’autorises un instant de détente.
Tu lèves les bras, tu plies les coudes, tu serres les poings. Puis, tu les rouvres, tu portes tes mains derrière la nuque, tu ramènes les épaules en arrière, tu bombes le torse. Tu bailles, tu t’étires.
Toute cette manœuvre a pour effet immédiat et magique de bien faire ressortir le dessin de tes pecs sous le coton blanc, de faire pointer tes tétons, de soulever le bas de ton t-shirt, découvrant d’abord l’élastique noir de ton boxer. Mais aussi, image furtive mais incandescente, cette ligne de petits poils dorés et fins qui descend depuis ton nombril, comme pour indiquer le cheminement vers ton sexe.
Et ce qui rend la chose super-excitante c’est que tu n’as pas conscience de ce qui vient de se passer.
— Mauvaise nuit ? je te questionne en m’approchant du comptoir, et de toi, en espérant intimement que tu ne te contentes pas d’acquiescer.
— Oui, pas terrible, tu me réponds sans rien ajouter de plus, en douchant tous mes espoirs d’en savoir davantage sur ce, celle ou celui qui a rendu ta nuit « pas terrible ».
Avant de m’encaisser, tu te penches sur l’évier pour attraper des verres, ce qui m’offre une deuxième rare vision de bonheur. Le col en V de ton t-shirt baille un peu, permettant ainsi à mon regard ravi de glisser assez profondément dans l’espace entre le coton et ta peau délicatement velue.
Je suis tout proche de toi, j’ai l’impression de capter un parfum de gel douche qui se dégage de ta peau.
A cet instant précis, hanté par ces deux images volées de ton intimité, je suis secoué par une furieuse envie de plonger mon nez dans l’échancrure de ton t-shirt, de caresser les poils de ton torse, de capter, de m’enivrer de l’odeur de ta peau, de descendre le long de ton torse pour humer les poils fins en dessous de ton nombril.
Petit serveur, si tu savais comment j’ai envie de toi, ce matin !
Je règle en espèces. Lorsque tu me rends la monnaie, je provoque volontairement un contact furtif.
Et à l’instant où les bouts de mes doigts effleurent la peau chaude de ta paume, mon corps est parcouru par un frisson secret et furieusement excitant. Je sais qu’il ne se passera jamais rien entre nous. Mais à cet instant, j’ai plus que jamais envie de te dire que tu es vraiment un garçon charmant, et que tu es beau à se damner.
J’aimerais trouver le courage de lancer le pavé de mon désir dans la mare de ta pudeur. Mais ce courage, je ne l’ai pas.
Et puis le café est bondé, je ne veux surtout pas te mettre mal à l’aise.
Et puis tu es trop jeune pour moi, et puis dans tous les cas tu ne voudrais pas de moi, et patati et patata. Celui qui tente quelque chose, risque toujours un refus. Mais à celui qui ne tente pas, le refus s’inflige tout seul.
Je me souviens parfaitement du choc que j’avais ressenti lorsque j’avais entendu ton pote brun au maillot du TFC te lancer, samedi dernier, en quittant le comptoir :
« Salut, Jérém ! ».
Là, j’avais été saisi par une douleur insoutenable, le genre de douleur provoquée par une nouvelle blessure sur une plaie toujours ouverte.
Jusqu’à cet instant, ta beauté, ton élégance naturelle, ton aisance, m’avaient rendu dingue de toi, tout en me rappelant vaguement des souvenirs. Mais la découverte de ton prénom avait précisé ces souvenirs, les avait rendus beaucoup plus nets. Et, surtout, douloureusement vivants.
La boucle était bouclée, le lien était établi entre le passé et le présent.
Bien sûr, physiquement, tu ne lui ressembles pas vraiment. Tu es châtain clair, avec un regard clair et lumineux, alors que lui était très brun, avec un regard de braise. Tu as un petit physique élancé, le sien était sculpté par le rugby.
Mais depuis que je connais ton prénom, lorsque je te regarde voltiger entre les tables de ton café, je le revois, lui, alors qu’il avait à peu près ton âge, en train de servir ses clients en terrasse, avec les mêmes gestes, la même aisance, la même élégance.
Plus de quinze ans séparent ces deux images, ces deux moments. Tu n’étais qu’un enfant à l’époque où ce gars travaillait déjà dans la brasserie à Esquirol, à l’époque où j’étais déjà en âge de tomber amoureux.
Il ne me reste qu’à te souhaiter une bonne journée, en bon client lambda, et à quitter le café.
Dans cette grise matinée du mois de novembre, un petit vent très froid s’est levé. Je remonte le col de ma veste, je plonge mes mains dans les poches, et je marche dans les allées en direction de la maison de mes parents.
Au fil de mes pas, une chanson mélancolique remonte de mon esprit.
Ce soir le vent qui frappe à ma porte
Me parle des amours mortes
Et je pense aux jours lointains
Que reste-t-il de nos amours
Que reste-t-il de ces beaux jours… 2 commentaires
2 commentaires
-
L’année 2017.
Cette année commence pour moi dans une ambiance de morosité persistante. Car c’est une année particulière. Elle marque les dix ans du départ de Jérém. Dix ans qu’il est sorti de ma vie, dix ans depuis la dernière fois où je l’ai vu.
Dix ans passés à essayer de me préserver, à éviter de prendre de ses nouvelles, et à subir de plein fouet celles qui venaient malgré moi par les amis communs, ou par la presse. Dix ans passés à essayer de l’oublier.
Dix ans, c’est en général l’un de ces anniversaires qui se « fêtent », qui nous font prendre conscience de la distance parcourue depuis l’événement « célébré », et nous font constater que l’on n’a pas vu passer les années.
Depuis le début de l’année, c’est comme si tout mon esprit était projeté vers cette date, ce 23 août qui clôturera la décennie écoulée depuis notre dernière soirée à Toulouse, depuis la dernière fois où « Ourson » et « P’tit Loup » ont existé.
Et dans cet élan, dans cette fébrilité, des tas de questions se pressent dans ma tête. Ce sont les mêmes qui me hantent depuis des années. Mais elles sont de plus en plus étouffantes, de plus en plus déchirantes.
Je me demande comment il a surmonté le choc de la publication des photos avec Rodney, si ça l’a poussé à assumer son orientation sexuelle.
Je me demande s’il a fait le deuil de sa vie d’avant, après son éloignement brutal du monde du rugby professionnel.
Je me demande ce qu’il fait de ses journées, s’il a trouvé une nouvelle passion, un nouveau rêve, ou du moins un emploi dans lequel il s’épanouit.
Je me demande ce qu’il devient depuis sa séparation d’avec Rodney. S’il a retrouvé quelqu’un, s’il a trouvé une stabilité affective.
Je me demande s’il est serein, apaisé. Je me demande s’il est heureux.
Et je me demande aussi s’il est toujours aussi beau, aussi sexy, aussi fougueux au pieu.
Je me demande qui a la chance de profiter de sa beauté, de sa virilité, de sa queue.
Evidemment, je l’imagine toujours aussi canon, et aussi bon baiseur. Bien sûr, je suis conscient que les années ont passé pour lui aussi. Je suis conscient qu’il a dû changer lui aussi.
Alors, j’aimerais tellement savoir comment la trentaine s’exprime sur sa belle gueule, sur son corps, dans son regard, dans son style. Je ne doute pas que cela doit être à tomber.
Parfois, en croisant dans la rue un beau brun dans son genre, dans sa tranche d’âge, je me dis : « Tiens, Jérém pourrait ressembler à « ça », aujourd’hui ».
Je n’ai aucun doute sur le fait que sa petitconitude d’origine, tel un bon cru, n’a pu que bien « vieillir », se muer en une virilité encore plus affirmée, une virilité aux arômes capiteux, donnant un millésime de mâlitude à même de faire bugger le plus blasé des « sommeliers ».
Il m’arrive toujours de me branler en pensant à son corps musclé, à sa queue – dans ma bouche, entre mes fesses – à ses coups de reins, à sa façon de me baiser, à sa façon de me faire l’amour, à la puissance de ses giclées, au goût de son jus chaud.
Je ne sais pas ce que je donnerais pour refaire une dernière fois l’amour avec lui.
D’un autre côté, je me demande s’il voudrait encore de moi. Les années ont passé pour moi aussi, et j’ai changé. Mes cheveux ont commencé à tomber, lentement mais inexorablement, et désormais les dégâts commencent à être visibles. Je les coupe de plus en plus courts, et je cultive une barbe de dix jours pour tenter de faire diversion. Mais ma barbe n’est pas assez drue. Je ne suis pas satisfait du résultat. Alors, dans le milieu de ma trentaine, je cherche à nouveau à me réconcilier avec mon apparence comme le faisait l’adolescent que j’ai été il y a vingt ans. Sans succès.
Oui, cette année les souvenirs me hantent encore plus que par le passé. Au fond de moi, j’attends cette date symbolique des dix ans du départ de Jérém comme pour boucler une boucle. Tout en moi tend vers cette journée, comme s’il s’agissait d’un rendez-vous à ne pas manquer.
Je ne sais pas ce que j’attends au juste. Car je sais parfaitement qu’il n’y a rien à attendre. Je sais très bien que le 23 août finira par arriver, et par passer, sans que rien ne change dans ma vie. Jérém ne reviendra pas. Et je n’arrêterai pas de penser à lui.
Un jour de mars 2017.
Ce soir, de retour à la maison après ma journée de travail, mon « comité d’accueil » à poil noir est comme toujours au rendez-vous, trépignant d’impatience derrière le portail, débordant d’énergie et d’affection, bondissant avec son ballon de rugby dans la gueule.
Contrairement à tant d’autres soirs où, fatigué de ma journée ou bien accaparé par d’autres tâches, je ne donne pas suite à ses propositions de jeu, ce soir je me lance dans une longue session de « rugby » avec mon chien d’amour.
Entre deux lancers de ballon, je suis particulièrement touché et ému par sa fougue. Et je suis fasciné par cette joie immense qui est la sienne, une joie simple et intense provoquée par un simple jouet, par le son du « pouic pouic », par le mouvement de lancer, par la course pour aller le rattraper, par ce moment de partage avec son maître.
Je lui envie cette insouciance, cette capacité à être totalement dans le présent. Galaak est juste dans l'instant, et dans l’instinct. Quand il mange, il mange, quand il dort, il dort, quand il court, il court, quand il joue, il joue, quand il fait des câlins, il fait des câlins, et il ne fait que ça. Une chose à la fois, avec tout son corps, et tout son esprit. Quand il est heureux, il l’est à 100%.
Je l’envie quand je le vois allongé sur la pelouse, la truffe en l’air, ou bien concentré sur le vol d’un oiseau qui traverse le ciel, sur le ballet aérien d’une feuille qui tombe, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Je l’envie quand il regarde parfois la rue et les voitures qui passent comme s’il jugeait nos vies effrénées et insensées d'humains. Je l'envie quand je le vois chercher le spot le mieux pour une petite sieste, sera-ce dans le jardin ou bien dans la maison ?
Certes, sans la conscience du Temps, l’esprit est soulagé d’un grand poids.
J’imagine qu’il n’a pas conscience d’avoir un passé. Il a peut-être des souvenirs, des bons, des mauvais. Mais même les mauvais ne semblent pas l’empêcher pas de vivre pleinement le présent.
Par ailleurs, je peux affirmer qu’il n’a pas d’agenda, d’échéance, d’obligation, de responsabilité, de contrainte, de conventions sociales à respecter.
Aussi, j’imagine qu’il ignore qu’un jour il ne sera plus là.
Sans la conscience du Temps, seul le Présent existe. Ce qui est vrai, dans tous les cas. Car, par définition, le Passé n’est plus, et l’Avenir n’est pas encore. Le Présent est donc le seul à mériter notre attention, le seul sur lequel nous avons un quelconque « pouvoir ». Je crois que nous, les humains, nous avons un peu perdu le sens des priorités.
En revenant à mon Galakou, je suis immensément touché par sa façon de donner son amour, sa tendresse, sa joie, sans compter, à n’importe quel moment, dès lors que je lui accorde un peu de mon attention. Il ne remet jamais à plus tard le moment d'être avec moi, de jouer, d'accepter les câlins que je lui donne. Il ne remet jamais à plus tard une occasion de jouer et d'être heureux.
Alors que je ne suis pas toujours prêt à répondre à ses sollicitations.
Lorsqu’il approche avec son ballon de rugby dans la gueule, c’est sa façon de me dire qu’il a envie de jouer.
Attends, Galaak, je suis claqué, ou occupé à regarder une série…
Lorsqu’il finit par se coucher sur le ventre, le ballon coincé sous une patte, c’est qu’il s’impatiente.
Je suis en train de faire du ménage, je termine et j’arrive…
Lorsqu’il vient se frotter contre ma cuisse, lorsqu’il passe son museau humide entre mon aisselle et le bureau, soulevant mon coude, en faisant couiner son ballon, c’est le dernier appel de phares.
Encore une minute, Galaak, je termine juste un truc…
Et puis les minutes passent, Galaak s’en va dans son panier, laissant le ballon au milieu de la pièce, comme le témoin d’une occasion ratée de partager du bonheur, comme une marque de sa déception et de sa frustration.
Je m’en veux de ne pas lui consacrer plus de temps, de ne pas toujours répondre à ses invitations. Je me dis que le temps passe vite et que je regretterai les instants que je ne lui ai pas consacrés.
Alors que, je le sais, c’est si bon de laisser tomber ce qui m’accapare, et dont l’urgence est très souvent discutable et relative, pour me payer une bonne « pause Galaak ».
Il suffit de saisir le ballon, là et maintenant, et de le lancer.
Martres Tolosane, avril 2017.
Lorsque je regarde en arrière, je me dis que j’ai quand même eu de la chance. Pendant cinq ans, j’ai vécu un amour extraordinaire, magique, un véritable feu d’artifice. J’ai pu profiter de sa beauté, de sa jeunesse, de sa virilité, de sa fougue. Et de son amour, par-dessus tout. Quelle chance inouïe et inespérée, après trois années de lycée passées à le croire totalement inaccessible !
J’ai été chanceux, terriblement chanceux, j’ai vécu un bonheur immense, un bonheur dont nombre de garçons comme moi n’osent même pas rêver. C’était comme un rêve éveillé.
Mais parfois on se réveille en plein rêve et tout a disparu. C’est ce qui m’est arrivé.
En perdant Jérém, j’ai perdu mon bonheur. Et j’ai beaucoup, beaucoup souffert.
Avec la souffrance, il y a eu la colère. Dès lors, j’en ai voulu à la Terre entière.
J’en ai terriblement voulu à ces cons qui nous ont agressés le soir de ses 25 ans. Je les ai haïs de toutes mes forces, et pas seulement pour nous avoir battus sans raison, mais aussi pour avoir exposé Jérém au jugement et à la honte, pour l’avoir replongé dans ses anciens fantômes. Et de nous avoir retiré de ce fait notre bonheur. Et, ceci, pour la seule raison que leur bêtise était irrécupérable.
J’en ai voulu à notre société, à la mentalité dominante qui méprise la différence, qui juge sans savoir et qui traite les victimes comme des coupables.
Mais j’en ai également voulu à Jérém.
Je lui en ai voulu de ne pas avoir eu le courage de se battre, de montrer qu’être gay ça n’a rien de honteux, que ce n’est pas une tare, que ça ne change rien au fait d’être un bon joueur. Et qu’en tant que gay on mérite le respect comme tout un chacun.
Je m’en suis ensuite voulu de lui en avoir voulu pour ça. Je sais très bien que s’il avait essayé de se battre frontalement contre tout un système, une société, une mentalité hostiles, ça l’aurait détruit.
Ensuite, je lui en ai voulu d’avoir oublié le bonheur et les promesses d’Ourson et P’tit Loup. D’être parti, d’avoir choisi le rugby, au lieu de me choisir, moi. Certes, c’est moi qui lui avais donné ce choix. Si je l’avais fait, c’était pour son bonheur. Papa avait raison, il aurait été très malheureux de tirer un trait sur le rugby. Mais le choix qu’il avait fait m’avait rendu malheureux.
Et je lui en ai voulu de ne pas avoir eu les couilles de me dire qu’il était tombé amoureux d’un autre garçon, de m’avoir obligé à partir à Londres, à me rendre à son appart, à rencontrer le garçon qui avait pris la place qui avait été la mienne dans son cœur.
L’imaginer amoureux d’un autre, coucher avec un autre, partager la vie d’un autre, être heureux avec un autre, c’était au-dessus de mes forces. Je n’arrivais pas à me faire à l’idée, je n’arrivais pas à l’accepter. Ce que je n’arrivais pas à accepter, c’était de l’avoir perdu.
Parfois, j’ai envie de me dire que notre histoire s’est arrêtée le soir de ses 25 ans, juste après la petite fête qu’avait concoctée Ulysse chez lui pour célébrer l’événement, juste après avoir fait l’amour dans le couloir qui menait aux parkings de l’immeuble.
Ma mémoire a besoin d’occulter ce qui s’est passé après, l’agression, notre éloignement. Et aussi, les mois, les années d’errance sentimentale après notre séparation, la douleur de l’absence, la difficile reconstruction de mon cœur salement abîmé.
Martres Tolosane, fin avril 2017.
Le mois d’avril va bientôt se terminer, le printemps s’installe. Tout autour de moi éclot, verdoie, sourit à la vie. Mon Galaak est plus fou fou que jamais, le retour des beaux jours lui donne encore plus envie de jouer.
C’est à l’approche de l’anniversaire de notre première révision avant le bac qu’une image traverse ma rétine et me replonge dans des souvenirs vieux de seize ans.
C’est en revenant des courses que je la croise. Et soudain mon cœur s’emballe, ma respiration s’arrête. Le temps s’arrête. Et je ne peux plus la quitter des yeux. Mon regard doit ressembler à celui d’un fou, car le mec au volant me dévisage à son tour. Je suis tellement ailleurs que je suis obligé donner un coup de volant pour ne pas me manger les bordures.
La 205 rouge est là, arrêtée à l’entrée du rond-point, alors que je circule à l’intérieur. Elle est conduite par un jeune garçon à casquette. Un garçon qui n’est pas Jérém, mais qui aurait très bien pu l’être. Un petit con comme il l’a été, un jeune loup terriblement sexy.
Et soudain je me revois dans sa 205 rouge, je me revois lors des retours de boîte de nuit, direction l’appart de la rue de la Colombette, direction son pieu, sa queue, sa virilité. Je me souviens tout particulièrement de cette nuit où il était venu à mon secours dans ces chiottes de boîte de nuit où ce gars éméché voulait me tabasser parce que je l’avais un peu trop maté. Je me souviens de son t-shirt blanc taché de sang. Je me souviens de sa façon de conduire d’une main et de fumer de l’autre, je me souviens de son parfum, de l’odeur de la cigarette, du désir qui ravageait mes tripes.
Je suis tellement ailleurs que je rate ma sortie, et je suis obligé de refaire un tour du rond-point.
Mais la 205 a déjà décollé, et elle s’est engagée dans une direction qui n’est pas celle que je dois emprunter. Je la regarde s’éloigner, puis disparaître au gré de la circulation, le cœur comme serré dans un étau.
Une 205 rouge pour « madeleine de Proust », une image capable, en un instant, de faire revivre tout un monde, celui de ma première jeunesse, celui de mon plus grand bonheur, celui d’un Paradis Perdu.
Le Fousseret, le mardi 2 mai 2017, 17 h 03.
Aujourd’hui, c’est la première date-anniversaire de l’année, celle de notre première révision dans l’appart de la rue de la Colombette. Dès le matin, je ne suis pas bien. Je passe une journée vraiment pas terrible. En sortant du boulot, je constate que le vent d’Autan est là, puissant, insistant, impitoyablement chargé de souvenirs.
Ce soir, je repense à certains de ses messages. Je les ai tous perdus il y a quelques années, mais je ne les ai pas oubliés pour autant. Certains sont gravés dans ma mémoire à la virgule près. Non, je n’ai jamais oublié ses SMS bourrés de fautes d’orthographe, à la fois si directs, si peu emphatiques, et pourtant si touchants.
Tout comme je n’ai jamais oublié son numéro de portable. Ça fait dix ans que je ne l’ai pas composé. Et je sais pertinemment qu’il a résilié la ligne dès son départ en Angleterre.
Mais ce soir, je suis irrépressiblement saisi par l’envie de faire un truc fou, désespéré. Ce soir, j’ai envie de composer son ancien numéro.
Je sais bien que je n’ai rien à espérer de cette petite folie. Jérém ne sera pas à l’autre bout des ondes. Mais je ne suis pas à une folie près. Je n’ai jamais cru non plus que je pourrais le revoir sur la terrasse de son premier appart. Mais ça ne m’a jamais empêché, bien longtemps après qu’il avait quitté les lieux, de passer devant son ancien immeuble, de lever les yeux et de le chercher du regard.
Alors, ce soir, même si je sais que ce ne sera pas lui qui décrochera, je compose ce numéro. J’ai envie de savoir s’il a été réattribué, et qui en a hérité.
Mon cœur fait des bonds entre chaque tonalité. Ça sonne dans le vide, et je commence à croire que je vais arriver sur le répondeur. Je me dis que c’est la meilleure chose qui puisse m’arriver, car ça me permettra de savoir qui est le nouveau titulaire, tout en m’évitant le malaise de justifier le but inexplicable de mon appel.
Mais ça décroche juste avant. A l’autre bout, la voix d’une nana.
— Allô, oui ?
Je suis tétanisé, je ne sais pas quoi lui raconter.
— Allô, c’est qui à l’appareil ? elle s’impatiente, confrontée à un silence qui pourrait paraître suspect.
— Allô ? je lance, par dépit.
— Oui, je vous écoute.
— Je… je… je bégaie.
— Vous êtes qui, Monsieur ?
— Je suis Nicolas…
— Nicolas qui ?
— Je cherche à joindre… Jérémie… je lance, comme un appel à l’aide.
— Vous avez dû composer le mauvais numéro. Il n’y a pas de Jérémie ici. Ce numéro est le mien…
— Ce numéro est celui de Jérém ! j’affirme contre vents et marées, le cœur serré, les larmes aux yeux.
— Il a peut-être été celui de votre Jérémie… mais maintenant c’est le mien, et depuis de nombreuses années !
Je ne sais plus quoi ajouter à cette conversation complètement surréaliste. Évidemment cette nana ne connaît pas le Jérémie que je cherche, ni l’histoire qui nous a liés pendant plus de cinq ans. Je ne peux rien faire d’autre que pousser un profond soupir de désespoir.
— Vous êtes sûr que ça va ?
— Ça va aller, excusez-moi pour le dérangement.
— De rien, je vous souhaite d’arriver à joindre ce monsieur.
— Si seulement c’était possible…
Toulouse, un peu plus tard ce même soir.
Ce soir, je n’ai pas eu le cœur de rester tout seul à Martres. En fait, Toulouse semble m’appeler. Alors, je pars dîner chez Papa et Maman, et j’ai même prévu d’y rester dormir.
Après le dîner, le vent d’Autan s’est levé. Il s’est mis à taper contre la fenêtre de ma chambre d’enfant, insistant, inlassable, violent. Comme s’il m’appelait, comme s’il voulait me dire quelque chose. Je l’ai écouté, je suis sorti. Je suis parti me balader.
Mes pas m’ont conduit dans ceux des souvenirs des derniers jours avant le bac. Et, en particulier, en ce mercredi 2 mai 2001 où j’avais traversé les allées pour aller à la rencontre de Jérém, le garçon qui avait ravi mon cœur depuis le premier jour du lycée.
Ce jour-là, le vent d’Autan soufflait très fort dans les rues de la ville Rose. J’ai le net souvenir de ce vent qui soufflait dans mon dos, accompagnant mes pas, encourageant ma démarche, comme pour faire taire mon hésitation. C’était le printemps, c’était la première année du nouveau millénaire. Mais c’était surtout et avant tout l’année de mes 18 ans.
Ce jour-là, le vent d’Autan me poussait à aller au bout de mon trajet, il me poussait à marcher tout droit vers la première révision de maths avec Jérém, vers la première révision de ma vie sentimentale, et de ma vie d’adulte.
J’avais passé le Grand Rond, j’avais filé sur le Boulevard Carnot, je m’étais engagé dans la rue de la Colombette, comme sur un nuage. C’était le début de cette histoire, de mon histoire.
Ce soir, comme en ce jour lointain, je traverse le pont sur la Garonne, je remonte les allées. Mais au lieu de continuer vers Jean Jaurès, je coupe vers la Halle aux Grains. Je continue jusqu’au Canal, et je le longe.
Je passe devant le « Grand Cirque » une boîte gay qui n’existait pas du temps où je fréquentais le quartier. Je continue et je passe devant cet autre haut-lieu de la vie gay toulousaine qui s’appelait jadis le « On Off », et qui s’appelle désormais le « Limelight ».
Je continue, jusqu’à croiser LA plaque. Je me laisse happer par l’appel du toponyme qui résume à lui seul à tout le bonheur de mes 18 ans, ainsi que l’immense nostalgie pour ce temps irrémédiablement révolu. En tournant dans cette rue, je ressens un immense frisson. Je viens de me souvenir que tout au bout se trouvait un autre local qui s’appelait la « Ciguë » et qui, Stéphane me l’a appris à ma pendaison de crémaillère, a également fermé ses portes il y a quelques temps.
Le frisson devient de plus en plus intense au fur et à mesure que je m’approche de la porte par laquelle j’avais tant de fois accédé au bonheur de mes premières révisions avec Jérém. Et lorsque je l’aperçois, je sens mon cœur imploser.
Elle était verte, elle est désormais bleu nuit. La façade aussi a changé. Elle était presque blanche, la voilà repeinte d’un jaune moutarde. Le tableau des boutons de sonnettes sur lequel j’avais tant de fois cherché « Tommasi » a été remplacé par un clavier numérique. Et la terrasse sur laquelle Jérém était tant de fois sorti fumer après m’avoir baisé, a tout simplement disparu, intégrée dans une extension de celui qui avait été l’appart de toutes mes premières fois.
Le constat est sans appel. Les éléments du décor urbain de mon histoire avec Jérém sont en train de disparaître les uns après les autres. Au fond de moi, je suis conscient que ce mouvement naturel des choses ne va pas s’arrêter, qu’il va continuer jusqu’à effacer chacun des repères de mon bonheur passé, comme le ressac anéantit les traces de pas sur le sable.
J’ai le cœur en miettes, l’estomac noué, j’en ai mal au ventre. Je ressens un vertige, et mes yeux s’embuent de larmes.
Que ne donnerais-je pour avoir dix-huit ans à nouveau, pour retrouver le Toulouse de ma toute première jeunesse, et revivre les frissons de mon premier amour !
J’ai souvent repensé à la phrase que m’avait dite Élodie, au Noël d’il y a dix ans : « seul le temps apaisera la blessure ». J’y ai repensé à chaque fois que la nostalgie me saisissait, que la tristesse m’emportait, que la mélancolie déchirait mon cœur.
Ma cousine avait raison, le temps est le meilleur pansement des blessures de l’esprit. Il est aussi la meilleure et la seule réponse aux questions qui n’ont et qui n’auront pas d’autre réponse.
Oui, le Temps a apaisé ma blessure. Il l’a guérie, même. Et pourtant, la cicatrice reste. Et parfois, au gré des changements de météo sentimentale et affective de ma vie, elle durcit, se contracte, redevient douloureuse.
Elle est toujours là, et je sais qu’elle ne partira pas. Je la contemple régulièrement, comme le témoin de la fin du bonheur de mes vingt ans, un bonheur dont je n’ai trouvé l’égal depuis, et dont j’ai du mal à imaginer retrouver l’égal un jour.
Toulouse, le mercredi 23 août 2017.
Ça y est, le « grand jour » est enfin là. Aujourd’hui, ça fait pile dix ans que Jérém est parti. Dix ans, déjà. Je n’ai presque pas vu passer ces dix ans. Quand j’y pense, ça me donne le vertige.
Il n’y a pas un jour pendant ces dix ans où je n’ai pas regretté l’amant, l’amoureux, le P’tit Loup qui donnait de si belles couleurs à ma vie. J’ai regretté la solidité de ses bras qui m’enserraient à la fois solidement et doucement, la douce puissance de son torse contre les mien, la chaleur de son corps, le parfum de sa peau, ses jambes contre les miennes sous la couette. Bref, j’ai regretté tous ces petits riens qui font le bonheur du Partage avec l’être aimé.
Au fil du temps, j’ai fini par en vouloir surtout au destin de m’avoir offert le bonheur de ces cinq années avec Jérém, un bonheur avec ses hauts et ses bas, certes, mais un bonheur insensé, vertigineux, et de me l’avoir retiré si brutalement. Pendant longtemps, sa présence dans ma vie m’a manqué comme un membre qu’on m’aurait arraché.
Au fond de moi, j’ai toujours pensé que nous nous retrouverions, que le destin nous réunirait un jour. C’est une promesse que j’avais cru lire dans ses yeux émus lors de cette belle soirée d'été d’il y a dix ans, la dernière que nous avions passée ensemble à Toulouse, après son premier retour d’Australie. C’est une promesse, ou une illusion, qui avait amorti le choc au moment de nous quitter, après avoir fait l’amour une dernière fois. Une promesse que je serre contre moi depuis tout ce temps.
Alors, depuis dix ans, et aujourd’hui encore, à chaque fois que le vent d’Autan se lève, je me surprends à être dans l’attente d’un miracle. Mon cœur sursaute, ma peau est parcourue par des frissons, et dans mes tripes tout se remet à remuer violemment. Car tout me ramène à lui.
Tout était beau, tout était parfait ce dernier soir à Toulouse d’il y a dix ans. Et je n’ai qu’un seul, immense regret. Celui de ne pas avoir su trouver les mots qui auraient pu l’apaiser, ce petit rien qui aurait pu le retenir.
En fait, si, j’en ai un deuxième. Celui de pas m’être battu davantage pour le suivre au bout du monde. Car, au fond de moi, je savais qu’il choisirait de partir.
Jérém est toujours dans mon cœur, et il l’est dans la lumière de mes plus belles années, les plus heureuses de ma vie. Et j’ai l’impression qu’il le sera toujours. Et que je ne pourrai plus jamais aimer aussi entièrement, aussi « corps et âme », aussi follement que je l’ai aimé.
C’est certainement pour cette raison que depuis dix ans j’ai été incapable de faire confiance, d’accepter l’amour qu’on m’offrait. Depuis dix ans, j’ai regardé ma vie défiler devant moi, comme un passager d’un train qui ne descendrait à aucune station.
And I'm still waiting/Et j'attends toujours
(…)
Ooh, I'm a fool/Oh, je suis un imbécile
To keep waiting/Pour continuer à attendre
Non, je n’ai jamais pu t’oublier, mon Jérém. Et, au fond de moi, je t’attends toujours. Bien que depuis tant de temps déjà, nos vies ne marchent plus ensemble.
Martres Tolosane, le vendredi 15 septembre 2017.
Aujourd’hui, j’ai 35 ans. Et je réalise que j’ai plus du double de l’âge que j’avais au moment où j’avais connu Jérém en ce premier jour du lycée. Au milieu de ma trentaine, j’ai l’impression que la quarantaine m’attend au tournant. Je n’ai pas peur de vieillir. J’ai surtout peur de rater les occasions, les belles choses que la vie a à m’offrir. Je suis encore jeune, certes, mais je sais que le temps passe, et qu’il passe vite. Je sais que Demain n’est que spéculation, car pour mille raisons il pourrait ne pas être.
Je ne veux plus gaspiller mon temps avec les regrets. Je ne veux plus vivre dans le passé.
Ça fait longtemps qu’espérer un retour de Jérém n’a plus de sens. Ça fait longtemps que j’aurais dû me faire une raison de notre séparation, faire mon deuil, passer à autre chose, tourner la page, construire une nouvelle relation, être à nouveaux heureux.
Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Et pourtant, je n’ai jamais réussi. Je me suis demandé comment cela était possible. J’ai fini par penser que mon attachement à Jérém et à cette époque de ma vie était pathologique, qu’il y avait un truc qui clochait en moi. J’ai pensé que j’avais besoin de voir un psy. Mais j’ai toujours tergiversé, procrastiné, et je n’ai jamais réussi à franchir le pas. Je ne saurais jamais si cela aurait pu m’aider.
Mais avec le temps, j’ai fini par me dire que si je n’arrive pas à me faire une raison de ma séparation d’avec Jérém et à avancer, c’est peut-être que trop de questions demeurent sans réponse.
Exemple. J’ai souvent repensé à ce soir d’août 2007 à Toulouse. Et je me suis toujours demandé ce qui se passait réellement dans sa tête à ce moment-là, quand on était au resto, pendant la balade sur la Garonne, lorsqu’il m’avait parlé de son intention de renoncer au rugby pour ne pas être harcelé et pour donner une chance à notre couple. Je me le suis demandé, car je n’ai jamais pu m’expliquer comment il avait pu affirmer ces choses à cet instant-là, et partir en Angleterre quelques jours plus tard à peine, et sans explications. Est-ce que ce soir-là il était venu chercher une sorte de « bénédiction » de ma part ? Est-ce qu’il était venu pour m’obliger donc à choisir à sa place ?
Par ailleurs, la liste des questions sans réponse est longue.
Comment s’est faite la rencontre avec Rodney, et quand ?
A-t-il été autant amoureux de lui que de moi ?
Pourquoi Rodney est parti ? Comment s’est terminée leur histoire ?
Pourquoi en 2013, lors de sa venue en France, et alors qu’il était déjà séparé d’avec Rodney, il n’avait pas eu l’idée de passer me voir, de renouer le contact ?
Est-ce qu’il avait seulement envie de me revoir ?
Peut-être qu’il n’a pas osé. Et, dans ce cas, pourquoi ? Craignait-il que je le rejette ?
Et s’il était venu me retrouver, est-ce que nous nous serions retrouvés « comme avant », comme « Ourson et P’tit Loup », ou bien nous n’aurions été que des « ex » ?
Ça, je n’aurais pas pu le supporter.
Alors, au final, est-ce que ça aurait été une bonne chose de le revoir ?
Peut-être qu’il a eu raison de ne pas revenir vers moi, de laisser le passé au passé.
Est-ce qu’il lui arrive de penser à moi et de prendre de mes nouvelles ?
Que sait-il de moi, depuis dix ans ? A qui a-t-il demandé ? Qu’est-ce qu’il a reçu comme réponse ?
La fin de mon histoire avec Jérém est à mes yeux un tableau inachevé. Un puzzle auquel il manque des pièces, des pièces qui pourraient m’aider à comprendre. Et comprendre est le premier pas pour se faire une raison et avancer.
Lundi 16 octobre 2017.
Aujourd’hui, Jérém a 36 ans.
Après m’être longtemps protégé des nouvelles à son sujet, je ressens à présent le besoin d’en demander pour tenter de combler les espaces vides des derniers instants de notre histoire et des dix années qui ont suivi.
Pendant la semaine de son anniversaire, j’appelle Thibault, Maxime, Ulysse. Je les questionne au sujet de mon beau brun. J’ai vraiment besoin de savoir. J’obtiens quelques infos, mais rien de particulièrement intéressant. Au final, je n’ai que des réponses partielles, insatisfaisantes.
J’apprends que Jérém ne leur a jamais vraiment parlé de ce qui s’était passé entre lui et moi, pas plus que de ce qui s’était passé entre Rodney et lui, comment avait commencé leur histoire, comment elle s’était terminée. Il ne leur avait jamais dit non plus pourquoi il avait choisi de ne pas reprendre contact avec moi lors de son voyage en France, alors qu’il était déjà séparé de Rodney.
Aussi, plus inquiétant, j’ai appris que Jérém a été extrêmement discret sur sa vie depuis quelques années, ce qui fait que personne ne sait pas vraiment ce qu’il trafique à l’autre bout de la Planète, quel est son état d’esprit réel, notamment depuis le départ de Rodney.
Maxime m’a confié que Jérém n’a jamais envisagé de voyage en France depuis des années, et qu’il ne semble vraiment pas chaud à l’idée, plusieurs fois émise de sa part, d’aller lui rendre visite. Maxime m’avoue être de plus en plus inquiet, car il ignore presque tout de la vie actuelle de son grand frère, tandis que leurs contacts récents s’apparentent plus à des simples notifications d’existence en vie qu’à de véritables échanges.
Bref, à la fin de mon « enquête », je n’ai pas appris grand-chose. A part que l’attitude récente de Jérém semble être assez inquiétante. Non seulement, il me manque toujours de nombreuses pièces pour compléter mon puzzle, mais je réalise que le puzzle est bien plus vaste que je ne l’imaginais. Et que les questions sont plus nombreuses que je l’avais imaginé.
Toutes sortes d’interrogations traversent mon esprit, toutes sans réponse.
Mais je ne désespère pas. Car il me reste une source à interroger. Et pas des moindres.
Au moment où j’essaie de prendre contact avec elle, Charlène est injoignable sur son portable. Après être tombé plusieurs fois directement sur son répondeur, je commence à m’inquiéter. Je finis par appeler au centre équestre. Je suis rassuré d’apprendre qu’elle est injoignable car elle est en déplacement à l’étranger chez l’un de ses enfants et qu’elle souhaite préserver la tranquillité de son séjour en coupant son téléphone. On me promet de lui faire part de mon coup de fil à la première occasion.
Quelques jours plus tard, je reçois un SMS de sa part m’annonçant qu’elle sera de retour pour les fêtes de fin d’année. Et qu’elle sera ravie de me retrouver à ce moment-là.
Toulouse, fin octobre 2017.
Il est de ces films, comme « Brokeback Moutain », « Week-end » ou « Free Fall », qui transpercent l’âme, qui vrillent les tripes, qui vous bouleversent, qui vous hantent pendant longtemps, et ce dimanche après-midi il y en a un qui s’est ajouté à cette liste.
Je suis allé voir « Call me by your name » et, depuis, cette histoire me hante. Le film est un véritable bijou, et les deux acteurs sont absolument sublimes et parfaits. Armie Hamer est d'une beauté fulgurante et aveuglante, et Timothée Chalamet est magnifiquement touchant. Le « couple » qu'ils forment est d'une telle évidence !
Tout dans le film est d'une pureté et d'une intensité rares, rien n’est superflu, beaucoup se niche dans tous ces « petits riens », des gestes, des regards, des petits mots. Comme lorsqu’Armie murmure de sa voix sexy la fameuse phrase qui donne son titre au film : « call me by your name and I’ll call you by mine », ou bien lorsqu’Elio dit : « I don’t want you to leave ».
La scène de leur « première fois » est magique, celle de la conversation avec le père après le départ d’Arnie est bouleversante. Quant à la scène finale (jusqu'au générique, qu'il faut regarder en entier) est poignante. J’ai fini en larmes. Et je ne peux pas m'empêcher de pleurer à nouveau en écoutant en boucle le CD de la musique du film, baignant dans cette atmosphère envoûtante, insouciante et sensuelle, une BO à la fois belle et d'une mélancolie déchirante.
La musique glisse comme de l’eau ou des larmes qu’on ne peut pas arrêter, il y a à la fois de la joie, de la tristesse, de la nostalgie.
C’est l’histoire d’un premier amour, le plus pur, le plus absolu, celui qui n’a pas peur de s’exprimer, et qui fait terriblement mal aussi.
Toulouse, le samedi 04 novembre 2017.
Hier soir, je suis retourné à Toulouse pour passer une partie du week-end avec mes parents. Et ce matin, après le petit-déjeuner, j’ai envie de faire un tour en ville.
Je me promène du côté des Carmes sans but précis, si ce n’est celui de prendre l’air, lorsque soudain, dans cette matinée grise et froide, dans mon horizon bouché par une intense mélancolie, un rayon de soleil apparaît. Il est intense, il est lumineux, il est aveuglant.
Une fraction de seconde, une image incomplète de toi captée du coin de l’œil, et je suis complètement subjugué. Car tu viens de m’arracher de ma morosité, tu viens de remettre des couleurs dans mon horizon terne.
Tu es rentré dans mon champ de vision, ton existence vient de m’être révélée. Et dès la toute première seconde, mon regard s’est trouvé comme verrouillé sur ta personne. Et plus rien n’existe autour de toi, et en dehors de toi.
Alors, je pile net. Tellement net que je manque de peu de me faire renverser par la nana qui me suit sur le trottoir, les yeux rivés sur son portable, ce qui lui la rend tout autant fautive que moi.
Ce matin, je n’avais pas prévu de faire une pause-café. Et pourtant, me voilà avec une soudaine envie de cappuccino.
Alors, sans te quitter des yeux, j’avance vers toi par le chemin le plus court. Je ne peux pas ne pas venir vers toi, j’ai besoin de voir ta belle petite gueule de plus près. J’ai besoin de capter tous les détails de ta beauté. J’ai besoin de comprendre si tu es réel ou bien si je n’ai fait que rêver de cette sublime beauté.
Je m’approche de l’entrée du café et, pendant un instant, je te contemple à travers la baie vitrée. Et là, en te regardant d’un peu plus près, le constat se confirme. Tu es vraiment, vraiment splendide.
Tu as des cheveux châtains très clairs, avec des reflets dorés comme le blé au mois de juin, et tu les as façonnés avec une petite crête impertinente à la Cristiano Ronaldo des premières années. Tu as des yeux gris sublimes qui semblent capturer, refléter et décupler toute la beauté du monde. Tu portes un t-shirt blanc bien ajusté à ton torse élancé, avec un col en V qui laisse dépasser quelques poils bien virils, ainsi que des portions d’une chaînette de mec aux mailles épaisses.
En rentrant dans le café, je suis saisi par une folle envie de faire un truc dingue. J’ai envie de venir te voir direct, j’ai envie de te parler en toute simplicité et en toute honnêteté, j’ai envie de te parler de l’Évidence. J’ai envie de te dire, tout simplement : « Tu vas me prendre pour un taré, mais il faut vraiment que je te dise que tu es incroyablement beau ».
Évidemment, je n’ose pas le faire. Tout ce que j’arrive à faire, c’est m’installer à une table vide, dans un coin du café, en attendant que tu viennes me voir pour prendre ma commande.
Je te regarde sortir de derrière ton comptoir, un plateau à la main, je te regarde traverser la salle et partir servir une table éloignée de la mienne.
Mon regard te suit à la trace, et finit par croiser le tien. J’ai l’impression de me liquéfier.
Ça ne fait pas plus d’une minute que j’ai découvert ton existence, et je suis déjà complètement sous ton charme.
Lorsque je te vois enfin approcher de moi, j’en ai instantanément le souffle coupé. Je ne te donne pas plus que 22, 24 ans au plus. J’en ai déjà 35. Et, pourtant, tu m’impressionnes. J’ai du mal à soutenir ton regard que je viens de croiser pour la deuxième fois et qui me donne toujours autant de frissons.
Avec un sourire à faire tomber des remparts de citadelle fortifiée, avec un entrain charmant, tu me lances :
— Bonjour !
— Bonjour, je te salue à mon tour.
— Qu’est-ce que je vous sers ?
J’aime ta voix un peu nasale, une voix jeune, avec un accent du sud assez marqué. Une voix qui m’apporte d’autres frissons encore.
J’aimerais qu’on me « serve » le serveur ! je manque de peu de te répondre.
— Je voudrais un cappuccino, s’il vous plaît, je finis par te répondre.
— Chantilly ou mousse de lait ? tu m’interroges.
— Un cappuccino à la Chantilly, ce n’est pas un cappuccino, je pontifie.
— C’est bien vrai, ça, tu me réponds du tac-au-tac, en me faisant une nouvelle fois le sublime cadeau de ton sourire magnifique.
Seule ombre au tableau, ce vouvoiement qui est une forme de politesse réciproque, mais qui instaure d’entrée une double distance entre nous. Celle qu’il y a entre le professionnel et le client. Mais aussi celle qui subsiste entre tes vingt ans et mes trente-cinq ans…
Lien vers 0408 Un intense rayon de soleil (Gueule d'Ange).Vos commentaires, toujours si précieux à mes yeux !
Merci d'avance, Fabien
 3 commentaires
3 commentaires
-
Amsterdam, 1er décembre 2023. Speech de Madonna.
Aujourd’hui, c’est la journée mondiale contre le SIDA.
Vous pensez à ça ? C’est important pour tout le monde ?
Peut-être que tout ça peut paraitre très lointain, peut-être que cela ne vous parle pas, on peut même penser que chaque jour est un jour de fête.
Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il n’y a pas de cure pour le SIDA. Les gens continuent de mourir du SIDA, vous savez ?
Quand j’ai débarqué à New York, j’ai eu la chance de rencontrer et devenir amie avec de nombreux magnifiques artistes, musiciens, peintres, chanteurs, danseurs, écrivains.
Et puis, un jour, ces gens ont commencé à devenir malades, et personne ne comprenait ce qui se passait. Les gens commençaient par perdre du poids, et puis ils tombaient comme des mouches. Ils allaient à l’hôpital, et là non plus personne ne comprenait ce qui était en train de se passer.
Les infos appelaient ça le « cancer gay », parce que ça sévissait principalement dans la communauté gay. Et ça, c’était une honte terrible. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez ça, maintenant, mais dans les premières années ’80 ce n’était pas cool d’être gay, ce n’était pas accepté d’être gay. Vous comprenez ça ou vous considérez juste vos droits pour acquis ?
Aujourd’hui, on peut se tenir debout et dire « je suis gay ».
Mais à l’époque, s’assumer était une action très brave et très courageuse.
Je ne sais pas si vous imaginez vraiment ce qu’a été, à cette époque où être gay était considéré comme un péché, comme quelque chose de dégoûtant, de voir soudainement une vaste portion de la communauté gay commencer à tomber comme des mouches.
Les gens mouraient partout. Et quand je dis qu’ils mouraient partout, je ne suis pas en train d’exagérer. Chaque jour je me réveillais et j’apprenais qu’un nouvel ami était touché. J’allais leur rendre visite, je m’assoyais sur le côté du lit pour les regarder mourir.
Et pendant ce temps, dans la communauté médicale personne ne voulait faire quoi que ce soit. Parce qu’ils disaient que ces gens méritaient de mourir. Oui, c’est ce qu’ils disaient.
C’étaient des temps affreux. J’ai personnellement perdu beaucoup d’amis bien aimés. J’aurais donné mes bras si j’avais pu trouver une cure pour leur permettre de vivre.
J’ai vu tellement de gens mourir, homme et femmes, enfants, hétéros, gays, etc. Parce qu’à cette époque le sang des transfusions n’était pas testé.
Les enfants aussi étaient ostracisés s’ils avaient le HIV. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c’étaient des temps dévastateurs. Pour moi, c’est comme si une entière génération avait été anéantie.
Et j’ai vu mon meilleur ami Martin en train de mourir. J’ai serré sa main, il souffrait énormément, il pouvait tout juste respirer, il voulait me chanter Maria Callas, Casta Diva. Et je lui ai dit, s’il te plait, Martin, laisse tomber. Et je regardais son esprit quitter son corps. Je ne sais pas si vous le savez, mais pendant « Live to tell », il est le premier visage qui apparait.
Et il y en a beaucoup d’autres après.
Mais je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez désolés pour moi. Je veux que vous sachiez à quel point vous êtes chanceux maintenant, à quel point vous êtes chanceux d’être vivants. Maintenant vous pouvez prendre un médicament et être protégés, c’est fou.
Et je me retiens chanceuse d’avoir moi-même survécu à cette triste époque.
Quand j’ai été à l’hôpital Saint Vincent à New York pour visiter des patients qui étaient mourants, leurs familles ne voulaient plus rien avoir affaire avec eux. C’était dans les années ’80.
Il y avait toute une salle dans laquelle il n’y avait que deux infirmières qui acceptaient de rentrer et de soigner ces malades. Car tout le monde disait « si tu touches une personne avec le SIDA, tu vas l’attraper ».
Et j’ai avance dans cette salle et j’ai vu tous ces hommes haletant leur dernier souffle, et tout ce qu’ils voulaient, c’était un câlin. Et j’ai marché entre les lits de beaucoup d’entre eux, et je leur ai fait des câlins. Et ils étaient dans un état de démence et ils pensaient que j’étais leur mère et ils disaient « Maman, merci d’être enfin venue ».
Je ne sais pas si cette scène, cette salle de spectacle est le bon endroit pour raconter ça, mais vous n’avez pas idée de ce que c’était pour tous ces personnes d’être laissés sur le côté, comme s’ils n’avaient pas d’importance, comme si leurs vies n’avaient pas d’importance.
Vous n’avez pas idée d’à quel point vous êtes chanceux maintenant, à quel point nous sommes chanceux.
Mais les gens peuvent être si cruels, vous savez ?
Et quand je suis revenue à la maison ce jour-là, après avoir visité cet hôpital, la presse était postée devant l’immeuble de mon appartement à Central Park West, et on m’a demandé : « Madonna, Madonna, c’est vrai que vous avez le SIDA ? ».
Je leur ai répondu : « Non, je me soucie juste des gens qui ont le SIDA ».
Il y a quelques années, j’ai écrit des livres pour enfants. Un jour, une femme s’est approchée de moi, elle est venue me parler et m’a dit : « Vous écrivez des livres pour enfants, vous avez des enfants, vous prenez soin des enfants, est ce que vous savez qu’il y a un pays en Afrique où plus d’un million d’enfants sont nés avec le SIDA ? ».
Et je lui ai dit : « De quoi parlez-vous ? ».
Et elle m’a parlé de ce pays appelé Malawi.
Et j’y suis allée, et c’était comme une histoire qui se répète. Je suis allée dans les hôpitaux, j’ai vu les corps empilés les uns sur les autres.
J’ai vu les gens mourir partout. Il n’y avait pas de médicament, aucun traitement, rien, pas d’antirétroviraux disponibles.
Des décennies plus tard, c’était comme voir l’histoire se répéter. Et c’est de cette façon que j’ai rencontré mon fils David, dont la mère était morte du SIDA, et tous mes enfants que j’ai adoptés au Malawi. Mes beaux enfants.
Une fois de plus, je ne vous raconte pas ça pour avoir votre compassion, je n’essaie pas de me faire mousser. Je veux juste parler de l’étroitesse d’esprit de certains gens. Et cela me rend malade, et cela devrait tous vous rendre malades aussi.
Où je veux donc en venir ?
Je veux juste honorer tous ceux que nous avons perdus à cause du SIDA, ceux qui vivent avec le SIDA, et ils sont nombreux.
Merci à la recherche médicale et aux gens qui ont consacré du temps à la sensibilisation.
Mais vous savez, à notre époque où nous avons accès à tant d’informations, l’ignorance n’a pas d’excuses. Si on peut mettre un terme à quoi que ce soit, que nous puissions s’il vous plaît mettre un STOP à l’ignorance !
Est-ce que je vous ai endormis ? Pensez-vous que j'allais terminer le spectacle de ce soir et ne pas parler de ça ?
La seule chose qui peut tous nous sauver, c’est la lumière qui nous fait briller, la lumière qui est dans chacun de nous. Nous devons la partager avec tout le monde. Alors, s’il vous plait, allumez vos lumières, s’il vous plait, allumez vos lumières, ne me faites pas supplier !
Son émotion lors de son discours était palpable par toutes et tous. Sa voix chevrotante lorsqu’elle évoque tous ces amis touchés par la maladie et décédés m’a ému. Ses mots semblaient venir directement de ses tripes. J’étais assez près d’elle, à quelques mètres à peine, pour voir qu’elle était tellement habitée par ses propos qu'elle en tremblait comme une feuille. J’ai même cru que la petite bouteille qu’elle tenait entre sa paume et son pouce allait se fracasser au sol. Je la voyais si menue, si fragile, elle était si émouvante à cet instant.
J’ai envie de la croire sincère. En fait, je trouve que plus elle vieillit, plus elle devient humaine et touchante. Et sincère.
Elle demande qu’on allume les torches de nos portables.
« Ne me faites pas vous prier ! » elle nous encourage
A cet instant, la salle est illuminée par des milliers de lumières de portables. C’est beau et terriblement émouvant.
Et là, elle chante « I will survive » juste avec un accompagnement de guitare, elle chante avec le public :
https://www.youtube.com/watch?v=AMimoWTyJfM 3 commentaires
3 commentaires
-
L’année 2016.
Brisbane, janvier 2016, au petit matin.
Dans une cellule de dégrisement d’un poste de Police.
Allongé sur le petit lit de ta cellule, le corps meurtri par les coups, épuisé par la fatigue et par une migraine terrible, tu te sens mal, très mal, pire que mal. Tu n’arrives pas à réaliser ce qui s’est passé, ce que tu as fait. Tu ne peux admettre d’en être arrivé là, tu ne peux t’empêcher de ressentir un profond écœurement à ton égard.
Pourtant, ça fait un bail que tu te déçois toi-même, chaque jour un peu plus que le précédent. Au cours de ces trois années, tu t’es senti tomber de plus en plus bas, tu t’es senti entraîné dans un cercle vicieux duquel tu n’as pas pu t’extirper.
Mais tu ne t’es jamais senti aussi minable qu’à cet instant où le bien le plus précieux pour un homme, sa liberté de mouvement, vient de t’être retiré pour une durée encore indéterminée.
Tu appréhendes les conséquences de cette horrible nuit. Tu t’en veux à mort pour la violence dont tu t’es montré capable, pour cette noirceur qui s’est exprimée chez toi, qui a explosé en un instant, et sans raison valable. Tu sais que tu ne te pardonneras pas d’en être arrivé là.
Tu crains que ta famille et tes amis puissent apprendre un jour ce que tu as fait.
Tu crains par-dessus-tout qu’IL apprenne un jour ce que tu as fait. Et qu’il soit déçu et dégoûté au point de se demander comment il a un jour pu tomber amoureux d’un sale type comme toi.
Toulouse, janvier 2016.
La nouvelle année démarre sur une sorte de nuage que je me suis construit autour de ma nouvelle passion. Je passe tout mon temps libre à écrire, soirées, nuits, week-ends. Et, devant mon clavier, je ne vois pas les heures passer.
Ça occupe mon esprit et ça me plaît. Même si mon seul lecteur, c’est moi-même. Mais ça me suffit. Je ne me sens pas prêt à partager mes récits avec qui que ce soit. C’est mon jardin secret, et ce que j’y cultive, c’est de l’ordre du très intime.
Les seuls moments où j’interromps mon écriture, c’est quand Martin me sonne. Agréables interludes qui me font renouer avec une certaine sensualité.
Je sais que ce que j’ai avec Martin ce n’est pas une relation équilibrée, et qu’elle contribue dans une certaine mesure à m’empêcher de rencontrer un gars avec qui je pourrais être heureux. Mais pour l’instant, ce gars je ne sais pas où le chercher.
Alors, oui, avec Martin, c’est une relation « faute de mieux », une relation purement sexuelle. Saupoudrée d’une certaine complicité, certes, mais qui ne m’offrira jamais une relation véritable.
Mais c’est aussi une relation qui ne me demande aucun investissement, une relation par laquelle je me laisse porter. Une relation qui me laisse toute la latitude pour tenter de faire la paix avec mon passé.
En fait, il y a d’autres occasions où je suis « forcé » de détacher les yeux de l’écran et les doigts du clavier. C’est lorsque Galaak vient se coller contre ma jambe et pousser avec une force capable de faire rouler mon fauteuil de bureau avec moi assis dessus.
C’est lorsqu’il réclame une sortie pipi, ou bien ses croquettes, un câlin, ou tout simplement un peu de mon attention. Ou une séance « pouic pouic ». Pour cela, il a bien appris du pauvre Gabin. Il approche avec le jouet entre les crocs, il est tout fou fou, mignon à croquer, et il le laisse tomber à mes pieds. Le message est clair. « Et maintenant, on joue ! La vie c’est fait pour jouer, aussi ! ».
C’est la pause Galaak.
Brisbane, janvier 2016.
Le désastre était inévitable. Ton esprit était trop noir, et depuis bien trop longtemps. Et tu étais saoul, beaucoup trop saoul. Tu étais une bombe ambulante à la charge instable. Tu aurais pu exploser à chaque instant, pour peu qu’une étincelle se présente sur ton chemin.
Et l’étincelle s’est présentée sous la forme d’un gars croisé sur une fête foraine, lui aussi un tantinet éméché. Vous êtes passés l’un à côté de l’autre, et ni lui ni toi n’avez rien fait pour éviter la collision. Vos épaules se sont heurtées violemment. Tu t’es retourné, il s’est retourné. Les insultes ont volé.
Et puis, l’outrage de trop est sorti de la bouche de ce type :
« Fukin’ fag ! ».
Là, tu as vu rouge. Tu l’as cogné en premier. Le gars était costaud, il ne s’est pas laissé faire, tu as pris quelques coups très violents en retour. La douleur et l’odeur de ton sang ont décuplé la rage qui couvait en toi. Tu t’es relevé, et tu t’es jeté sur lui. Tu l’as cogné de toutes tes forces. Et tu as fini par avoir le dessus.
Toute la rage, la colère, la tristesse, le sentiment d’injustice, l’humiliation, la déception, la solitude accumulées depuis des années sont sorties de toi, d’un coup, d’un seul, te transformant en un fauve à la violence incontrôlable.
Et tu l’as frappé encore et encore. Le type s’est transformé en punchingball, en exutoire tout trouvé pour ton esprit meurtri par trop d’années de subissements. Et il a pris pour tous ceux qui t’ont humilié ou fait du mal un jour.
Il a pris pour ces connards qui t’ont tabassé, à Paris, le soir de tes 25 ans, et qui t’ont volé des mois de rugby, et ton fragile équilibre si difficilement bâti.
Il a pris pour ceux qui t’ont traité de pédé pendant un match après ton retour sur le terrain.
Il a pris pour ces charognards qui t’ont pris en photo avec Rodney, qui ont écrit de la merde, qui l’ont publiée, en anéantissant ainsi, juste pour vendre un peu plus de papier, toute ta carrière au rugby.
Il a pris pour ceux qui t'ont aimé et admiré tant que tu marquais des essais et qu'ils te croyaient hétéro, et qui t'ont craché dessus quand ils ont su que tu étais gay.
Il a pris pour les sponsors qui se battaient pour t'engager et qui ont tous disparu jusqu'au dernier le lendemain de l'article sur ce maudit torchon.
Il a pris pour ceux qui t'ont poussé vers la sortie du rugby alors que tu avais encore tant de belles années devant toi.
Il a pris pour toute cette humiliation qui t’a meurtri, t’obligeant à fuir à l’autre bout de la Planète.
Tant qu’à y être, il a pris aussi pour ceux qui n'ont pas voulu de toi au Stade Toulousain après ton bac. Un rêve, celui de jouer en Noir et Rouge, qui ne t’a jamais quitté, et qui a été presque à ta portée à un moment, avant de d’être lui aussi arraché le soir de tes 25 ans.
Et, pourquoi pas, il a pris aussi pour le mec qui a séduit ta mère et qui l’a amené avec lui alors que tu n’étais encore qu’un enfant. Et pour les gosses en CP qui se moquaient de toi et te bousculaient parce que tu étais un enfant petit, maigrichon, isolé et taciturne.
Il a pris aussi pour ce joueur biarrot qui t’a explosé le genou lors d’un placage et qui t’a volé une année de rugby. Et pour tous ces coups que tu as pris parce que tu étais le joueur à abattre pour espérer remporter le match. Des coups répétés et violents, dont le souvenir se réveille de plus en plus souvent dans ta chair, et de plus en plus douloureusement.
Au final, le gars de la fête foraine a pris pour toute la colère qui s’est accumulée en toi jusqu’à devenir totalement incontrôlable le jour où tu t’es retrouvé seul et sans rêves.
Il a pris pour tous ceux qui auraient mérité tes coups, il a pris les coups que tu ne pourras jamais assener à leurs destinataires naturels.
Il a pris parce que tu te détestes, tu te dégoûtes d’être gay, car tu sais que cette « tare » te suivra toute ta vie et que ça jouera toujours contre toi. Parce qu’être pédé a été la source de tous tes problèmes. Parce qu’être pédé t’a fait tout perdre, le rugby, ta passion, ton rêve, les honneurs, la gloire, la belle vie, tes potes. Et l’amour, aussi.
Et par-dessus tout, il a pris pour ta solitude et ton malheur actuels qu'aucun voyage, aucune cuite, aucune baise n'arrive pas à te faire oublier.
Heureusement, quelqu’un est venu s’interposer, t’immobiliser. Ils ont dû s’y prendre à plusieurs pour te maîtriser. Retenu par de nombreux bras charitables, ta pression retombe d’un coup et tu réalises avec horreur ce que tu viens de faire. Tu regardes le type à terre et cet autre gars qui lui porte secours. Et déjà les remords déchirent ton âme.
La peur du pire t’envahit, tu te mets à trembler comme une feuille. Et les larmes sortent de toi comme un torrent en crue, tu pleures sans plus pouvoir t’arrêter.
Toulouse-Martres Tolosane, janvier 2016.
En ce début d’année, ça bouge dans mon taf. Suite à un départ à la retraite, je me vois proposer un nouveau poste qui m’amènera à être le plus souvent présent sur les sites d’exploitation au sud de Toulouse.
L’envie de me rapprocher de mon nouveau taf se joint à celle de prendre un nouveau départ et de chercher un meilleur cadre de vie pour moi et mon Galakou d’amour. Je décide de quitter Toulouse et d’emménager à la campagne. Après une courte recherche, je pose mes valises dans une maison avec un grand jardin située dans un très charmant village sur la route des Pyrénées.
En quittant Toulouse, je m’éloigne de tous mes repères, ma famille, mes amis. C’est un nouveau départ, un saut vers l’inconnu. Mais je crois que je vais être bien à Martres-Tolosane.
Le soir de mon emménagement, je regarde Galaak gambader dans le jardin et poser son odeur aux quatre coins de la clôture. Je crois que lui aussi va être bien ici.
Brisbane, janvier 2016.
Dans une cellule du Centre Correctionnel.
La question ne cesse de tourner dans ta tête. Comment as-tu pu en arriver là ? Comment es-tu devenu cette bombe à retardement qui ne demandait qu’à exploser ?
A bien regarder, cette « charge explosive » s’est accumulée en toi depuis ton enfance. Elle est la somme de tes peurs, de tes frustrations, et de tes humiliations.
Le fait est qu’au lieu d’affronter tes démons intérieurs, tu as trop souvent choisi de les fuir. C’est tout toi, ça, Jérém. Fuir plutôt qu’assumer. Depuis le temps, tu devrais avoir appris la chanson. Mais ce n’est toujours pas le cas, hélas.
Il ne sert à rien de fuir pour tenter de semer tes démons intérieurs. Car ils sont en toi. Et si tu ne leur règles pas leur compte, ils ne cessent de grandir avec le temps. Jusqu’à ce que la jauge se retrouve à un niveau critique.
C’est ce qui t’est arrivé, Jérémie.
Après la bagarre, l’attente des secours t’a paru interminable. Tu as été soulagé de voir que le type que tu avais cogné semblait moins amoché qu’il t’avait semblé sur le coup.
Quant à toi, tes quelques blessures étaient plutôt légères. Ainsi, après un court détour par les urgences, la Police t’a embarqué et foutu en cellule de dégrisement. La dynamique de l’« accident » a été très vite reconstituée. Ton état d’alcoolémie crevait le plafond. Le type aussi était saoul. Mais toi, tu t’es acharné sur lui, de nombreux témoins ont pu le confirmer. Tu as été renvoyé en comparution immédiate devant un juge.
Tu as eu de la chance. Ton avocat t’a appris que le type n’aura pas de séquelles. Et tu as pleuré de soulagement.
La sentence a été somme toute clémente. Deux mois avec sursis, quelques dizaines d’heures de travaux d’intérêt général, le remboursement des frais médicaux du type, ainsi qu’un fort dédommagement.
Martres Tolosane, début avril 2016.
Près de trois mois après mon installation à Martres, la maison est enfin complètement aménagée. Le printemps arrive, et je sens monter en moi une nouvelle envie, celle de recevoir du monde dans mon petit chez moi à la campagne. Autour de grillades dans le jardin, je pends la crémaillère en plusieurs actes.
D’abord avec ma famille, Papa, Maman, mais aussi Elodie, Philippe et la petite Lucie. Elle n’est plus si petite d’ailleurs, la crevette a bien grandi, elle va bientôt avoir 14 ans, et il semblerait qu’elle ait déjà un amoureux au collège.
Quelque temps plus tard, c’est au tour de mes amis de découvrir mon nouveau cadre de vie. A commencer par Thibault et Arthur, les deux adorables pompiers, forts désormais d’une histoire de près de dix ans. Ils ont également amené le petit Lucas qui, du haut de ses 14 ans et demi, est en train de devenir plutôt beau garçon. La passion sportive de son papa ayant déteint sur lui, il ne jure que par le rugby et il joue dans une équipe junior au poste d’ailier. Comme Jérém en son temps.
Sont également de la partie Julien, le beau moniteur d’autoécole, ainsi que sa (nouvelle) copine, une certaine Laura. « Je crois que c’est la bonne » il m’a lancé discrètement en arrivant chez moi, tout en accompagnant ses mots avec un sourire fripon et un clin d’œil malicieux en contraste total avec ses propos.
J’ai bien évidemment convié Stéphane et Iban, dont la relation dure depuis trois ans déjà.
Entouré de mes amis, je me sens bien, je passe une très agréable journée. La conversation est rythmée, joyeuse. Personne ne se hasarde à évoquer de près ou de loin le sujet qui pourrait gâcher l’ambiance.
C’est fou comme près de dix ans après ma séparation avec Jérém, ce sujet soit toujours tabou. C’est certainement de ma faute. J’ai voulu me protéger, et mes amis ont respecté cela. Jérém a disparu de nos conversations. J’aimerais pouvoir demander de ses nouvelles, je voudrais pouvoir montrer que je suis guéri, que j’ai fait mon deuil de cette histoire.
Mais j’ai peur de demander, j’ai peur de savoir, j’ai peur que le deuil ne soit toujours pas achevé.
Brisbane, avril 2016.
Après avoir réglé ta dette avec la justice, la nouvelle année peut enfin commencer pour toi, Jérémie. Cependant, rien ne laisse présager qu’elle sera différente de la précédente.
Car tes démons intérieurs reviennent aussitôt te titiller. Tu ne veux pas retomber dans les travers qui t’ont conduit à cette maudite bagarre, mais tu sens que tu n’es pas assez fort pour remonter la pente tout seul.
En fait, tu n’as jamais été assez fort pour être bien tout seul. Tu as toujours eu besoin de te sentir épaulé pour être bien.
Enfant, c’est Thibault qui t’a soutenu en premier. Et c’est grâce à lui que tu avais rencontré le rugby. Et, avec le rugby, c’est tout un monde qui s’ouvrait à toi, .
C’est grâce au rugby si tu avais enfin eu des potes. C’est encore grâce au rugby que tu t’étais taillé ce corps musclé qui a attiré sur toi les regards depuis ton adolescence. Et c’est toujours grâce au rugby que tu avais trouvé une passion, que tu t’étais senti à ta place pour la toute première fois de ta vie, que tu avais gagné de l’assurance, que tu t’étais senti respecté, admiré, jalousé même.
Le rugby t’avait permis d’affronter et d’apprivoiser l’un de tes démons, la peur de l’exclusion.
Mais un autre était à l’affût, et celui-ci te paraissait encore plus terrifiant que le premier.
Ce démon épouvantable était celui de tes attirances inavouables.
Et là, c’était Nico qui avait pris le relais. Nico avait su te montrer qu’il n’y avait rien de mal à aimer un garçon, et qu’être gay n’était pas une tare, et que ça ne t’ôtait pas le droit d’être heureux.
Avec Nico, tu avais appris à accepter qui tu étais, et à ne plus te détester parce que tu es gay.
Ulysse t’avait lui aussi beaucoup soutenu. Il t’avait aidé à t’intégrer dans le monde du rugby professionnel, il t’avait lui aussi donné une « recette » pour que tu puisses dépasser ta peur d’échouer, pour que tu croies en toi.
Au final, tu avais fini par trouver un certain équilibre entre ta passion et ta vie, entre le rugby et Nico. Mais tout cela avait volé en éclat le soir de tes 25 ans.
Ce soir-là, tu t’étais senti doublement vulnérable.
D’abord « physiquement ». Car, même si tu avais essayé de te défendre et de défendre Nico, tu n’avais pu faire qu’encaisser, et regarder Nico encaisser lui-aussi, les coups de ces bâtards.
Mais dès le lendemain, tu t’étais également senti vulnérable « socialement ». Il a fallu des années de « mise en scène » pour construire ton image d’hétéro socialement acceptable, des années d’efforts et d’exploits pour façonner ta carrière de rugbyman professionnel de premier plan. Et il avait suffi d’un instant pour que toute ta construction s’effondre. Tu ne t’attendais pas à ça. Et ça, ça t’avait traumatisé.
Ton image avait volé en éclats, et tu te sentais considéré comme un imposteur, un menteur, un traître.
Pendant les longs mois de convalescence, tu avais réussi à récupérer ton corps, mais pas ton mental. Ni ton aura de sportif prestigieux. L’humiliation et la honte t’avaient suivi jusque sur le terrain, lors de ton retour en équipe. Tu t’étais fait insulter. Dès lors, tu avais su que tu ne pourrais plus jamais revenir au top dans le rugby.
Tu étais si mal que tu avais même imaginé quitter le rugby pour de bon. Tu cherchais surtout à fuir l’humiliation publique d’un outing forcé. C’était vital pour toi, c’était ta façon de sortir la tête de l’eau, de ne pas te noyer.
Puis, tu avais croisé la route de Rodney. Ce qui t’avait immédiatement plu chez lui, ça avait été sa façon de s’assumer. Rodney était un rugbyman connu et respecté qui vivait sereinement son homosexualité, sans vraiment s’en cacher, sans en avoir honte, et sans que cela nuise à sa carrière. Et en plus, il était tellement charismatique ! Il était pote avec tout le monde, il était extrêmement populaire. Ça t’a paru fou, incroyable.
Nico avait été une inspiration, Rodney t’apparaissait carrément comme un modèle.
Après le traumatisme de l’agression parisienne, tu as cru que tu serais davantage en sécurité avec lui.
Martres Tolosane, fin avril 2016.
Martin m’avait annoncé son départ à l’automne dernier. Et c’est maintenant que ça se concrétise. J’ai beau m’y être préparé, lorsqu’il m’a annoncé la date précise de son déménagement en Normandie, j’ai senti un peu plus de vide gagner mon cœur. Ma relation avec Martin aura duré tout juste un an. Ce garçon n’était qu’un sex-friend, certes, mais d’une certaine façon je m’étais attaché à lui. Tout autant que nos galipettes, nos conversations vont me manquer. Sa présence va me manquer. Le regard qu’il portait sur moi me faisait me sentir attirant, son envie de remettre « ça » régulièrement me faisait me sentir désirable. Au final, sa présence contribuait à maintenir un semblant d’équilibre dans ma vie.
D’un autre côté, j’ai comme le sentiment que son départ marque également un nouvel essor pour moi. En fait, l’année 2016 commence vraiment après le départ de Martin.
Brisbane, avril 2016.
Et puis, tout a volé en éclats à nouveau, le jour où ces maudites photos avaient été publiées.
Tu te souviens de ce jour de l’été 2009 comme si c’était hier. Tu l’avais appris en même temps que Rodney, par un coup de fil reçu par ce dernier. Votre agent vous avait informés que le tabloïd était en kiosque, et que les photos circulaient sur Internet. Le mal était fait, le désastre irréversible.
Tu avais cru que le ciel te tombait sur la tête. Et tu n’arrivais pas à comprendre comment Rodney, après un court moment de surprise, puisse avoir l’air si serein. Il tentait de te rassurer, mais son calme ne faisait qu’amplifier tes angoisses. Tu étais obsédé par les conséquences désastreuses que cette affaire aurait sur ta carrière, par la honte que tout le monde sache que tu étais pédé.
Sept ans après la parution de ces maudites photos, tu ressens toujours en toi un sentiment de terrible gâchis et de profonde injustice.
Le lendemain de la publication, tu étais très mal. Tu te cassais la tête en essayant de trouver ce qu’il convenait de faire, s’il existait un moyen pour rattraper le coup. Mais tu étais sous le choc, tu paniquais, et tu étais incapable de réfléchir.
Pour toi, la désillusion a été douloureuse. Car tu venais d’en faire l’expérience, à chaque fois que tu avais eu l’impression d’être en sécurité, la vie venait violemment te rappeler que tu ne le seras jamais, nulle part.
Quelques jours plus tard, le téléphone de Rodney avait sonné à nouveau. C’était le journaliste d’une grande chaîne anglaise qui lui proposait une interview pour donner son point de vue vis-à-vis de ces photos. L’invitation était également valable pour toi, Jérémie. Toi aussi tu étais convié à t’exprimer au sujet de ces images volées.
Mais pour toi, c’était hors de question de te prêter à cet exercice périlleux. Te montrer publiquement après le tollé provoqué par ces images était au-dessus de tes forces.
Mais Rodney voyait les choses autrement. Il avait envie de régler ses comptes avec une certaine presse indigne, il voulait y aller la tête haute, assumer qui il était, et dire « merde » à ceux qui le jugeaient. Tu avais tenté de l’en dissuader. Il n’y avait pas eu moyen. Il était trop déterminé à ne pas subir.
La parution des photos avait ébranlé ton équilibre. Le choix de Rodney avait empiré ton mal-être. Tu savais que ton nom serait évoqué, alors que tout ce que tu voulais était qu’on t’oublie.
Ça n’avait pas raté, ton nom était sorti dans l’interview. Rodney avait été très correct vis-à-vis de toi, tu avais vraiment apprécié sa façon de recentrer le sujet de l’interview. D’ailleurs, au fond de toi tu savais qu’il avait fait le bon choix, et que dans son interview il avait été juste, ferme, et exemplaire. Au fond de toi, tu avais admiré son choix, sa maturité, sa force.
Et pourtant, tu n’avais pas su le lui montrer. Tu étais trop mal pour ça. Tu avais prétendu lui en vouloir du fait d’avoir encore remué cette histoire, alors qu’en réalité tu t’en voulais à toi de ne pas être aussi fort que lui.
Rodney avait assumé, et il était passé à autre chose. Alors que toi, tu avais fait un refus d’obstacle, et tu étais resté bloqué là-dessus.
Cette histoire avait mis un arrêt net et brutal à vos carrières. Les sponsors vous avaient lâchés du jour au lendemain, et la direction de l’équipe avait tout simplement annulé le renouvellement de vos contrats. Il n’y avait plus rien eu à faire, pas de recours possible.
De toute façon, tu n’aurais plus osé te pointer dans un vestiaire. Le sentiment de honte te paralysait. Tu te disais qu’où que tu ailles, tu risquerais toujours d’être harcelé et humilié.
Au final, Rodney s’en était sorti la tête haute. D’autant plus que, pour lui, l’arrêt de sa carrière au rugby ne portait pas grand préjudice. Car elle avait été écourtée d’un an ou deux au maximum.
Mais toi, toi tu ne t’en tirais pas à si bon compte. Ta carrière était loin d’être terminée, et tu avais encore de belles années devant toi. Toi t’étais passé direct de la gloire au déshonneur sans transition, et la chute avait été particulièrement brutale.
Tu avais donc fait le choix de fuir pour ne plus être exposé médiatiquement. Tu étais parti le plus loin possible de tout ça.
Rodney n’avait pas besoin de fuir, ni de s’exiler à l’autre bout de la Planète. Il était bien dans ses baskets, lui. Mais il savait que tu étais mal, et il t’avait rejoint en Australie. Il avait choisi d’être avec toi plutôt qu’avec sa famille. C’était un beau geste d’amour.
Mais tu t’étais renfermé sur ton malheur, tu étais devenu instable et agressif. En dépit de l’amour que Rodney te portait, de son soutien, de sa présence, de sa patience, ton mal-être n’avait fait que grandir et il avait très vite eu besoin d’une cible pour s’exprimer. Cette cible était toute trouvée.
Tu avais été insupportable avec Rodney, injuste, infecte. Tu lui en avais voulu sans raison valable, tu avais recommencé à boire, tu avais refusé de te reprendre en main. Tu l’avais trompé. Il t’avait pardonné. Tu avais recommencé. Les disputes étaient arrivées, de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes.
Martres Tolosane, mai 2016.
Comme chaque année, le début du mois de mai est pour moi une source de nostalgie et de mélancolie. Le deux du mois est l’anniversaire de la première révision avec Jérém dans l’appart de la rue de la Colombette. Et cette année, l’anniversaire est de ceux qu’on « fête ». 15 ans déjà !
Tout comme il y a 15 ans, ce soir le vent d’Autan souffle. Il me ramène les souvenirs de l’année 2001 et celles qui l’ont suivie, les plus heureuses de ma vie, les années où j’ai été amoureux, les années où j’ai aimé.
Dans cette période de nostalgie inconsolable, la présence de mon Galakou d’amour est particulièrement précieuse. Il y a une connexion particulière entre lui et moi, un lien qui fait qu’il est capable de sentir venir mes larmes, et d’intervenir avant même qu’elles coulent sur mes joues. Sa technique est simple. Il vient alors se blottir contre ma jambe, il relève le museau, il ouvre sa gueule en poussant des respirations appuyées, il émet un bruit qui ressemble à un bâillement mais qui n’est qu’une invitation au câlin, il cherche mon regard, il cherche le contact, il cherche un échange de tendresse.
E lorsque je croise ses yeux emplis d’amour et de tendresse, je vais déjà mieux. Je plonge mes mains dans son poil aussi doux que son regard, et je vais encore mieux. Je saisis son museau avec ma main, je caresse ses joues qui remplissent parfaitement ma paume, et je vais beaucoup mieux.
Martres Tolosane, lundi 2 mai 2016, au soir.
C’est la première fois que je ne vis pas cet anniversaire à Toulouse, que je ne me balade pas aux alentours de mon lycée, de la rue de la Colombette, du boulevard Carnot, de la Bodega, sorte de pèlerinage pour tenter de chasser ma mélancolie, tout en la cultivant. Car cette mélancolie, ce sentiment de manque, c’est tout ce qui me reste de mon histoire avec Jérém.
Mais cette année, ce pèlerinage n’aura pas lieu. C’est peut-être un pas dans la bonne direction. Peut-être qu’un jour j’arrêterai de célébrer ce curieux anniversaire.
Est-ce que Jérém y pense parfois, à ce jour de mai ? Est-ce qu’il pense parfois à moi ?
Ce soir, alors que la tristesse me happe dans mon canapé, Galaak approche avec son ballon, le fait tomber. Il me regarde fixement pendant un petit moment, tout en remuant la queue. Et puisque je ne réagis pas assez vite, il finit par s’assoir, puis s’allonger sur le ventre, tout en faisant passer sa patte par-dessus le ballon, à la fois une invitation et un défi pleins de tendresse.
Ce soir, j’ai l’occasion de faire l’une de plus belles photos de mon amour de Labrador.
Je saisis le ballon de rugby qu’il tient toujours sous la patte et je le lui lance. C’est parti, on va jouer.
Jouer avec mon chien m’apaise. Le regarder courir après son ballon m’emplit de tendresse, car sa joie totalement insouciante est contagieuse. Et ma mélancolie se dissipe.
Oui, c’est la pause Galaak. Redoutable thérapie de rugbydog.
Sidney, mai 2016.
Tu réalises que tu vas bientôt avoir 35 ans, et le bilan de ta vie est catastrophique. Tu as tout perdu de ce qui faisait ta vie d’avant.
Tu repenses sans cesse aux années magiques de ta carrière dans le rugby professionnel.
Tu repenses aux grands matches dans les grands stades, tu ne pourras jamais oublier le vertige qui t’avait cueilli la première fois que tu avais foulé la pelouse du Stade de France et que tu avais été soufflé par la ferveur, l’enthousiasme, le bruit de 80.000 supporters. Tu ne pourras jamais oublier cette vibration des supporters qui faisait trembler même la pelouse sous tes pieds et qui se transmettait à toi, jusqu’au plus profond de ton cœur. Non, tu n’oublieras jamais à quel point tu t’étais senti heureux et en phase avec toi-même, à cet instant précis !
Tu repenses aux points marqués, aux point ratés, à la tension du vestiaire avant les matches, aux frissons du terrain, aux émotions partagées après une victoire ou même après une défaite. C’était tellement grisant tout ça !
Tu repenses à ce jour mémorable où tu avais enfin soulevé le Brennus.
Tu repenses aux pays que tu avais visités, aux équipes que tu avais affrontées avec le Tournoi des Six Nations.
Tu repenses au temps où ta carrière était promise à un bel avenir que personne n’aurait pu te retirer.
Tu repenses aux amitiés nées autour du rugby, et tu repenses à ces garçons qui étaient devenus des potes inestimables, Thibault, Ulysse, Rodney et qui t’avaient, chacun à leur façon, tant apporté.
Tu repenses à d’autres rencontres, à des entraîneurs, des dirigeants, des anciens joueurs, tous ces gens qui avaient cru en toi, qui t’avaient témoigné de l’estime, des rencontres qui t’avaient marqué, aidé, rassuré, poussé à croire en toi et à te surpasser.
Tu repenses à ta vision de l’avenir à l’époque, un avenir qui te semblait tout tracé. Tu te voyais jouer au rugby jusqu’à 35 ans, c’est-à-dire à peu près l’âge que tu as aujourd’hui. Si tout s’était passé comme prévu dans ta tête, à l’heure qu’il est, tu t’apprêterais peut-être à raccrocher les crampons. Mais ton « aura professionnelle » serait telle que tu aurais l’embarras du choix face aux nombreux postes d’entraîneur ou de consultant que les clubs les plus prestigieux de la Planète, en France ou à l’étranger, t’auraient proposé.
Tu espérais jouer assez longtemps, avoir des statistiques assez impressionnantes, pour marquer durablement les esprits. Ton rêve le plus cher était qu’on se souvienne de toi comme de l’un des meilleurs joueurs de ta génération. Et même, si possible, comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.
Tu repenses à ton corps musclé en boxer sur des affiches en 3 sur 4 dans toutes les villes de France, à ta gueule dans la presse sportive et people.
Tu repenses aux nanas qui faisaient clairement la queue pour avoir ta queue. Et à certains gars qui postulaient pour la même chose, juste un peu plus discrètement.
Tu repenses à l’insouciance de ces années où l’argent coulait à flots, et où la dépense était sans compter.
Tu repenses à cette impression que tu ressentais à cette époque en te levant le matin, l’impression que ta jeunesse serait toujours là et qu’elle te protègerait de tout. C’était l’impression d’être invincible, invulnérable, immortel. C’était une illusion, mais elle était tellement convaincante, que tu avais fini par y croire.
Martres Tolosane, juin 2016.
Pour tenter de combler le manque laissé par le départ du beau Martin, je reviens sur l’application.
Pour me rendre compte que, primo, à la campagne il n’y a pas du tout le même choix qu’en ville. Au point que, certains soir, la mosaïque de l’application ressemble à s’y méprendre au shooting pour le casting des Gremlins.
Et que, secundo, je n’ai pas besoin de ça, des plans sans lendemain, des rencontres fugaces, des heures perdues à essayer d’appâter un mec qui essaie d’en appâter un autre qui lui aussi essaie d’en appâter un autre. J’avais oublié à quel point tout cela est chronophage, frustrant et terriblement dévalorisant.
Alors, je décide d’arrêter les frais. Je décide d’arrêter de gaspiller du temps et de l’estime de moi. A un moment, il faut savoir dire STOP. Il s’agit de prendre le temps de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, d’admirer le paysage, d’attendre, de comprendre, de se comprendre, de se connaître soi-même, de comprendre ce dont nous avons vraiment besoin. Calmer le jeu est un exercice difficile, mais ça fait un bien fou.
Pour me changer les idées, je peux toujours compter sur Galaak, mon clown attitré. Il me fait rire, égaie mes journées et mes soirées de sa simple présence.
Dans mon jardin, il y a un cerisier, et ce printemps il est chargé à craquer. Un soir, alors que je suis en train de tondre la pelouse, j’entends un bruissement insistant de feuillage. Lorsque je lève mon regard, je n’en crois pas mes yeux. Galaak est posté sous le cerisier. Il est assis, le museau pointé vers le haut, tout son corps, son attention et son désir visant quelque chose de très précis. Un instant plus tard, je le vois se propulser avec ses pattes arrière, lever les pattes avant, se s'élancer en direction d’une branche, ouvrir la mâchoire au bon moment, la refermer sur une cerise, et atterrir en entraînant dans son mouvement la branche de l’arbre. Jusqu’à ce que le fruit se détache et que la branche retourne à sa position naturelle dans un mouvement brusque qui génère ce grand bruit de feuillage que j’avais entendu. Une fois atterri, il profite de sa prise, qu’il déguste lentement, avec une douceur extrême. Je découvre ainsi que mon chien, que je savais déjà gourmand de toute sorte de fruits, à l’exception des agrumes, est capable d’aller bouffer les cerises directement sur les branches basses de l’arbre. Je n’invente rien, j’ai la vidéo.
Nouvelle pause Galaak.
Le Labrador est le meilleur des anti-dépresseur et, à ce titre, ses croquettes devraient être remboursées par la Sécu.
Sidney, juin 2016.
Mais tous tes rêves avaient été brisés en un instant. En quelques instants. Il avait suffi d’une agression gratuite, de quelques ragots et de quelques photos pour que ta forteresse de bonheur et tes rêves d’éternité s’écroulent comme un château de cartes.
Quel immense gâchis, alors que tu avais vraiment tout pour réussir !
Près de sept ans après ton retrait soudain du rugby professionnel, qui se souvient encore de l’ailier Jérémie Tommasi qui a joué pendant plusieurs saisons, et marqué de très nombreux essais, dans l’une des équipes plus puissantes du Top XV ? Qui se souvient de tes sélections en équipe de France, ou de ta brillante carrière internationale en Angleterre et en Afrique du Sud ? Qui se souvient de ton nom, de ton palmarès ?
Si quelqu’un se souvient de ton nom aujourd’hui, il y a à parier que ce soit plutôt en relation avec ces sales photos que pour tes exploits sportifs. Il y a à parier que si ton nom venait à être évoqué, il serait davantage associé à des moqueries et à du mépris qu’à de l’estime et à de l’admiration.
Tu sais que ta chute a déçu énormément de monde, tous les gens qui ont cru en toi, qui t’ont poussé, encouragé, admiré, les entraîneurs, les coéquipiers, les supporters. C’est frustrant, et terriblement douloureux.
Tu imagines que ta déchéance doit régaler les gens qui ne t’aimaient pas. Et ça, c’est terriblement humiliant.
Mais le pire, c’est la déception et l’inquiétude que tu as ressenties chez les gens qui t’aiment.
Maxime, ton père, Thibault, Ulysse, Charlène. Le plus dur, ça a été de décevoir les espoirs qu’ils avaient placés en toi, en ton avenir sportif. Tu as fini par les tenir à distance. Pour ne plus les sentir s’inquiéter pour toi, pour ne pas sentir leurs déceptions tout juste voilées.
Aujourd’hui, plus rien ne te retient en Australie. Rien à part le fait d’être désormais complètement fauché. Après avoir réglé les frais médicaux et les dédommagements du type que tu as tabassé à la fête foraine, il ne te reste plus rien. Et tu es à présent obligé de cumuler les jobs pour voir venir. Tu n’as même plus de quoi t’acheter un billet d’avion pour rentrer en France.
Mais au fond, ce n’est pas plus mal. Si tu as envie de retrouver les tiens, tu n’as pas du tout envie de leur montrer ce que tu es devenu. Tu as trop honte de toi.
Non, tu ne leur demanderas pas de l’argent pour rentrer. Tu ne supporterais pas une humiliation de plus.
Orlando, Floride, 12 juin 2016.
A Orlando, en Floride, un fou furieux pénètre dans une boîte gay, le « Pulse ». Il est armé d’un fusil d’assaut et de plusieurs recharges de munitions. Il ouvre le feu et tue 49 personnes et en blesse 53 autres.
L’acte est clairement un crime homophobe.
On découvre avec sidération qu’en 2016 on peut encore se faire tuer parce qu’on est gay, et ça se passe dans la première démocratie du monde occidental.
Le monde est malade, il n’y a plus de doute.
Canberra, juillet 2016.
Rodney a quand même tenu bon plus de trois ans. Trois ans à supporter ta morosité, tes sautes d’humeur, ta colère, vos accrochages incessants, tes tromperies à répétition.
Puis, un jour de 2013, après une énième dispute, il avait fait ses bagages et était reparti en Angleterre. Tu sais qu’il l’avait fait la mort dans le cœur, car il t’aimait toujours, malgré ton comportement de con, fait et fini. Il avait essayé de t’aider à aller mieux, mais tu ne lui avais pas permis de t’aimer.
Tu t’étais rendu assez insupportable pour mettre à mal l’amour qu’il te portait. Tu avais dû être vraiment infecte pour qu’un garçon si généreux, patient et amoureux, arrive à jeter l’éponge.
Lorsque Rodney était parti, tu avais ressenti un immense vertige. Le vertige abyssal de la solitude. Mais tu t’étais également senti soulagé. Tu n’en pouvais plus de lui imposer ton mal être et de le faire souffrir. Tu aurais voulu pouvoir faire autrement, mais tu n’avais pas pu. Ta colère et un profond sentiment d’injustice te rongeaient de l’intérieur, et tu n’arrivais pas à te reprendre en main.
Toulouse, juillet 2016.
Tu enserres tes mains sur mes épaules dans une prise ferme, brutale, et tu commences à me limer avec une cadence de dingue. Tes coups de reins sont assénés avec une puissance dont je me délecte. Cet instant est exactement comme je me l’étais imaginé. Ton souffle chaud et bestial dans mon cou, ton animalité déchaînée. C’est même mieux que je me l’étais imaginé. Je ne contrôle plus rien, je t’appartiens entièrement.
C’est vraiment ce côté « animal » qui me fascine chez toi, cette attitude de bon petit macho pour qui seul son propre plaisir compte.
J’espère que la capote va tenir bon, qu’elle va supporter jusqu’au bout la sauvagerie de tes assauts.
Et puis, ça vient. Je sens tes mains se contracter encore un peu plus, tes doigts s’enfoncer davantage dans ma chair. Je ressens l’intensité des secousses de plaisir qui agitent ton corps. Malgré la musique qui retentit dans le haut-parleur placé juste au-dessus de nous, je capte les râles que tu retiens de justesse. Tu jouis dans la capote, mais grâce à mon cul. Quel honneur, tu me fais, beau mâle Kevin !
Tu te déboîtes aussitôt. Tu es pressé. J’ai perdu la notion du temps mais je pense que les dix minutes de ta pause sont passé depuis un moment.
Je me retourne. Rien dans ton attitude indique que tu envisages de me renvoyer l’ascenseur. Tu t’en fous si j’ai envie de jouir à mon tour ou pas. Tu as joui, le but est atteint. Tu enlèves ta capote et tu la jettes dans la cuvette, tu fais disparaître ta belle queue luisante de sperme dans ton boxer. Tu fais repasser ton t-shirt noir par-dessus la tête, il retombe sur ton torse comme un chat retombe sur ses pattes. Tu remontes ton jeans, tu agrafes ta ceinture. Le cliquetis que produit la boucle secouée par tes mouvements secs résonne dans mes oreilles avec une sensualité particulière.
Dans le petit espace, l’odeur de foutre s’ajoute désormais aux autres odeurs de chiotte. C’est l’émanation olfactive de ton plaisir, du plaisir d’un superbe mâle.
Je te regarde une dernière fois, et j’essaie de graver dans ma mémoire ce dernier instantané de ton intimité sexuelle. Ton brushing a été un brin malmené par le double passage de ton t-shirt, ainsi que par la vigueur de tes assauts.
La sueur a perlé sur ton front, tes lèvres entrouvertes laissent s’échapper des expirations puissantes que la musique m’empêche de capter. Ta pomme d’Adam se balade nerveusement le long de ta gorge, signe inconscient du passage récent de l’orgasme.
Pendant une seconde, tu es complètement ailleurs, perdu dans l’atterrissage de ta jouissance de mâle, complètement déconnecté du présent. Ça ne dure qu’un instant, mais c’est beau, beau à en crever.
— Salut ! tu me lances à la va vite, en défaisant le loquet. Et tu disparais, sans le moindre regard, sans le moindre égard.
Je referme la porte derrière toi. Et je me retrouve instantanément en tête à tête avec ma solitude.
Tu as vraiment été un bon coup, Kevin ! L’impétuosité presque agressive de tes gestes, l’arrogance de ton attitude de mâle qui exige son dû, tout en méprisant celui qui le lui offre – bref, ta façon d’être et de me baiser – m’ont foutrement chauffé. Sans parler de ta queue vraiment bien foutue, de tes coups de reins puissants et sauvages, de tes mains saisissant ma chair, la contraignant, me donnant l’impression que je n’avais pas d’autre choix que de satisfaire tes envies jusqu’au bout.
Et puis il y avait le contexte aussi. Ça s’est fait pendant ta courte pause, sur ton lieu de travail, dans une cabine des chiottes ouvertes au public. Sexy Kevin, tu m’as offert une baise frôlant le fantasme absolu !
La vision de ta capote qui flotte dans la cuvette fait écho au souvenir de tes va-et-vient qui pulsent encore dans ma chair, de la prise de tes mains qui entrave encore mon corps, de ta présence en moi.
Oui, tu as été un sacré bon coup. Et pourtant, désormais seul dans ce lieu où tu viens de me sauter sans ménagement, je me sens sale. Et je n’ai même pas joui ! C’est sciemment que j’y renonce, préférant quitter ce lieu sans que le vide post-coïtal vienne me foutre le cafard.
Je tire la chasse, comme pour faire disparaître la dernière trace de cette baise que je regrette déjà.
Ce qui ne m’empêche pas, en quittant cette cabine à mon tour, de sentir monter en moi une sensation de dégoût.
J’ai beau me dire que ce que je viens de faire n’a rien de répréhensible, j’ai beau me dire que prendre autant de plaisir ne peut pas être mauvais. Au fond de moi, je regrette déjà de m’être offert de cette façon.
Je ressens en moi comme un sentiment de trahison de moi-même et de mon passé, comme si je me sentais désormais indigne de ce garçon amoureux, de ce garçon aimé que j’ai été. Certes, ce garçon s’était déjà retrouvé dans des chiottes pour des bonnes baises sauvages. Mais c’était avec le mec qu’il aimait comme un fou.
Qu’est donc devenu ce garçon ?
A cet instant précis, j’ai l’impression d’avoir tué ce garçon. Ce garçon pour qui, il y a longtemps déjà, un autre garçon nommé Jérémie Tommasi était le seul but dans sa vie. Quand le cœur est privé d’amour, le corps prend le dessus et s’enfonce dans la luxure.
J’ai l’impression d’avoir un jour connu le Paradis, avant d’en tomber, et de me perdre en Enfer aujourd’hui.
Comment pourrais-je regarder en face mon beau Jérém si d’aventure le destin rendait cela possible, alors que je sais qu’en rentrant tout à l’heure, j’aurai déjà du mal à me regarder moi-même dans la glace ?
Oui, en quittant le centre commercial, j’ai l’impression de trahir la beauté de ma grande histoire avec Jérém.
Pendant toutes ces années, la machine mentale à archiver le passé a eu tout le temps de trier les souvenirs pour ne retenir que ce que j’avais besoin d’en retenir, à savoir, les moments les plus heureux.
Comme celui du jour où je l’ai vu pour la première fois dans la cour du lycée, de sa casquette et de son t-shirt noirs, ou le souvenir de notre première révision, de son t-shirt blanc, le bonheur de nos retrouvailles, de nos nuits d’amour, de nos baisers, de nos câlins, de nos confidences sur l’oreiller, de notre complicité.
Mais au fond de moi je sais qu’elle a occulté les attentes interminables, la peur de l’abandon, les angoisses, les déceptions. Et notre séparation. En fait non, je n’ai rien oublié, mais le temps a anesthésié ce qui a longtemps été douloureux.
Non, notre histoire n’était pas parfaite. Mais elle était belle, et elle était pure. Même nos erreurs, et Dieu sait que nous en avons commises, tous les deux, étaient « innocentes », sans intention de faire du mal à l’autre. Même nos baises les plus « sauvages » n’étaient en réalité que le préalable de jours heureux, une façon de nous apprivoiser.
Nous nous sommes faits du bien, et aussi beaucoup de mal. Le premier était une évidence, le deuxième rien d’autre que le fruit de nos maladresses. C’était ma première histoire, mon premier amour, et ça l’était pour lui aussi. Nous avions tout à découvrir de la vie, et de nous-mêmes.
Nous étions heureux. J’étais heureux. Avec le recul, j’ai l’impression que même quand je souffrais, j’étais heureux. Car je me sentais si vivant !
Ce samedi, je me suis rendu dans un magasin d’électroménager dans une zone commerciale de Toulouse pour m’acheter un nouveau lave-linge. Et tu étais là, beau mâle Kevin au charme sauvage, derrière le comptoir, et tu avais l’air d’un fauve en cage. Je t’ai maté, et c’est de cette façon que j’ai ouvert la porte de ta « prison ». Je t’ai fait retrouver ta liberté et ta fierté, et tu m’as fait profiter de toute sa sauvagerie. J’ai bien kiffé, mais tes griffes ont laissé quelques blessures derrière elles.
Melbourne, août 2016.
Tant que Rodney était resté à tes côtés, sa présence te tenait à flot, d’une certaine façon. Mais depuis qu’il est parti, tu te laisses complètement vivre.
Depuis trois ans, tu n’as fait que bourlinguer dans cet immense pays-continent qu’est l’Australie. Tu es comme un bateau sans moteur et sans voile, tu pars à la dérive. Tu as voyagé de ville en ville sans jamais t’arrêter, sans jamais trouver un endroit où te poser, un endroit où tu te sentirais bien.
Le fait est que tu ne t’es jamais senti bien nulle part. Car c’est au fond de toi que tu ne te sens pas bien. Il faut être en paix avec soi-même pour être bien. Dès lors, peu importe l’endroit, on sera toujours bien.
Mais tu n’es pas en paix avec toi-même.
Alors, dans ton errance de trois ans, les tentations t’ont attiré comme un vertige devant la falaise.
Tu as baisé, beaucoup trop baisé, tu as chopé quelques saloperies, mais rien qui ne se soigne pas avec des antibios ou une piqûre. Tu as eu de la chance.
Et tu as bu, tu as trouvé la bagarre. Jusqu’à celle avec le type de la fête foraine qui aurait pu gâcher toute ta vie. Heureusement pour toi, cette affaire ne s’est pas trop mal terminée. Et tu t’en es tiré somme toute à bon compte.
Et maintenant, après trois années d’errance, la vie se charge de te présenter l’addition. Plusieurs additions, même.
D’abord, une addition « physique ». Depuis quelque temps, quand tu te regardes dans un miroir, tu n’aimes plus du tout ce que tu vois. Ton corps a changé, et ce n’est pas une réussite. Tes muscles ne sont plus aussi saillants qu’avant, et tu as pris du poids.
Oui, quand tu te regardes dans ton miroir, tu sais que le processus est engagé, et que plus tu attends pour te reprendre en main, plus ce sera difficile de redresser la barre.
Le fait est que ton hygiène de vie est calamiteuse. Tu manges n’importe comment, tu bois trop, et tu ne fais plus de sport.
Certes, tu es toujours beau, tu n’as aucun problème à lever un gars quand tu en as envie.
Du moins jusqu’à ce soir où tu as croisé ce mec en boîte. C’était un beau petit blond aux cheveux bouclés, aux yeux gris magnifiques, profonds, lumineux. Et ce garçon sublime t’a mis un râteau aussi inattendu que monumental.
« Sorry, too old for me ! », il t’avait balancé au moment où tu avais essayé de l’aborder.
« Désolé, trop vieux pour moi ! ».
Des mots lancés avec la « candeur infernale » de sa jeunesse, mais blessants comme une lame de couteau dans tes oreilles.
Des mots accompagnés d’un rire à la fois si beau, si insolent et si cruel.
Des mots « mis en images » un peu plus tard dans la soirée, par contraste, lorsque tu l’avais vu repartir avec un autre superbe mec de son âge.
Certes, ce soir-là tu n’étais pas à ton avantage. Tu n’étais pas vraiment bien sapé, tu avais les cheveux et la barbe trop longs, ce qui faisait ressortir les quelques prémices de blanc qui ont depuis peu commencé à entacher la perfection de ta brunitude.
Mais son râteau t’avait salement surpris, il t’avait fichu un sacré coup au moral. D’autant plus que ce petit mec te faisait foutrement envie !
Certes, tu en as eu d’autres, depuis, de beaux garçons. Et pourtant, cet « accident » t’a marqué, et au fond de toi tu sens que tu as perdu pas mal de ton assurance. La peur du rejet te hante désormais.
Mais il y a aussi une autre addition qui se présente à toi, une addition plus d’ordre « moral ».
Là non plus, tu ne te reconnais plus. Ne rien faire de tes journées, ne pas avoir de but, ça ôte à la vie toute sa saveur. L’oisiveté ne remplace pas la passion. Les plans et les cuites ne remplacent pas l’amour. Et une vie sans passion et sans amour, c’est fade, c’est triste.
Alors, tu vis le présent. En fait, non, tu vis AU présent. Et, ce faisant, tu subis le présent, tu te laisses porter par l’instant.
Quand tu as l’esprit clair, tu en baves. Avec le recul, tu réalises que Thibault, Nico, Ulysse, Rodney, t’ont chacun aidé à leur façon. Chacun de ces garçons t’a soutenu, encouragé, préservé de toi-même. A chaque fois que tu as été entouré, tu as pu maîtriser tes démons intérieurs.
Mais leur influence n'a pas vraiment pris racine en toi. Elle a disparu dès que ces garçons sont sortis de ta vie. Dès que tu les as obligés à sortir de ta vie.
Les autres peuvent nous aider à un moment. Mais nous sommes les seuls à pouvoir affronter nos démons intérieurs et à pouvoir les vaincre.
Martres Tolosane, août 2016.
Lorsque je porte un regard sur ma vie sexuelle depuis trois ans, le bilan n’est guère reluisant.
L’application m’a pris pas mal de temps et d’énergie. Et, la plupart du temps, ne m’a rien apporté de plus que des plans sans lendemain.
Mais elle m’a aussi offert quelque surprise. Elle m’a grandement facilité la tâche pour des rencontres inattendues, comme avec Pierre, le jeune chauffagiste croisé dans un magasin de matériaux. Elle m’a offert une relation d’un an, une relation à la fois sensuelle et amicale, avec Martin, le bogoss volage.
Mais j’ai fini par me lasser de ce système de « consommation » des relations.
Lorsque j’ai banni l’application de mon téléphone, c’est la « chance » qui a pris le relais. D’abord, en mettant sur mon chemin cette bombasse de Justin, le p’tit con New-Yorkais croisé lors de mon déplacement pour aller assister au concert de Madonna au Madison. Et, tout dernièrement, la rencontre totalement improbable avec Kevin, le bel animal croisé derrière le comptoir d’un magasin d’électroménager.
Oui, j’ai eu des aventures, mais aucune relation digne de ce nom. Tous ces plans ont flatté mon corps, mais se sont avérés meurtriers pour l’esprit. Ils m’ont tous laissé un arrière-goût de plus en plus amer et persistant de solitude.
Oui, la solitude. Après ma séparation d’avec Jérém, je l’ai cherchée, car je ne me sentais pas prêt à commencer une nouvelle relation. J’avais peur de souffrir à nouveau, et j’avais surtout peur d’oublier Jérém. Je ne voulais pas l’oublier, et j’espérais toujours d’assister au miracle de son retour. Alors, j’ai fui les quelques gars qui semblaient chercher plus que du sexe.
Mais aujourd’hui, elle me pèse de plus en plus.
Melbourne, août 2016.
Tu le revois en train de te sucer, tu te souviens de la sensation de ses lèvres autour de ta queue, de sa langue s’affairant sur ton gland. Tu te souviens du plaisir qui monte, parfois doucement, parfois très vite. Tu te revois sur le point de perdre pied, puis en train de jouir dans sa bouche, tu le revois en train d’avaler avidement ton jus.
Tu te revois en train de le pilonner, tu te rappelles la sensation de ta queue qui glisse, qui va et qui vient dans son trou chaud, tu le revois en train de prendre son pied au rythme de tes coups de reins, bien soumis à ta virilité, tu repenses à la montée progressive de ton orgasme, et au plaisir inouï de lui gicler dans le cul.
Tu te souviens de l’odeur de sa peau, de cette bouche, de ce cul, qui étaient toujours prêts à accueillir ta queue et tes envies. Tu te rappelles son regard, son désir qui décuplait le tien, qui flattait ton égo, qui te rassurait, qui te donnait des ailes.
Tu te rappelles comment tu te sentais exulter, corps et esprit, grâce à lui.
Et dans ce lit inconfortable, tu jouis. Tu jouis entre les fesses d’un inconnu que tu as levé dans un lieu de drague, un inconnu dont tu n’as même pas retenu le prénom, et dont tu auras oublié le visage demain.
Et lorsque l’excitation retombe, sa présence t’est instantanément insupportable. Tu es soulagé de le voir se rhabiller et partir dans la foulée. Mais son départ rapide te laisse seul avec tes démons.
Seul dans ta chambre d’hôtel, la misère de ton présent réapparaît aussitôt. Et la nostalgie te happe. Tu te souviens de ses bras, de ses baisers, de ses mots, de ses regards doux qui étaient toujours là après ton orgasme pour accueillir tes angoisses, pour apaiser tes démons.
C’était bien, avec Nico, c’était le bon temps. Et tu te mets à rêvasser au bonheur du passé pour tenter d’oublier la misère du présent.
Tu repenses à ce jour où il t’avait proposé de réviser les maths pour le bac. Tu repenses à toute cette période, à ces baises dans ton premier appartement, à son attirance presque palpable pour toi, pour ton corps, ta gueule, ta queue, à son dévouement pour ton plaisir. Mais tu te souviens aussi de son besoin de tendresse que tu lui avais longtemps refusé, alors que tu en avais autant envie que lui. Tu te souviens de comment son regard t’avait aidé à accepter qui tu étais et à cesser d’en avoir honte.
Tu repenses souvent aussi à ce jour pluvieux, à cette attente sous la Halle de Campan, une attente qui t’avait parue interminable. Et puis tu te repasses en boucle l’instant où tu l’avais entendu approcher, où tu t’étais retourné et que tu l’avais vu, l’instant où vous vous étiez serrés dans les bras l’un de l’autre, où vous vous étiez embrassés, avec le même désir, la même fougue, le même amour.
Tu repenses aussi à cet autre souvenir, sur la butte devant la cascade de Gavarnie, tu le tenais dans tes bras, sa nuque attirait tes baisers et une infinie tendresse. Tu avais une nouvelle à lui annoncer, celle de ton départ à Paris, et ça ne sortait pas. Car tu ne voulais pas lui faire de la peine, tu ne voulais pas gâcher cet instant de bonheur parfait.
Tu repenses à ce voyage Italie, à votre complicité, à la douceur de ses baisers, de ses caresses, de sa présence.
Nico a toujours été là quand tu as eu besoin de lui.
Tu repenses à l’accident de voiture à Paris, lorsqu’il n’avait pas hésité à raconter à la Police qu’il était au volant, alors que c’était toi. Il l’avait fait pour te sauver le cul, parce que tu avais bu et que tu n’aurais pas dû prendre le volant.
Ou à cette longue période de rééducation après ton accident de rugby, à sa présence sans faille, à Paris, à Capbreton, sans hésiter un seul instant à mettre ses études entre parenthèses pour être à tes côtés et supporter tes sauts d’humeur et ton ingratitude.
Nico t’a même offert l’occasion de renouer avec ta mère avec qui tu étais fâché depuis ton adolescence, depuis qu’elle avait refait sa vie.
Et tu repenses au soir de tes 25 ans, quand tu lui as fait l’amour dans le sous-sol de l’immeuble où habitait Ulysse. C’était votre dernier moment heureux.
Au fond de toi, tu sais que tu ne seras plus jamais aussi heureux que pendant ces quelques années que tu as partagées avec lui.
Dans un train, début septembre 2016.
Dans un train que j’ai emprunté pour un déplacement professionnel, j’ai croisé deux petits mecs qui m’ont beaucoup ému. Deux choupinous tout juste majeurs, ou peut-être même pas majeurs, débordant de jeunesse et de beauté. Et rayonnants de tendresse mutuelle. Ils se tenaient dans l’espace entre deux wagons, appuyés à une barre verticale. J’ai remarqué les doigts qui se frôlaient et qui semblaient faire des étincelles dans le contact réciproque. J’ai remarqué les regards qui se cherchaient, se caressaient, les petits sourires timides et un peu gênés qui s’entrechoquaient. J’ai remarqué l’alchimie des corps qui s’attirent, des esprits qui s’aimantent.
J’ai ressenti d’infinis frissons en regardant ces deux garçons. Je me suis demandé qui ils étaient, comment ils s’étaient connus, quand ils s’étaient aperçus qu'ils se plaisaient, ce qu’ils ressentaient exactement l’un pour l’autre. J’aurais voulu connaître le bonheur qu'ils ont éprouvé la première fois que leurs désirs se sont croisés, rencontrés, reconnus.
Je me suis demandé à quel point ils devaient bien, tous les deux, enfermés dans leur bulle, seuls au monde, isolés de toute la laideur de l’existence.
Et je me suis dit que j’aimerais tellement retrouver un amour si intense et si passionné que le leur. L’amour le plus beau, le plus fou, le plus insouciant, celui qui déplace des montagnes. Le premier amour.
Si seulement je savais chercher aujourd’hui un garçon qui ait envie de faire un petit bout de chemin avec moi !
Mes amis, Thibault et Stéphane ont eu de la chance, et je suis heureux pour eux. Alors, pourquoi pas moi ? Peut-être que ma chance viendra un jour où je ne l’attendrai plus.
Adélaïde, 15 septembre 2016.
Aujourd’hui, Nico a 34 ans. Tu te demandes ce qu’il fait, avec qui il est, ce qu’il devient.
Ça fait un moment que tu n’as pas eu de ses nouvelles. Tu en as pris, pendant longtemps, auprès de vos amis communs. Et tous les récits te parlaient d’un Nico toujours seul, qui ne t’avait donc pas « remplacé » après votre séparation. Dans un premier temps, cela avait en quelque sorte flatté ton ego.
Mais très vite, cet état de choses t’avait profondément attristé.
Car tu avais appris également que Nico se posait tout un tas de questions sur ce qui t’avait conduit à partir jouer en Angleterre à la rentrée 2007, alors que quelques jours plus tôt tu lui avais assuré vouloir renoncer au rugby et rester en France, parce que tu voulais donner une chance à « Ourson et P’tit Loup ».
Là encore, son dévouement avait été au rendez-vous. Il avait su de suite que cette décision te rendrait malheureux. Alors, il avait ouvert la porte et il t’avait laissé libre de prendre ton envol vers le ciel d’Angleterre, un ciel que tu imaginais plus dégagé pour ton avenir sportif que celui de France. C’était une preuve d’amour, une ultime preuve d’amour, dont tout le monde n’aurait pas été capable.
Et comment l’avais-tu remercié pour cette abnégation, pour avoir fait passer ton bonheur avant le sien ?
Tu avais fait le choix de partir sans même le lui annoncer, en estimant qu’il valait mieux le silence que des explications difficiles et douloureuses. C’était la voie de la facilité, car tu n’as jamais été doué pour gérer la souffrance des autres, notamment lorsque tu en étais la cause.
Alors, tu es parti comme un voleur, l’obligeant à monter à Londres pour découvrir que tu étais avec un autre. Tu sais que tu as été lâche. Il ne méritait pas ça, lui qui a toujours été là pour toi, quitte à prendre des risques, à se mettre en danger, à mettre sa vie au second plan. Et à se rendre malheureux pour que tu puisses être heureux.
Tu t’en veux de lui avoir imposé ça, tu t’en veux chaque jour. Tu sais que pour aller de l’avant, Nico aurait besoin de réponses à ses questions, et que le seul à pouvoir lui apporter tout cela, le seul à pouvoir lui apporter les explications capables de le libérer du poids du passé l’empêchant de marcher vers l’avenir c’est toi, Jérémie.
Après toutes ces années, tu n’es plus du tout sûr d’avoir fait le bon choix à l’époque. Mais à présent, tu te dis qu’il est trop tard pour revenir en arrière. Tu n’oseras plus jamais revenir en arrière. Tu lui as fait bien trop souvent le coup de disparaître et de revenir. Tu te dis que tu as perdu toute crédibilité, toute confiance. Il doit t’en vouloir, et à juste titre.
En fait, tu n’en sais rien. C’est depuis ton voyage en France en 2013 que tu n’as plus cherché à avoir de ses nouvelles. Tu as essayé de l’oublier, tu as essayé d’oublier tes regrets et tes remords.
Peut-être que Nico a réussi, lui, à t’oublier.
De toute façon, tu n’as même plus les moyens d’aller le retrouver, même si tu trouvais le courage d’affronter son regard et ta culpabilité. Tu es bloqué sur ce continent à l’autre bout de la Planète.
Alors, Nico est désormais, et il le restera pour toujours, le plus grand regret de ta vie. Tu sais que tu l’as rendu malheureux, et qu’en le rendant malheureux, tu t’es rendu toi-même malheureux.
Car, au fond de toi, tu le sais. Le jour où tu as choisi le rugby plutôt que son amour, tu as fait la plus grosse erreur de ta vie.
Tu te demandes s’il pourra te pardonner un jour d’avoir été si injuste, si ingrat, si lâche avec lui.
Et tu espères seulement qu’il a trouvé le chemin pour être à nouveau heureux.
Martres Tolosane, 16 octobre 2016.
Galaak sait toujours quand je suis triste et nostalgique. Il le ressent dans son grand cœur de Labrador. Et avec son fabuleux instinct de Labrador, il a toujours la recette pour me faire aller mieux.
Ce soir, alors qu’une fois de plus la tristesse me happe brutalement, il se saisit de son ballon et me l’apporte pour une séance de jeu. J’accepte son invitation, je l’attrape, je le lance, il part le récupérer en bondissant. Lorsqu’il le saisit entre ses crocs, la modulation de pression de sa mâchoire a pour effet de produire un son qui change en permanence d’intensité et de hauteur. Un son qui semblerait presque exprimer des émotions, son impatience, son excitation, son plaisir de jouer et de partager ce moment avec moi, et de me voir sourire et aller mieux par la même occasion. Ces couinements répétés et d’intensité changeante ce sont en quelque sorte « la voix de Galaak ».
Aujourd’hui, Jérém a 35 ans. Je n’ai jamais oublié l’un de ses anniversaires. Car je n’ai jamais cessé de penser à ce garçon dont le visage est le visage de la période la plus heureuse de ma vie.
Où es-tu mon Jérém ? Que fais-tu ? Es-tu heureux ? Penses-tu, parfois, à moi ?
Washington, novembre 2016.
Après deux mandats de présidence assurée par un homme d’origine afro-américaine, une première et un exploit dans un pays où la ségrégation n’a été abolie que 50 ans plus tôt, le vent politique tourne du tout au tout aux Etats-Unis. Cette année, où un homme à la chevelure couleur de la paille est élu à la Maison Blanche.
La désillusion et l’inquiétude dans une grande partie du pays et du monde entier sont palpables.
L’histoire est un éternellement recommencement. La marche du monde ressemble parfois à un pas de crabe. Un pas en avant, et deux en arrière.
Toulouse, jour de Noël 2016.
Comme chaque année, je fête le réveillon de Noël avec mes parents. Je passe un bon moment. Tout en me remémorant le réveillon d’il y a quelques années, lorsque Jérém était venu me chercher après une période d’éloignement, et nous offrir un nouveau chapitre à notre histoire.
Le lendemain, le jour de Noël, une triste nouvelle paraît dans la presse. George Michael est retrouvé sans vie dans sa voiture garée dans une rue à proximité de sa demeure.
L’un des fantasmes sexuels majeurs de mon adolescence n’est plus. Et bien que les coups durs de la vie l’aient précipité depuis pas mal de temps déjà dans toute sorte d’excès, et que ces excès aient eu prématurément raison de sa beauté et de sa jeunesse, il restera à tout jamais à mes yeux le bogoss de « Faith » et de « Kissing a fool ».
Un immense musicien, un auteur sublime, un interprète superbe.
Mais aussi le sublime petit con de « Wham ! », exhibant sa jeunesse et sa demi-nudité avec une insolence frôlant le chef d’œuvre absolu. En fait, c’est surtout sa joie de vivre que le temps lui a ôté prématurément.
Adieu, George. Et que tes retrouvailles là-haut avec ton Anselmo soient belles, et chaudes. Et qu’il te reprenne à nouveau par la main comme il t’a pris ce jour où il a foudroyé ton cœur en assistant à l’un de tes concerts. Qu’il te prenne par la main comme on aurait tous besoin de l’être pris un jour, comme « Jésus avec un enfant ».
Cette année a été une bien triste année pour les stars de mon adolescence.
Prince a lui aussi tiré sa révérence en avril, lui aussi emporté par le fléau de la crise des opioïdes qui a avait déjà emporté Michael Jackson sept ans plus tôt. Un scandale sanitaire dont les Etats-Unis commencent tout juste à saisir l’ampleur, après des années d’un laisser faire criminel des autorités au profit d’intérêts privés sans scrupules.
Whitney Houston étant elle aussi disparue il y a quatre ans – quelle voix, quel immense gâchis ! –
De mes repères musicaux des années ’80, il ne reste plus que Madonna.
Longue vie à elle, mon principal et dernier repère !
A propos de Madonna, en cette maudite année 2016, on a également déploré la disparition de celui qui l’a tant inspirée au début de sa carrière. En janvier, David Bowie est parti rejoindre ces étoiles dans cet Espace qu’il a si souvent évoqué dans ses chansons.
Dans une ferme en Nouvelle Galles du Sud, décembre 2016.
Depuis un mois, tu as atterri dans cette grande ferme avec la bagatelle de 10.000 brebis à tondre. La tâche était immense et vous étiez nombreux à vous y atteler. Tu as commencé comme attrapeur, puis tu es passé tondeur. Pendant des semaines, ce travail fortement physique t’a épuisé, t’a empêché de trop réfléchir et broyer du noir.
Tu as aussi fait de belles rencontres, avec des gens un brin « hippies post-modernes », des gens gravitant autour d’une philosophie de vie basée sur le lâcher prise et le détachement des biens matériels. Une mentalité qui t’a beaucoup touché. Et pour la première fois depuis ton arrivée en catastrophe en Australie, tu as eu l’impression d’aller mieux. De te sentir utile, valorisé, intégré dans un « monde ».
Dans cette ferme du bout du monde, tu as l’impression d’avoir trouvé des potes, presque une nouvelle famille. Après les longues journées de tonte, le soir, autour du feu, on parlait, on s’écoutait. A tour de rôle, tes collègues racontaient leurs vies, leurs déboires, leurs regrets et leurs remords. Tu as senti une ambiance écoute et d’empathie, sans jugement aucun. Il faut dire que le joint aide bien à délier les langues et à suspendre les jugements.
Et tu as fini par te sentir à l’aise pour parler des bêtises que tu as faites depuis quelques années, de tes errances. Tu as trouvé de l’écoute, tu t’es senti compris et épaulé. Et ça t’a fait un bien fou de vider ton sac. Tu n’as pas pu arriver à la fin de ton récit sans que les larmes viennent brouiller un peu plus ton accent déjà rude à entendre.
Oui, tu as pleuré. Et tu t’es senti soulagé. Pour la première fois depuis des années, tu as senti ton cœur se délester d’un poids. Pour la première fois depuis des années, tu te dis que, malgré tout ce que tu as perdu et que tu ne retrouveras pas, l’avenir peut t’offrir des jours meilleurs.
Toulouse, 31 décembre 2016, 23h59.
Dans une minute à peine, une nouvelle année s’achève et une nouvelle commence.
Tout le monde semble s’agiter autour de cette échéance, comme si elle allait marquer une véritable démarcation entre un « avant » et un « après ». En réalité, même si dans une minute on aura changé d’année, demain ce sera juste la suite d’aujourd’hui. Demain, rien n’aura changé. Ma solitude demeurera intacte, tout comme la nostalgie des années que j’ai passées avec Jérém.
Et pendant que le compte à rebours retentit, mes pensées s’envolent à l’autre bout de la Planète.
Dans une ferme en Nouvelle Galles du Sud, 31 décembre 2016, 23h59.
Ton réveillon de la nouvelle année, tu le fêtes avec eux, autour d’un grand feu. Ça boit, ça rigole, ça fume de joints, ça chante. Tu es entouré, et tu passes une bonne soirée. Mais ta solitude, tu la portes toujours dans ton cœur. Tout comme la nostalgie des années que tu as passées avec Nico.
Et pendant que le compte à rebours retentit, tes pensées s’envolent à l’autre bout de la Planète.
 4 commentaires
4 commentaires
-
Mercredi 16 septembre 2015.
En ce milieu du mois de septembre 2015, pour fêter mes 33 ans, j’ai cassé ma tirelire et je me suis offert une petite folie. Un rendez-vous au Madison Square Garden à New York avec Madonna et 20.000 autres Rebel Hearts.
— Tu chanteras et tu danseras pour deux, mon Nico, m'a lancé Elodie, ma cousine adorée, qui n’a pas pu m’accompagner, préférant rester avec sa petite famille.
— Tu lui passeras le bonjour de ma part, m’a glissé Stéphane, mon pote adoré, qui n’a pas pu m’accompagner, préférant rester auprès de son chéri.
Pour mon séjour en solo aux USA, l'idée de loger chez l'habitant me paraît d’emblée agréable. Sur Internet, je survole les annonces et je finis par tomber sur une offre qui retient mon attention. Situé entre Lower Manhattan et East Village, un loft bordé par une immense baie vitrée avec vue imprenable sur le skyline de la Grande Pomme.
Je clique sur l'annonce. Entre la photo principale, avec vue sur le séjour, et la description du logement, un petit rond avec un selfie des proprios. On y trouve une petite brune, Betty. Mais, surtout, surtout, surtout, un très charmant Justin. Un p’tit con à casquette avec des airs de p’tit branleur sexy en diable.
Je clique sur la photo, ça l’agrandit un peu. Le mec a vraiment l'air grave bandant dans son t-shirt blanc avec une échancrure plutôt affolante.
Ce n'est pas le logement le plus abordable. Mais, entre la vue imprenable sur New York et la bonne petite gueule de Justin, mon choix est vite fait. J’ai envie de le voir de près, ce p’tit branleur.
Après un voyage d’une quinzaine d’heures, Blagnac et Paris me semblent très loin derrière moi, appartenant presque à un autre monde, à une autre vie. Un autre monde et une autre vie qui s’effacent complètement de ma mémoire lorsque le profil vertical et minéral de New York se dessine au-delà de l'immensité d'eau et de ciel, première vision de terre et de civilisation depuis de longues heures. La première fois qu'on arrive à New York par les airs, avec un beau soleil, c’est le genre de spectacle qui marque l’esprit.
Les gratte-ciels semblent m’ouvrir les bras, comité d'accueil silencieux et majestueux devant lequel je me sens tout petit. Car cette ville dégage une impression de grandeur, de toute puissance. A vrai dire, c’est plutôt une illusion, qui frappe le regard mais qui ne trompe plus l’esprit. Car l’illusion s’est évaporée un matin d’il y a 14 ans, jour pour jour, lorsque deux avions, en modifiant leurs trajectoires sous la contrainte terroriste, ont modifié à tout jamais celle de cette ville et du monde entier.
Je me souviens du regard sonné de Charlène lorsqu’elle nous avait annoncé ce qui était en train de se passer, alors que Jérém et moi étions venus lui annoncer qu’il partait jouer à Paris. Je me souviens de notre excursion à Gavarnie juste avant, des longues minutes passées dans ses bras sur la butte devant la grande cascade. Je me souviens de ces jours où j’avais été fabuleusement heureux, alors que le monde était en train de basculer.
L’aéroport JFK se profile à l'horizon, matérialisé par des centaines d'avions garés en grappes autour des nombreux terminaux.
A New York, comme à Toulouse et à Paris, il fait encore chaud en ce mois de septembre. Alors, Blagnac, Orly, Charles de Gaulle ou JFK, c’est le même combat. Les halls d’aéroport sont des concentrés massifs de mâles. Des bruns, des blonds, des châtains, des poilus, des imberbes, de toutes les races, de tous les âges, de toutes les provenances, de toutes les catégories – les petits cons insolents, les mâles affirmés et virils, les jeunes papas sexy, les baroudeurs, les métrosexuels, les « plutôt nature ». Des mecs beaux, sexy, impertinents, ou simplement touchants, attirant tour à tour mon attention au travers de quelques éléments visuels – une belle petite gueule, un corps bien bâti, ou bien un physique plus ordinaire mais à l’intense sensualité, un brushing insolent, un t-shirt bien porté, un débardeur aux bretelles divinement tendues sur des épaules dénudées – ou d’éléments olfactif – une note de parfum qui traîne sur le passage d’un beau garçon et qui vrille instantanément mes neurones. Des mecs dont les attitudes masculines – une façon de se tenir, de marcher, de mâcher un chewing-gum, un regard charmeur, un autre viril – sont souvent inconscientes. Et justement pour cela, terriblement émoustillantes. Un nombre incalculable de beaux mecs défile sous mon regard émerveillé, et très vite saturé. Au bout de quelques secondes, je ne sais plus où donner du regard, et du désir.
Tous ces mecs sont autant de coups de poing reçus dans mon ventre, autant de frustrations à digérer. Car tous ces destins de bogoss me sont inaccessibles. Leurs vies resteront à jamais mystérieuses et secrètes, et les dizaines de questions qui assaillent mon esprit à leur sujet resteront sans réponse. C’est cette frustration, aussi douloureuse soit-elle, qui rend justement ces petits instants si furieusement magiques.
Un ami m’a dit un jour que New York s’apprivoise en émergeant du métro. En provenance de JFK, je suis son conseil avisé. Je sors du « subway avec la chanson « Ray of light à fond dans mes écouteurs.
Et comme dans le clip de la chanson, une multitude de New-Yorkais semble défiler autour de moi et s’agiter dans un flux ininterrompu et frénétique qui me donne le vertige. Les gens, comme le liquide vital circulant dans les veines souterraines d’une ville monstre. C’est la vie à 1000 à l'heure, celle qu’on s’imagine régner dans cette ville qui ne dort jamais.
Je reste immobile à côté de la sortie de métro pendant un petit moment, comme pour m’imprégner de cette folle dynamique, ou plutôt pour m’y habituer, pour redescendre du choc provoqué par toute cette énergie, cette animation, cette hétérogénéité raciale et culturelle, cette diversité par rapport à la France. Un garçon passe, et un autre, et un autre encore, tous plus beaux et sexy les uns que les autres. Mon cerveau est assailli par une telle quantité de stimuli qu’il n’a presque plus de ressources pour détecter et apprécier le Masculin, pourtant son intérêt majeur.
Les chansons de l’album « Confessions on a dancefloor s’enchaînent dans mes écouteurs pendant que je me promène dans la ville.
A Central Park, je marche en cadence sur le rythme entrainant de « Hung Up ».
A Times Square, j’enchaîne avec « Sorry ».
Au Madison Square Garden, je me laisse emporter par « Let It Will Be ».
A l’Empire State Building, « Forbidden Love » enchante mes pas.
L’énergie de New York est comme une ivresse qui me cueille dès le premier verre, ça monte à la tête très vite. Plus je la découvre, plus j’ai envie de m'imprégner de cette ville, de sa modernité, de son hétérogénéité, de ses contradictions.
Mais pour l’heure, le décalage horaire ne me rate pas. En milieu d’après-midi, qui serait déjà très tard le soir en France , je ressens un énorme coup de fatigue. J’ai besoin de manger un bout et de me poser. Le rendez-vous au Madison approche, j’ai besoin d’être en forme.
Je cherche l’immeuble, l’étage, l’appart. Je sonne, la porte s’ouvre sur un magnifique espace de vie empli de lumière. L’endroit est exactement comme sur la photo, le séjour longé par une immense baie vitrée ouverte sur les gratte-ciels.
Oui, la porte s’ouvre, et je suis reçu par toi, P’tit con. Toi aussi, tu es presque comme sur la photo… mais en dix fois mieux ! Je t'avais trouvé mignon sur l’annonce. Mais là, en vrai, tu es carrément canon !
En sortant de l’ascenseur, juste avant de sonner à ta porte, j’écoutais « Beautiful Stranger » une chanson qui dit :
Haven't we met/Ne s'est-on pas déjà rencontrés
You're some kind of beautiful stranger/Tu es une sorte de bel inconnu
You could be good for me/Tu peux être bon pour moi
I have the taste for danger/J'ai le goût du danger
Et je trouve que cette chanson te sied à merveille. Tu as 22, 23 ans max. Et tu es sexy, terriblement, dangereusement sexy.
En cette belle et chaude journée, tu te balades torse nu dans l’appart, et tu es assez à l’aise avec ta demi-nudité pour aller ouvrir la porte à un inconnu dans cette tenue, pour lui laisser découvrir et apprécier un parfait exemple de physique de p’tit con. Un torse élancé mais tout en muscles, des épaules joliment bâties, des pectoraux sculptés et imberbes entre lesquels se balade une longue chaînette de mec, des abdos délicieusement saillants d’où prend naissance une fine ligne de poils bruns qui disparaît dans un short gris style molletonné. Ce dernier laissant non seulement dépasser l’élastique d’un boxer blanc de marque, non seulement apprécier la naissance d’un pli de l'aine saillant, mais également deviner une belle bosse sur le devant. Ta peau a l’air fabuleusement douce.
Et pour couronner le tout, tu as une jolie petite gueule d’ange sexy en diable, un visage aux traits parfaits sublimés par cette touche de perfection, une petite barbe d'une semaine taillée avec soin.
Tu es beau par nature et insolemment sexy par choix délibéré. Ça n’expliquerait pas autrement ce look « torse nu totalement décomplexé », ou cette putain de casquette vissée à l'envers et très haut sur la tête, couvrant juste le sommet de ton crâne et dégageant en grande partie tes cheveux châtain clair coupés presque à blanc. Ou encore, ce parfum de mec à l’essence poivrée, entêtante, qui se dégage de toi. Ou encore, détail qui finit de m’assommer, cette insolence, cette canaillerie permanentes dans ton regard.
Petit mec, tu pues le sexe à 100 mètres à la ronde. Ton regard pénétrant, ton physique insolent, ton attitude de bogoss branleur sont une pure provocation, une tentation cruelle pour ceux qui aiment les beaux garçons. Ça prend aux tripes. Le désir que tu inspires est violent, brutal, brûlant, déchirant.
Face à ton attitude de p’tit branleur effrontément sexy, un peu trop sûr de toi, de ton physique, de ton charme et, certainement, de ta queue aussi, face à cette belle insolence, cette effronterie, cette insouciance, cette inconscience, cette assurance qui est l’apanage de celui à qui la vie n’a pas encore eu l’occasion d’apprendre l’humilité, je ressens en même temps l’envie de te gifler pour tenter de calmer ton arrogance et l’envie encore plus brûlante, encore plus violente, encore plus irrépressible, de te calmer par le plaisir, de te faire jouir jusqu’à ce que tu demandes grâce.
Te faire jouir, c’est juste une nécessité impérieuse.
Oui, le « p’tit con », en tant que catégorie « Mâle junior » est capable de nous mettre devant bien de contradictions.
— Hi ! je te salue, beau New-Yorkais.
— Hi ! tu me réponds, tout en m'offrant une bonne poignée de mec et un sourire des plus canaille.
Ça ne fait qu’une poignée de secondes que je suis devant toi, et ça y est, je viens de perdre tous mes moyens. Car tu me rends dingue !
Tu me fais la visite de l'appart, tu me conduis jusqu'à ma chambre, tout en me donnant quelques consignes en anglais que je tente de capter tant bien que mal.
Ta copine n’a pas l’air d’être là, et je n’ai même pas envie de te demander où elle est, si elle va revenir bientôt. Je suis tellement bien ici, seul avec toi.
Puis, tu t’éclipses. Tu viens de disparaître de ma vue et déjà tu manques à ma vue. Envie furieuse de toi, Justin, envie de savoir comment t’es monté, mais surtout envie violente de te donner du plaisir.
Je me demande ce que ça doit faire de s’occuper d’un mec comme toi, de te donner tout ce que tu demanderais, réclamerais, exigerais, de te sentir prendre ton pied. Je me demande comment un parfait p’tit con comme toi se comporte au lit.
Un quart d’heure plus tard, je m'installe dans un fauteuil du séjour. J’ai envie de profiter du soleil qui filtre au travers des baies vitrées et qui chauffe ma peau, ainsi que de la vue sur la puissance verticale de la ville.
Mais comment me détendre, comment me vider l’esprit en profitant de la vue, alors que toi, p’tit con, tu reviens dans le séjour et promènes ton insolente jeunesse devant moi, toujours torse nu, toujours avec cette sempiternelle casquette qui te donne une allure de figurine Playmobil en version méga sexy.
Alors, comment me contenter de mater un paysage de béton et de verre alors qu’un magnifique paysage d’abdos et de pecs happe mon regard et hante mon esprit ?
Ta présence me trouble. Et pourtant, lorsque tu disparais à nouveau dans le couloir, je n’arrive pas davantage à profiter du paysage. Car la vue perd bien de son charme sans ta présence dans mon horizon.
Je me dirige vers ma chambre. En fait, je te piste. La porte de la tienne est entrouverte. Et toi, p’tit con, tu es en train de faire des pompes à côté du lit.
Je me fige à te regarder, happé par la vision de tes muscles en tension, sous l’effet du travail et de l’effort. Tu tournes la tête, nos regards se croisent. Soudain, je suis mal à l’aise, je voudrais trouver la bonne réplique pour justifier mon regard, ma présence, pour te féliciter pour ta plastique de fou sans trahir mon désir brûlant. Bien évidemment, les mots me font défaut. Pourtant, dans ma tête, c’est la fête. Alors, je me contente de te sourire, avant de me réfugier dans ma chambre.
Allongé sur le lit, dans la pénombre, ton image n’a de cesse de me hanter. Tu as l’air d’un petit mec du genre plutôt glandeur, qui se laisse vivre, qui sait profiter, dans tous les sens du mot, un mec qui ne fait pas grand-chose de sa vie. Je ne sais pas quelle définition te correspond le mieux, je crois que « p’tit branleur sexy » te va comme un gant. Et cette idée m’excite grave…
Grâce à toi, Justin, cet après-midi j'ai eu droit à quelques moments de bonheur. L’irrésistible fraîcheur de ta p’tit contitude provoque en moi un désir viscéral, déraisonnable, irrépressible. Ton physique de p’tit con, ta belle petite gueule, ton regard, ton sourire, ta simple présence, tout chez toi pétille d’une jeunesse ravageuse. Quand on te regarde, on se dit que ta jeune virilité ne doit avoir ni plus ni moins que le goût du bonheur.
Et de surcroît, un p’tit con comme toi n’est jamais à court de surprises. La première m’attend lorsque je me rends aux toilettes. Lorsque je pose la main sur la poignée de la porte, celle-ci s’ouvre toute seule, et je me retrouve face à toi. Pendant une fraction de seconde, je croise ton regard, ce regard jamais dépourvu d’une petite étincelle canaille. Tu es un sacré charmeur, petit Justin !
Je suis à moins d’un mètre de ton torse et ton parfum remonte par mes narines et met direct mes neurones en PLS.
Tu avances, tu passes devant moi tout en te tripotant je ne sais quel élément de ton service trois pièces au travers du tissu molletonné. C’est toujours fascinant de réaliser à quel point certains mecs ne semblent pas se rendre compte à quel point le fait de se tripoter le paquet de la sorte peut donner des sueurs autour d’eux.
Mais côté « surprises », le meilleur reste à venir. Ça se passe en fin d’après-midi, lorsque je me dirige à nouveau vers ma chambre. Je pose la main sur la poignée, et voilà que la porte s’ouvre toute seule. Pas celle de ma chambre, mais celle juste à côté, celle de la salle de bain.
Toi, bel étalon, tu apparais dans un nuage de vapeur sentant le gel douche et le deo de bogoss. Tu apparais évidemment torse nu, la peau et les cheveux encore humides, juste couvert d’une serviette nouée autour de la taille. Lorsque tu captes mon regard sur toi, tu me lances un petit sourire plein de malice qui ferait fondre un glacier. J’ai l’impression que tu as compris que je te kiffe un max et que tu me nargues, que tu me provoques, que tu t’amuses avec moi. Tu veux ma peau ! Je sens que ma santé mentale vacille.
Tu continues ton chemin, je te regarde traverser le couloir et disparaître dans ta chambre. Mon cœur alterne emballements à répétition et ratés soudains.
Avant de me rendre dans ma chambre, je ne peux résister à la tentation d’un détour par cette salle de bain que je soupçonne de receler un univers de bonheur absolu après qu’un p’tit con comme toi ait pris sa douche.
La pièce est en effet saturée de vapeurs et d'un intense parfum de propre et de mec sexy. Ici, tout me parle de toi, qui étais à poil, juste là, un instant plus tôt.
Je me prends à imaginer tes gestes quotidiens et intimes dans sa salle de bain. Tu te dessapes, tu poses ton boxer et ton t-shirt recelant ses bonnes petites odeurs de la journée. Tu passes sous l’eau, te savonne, l'odeur du gel douche imprègne ta peau. L’eau coule entre tes pecs, glisse sur tes abdos, sur ton sexe. Tu te caresses peut-être sous l’eau, tu te fais peut-être même plaisir jusqu’au bout.
Tu sors de ta douche tout propre, tout frais, auréolé de ta sexytude aveuglante. Tu te sèches. Tu te postes devant ton miroir, tu vaporises copieusement ta peau avec ton déo. Sous les aisselles, sur le torse, laissant autour de toi une fraîcheur entêtante qui envahit la pièce et flotte longtemps dans l’air après ton passage. Tu te coiffes, tu t’habilles. Tant d'images, de scénarii mille fois joués dans ma tête, mettant en scène nombre de ces p’tits cons à hurler qui, comme toi, me rendent dingue.
Lorsque je reviens dans le séjour, tu es installé sur le canapé, devant la télé, toujours torse nu, mais tu portes un nouveau short molletonné. Tenue réglementaire de bogoss, quoi.
Je m’installe sur « mon fauteuil » et, pendant que tu zappes entre mille chaînes, je suis hypnotisé par ta présence. Tes vingt ans m'éblouissent, tes oreilles fines me donnent une furieuse envie de les lécher, de les mordiller.
Je voudrais te parler, mais de quoi ? Mon anglais n’est pas assez bon pour tenir une conversation, et je suis sûr que même si c’était le cas, tu ne serais pas intéressé par ce que j’aurais à te raconter. Même mes questions te sembleraient nazes.
Finalement, contre toute attente, c’est toi qui te charges de rompre la glace.
Tu me demandes d’où je suis en France, et ce que je viens faire à New York. Je suis heureux que la conversation soit engagée. Je te parle de Toulouse, tu me dis « You came from Toulouse, so are you a looser ? ». Je t’explique que je viens pour le concert de Madonna. « Old singer », tu commentes, tout en entonnant quelques mesures de son dernier grand éclat en date auprès du grand public, datant d’il y a dix ans déjà, « Hung Up ».
Je t’en foutrai des Old Singer, saleté de p’tit con !
La conversation se poursuit autour des sites incontournables de la ville. Tu me parles, je ne comprends pas tout, je t’écoute, je te mate, je bous de l’intérieur. Plus je t’écoute, plus je trouve qu’au-delà de ta sexytude bouillante, tu es touchant. Ton débit de parole est lent, ton timbre, assez doux. Malgré la barrière d’un anglais que je suis loin de maîtriser correctement, je ressens dans ta voix un délicieux mélange des vibrations viriles et d’intonations transpirant un je-ne-sais-quoi d'enfantin.
Par moments, tes mots semblent même laisser transparaître une certaine naïveté, ou candeur, tes attitudes, une forme de timidité et de fragilité. Comme si tu n’étais pas aussi sûr de toi que tu le prétends en exhibant sans réticences ton corps de fou.
Ton zapping prend fin et notre conversation aussi. Tu mates une émission sans intérêt.
Quand je te regarde, affalé contre le dossier du canapé, les cuisses un tantinet écartées, le bassin bien vers l’avant, l’élastique du boxer qui dépasse outrageusement du short, le bras levé, le coude plié, la main entre la tête et le dossier du canapé – m'offrant ainsi une vue magnifique sur ton aisselle légèrement poilue, sur tes tétons saillants, sur ta peau lisse, musclée, parfumée – ton entrejambe pratiquement offert, la bosse qui se dessine de façon insolente, qu’est-ce que je donnerais pour te sucer, là, tout de suite, sur le canapé !
Tu fixes l’écran de la télé avec un regard intense, concentré, tu es sexy à tomber. J’ai envie de promener ma langue sur chaque centimètre carré de ta peau.
Je ne peux pas renoncer à immortaliser une telle splendeur mâle. Je ne t’aurai pas, beau Justin, je ne te ferai pas jouir comme tu le mérites, mais je t’amènerai « dans mes bagages », et je t’inviterai dans mes branlettes.
J’étudie donc la stratégie pour capter l’instant d’éternité. Le reportage photo « Tranche-de-vie-de-bogoss » est une opération risquée mais très stimulante. Une action délicate, nécessitant une bonne dose de patience et de discrétion. Il faut capturer l’animal à son insu, pour que le naturel, composante majeure de son charme, soit préservé. Il faut à tout prix éviter d’attirer l’attention du spécimen si on veut mener le hold up photographique à bon port. Et, accessoirement, si on veut éviter de prendre sa main dans la gueule.
Hélas, j'ai beau y mettre toute ma discrétion. Tu tournes la tête pile au moment où je prends le plus de risque pour obtenir un bon cliché.
Ton regard fixe et interrogatif, noir et hostile, se fige alors dans l'écran du téléphone. Et mon sang se fige lorsque je t’entends me lancer, sur un ton plutôt « mec des cités à la sauce new-yorkaise » :
— What the fuck are you doing ?
Euh… qu’est-ce que je suis en train de faire ???
— No… nothing… je bégaie.
— T’étais en train de me prendre en photo ? tu aboies dans ton anglais américain bien serré, le ton entre interrogateur et accusateur.
Dans ma tête, c’est le tsunami. Je panique. Comment me sortir de ce pétrin ? Impossible de nier l'évidence, je me suis fait gauler. Alors, autant jouer cartes sur table. Tu ne vas quand même pas me péter la gueule. Je sais que j’ai pour moi l’arme ultime de la dissuasion des années Internet, le commentaire client. En moins de 100 caractères, je peux pulvériser ta réputation.
— Si, je te prenais en photo ! j’admets calmement.
— Why ? Pourquoi tu me prenais en photo ? tu me questionnes, ta voix passant rapidement d’un ton accusateur à un ton plutôt agressif.
Et toujours cette chanson qui trotte dans la tête…
If I'm smart then I'll run away/Si j'étais futé je m'enfuirai
But I'm not so I guess I'll stay/Mais je ne le suis pas donc je pense que je vais rester
Heaven forbid/Surtout pas
I'll take my chance on a beautiful stranger/Je vais tenter ma chance avec un bel inconnu
— Parce que tu es vraiment sexy, je me sens à l’aise pour te répondre.
— Espèce de pédé !
Voilà ton commentaire de p’tit con.
— Oui, je suis pédé. Et les mecs comme toi, ça me fait craquer, j’enfonce le clou. J’ai l’impression de ne plus avoir de limites.
— Rien à foutre, moi je n'aime que les nanas !
Voilà ta conclusion sans appel.
— Ça, j'en suis sûr, c'est bien pour ça que tu me plais autant, je te cherche.
Pas de réaction de ta part. Ton regard est toujours rivé sur l’écran télé. Au point où j'en suis, je décide d'y aller cash, en espérant employer les bons mots dans une langue qui n’est pas la mienne.
— Et je pense que je saurais te faire des choses que les nanas ne t’ont jamais fait…
— Sans façon, tu me lances, toujours sans quitter l’écran télé des yeux.
— T'as jamais eu envie de coucher avec un mec ? je te provoque.
— Tu me prends pour qui ? tu réponds sur un ton agacé, en posant à nouveau ton beau regard noir sur moi, fulminant comme un ciel d’été avant l’orage.
— Tu as tort… tu pourrais kiffer ce que je pourrais te faire ! je trouve le cran de te renvoyer.
— Je ne crois pas, non, tu assènes sèchement, en zappant mécaniquement sur la télécommande.
— Je n’ai pas pris de photo, t’inquiète, je tente de calmer le jeu.
Je m’efforce de ne rien montrer, mais cette petite confrontation m'a bien secoué. J'en tremble carrément. Je déteste la confrontation, je suis du genre plutôt à éviter le conflit. Et me prendre le chou avec un mec, en anglais, ça me fait encore plus bizarre.
Après quelques interminables instants de silence, tu allumes ta console et tu lances un jeu vidéo du style « je suis l’arme à recharge illimitée qu’on voit en bas de l’écran et je tire sur tout ce qui bouge ». Typiquement, un jeu vidéo de p’tit con.
Je te regarde malmener la manette sans fil, l’orienter dans l’espace devant toi pour provoquer des mouvements à l’écran. Perso, je n’arrive pas à comprendre comment on peut cramer son temps de cette façon. Même si je n’avais rien à faire de mes journées, je trouverais toujours plus intéressant pour employer mon temps que de jouer à un jeu vidéo, notamment de ce style, où l’on ne fait que dégommer tout ce qui bouge.
En revanche, te regarder jouer, toi, te voir happé par le jeu, te voir te défouler, ça c’est une activité à laquelle je pourrais me consacrer pendant des heures. Avec ton torse nu, tes pecs et tes abdos saillants, ta peau douce, ta chaînette de mec, ta casquette vissée à l’envers sur ta tête, tout pris par ton jeu, tu me renvoies illico à la toute première révision avec Jérém, lorsque, après m’avoir dépucelé et baisé de partout, il m’avait lancé, avant que je quitte l’appart :
« Pas un mot à personne de ce qui s’est passé aujourd’hui, compris ? Sinon, je te défonce ».
— Tu veux jouer ? je t’entends me lancer, me tirant ainsi des assauts de la nostalgie.
Sans attendre ma réponse, tu me tends une manette, sans pour autant quitter l’écran des yeux.
— Tu ne veux pas plutôt jouir ? je crame d’envie de te demander du tac-au-tac.
Hein ?!?!?! Qui, moi ? Jouer à un jeu vidéo ? Est-ce que j'ai la tête d'un mec à jouer à des jeux vidéo ? Je n'ai jamais eu envie de mettre les doigts sur une manette, et je ne suis même pas sûr d'avoir assez de doigts pour maîtriser toutes les touches !
— Je ne sais pas jouer à ces trucs-là ! j’avoue, terrorisé à l’idée de me ridiculiser devant un petit mec de dix ans mon cadet.
— Who cares, man ? Just play ! On s’en fout… joue ! tu m’ordonnes.
— Tu vas me mettre une raclée ! je te balance, tout en me retenant de justesse de te balancer qu'il y a d'autres raclées bien plus agréables à recevoir de la part d’un mec comme toi.
— Joue, je te dis ! tu insistes sur un ton de plus en plus appuyé, te penchant vers moi pour mettre la manette carrément entre mes mains. Ton deo de p’tit con me percute à nouveau de plein fouet. Comment veux-tu que je me concentre au jeu, après avoir sniffé ton odeur ?
Et là, j’ignore comment c'est sorti, mes mots mes surprennent en même temps qu’ils glissent de mes lèvres :
— Ok, je joue. Mais après je te suce !
— Win, first ! je t’entends lâcher, un petit sourire lubrique au coin des lèvres.
Gagne, d’abord.
Putain ! Soudain j’ai l’impression que dans ta tête tu as déjà fait un pas vers le grand saut. Que tu envisages désormais de déroger à ta règle « je n’aime que les nanas ». J’ai l’impression que tu as déjà envie de ce que je te propose.
— Je vais gagner, t’inquiète ! je bluffe, enivré par cette petite ouverture de ta part.
— Jamais de la vie, tu es trop vieux pour ça, tu ricanes.
Je sais que je n’ai aucune chance de gagner. Et que je ne gagnerai donc pas mon « pari ». Mais tant pis. Ce début de complicité avec toi, magnifique Justin, m’enivre déjà.
— P’tit con, va ! je te balance, tout en m'installant à côté de toi et en frôlant ta main au passage. Premier contact physique avec toi, p’tit con, depuis ta poignée de main à mon arrivée. Contact fugace entre les bouts de nos doigts, frottement léger, mais frisson intense pour moi, comme une décharge électrique qui se propage dans tout mon corps.
Tu relances le jeu, tout en m’expliquant le fonctionnement en trois mots. Enfin, deux mots : Tu + tires !
Le jeu défile, sans que je sache vraiment ce que je suis censé faire. J’appuie sur toutes les touches, je me trouve gauche, maladroit, je ne sais même pas si je suis en train de marquer des points ou d’en perdre.
Je ne sais pas pendant combien de temps nous jouons à ce jeu de massacre. Ce que je sais, c’est que lorsque mon regard tombe sur les scores, ma surprise est immense et mon incrédulité totale en constatant que le mien est plus élevé que le tien. De son côté, le compte à rebours n’affiche plus que quelques secondes. La victoire est à portée de main, la pipe aussi ! Bien sûr, je suis conscient que tu es toujours en mesure d’annuler notre « pari », que tu peux avoir changé d’avis, ou juste avoir joué avec moi. Peut-être que cette pipe n’a même jamais été envisagée dans ta tête.
Mais il faut que j’en aie le cœur net, il faut à tout prix que je garde mon avantage. Je continue d’appuyer comme un malade sur le bouton qui me sert de gâchette. Et lorsque « Game Over » s’affiche enfin en grand en haut de l’écran, mon côté de l’écran clignote en bleu et affiche « Winner ».
— J’ai gagné ! je triomphe.
— Je n’ai pas trop fait d’effort pour gagner non plus, tu me mets à l’aise direct.
— Tu as vraiment envie que je te suce, alors !
Une bonne flamme lubrique embrase désormais ton regard. Tes mots, ton attitude et tes gestes dévoilent tes envies.
Tu poses ta manette sur la table basse, tu écartes un peu plus les jambes, tu glisses ta main dans le tissu molletonné, tout en me balançant, le regard rivé dans le mien :
— Tu veux la voir, n'est-ce pas ?
— Depuis que j’ai vu ta photo sur le site, j’y vais franco.
— Et tu veux la sucer, tu enchaînes, l’air de plus en plus assuré, de plus en plus maître de la situation, de plus en plus excité.
— Oui, autant que tu veux te faire sucer, je me lâche.
Décidément, cette chanson semble écrite sur mesure pour toi…
I looked into your eyes/J'ai regardé dans tes yeux
And my world came tumbling down/Et mon monde s'est effondré
You're the devil in disguise/Tu es le démon déguisé
That's why I'm singing this song/Voilà pourquoi je chante cette chanson
Toi, petit démon à la gueule d’ange, déguisé en jeune mec charmeur et sexy, toi, tentation irrépressible, ravageuse !
Ton regard est celui du serpent au jardin d’Eden, ton corps le fruit défendu. Comment je la comprends, à cet instant, cette conasse d'Ève. Mon Paradis pour « croquer » dedans.
— Les pédés comme toi ont besoin de la queue d'un mec pour prendre leur pied, tu surenchéris.
Tes mots de petit macho me chauffent à bloc, tout en m’inspirant une impression de déjà entendu, faisant appel à des souvenirs liés à des jours lointains, dans l’espace et dans le temps. Comme ils sont lointains, et en même temps si proches, car toujours en moi, dans mon cœur, la rue de le Colombette, et l’année 2001 ! A croire que, au-delà de l’espace et du temps, l’espèce « p’tit con » possède un vocabulaire spécifique qui transcende les langues.
— C’est tellement ça, je me livre sans résistance, sans honte aucune.
Je ressens ton désir de me voir soumis à ta domination de jeune mâle. Alors, je décide d’assumer mes envies à 100%.
— Je suis sûr que tu vas kiffer ce que je vais te faire !
— Du style ? tu me lances, l’air intrigué.
Ta question me donne un bel avantage, un avantage inattendu, et me fait pousser des ailes.
— Une vraie pipe, pour commencer !
Car tu n’es vraiment qu’un p’tit con à faire jouir d'urgence.
— Tu ferais mieux de venir sucer avant que je change d'avis ! tu me lances, l’air de t’impatienter, alors que ton érection se manifeste désormais très nettement sous le tissu molletonné.
— Tu veux faire ça ici ? je m’inquiète.
— Elle ne te plaît pas la vue ? fais-tu, décontracté au possible.
— On ne risque pas d’être surpris par ta cop…
— Elle n’est pas là, tu me coupes net, avant d’enjoindre sur un ton péremptoire :
— Suce !
Je viens de me glisser entre tes cuisses, je suis enfin là où j’ai le plus envie d’être au monde, à genoux devant toi, p’tit branleur sexy. J’approche mon visage de ton short jusqu’à poser carrément mon nez sur cette belle bosse proéminente. Et j’ai l’impression de sentir l’odeur de ta teub à travers le coton.
Je tire un bout de la cordelette nouée juste en dessous de ton nombril. D’un geste très naturel, tu lèves le bassin pour mieux laisser glisser le short et le boxer le long de tes cuisses.
Le voilà le Saint des Saints de ta virilité, cette belle queue s’érigeant au-dessus d’une délicieuse touffe de poils châtain clair.
Je ne peux résister plus longtemps à l’envie de la prendre en bouche et de commencer à te pomper. Je te suce avec désir, avec entrain, j’ai envie de te montrer que tu as eu raison de te laisser aller, et j’ai envie en même temps de te remercier de me faire ce cadeau.
Tu as gardé ta casquette sur la tête et j’aime ça, que tu gardes ta casquette de Playmobil bandant pendant que je te suce. Je sens ton regard sur moi, et j'aime ça aussi, que tu me regardes à genoux, accroupi entre tes jambes, pendant que j’œuvre pour t’offrir le plaisir que tu exiges.
Non, je n’arrive pas à croire que tu m’aies laissé gagner pour gagner une pipe au passage, l'air de rien. « Je n’aime que les nanas ». C’est ça, p’tit con, à d’autres !
Ta respiration joue désormais la partition de ton excitation. Tu fermes les yeux, tu lèves la tête vers le ciel, tu ouvres la bouche à la recherche de ton souffle, coupé par le plaisir. Tu profites désormais sans vergogne des talents de ma langue et de mes lèvres.
Ma main te branle et ma langue fait des « 8 » bien appuyés sur tes bourses, et ça aussi, tu as l’air de bien apprécier.
Je descends vers ton entrecuisse, et tu me laisses faire. Du moins jusqu’à ce que ma langue effleure l’entrée de ta raie. Tes mains se posent alors sur mes épaules, elles me retiennent fermement.
Alors, quoi ? T’as peur de … ? De ne pas aimer ? Ou, au contraire, de trop aimer ?
A croire que là aussi, au-delà de l’espace et du temps, lorsque la p’tit contitude est confrontée à ses fantasmes et à ses envies les plus refoulées, les réactions demeurent immuables.
Le fait est que tu DOIS goûter à ça, beau New-Yorkais, c’est obligé, et tu dois y goûter aujourd’hui même, et ça doit être moi et personne d’autre l’artisan de ce bonheur qui t’attend ! Je force avec mon buste et j'arrive enfin à effleurer ta raie avec le bout humide de ma langue. Et là, presque instantanément, comme lorsqu’on tape le bon code sur un clavier et qu’une porte s’ouvre, tes bras cessent toute résistance. Je te vois te détendre, puis attendre, offert, impatient.
Non seulement ta résistance cesse, mais très vite tu écartes un peu plus tes jambes, tu ouvres grand tes cuisses, tu laisses glisser tes fesses bien au bord du canapé, même un peu dans le vide. Ton corps tout entier œuvre pour me dégager la voie. Tu es désormais complètement offert à ma langue, sans limites et sans pudeur.
Alors j’y vais franco. Avec mes deux mains, j’écarte tes fesses et avec ma langue j’y vais de plus en plus fort, de plus en plus profondément, ivre d’avoir enfin le droit d’accéder à l’endroit ultime de ton intimité.
Je ne me trompe pas en affirmant que jamais avant cet après-midi, personne ne t’avait fait ça ? Et que tu ne t’attendais pas, ce matin, en te levant, à découvrir en ce 16 septembre 2015, ce truc de dingue, et encore moins par l’œuvre de la langue d’un garçon ?
Toi qui as voulu d’abord me retenir parce que, j’imagine, dans ta tête « il n’y a que les pédés qui aiment ça », dès l’instant où tu y as goûté, tu as aimé, et pas qu’un peu.
Tes deux mains voulaient me repousser, elles veulent désormais me rapprocher. Elles se posent sur ma tête, tes bras exercent une pression de plus en plus forte, violente, animale pour que mon visage et ma langue s'enfoncent encore plus en toi. Tu y vas tellement fort que j'ai presque du mal à respirer. Pourtant, cela me chauffe à bloc.
Alors, je n'ai plus qu'une envie, celle de te faire jouir du cul, p’tit branleur sexy !
Ma langue se déchaîne, te sentir prendre ton pied à fond est comme une drogue qui mène vite à l’addiction. C’est une escalade de plaisir et d’excitation. Des spasmes violents secouent ton beau corps, notification inconsciente de la tempête de nouvelles sensations qui fait des ravages dans ta tête.
J’y vais comme un fou, encouragé par la vision que tu m’offres, ton torse allongé à l’horizontale sur le canapé, tes pecs et tes abdos saillants ondulant au rythme de ta respiration haletante, tes couilles bien pleines et ta queue raide, ton gland flirtant avec ton nombril, suintant une petite goutte brillante provoquée par une excitation hors normes. C’est l’image d’un bonheur absolu. Le tout, à quelques centimètres à peine de mes yeux.
L’une de tes mains finit par quitter ma nuque et atterrir sur ta queue. Tu commences à te branler pendant que je te bouffe le cul. On dirait bien que ma petite astuce coquine t’a donné une envie furieuse de jouir ? Est-ce que j’ai réussi, ça, moi, « l’espèce de pédé » ?
C’est lorsque je sens ton corps se raidir, lorsque je t’entends pousser un râle profond de satisfaction, lorsque je sens ton orgasme débouler, c’est à cet instant que j’ai ma réponse.
Lorsque je lève la tête, un spectacle magnifique se présente à moi. Tes giclées parsèment tes pecs et tes abdos, jusqu’à ton cou.
Nos regards se rencontrent. Et là j’ai la certitude que tu as envie de la même chose dont j’ai envie.
Polir ton gland, ne pas laisser une seule goutte de ton nectar de mec, profiter de cette main que tu me tends, comme un ordre silencieux, comme une évidence, lécher tes doigts gluants de ce jus brûlant de p’tit branleur. De là, démarrer un merveilleux voyage des sens, un voyage qui se poursuivra vers tes abdos, qui remontera ensuite vers tes pectoraux, sans oublier de s’attarder autour de tes tétons bien saillants. Lécher ta peau douce, ton torse tiède, m’enivrer de ton odeur, lécher, savourer, apprécier, avaler avidement toute trace brillante de ton orgasme.
La raison a tendance à s’éclipser face aux envies primaires suscitées par un mec comme toi, réaction animale à la testostérone.
Le fantasme est si fort, si puissant, si excitant, je le devine à ton regard qu’il l’est tout autant dans ma tête que dans la tienne.
Et pourtant, ce fantasme restera un fantasme. Tout comme ça le restera celui qui me hantait juste avant que tu jouisses, celui de te laisser te décharger dans ma bouche et avaler direct ta virilité, ta jeunesse, ta sexytude, ton insolence.
C’est frustrant, c’est râlant, c’est rageant. Mais le fait est que je ne te connais pas, mec. Qui sait où un p’tit queutard de ton espèce a pu laisser traîner sa belle queue dans une ville aux mille tentations comme New York.
Alors, bien que l’ivresse des sens (je n’ai toujours pas joui) m’inspire des idées débridées, une petite voix de trentenaire me dit qu’il vaut mieux assumer une petite frustration plutôt que risquer une grosse infection.
Je me contenterai alors de survoler ton paysage anatomique à très basse altitude avec mon nez, pour m’enivrer de cette odeur de nectar de jeune mec, tout en me faisant violence pour empêcher ma langue de s’en délecter. C’est une odeur forte et douce à la fois, elle est à l’image de ton regard, de ta voix, de tes attitudes de jeune mâle, de toi. Cette odeur, c’est tout toi, du « pur jus » de p’tit con.
Tu pars fumer à une fenêtre. Appuyé au rebord, ta cigarette au bec, le regard perdu dans l’immensité du paysage urbain, tu me fais penser à un autre gars, cigarette au bec, appuyé au parapet de sa terrasse, une terrasse si lointaine dans l'espace et dans le temps. Lui aussi, lorsqu'il avait joui, il avait besoin de ce petit plaisir faisant écho – ou le prolongeant d’une certaine manière – à celui que je venais de lui offrir.
Lorsque tu écrases ton mégot, lorsque tu te retournes, je vois dans ton regard que tu n'en as pas eu assez. Je le vois à ta queue que tu en as pas eu assez. Lui non plus il n’en avait pas eu assez, il n’en avait jamais assez. Heureuse jeunesse !
Je te regarde avancer vers moi, impatient et excité de découvrir ce dont tu as envie maintenant. Tout comme en ce lointain jour de mai, avec lui.
Tu passes à côté de moi, sans un mot, tu te diriges vers le couloir.
— C’mon, follow me ! je t’entends lancer.
Mais oui, je vais venir avec toi je te suivrais même en enfer, maintenant que j’ai la chance d’accéder à ta virilité !
Je te suis, tu te diriges vers ma chambre. Tu rentres, je rentre derrière toi. Je n’ai pas le temps de fermer la porte, tes mains me saisissent déjà, je me retrouve allongé sur le lit. Je te regarde et je sais que tu as à présent envie de me défoncer. Tu me laisses tout juste l’occasion d’enlever mon short et mon boxer, tu me retournes comme une crêpe. Tes gestes ont la précipitation de l’excitation bien avancée.
Je me trouve allongé sur le ventre, face à la porte glacée du placard. Je te vois dans le miroir, je te regarde en train de grimper sur le lit, derrière moi, je vois ta queue tendue avancer vers mon entrejambe. Je sais que t’as envie de me baiser, de défouler sur moi ce rut que j’ai provoqué en toi.
Tu viens en moi, sans te protéger. Une partie de moi est en alerte rouge, elle tente de me prévenir sur le niveau de risque et d’inconscience de la situation. Mais une autre partie de moi crève d’envie de s’abandonner à l’un des désirs les plus brûlants enfouis en moi, un désir inassouvi depuis la dernière fois où j’ai fait l’amour avec Jérém, il y a bientôt huit ans, celle de me laisser remplir par le jus d’un si beau garçon. Alors, je te laisse faire, je suis fou, je me laisse faire.
Je tente de réconcilier les deux parties en conflit dans ma tête en me disant que je te laisserai juste faire pendant un moment, et que je te demanderai de sortir et de passer une capote avant de jouir.
Je te laisse commencer à coulisser en moi, à me tringler, sans rien savoir de toi, sans savoir si tu es clean, sans savoir à quelle « distance » se situe ton orgasme. Tu pourrais très bien jouir très vite, et mon raisonnement fallacieux ne me protégera pas des risques que j’aurai pris.
De toute façon, je sais très bien que lorsque le plaisir sera enclenché, je n’aurai pas le courage ni l’envie de l’arrêter. Que je n’aurais qu’une envie, d’aller jusqu’au bout, et de te laisser te vider les couilles dans mon cul.
Te sentir coulisser en moi, me sentir possédé par toi, p’tit branleur sexy, dominé par ta virilité et tes envies, c’est pour moi un bonheur indicible. Tout mon corps est embrasé par une excitation que je n’ai pas ressentie depuis des années. Ta queue me remplit à merveille, elle m’offre le plaisir physique. Mais ton image dans la glace – ta belle petite gueule crispée par l’excitation, ta casquette toujours vissée sur ta tête, ton torse et ta chaînette ondulant au gré de tes coups de reins, ton attitude de jeune mâle en quête de son seul plaisir, un mâle qui ne vas pas me lâcher tant qu’il ne se sera pas vidé les couilles – déclenche en moi le plaisir ultime, un plaisir purement mental, le plus puissant de tous, celui du mec qui aime se sentir « l’instrument » du plaisir d’un beau mâle. Jouir avec tout mon corps et tout mon esprit, peu de garçons ont su m’offrir ce bonheur suprême.
Tu prends appui sur mes épaules pour donner plus de puissance à tes coups de reins. Lorsque tu te penches un peu plus sur moi, je sens le contact léger de ta chaînette longue et fine entre mes omoplates. Soudain, je suis rattrapé par le souvenir d’un autre miroir, d’une autre chaînette, plus courte, plus épaisse, mais tout aussi sexy.
« Ouvre les yeux, putain, et regarde ce qui t'arrive, regarde comment tu te fais baiser, comme une pute ! ».
Décidément, il avait le sens de la formule pour me faire bander.
Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te laisser jouir en moi, beau Justin !
Heureusement, j’ai toujours une capote sur moi. Tu tiques un peu, mais tu finis par te résoudre à la passer avant de revenir en moi et recommencer à me pilonner.
Je n’ai pas à attendre longtemps avant d’entendre à nouveau ton râle de mec tentant d’apprivoiser son orgasme. Le reflet du miroir me montre ton corps secoué par l’explosion de ton plaisir de mec. Ta tête part vers l’arrière, ton torse se bombe, ton bassin ondule frénétiquement. Tu jouis.
Et moi, j’ai envie de pleurer. Y-a-t-il quelque chose de plus fabuleusement beau que de voir un mec comme toi submergé par le plaisir qu’il a atteint en coulissant en moi ?
Un instant plus tard, tu t'abandonnes sur moi de tout ton poids, la respiration bruyante, le rythme cardiaque très rapide. Comme lui, tu restes immobile pendant quelques instants, la queue toujours raide, toujours enfoncée en moi, tu récupères de « tes émotions ».
Lorsque tu te déboîtes de moi, je me retourne instinctivement, car j’ai besoin d’être rassuré. J’ai besoin de savoir que la capote est toujours sur ta queue et qu’elle a résisté à ta fougue de jeune étalon. Ma mésaventure avec Benjamin il y quelques années résonne toujours en moi, à chaque fois que je me fais prendre. Tout va bien de ce côté-là, je suis rassuré.
J’ai quand même la forte impression que si je t’avais laissé faire, parti comme tu étais parti, fougueux, excité, impétueux, débordant de testostérone bouillante, toi tu aurais été au bout, tu m’aurais joui dans le cul. Tu n’es vraiment qu’un sale gosse, appartenant à cette génération qui semble ignorer le B.A.BA des bonnes pratiques en matière de sexe, une génération qui n’a pas vécu l’hécatombe du SIDA dans les années ’90, une génération qui n’était pas encore là quand Freddy Mercury n’était déjà plus là. Une génération qui, encouragée par l’alibi du PrEP, la fausse conviction que la trithérapie est une promenade de plaisir, grandit dans une désinformation qui lui fait imaginer que le SIDA n’est guère plus grave qu’un rhume, s’autorisant par conséquent une insouciance dans les pratiques sexuelles qui traduit à la fois un défaut flagrant de respect de soi et une attitude criminelle envers l’autre.
Pour peu que, comme de nombreux petits cons de ton espèce et de ton âge, tu te berces dans la fausse illusion que tremper la queue dans un cul inconnu ça ne représente pas de risque pour toi, tu ne voyais certainement pas le problème.
Il m’a fallu faire face à ta fougue, à ton impatience, cette nouvelle impatience de jouir amenée par la découverte de nouveaux plaisirs. Il m’a fallu en même temps lutter violemment contre mon envie viscérale de recevoir en moi la décharge virile d’un p’tit con comme toi.
Mais j’ai quand même réussi à imposer ce bout de caoutchouc grâce à qui, en te regardant t’en débarrasser, le réservoir bien rempli, avant de le coiffer d’un petit nœud, je peux terminer de me branler et jouir le cœur léger.
Dans les rues de New York.
Une demi-heure et une douche plus tard, je me balade à nouveau dans les rues de New York, mon entrejambe me rappelant à chaque pas le bonheur de m’être fait sauter par toi, bel inconnu prénommé Justin.
L’heure du concert approche. Je me dirige vers le Madison Square Garden à grand pas. Dans mes écouteurs, les chansons de l’album « American Life ». Elles me ramènent à Capbreton, pendant sa convalescence, après son accident au genou.
L’excitation monte en flèche lorsque j’aperçois la foule qui se presse devant les entrées. Et ça me fait chaud au cœur. Madonna a beau ne plus vendre autant de disques qu’à la grande époque, ne plus passer en radio, faire des choix artistiques qui ne font plus l’unanimité, changer d’apparence et pas toujours dans le bon sens, abuser du bistouri. Après trente ans de carrière, elle demeure néanmoins une bête de scène capable d’aligner en quelques mois plus de 80 dates sur quatre continents, une icône pop capable d’attirer à elle près de deux millions de fans disposés à engager des sommes considérables pour la voir en vrai.
Comme d’habitude, elle se fait attendre. Le public l’appelle, se chauffe tout seul. Entre agacement et impatience, les fans n’en peuvent plus.
Lorsque l’intro vidéo démarre enfin sur des percussions aux basses rutilantes, lorsque les danseurs déboulent sur scène avec des costumes qui semblent sortis tout droit de l’armée des soldats de terre cuite de l’empereur Qin, voilà, la salle est en délire.
Mais lorsqu’elle apparaît enfin, enfermée dans une cage à 20 mètres du sol, la salle s’embrase carrément. On la retrouve comme on retrouverait une amie qu’on ne voit que très rarement, mais avec qui la communion spirituelle demeure intacte, comme si on s’était quittés la veille. Une amie avec qui on aurait fait les quatre cents coups, avec qui on partage d’innombrables souvenirs. Des souvenirs communs, ses chansons, auxquels chacun d’entre nous en accroche d’autres plus personnels. Une amie à qui on pardonne tout ou presque, car elle ne nous a jamais laissé tomber.
Les nouvelles chansons se mélangent aux anciens tubes incontournables. La puissante « Iconic » fait l’ouverture du show, « La vie en rose » s’invite dans la playlist et l’incontournable « Holiday » clôt la grande messe, comme à chacune de ses tournées.
Ses tenues se sont rallongées, elles sont plus couvrantes que par le passé. Les années ont passé, la Star ne souhaite plus montrer autant d’elle qu’auparavant. Pour entretenir le mythe, il vaut mieux parfois se montrer discrète. Niveau danse, la souplesse est moindre, l’assurance d’antan vient un peu à manquer. Dans les précédentes tournées, on avait l’impression, car l’illusion était savamment entretenue, que tout ce qu’elle faisait, danse, présence scénique, n’était qu’un jeu d’enfant accompli presque sans effort, qu’elle en avait toujours sous le champignon, qu’elle aurait pu faire encore mieux si seulement elle l’avait voulu. Désormais, on a l’impression qu’elle est à fond sur le champignon, qu’elle atteint ses limites. On voit qu’elle donne tout, comme elle l’a toujours fait sur scène, mais qu’elle ne pourrait pas donner plus. Et, surtout, qu’elle ne peut plus donner autant qu’avant. Elle en devient touchante.
Pour son dernier album, elle nous a tous un peu perdus, fans de la première heure et grand public, avec ses nouvelles productions et sa promo en demi-teinte, mais le show qu’elle nous offre est fabuleux, elle se rattrape de façon grandiose.
Car sa plus grande force, c’est sa présence, cette présence qui traverse les décennies, et ma vie, et qui en constitue l’un des rares éléments de stabilité, comme un repère, au milieu des tempêtes, et même de la plus grandes de toutes, celle qui m’a mis à terre il y a désormais presque huit ans, lorsque Jérém est sorti de ma vie.
Je sors du Madison les yeux pleins d’étoiles.
Il n'est que minuit, et la nuit new-yorkaise semble si jeune et si pleine de promesses. Tout grouille autour de moi, les gens, les rues, les voitures, les bruits de la ville, les enseignes clignotantes et les écrans géants illuminant Times Square comme en plein jour.
Je regarde la foule circuler autour de moi et, une fois de plus, je suis comme étourdi par toutes ces occasions, toutes ces rencontres possibles, toutes ces vies qui se croisent, qui s'effleurent sans que les destins se rencontrent. C’est la foire des occasions, des occasions manquées. Je me dis que, peut-être, dans toute cette foule, deux êtres faits l’un pour l’autre passent à côté l’un de l’autre sans se voir, comme dans un Mahjong avec beaucoup trop de tuiles.
Je ressens comme un état d’ivresse, j’ai l’impression de percevoir toute l’énergie de vie de la foule, une énergie qui semble se propager à travers le sol, courir dans les rues, sur le bitume et irradier en moi, comme si j’étais connecté avec tout ce qui est vivant.
Je suis à New York et j’ai l’impression que je ne me suis jamais senti aussi vivant. Je suis cueilli par une espèce d’immense euphorie. Dans cette ville immense et étrangère, tout semble tellement possible, y compris apprendre à vivre avec un passé douloureux, avec le manque, le déchirement, le deuil impossible.
Oui, la nuit est jeune, et il y a plein d'endroits où je voudrais aller. Des bars, gays, ou pas. Une partie de moi a envie de savourer tout ce qu’est capable d’offrir la Grande Pomme.
Je marche pendant une heure, sans arriver à me décider à franchir l’une ou l’autre des entrées en dessous d’enseignes toutes plus clignotantes et criardes les unes que les autres.
Le fait est qu’une force irrépressible, irrésistible, violente m’entraîne vers toi, P’tit branleur sexy.
Je suis rentré au Madison en pensant à toi, p’tit con, à ce que tu m’avais fait une heure plus tôt.
Je suis sorti du Madison toujours en pensant à toi, à cette furieuse envie de recommencer ce que tu m’as fait quelques heures plus tôt.
Et là, pendant que je marche dans les rues de New York, alors que chacun de mes pas m’apporte toujours l’écho de ta venue en moi, j’ai encore furieusement envie de toi, un peu plus à chaque instant, à chaque pas.
J’ai envie de rentrer, envie de savoir si tu es encore levé si tu as envie de recommencer. Au fond de moi, je n'arrive même pas à croire que c'est arrivé. Au fond de moi, je sais que je vais finir seul à me branler dans ma chambre et que j’aurais gâché ma première nuit à New York. Dans le doute, je passe acheter des capotes dans une pharmacie. Et je viens à ta rencontre, beau Justin.
A l’appart, le séjour est plongé dans le noir. Enfin, dans le noir comme peut l’être un appart à New York avec une énorme baie vitrée laissant filtrer les lumières de toute une ville.
Pendant que je me perds dans la contemplation de cette immense fourmilière étincelante, je remarque un reflet de lumière bleutée et nerveuse d’un écran venant du couloir.
Je suis le reflet, jusqu’à l’entrebâillement de la porte de ta chambre. Te voilà, p’tit con sexy, allongé sur ton lit, toujours torse nu, devant ta télé, les yeux et les doigts rivés sur ton portable. Tu ne m’as pas entendu rentrer, tu ne m’as pas vu en train de te mater. J’adore cet instant où je te contemple sans que tu en sois conscient.
La simple vue de ton corps provoque en moi des frissons géants. Quand je pense que je me suis tapé ça, je suis toujours sur le cul. J’ai envie de pousser la porte et te sauter dessus sans attendre.
Et là, tu tournes ta tête et tu captes enfin ma présence. Tu me fixes pendant un instant. Tu sais que je te désire au-delà du raisonnable, tu sais que tu peux me demander absolument tout ce que tu veux. Tu me souris, triomphant, et tu baisses ton short et ton boxer.
If I'm smart then I'll run away/Si j'étais futée je m'enfuirais
But I'm not so I guess I'll stay/Mais je ne le suis pas alors je pense que je vais rester
Tu as envie de tirer un dernier coup pour bien dormir, c’est ça ? Et bien tu l’auras ton dernier coup !
Quand je pense que tu ne voulais pas coucher avec un mec et maintenant c'est toi qui m’offres ta queue de ton propre chef !
Je m’approche de toi et tu éteins la télé. La chambre est désormais plongée dans un noir presque total. Je viens te sucer en m'orientant à ta respiration, à la chaleur de ton corps, à l’odeur de ta teub. Te sucer dans le noir, c’est très excitant. Dans le noir, ton plaisir, mon plaisir, tiennent dans des sensations autres que visuelles, des sensations tactiles, olfactives, auditives, gustatives. C’est une expérience originale, intense, excitante.
Je te suce comme un fou, je te suce pour te faire jouir comme un malade, et dans ma tête la bataille fait rage entre l’envie violente de te laisser jouir dans ma bouche, de goûter enfin à ton jus de mec, de t’avaler, et une crainte des plus rabat-joie, celle justement de recevoir tes jets par surprise, et de m’en inquiéter après coup.
Le conflit est sanglant, mais de courte durée. Je ne saurais jamais si je t’aurais avalé ou pas car, toi, p’tit con, tu as d'autres projets.
Tu t'allonges sur le lit, à plat ventre. Je sais ce que tu veux, tu veux que ma langue vienne encore te faire plaisir là où personne n’avait eu accès avant cet après-midi.
Je m’exécute avec un bonheur immense, je m’exécute pour te faire plaisir, pour me faire plaisir. Je m’exécute jusqu’à que tu me montres que tu as envie d’autre chose.
Je te regarde, p’tit con sexy, à quatre pattes sur le lit, les fesses cambrées, la casquette toujours vissée à l’envers sur ta tête, m’offrant ton cul sans vergogne.
T’as envie de te faire baiser, hein ? Est-ce la première fois pour toi, ou bien t’as déjà laissé un autre p’tit con de ton espèce être ton maître sexuel ? Est-ce que tu brûles d’envie d’aller à la découverte de l’inconnu ou bien tu sais exactement où tu t’aventures ? Est-ce que tu réclames de te faire mettre, en profitant d’avoir un pédé sous la main, et en toute connaissance de cause du plaisir que tu vas en retirer ?
P’tit con, est-ce que tu as déjà ressenti ce doute intérieur face à cette envie te demander si tu vas vraiment aimer, comment tu vas gérer le regard de l’autre, comment tu vas te sentir au plus profond de toi-même, après ? As-tu déjà ressenti la crainte de te faire happer par ce plaisir, d’en devenir dépendant à la première prise comme pour une drogue, la crainte de te laisser entraîner dans un tunnel sans retour ? Ou bien, ce doute c’est aujourd’hui que tu vas l’affronter ?
J’ai un peu de mal à venir en toi, je dois m’y prendre à plusieurs reprises, composer avec les réticences de ton trou, et tes grimaces de souffrance. La sodomie est un plaisir qui se mérite. Mais je finis par trouver le moyen de me glisser en toi.
A présent, ton corps tout entier ondule, frissonne, demande, aspire au contact d’une autre virilité que la tienne. Tu implores un plaisir que tu méprisais jusqu’à il y a peu, et que tu mépriseras peut-être à nouveau dans quelques minutes, un plaisir que tu regretteras, ou auquel tu auras pris goût. Ce qui est certain, dans l’instant présent, c’est que ce nouveau plaisir te rend tout simplement dingue.
Quant à moi, le simple fait de te voir dans cette position, dans cet état, de sentir ton trou enserré autour de ma queue, de réaliser qu’il m’est donné l’opportunité de posséder un p’tit con de ton espèce, tout ça me paraît tellement irréel !
Que de chemin parcouru, beau p’tit con, en à peine quelques heures, toi, le mec qui n’aime(ait) que les nanas !
Est-ce qu’on peut imaginer assister à quelque chose de plus dingue que cette image, ce genre de p’tit con, de p’tit mec sexy, macho, arrogant, fier de sa queue, à quatre pattes sur un lit, en train de se faire baiser ?
Mes coups de reins sont toujours en retenue, je te ménage bien sûr. J’ai envie de passer à la vitesse supérieure, mais je ressens quand même des sensations magiques en me stabilisant sur cette douce vitesse de croisière.
Une vitesse qui finit néanmoins par se révéler insuffisante, puisque à un moment je t’entends balancer sèchement, la voix étranglée par un mélange de plaisir et d’excitation, de frustration et d’agacement :
— Fuck me harder... go on, go on !
Ah, putain c’est bon de baiser avec l’audio en anglais, d’entendre de ta bouche quelque chose comme « Baise-moi plus fort, vas-y, vas-y ! » !
Tes mots m’encouragent, me donnent confiance. Là, je sais que je peux y aller franco, et je commence à te pilonner vigoureusement, de plus en plus vite, je te martèle sans ménagement. Mes cuisses claquent contre tes fesses, mes couilles frappent ton entrejambe.
Et toi, p’tit con, tu assumes, tu encaisses, et tu en redemandes.
— Harder, harder !
Tu en veux davantage, et je ne sais même pas si je pourrais te donner davantage. J’ai l’impression que je suis à fond, que je me donne à fond, je te cartonne avec toute la puissance dont je suis capable, m’approchant très vite de l’orgasme. Je te pilonne sans me retenir, je te pilonne sans plus m’occuper de toi, tout concentré sur mon plaisir qui monte, qui monte, qui monte…
— Je vais venir, je te préviens, alors que mon premier jet se love déjà dans la capote.
Ta seule réponse est un silence ponctué par tes halètements profonds et rapides.
Je viens de jouir et je me sens vidé de toute énergie. L’excitation me quitte rapidement et mon corps ne réclame désormais qu’un repos mérité. J’ai juste envie de me déboîter de toi et de m’allonger sur le lit pour retrouver mes esprits.
Mais c’est compter sans toi. Car tu vois les choses bien autrement.
Je n’ai pas le temps d’atterrir de mon orgasme, ni même de retirer ma capote, que déjà tes mains m’attrapent, me retournent, me plaquent sur le matelas à la place qui était la tienne une seconde auparavant. J’entends le bruit du déchirement d’un petit emballage. Un instant plus tard, tu t'enfonces en moi, et tu me baises comme un animal plus en rut que jamais, presque avec rage. Comme si tu te vengeais, comme si tu me punissais désormais pour t’avoir fait l’affront de te faire jouir du cul. Comme si tu voulais remettre les pendules à l’heure, et rétablir la primauté de ta virilité.
Regrettes-tu déjà ? Ta virulence est-elle une sorte de catharsis ? Ou bien, juste l’effet d’une excitation incontrôlable apportée par ce nouveau plaisir ?
Quoi qu’il en soit, j’adore cette saillie sauvage, rageuse, absolue, inouïe, féroce, furieuse. Une saillie qui ne dure, hélas, pas très longtemps, car tu ne tardes pas à venir, à te décharger en limant mon cul au fer rouge.
Jeudi 17 septembre 2015.
Lorsque je me réveille le lendemain matin, il est déjà presque 11 heures. Il fait un temps magnifique, et déjà depuis le couloir, je réalise que l’appart baigne dans une lumière presque aveuglante.
En tendant l’oreille, j’entends des bruits connus, des coups de feu, des cris, des ordres, des explosions, des bruits typiques de ce jeu vidéo à la con que toi, beau Justin, sembles affectionner tout particulièrement. Enfin, je devrais plutôt parler de ce jeu comme d’un chef d’œuvre. Depuis qu’il m’a permis d’accéder à ta magnifique queue du bogoss new-yorkais, je n’arrête pas de lui trouver des vertus insoupçonnées.
Je te rejoins dans le séjour. Je suis heureux de te retrouver, beau Justin.
— Morning ! je te lance, aveuglé autant par la clarté qui se déverse par les baies vitrées, que par la beauté ravageuse de ton torse toujours rigoureusement nu, par l’insolence de ta jolie petite gueule, par l’attitude nonchalante de ton corps affalé sur le canapé, par cette putain de casquette à l’envers qui décidemment ne te quitte jamais, et par le souvenir toujours bouillonnant de nos ébats de la veille. Ça me paraît toujours irréel, et pourtant !
— Hi ! tu me réponds, sans quitter l’écran des yeux, tout en me tendant une manette.
Euh… de bon matin, avant le petit déj… je ne suis pas sûr que ça va le faire…
Mais je joue quand même. Après tout, je te dois bien ça, beau p’tit con.
Au bout de quelques minutes, je me rends compte que je suis à la ramasse. Ton score est deux fois plus important que le mien. Il faut dire que tu ne joues pas franc jeu. Tu utilises des armes non conventionnelles pour distraire l’adversaire que je suis. Ton torse dénudé est une pure provocation, surtout après ce qui s’est passé la veille. Tu es vraiment un petit démon déguisé sous des allures de bogoss.
Comment veux-tu que je marque des points alors que je n’arrive pas à cesser de mater tes abdos, tes pecs, les poils de ton chemin du bonheur indiquant la direction de ce sexe que je rêve de reprendre en bouche ? Et je ne parle même pas de ton deo p’tit con qui se dégage insolemment de ta peau !
Je joue vraiment trop mal, j’enchaîne les erreurs, les ratés. La vie de mon avatar est désormais en danger. Je joue tellement mal, qu’à un moment tu finis par mettre le jeu en pause et par me balancer :
— But what the hell are you doing ?
Ton sourire ravageur et coquin au coin de l’œil, au bord des lèvres, me rend fou de désir.
— Qu’est-ce que je fais ? Je n’ai pas envie de jouer. J’ai juste envie de toi, mec.
Je balance ma manette sur le fauteuil à côté et je me glisse entre tes cuisses.
Dès que ton gland se présente devant mes yeux, à portée de ma bouche, je te suce. Je te suce avidement, je te suce alors que toi, p’tit con, tu as redémarré le jeu.
Ainsi, pendant que tu manies ta manette avec dextérité, moi c’est ta queue que j’essaie de manier avec dextérité. A chacun les jeux qui lui siéent le mieux.
Je te suce depuis un bon petit moment déjà, lorsque j’entends la machine annoncer : « Game Over », suivi par un : « Shit ! » sortant de ta bouche, sur un ton plutôt agacé.
— Tu m'as fait perdre, tu lâches, irrité.
— Plains-toi je tente de te décrisper, tout en obligeant mes lèvres à quitter momentanément leur bonheur.
— Tu m'as fait perdre ! je t’entends insister, sur un ton presque accusateur.
Baiser avec des petits cons, ça a aussi ses inconvénients.
— Peut-être, mais je pense pouvoir me rattraper en te faisant jouir à un point tel que tu vas oublier ton jeu à la con !
— T’as intérêt ! tu t’exclames, l’attitude du mec qui considère que son plaisir est un dû.
Tu as vraiment une sacrée tête à claques, mais tu es tellement, tellement, tellement bandant !
Vendredi 18 septembre 2015.
Le lendemain matin, à mon réveil, l’appart est plongé dans le silence le plus total. Pas de bruits de coups de feu, d’explosions, pas de cris venant d’un jeu vidéo « passionnant ».
En ce jour de mon départ de New York, l’appart semble désert. Ta présence me manque. Je te cherche. Tu n’es pas dans ta chambre, j’aperçois ton lit vide dans l’entrebâillement de la porte. Tu n’es ni aux toilettes, ni dans la salle de bain, ni dans le séjour. Tu es où mon beau p’tit con ?
La nuit dernière tu m’as encore baisé comme un Dieu, et je ressens l’écho de tes coups de reins à chaque pas. J’ai besoin de te dire au revoir, avant de partir à l’aéroport.
En attendant, je me fais couler un café et je profite longuement du spectacle qui s’offre à moi, et rien qu’à moi, cette vue imprenable sur la verticalité de la ville baignant dans la lumière du matin.
Mais l’heure tourne, et le moment vient où je suis vraiment obligé d’y aller, sous peine de rater mon avion.
Je ne peux pas m’imaginer partir sans te revoir une dernière fois, après tout le plaisir qu’on s’est donné. Mais au fond c’est peut-être bien ainsi. Peut-être que toi non plus tu n’avais pas envie de me dire au revoir. Tu as peut-être raison. Pas de toi à l’appart, pas d’au revoir, pas de situation gênante. Il est parfois moins douloureux d’arracher un pansement d’un seul coup que de tenter de le décoller par petits bouts.
Je laisserai un commentaire positif sur Airbnb, « Très bon concept que ce B&B, Bed&Bite ».
Je m’apprête à quitter l’appart, lorsque la grande porte d’entrée s’ouvre. Et toi, p’tit con, tu es là, devant moi, tu portes un t-shirt blanc qui te va comme un gant, à l’échancrure vertigineuse, un t-shirt ressemblant en tout et pour tout à celui du selfie dans l’annonce. Et, bien sûr, ta sempiternelle casquette à l'envers vissée très haut sur la tête.
Tu refermes la porte derrière toi. Tu ne me dis même pas bonjour. Moi non plus, d’ailleurs. On se regarde, on se comprend.
Dans tes yeux, toujours cette bonne flamme lubrique que tu n’avais pas à mon arrivée, et qui ne t’a plus quitté depuis 48 heures. Ta main caresse déjà ta queue par-dessus le short. Sacré petit allumeur qui a définitivement pris goût aux plaisirs entre garçons ! Tu bandes, mec, tu as envie d’un petit cadeau d’au revoir, d’une dernière bonne petite pipe.
Tu en as envie, et moi je ne peux pas résister, quitte à me mettre en retard pour l’avion.
Putain, tu me fais un effet, mec, ça fait tellement longtemps que je n’ai pas ressenti ça pour un garçon. Je crois que je n’ai ressenti cette envie furieuse, déraisonnable, ravageuse, qu’une seule autre fois dans ma vie.
Tes épaules appuyées contre la porte d’entrée, le bassin en avant, les jambes légèrement écartées. Et moi, à nouveau à genoux devant toi, engagé dans une dernière, intense, longue, mémorable pipe.
Putain, qu’est-ce que t’es sexy avec ce t-shirt blanc ! Ça décuple mon envie de te sucer. Et lorsque tu le soulèves et tu le coinces derrière ta nuque, là, je deviens dingue. A cet instant, il n’y a plus d’avion, il n’y a plus de vie ou de taf qui m’attendent à Toulouse. A cet instant précis, mon seul but est de te faire jouir.
I looked into your eyes/J'ai regardé dans tes yeux
And my world came tumbling down/Et mon monde s'est effondré
You're the devil in disguise/Tu es le démon déguisé
That's why I'm singing this song/Voilà pourquoi je chante cette chanson
Tes mains retiennent très fort ma tête, tu me cartonnes la bouche, ta queue m’étouffe. Quel plaisir de contribuer à faire de toi un petit macho fier de sa queue, et quel bonheur de sentir en toi ce nouveau feu que j’ai allumé de ma main, de ma bouche, de mes fesses, et même de ma queue.
— Putaaaaaaaaain de salope, tu vas m’avoir ! je t’entends aboyer.
Ton orgasme secoue ton beau corps de jeune mâle je me fais violence pour obliger mes lèvres à quitter ton manche avant que tes giclées jaillissent de ta queue. Je me fais violence, car ce que je désire plus que tout est de connaître le goût de ta virilité. Et je te fais violence, car je dois forcer pour arriver à me dégager de ton bassin qui ne veut pas reculer, à me dégager de tes mains qui ne veulent pas lâcher prise. Tu crèves d’envie de me voir avaler, je le sais, p’tit con.
Et lorsque ton jus jaillit enfin, de nombreux jets puissants et épais viennent tâcher mon t-shirt.
La puissance de tes assauts, ainsi que ton odeur de jeune mâle, ce sont les derniers souvenirs que je garderai de toi, Petit Dieu à l'insolente jeunesse et à l’impertinente sexytude.
Après avoir passé un nouveau t-shirt, je marche dans la 5th avenue, direction métro-JFK-CDG-Blagnac, tout en savourant une dernière fois la grisante sensation d’être dans cette ville à l’énergie folle. « New York is not a city, it’s a state of mind », glissait Madonna lors d’une précédente tournée.
Au revoir, Madonna, nous nous reverrons lors de ta prochaine tournée, dans un autre pays. Ne tarde pas trop, ok ?
Au revoir, New York, je ne sais pas si je te reverrai un jour. Tu es comme une ivresse qui cueille dès le premier verre, et qui monte à la tête très vite. Mais après t’avoir côtoyée pendant quelques jours, je crois pouvoir dire que si je t’aime, c’est uniquement en tant que touriste. Je crois bien que je ne pourrais pas t’adopter en tant qu’habitant. Ton énergie est bien trop surpuissante pour moi. La ville où je me sens bien est Toulouse, car elle et moi partageons un même rythme, une conception de l’existence plus apaisante et à taille humaine.
Et au revoir à toi aussi, beau Justin. Ou plutôt, adieu. Pour toi, c’est une quasi-certitude, je ne te reverrai plus. Mais je ne t’oublierai pas pour autant. Car ta jeunesse et ta sexytude m’ont bouleversé. Car le plaisir que tu m’as offert m’a ramené aux meilleurs moments de ma vie.
Et, par-dessus tout, car tu m'as rappelé que, où que j’aille, qui que je suce, qui que je baise, il était une fois une histoire qui s'appelait « Jérém et Nico ».Vos commentaires sont le carburant de mon écriture.
 1 commentaire
1 commentaire
Jérém&Nico - Saison 1