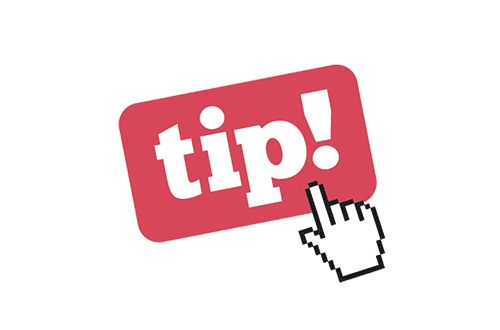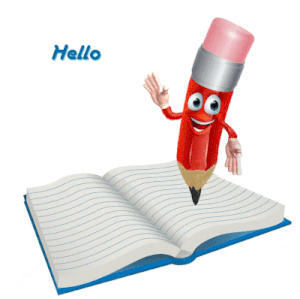-
Par fab75du31 le 18 Septembre 2022 à 22:39
Mardi 8 avril 2003.
Le lendemain, je rejoins le Centre de rééducation de Capbreton en passant par la plage. Je marche sur le sable, je m’emplis les yeux du mouvement incessant des vagues, je me laisse emporter par le bruit de l’océan. J’ai l’impression que ce déferlement d’énergie visuelle et sonore vient jusqu’à moi, en moi, et me recharge à bloc.
Après cette petite marche matinale, je me sens revigoré, et plein d’optimisme. Pas dégueu comme trajet au saut du lit pour les prochaines semaines. Pourvu que tout se passe bien pour Jérém !
Je suis au Centre à 9 heures, et j’attends tout le reste de la matinée pour voir Jérém. Il est 13h30 passées lorsque le bobrun revient de la batterie d’examens préalables au démarrage de sa rééducation.
— J’ai l’impression d’avoir passé plus d’examens ce matin que pendant toute ma vie. Ça n’en finissait plus ! il s’exclame.
— Alors, ils t’ont dit quelque chose ?
— Non, rien. Je dois voir mon médecin référent en fin d’après-midi pour faire le point.
— Je suis sûr que tout s’est bien passé.
— On verra. Pour l’instant je vais manger, je meurs de faim.
Je rentre manger aussi. J’en profite pour faire une petite sieste et pour faire quelques courses. Je reviens au Centre vers 18h00, avant le repas du soir. Je suis optimiste, j’ai besoin d’être optimiste.
Mais mon optimisme va être de courte durée. Ce soir, Jérém tire la mine des mauvais jours. Son regard est noir et fuyant, et tout dans son attitude dégage la déception et la colère.
— Salut, Jérém, ça va ? je lui tends le bâton pour me faire battre.
— Non, ça ne va pas ! il explose aussitôt.
— Qu’est-ce qui se passe ?
— Il se passe que le tendon du pied n’a pas cicatrisé comme il aurait dû. Il semblerait que l’opération ait foiré. Je suis foutu !
— Ne dit pas ça ! Il a dit quoi exactement, le médecin ?
— Il pense que c’est à surveiller, et qu’il faut y aller mollo avec la rééducation, sinon il risque de péter à nouveau. La rééducation va prendre des plombes, je ne vais pas tenir !
— Si, tu vas tenir. Tu vas tenir parce que c’est ta seule chance, ta seule option pour espérer rejouer un jour.
— Je suis fatigué, j’ai pas envie !
— Tu dois au moins essayer. Essayer c’est le premier pas pour y arriver.
— C’est ça, oui !
— De toute façon, tu dois y arriver, sinon je vais aller me faire péter la gueule par les gars de Châteauroux ! j’essaie de le faire rire.
Mais Jérém n’est pas en état de rigoler, et ma petite vanne tombe à plat.
— En plus, je me suis fait pourrir à cause des joints !
— Ils l’ont vu aux examens ?
— Oui, et à partir de maintenant, c’est interdiction complète.
— Je t’avais dit, Jérém !
— Il m’a interdit l’alcool et la cigarette, aussi…
— La cigarette ?
— Il m’en laisse dix par jour. Je vais devenir fou.
L’heure du dîner arrive. Je le trouve à nouveau découragé, pessimiste, négatif, et ça me brise le cœur de devoir le laisser.
Je ne suis pas vraiment bien lorsque j’arrive à l’appart. La solitude me pèse ce soir. Heureusement, j’ai pensé à apporter ma radio cd et quelques CD pour avoir un peu de compagnie.
Mais lorsque j’ai le moral au fond des chaussettes, comme ce soir, aucun CD ne me fait envie. Alors j’allume la radio, et je délègue à un programmateur musical le choix de ce que je vais écouter.
Une surprise m’attend ce soir-là. A l’issue d’une page interminable de pub, et alors que mes pâtes sont presque prêtes, une voix sort de la radio, traverse le vide du petit séjour, rentre dans mon pavillon auriculaire, fait vibrer mon martelet, pénètre dans mon cerveau, et pointe direct vers mon cœur. Là, elle provoque un feu d’artifice. Quelques mots a cappella scandés par une voix que je reconnaîtrais entre mille, malgré les filtres et autres artifices.
Do I have to change my name
Will it get me far
Should I lose some weight
Am I gonna be a star
(…)
American life…
J’étais au courant que son retour dans l’actualité musicale était imminent. Mais avec tout ce qui s’est passé en quelques jours, j’avais perdu tout ça de vue.
Et là, c’est la claque. Un nouveau titre, dans un style épuré, avec des sons percutants, et d’une grande élégance. Cette voix, cette présence, est la petite note positive qui me permet de ne pas me noyer dans les inquiétudes qui assombrissent à nouveau l’horizon de Jérém. Et le mien, par ricochet.
Décidemment, Madonna est toujours là quand j’ai besoin d’une voix familière, elle accompagne ma vie et me donne de la joie, souvent au moment où j’en ai le plus besoin.
Son effronterie, son énergie, sa façon d’être ce qu’elle veut, faisant fi des contraintes sociales, ouvrant de nouveaux possibles en dehors des préjugés, de l’ordre établi, sa façon de donner de la visibilité aux minorités dans ses chansons – Vogue, s’il ne faut en citer qu’une – minorités dont je fais partie, cela me parle et me touche au plus haut point.
Sa façon d’exprimer sa sexualité, ses envies, ses désirs, ses fantasmes (c’est dans son livre Sex que j’ai vu pour la première fois deux hommes s’embrasser) de façon décomplexée, déculpabilisée, sa façon de faire ce qu’elle veut et de profiter de la vie comme elle l’entend, cela me fait rêver, alors qu’au fond de moi je sens et je sais que la société me censure à cause de ma différence.
Son côté à la fois icône et iconoclaste est explosif.
Je penserai toujours à cela, à cette joie que j’ai ressentie à chacune de ses sorties discographiques, à cette sensation rassurante d’avoir une amie artiste qui ne me laisse pas tomber, qui est là à chacun des tournants de ma vie, j’y penserai toujours tant d’années plus tard, lorsque l’âge la rattrapera, l’entraînant dans une dérive sans fin. Et ma tendresse à son égard ne flanchera jamais.
Mercredi 9 avril 2003.
Le lendemain matin, je mate le Morning Live. Je prends sur moi et je m’accroche pour ne pas me laisser décourager par les niaiseries de mauvais goût dont cette émission a le secret. Mon effort et mon dévouement finissent par être récompensés car je finis par tomber sur le clip que j’attendais.
Do I have to change my name
J’apprends par les bandeaux qui s’affichent en bas de l’écran que ce clip serait une version très édulcorée de l’original, version que Madonna aurait réalisée dans l’urgence, la première ayant été boycottée par MTV car jugée trop polémique à l’égard du président des Etats-Unis et de sa décision de mener une guerre contre l’Irak. Notamment dans un contexte où les médias américains commençaient à parler des premiers boys tombés dans le désert à 10000 bornes de chez eux.
J’ai l’impression que depuis le 11 septembre, le monde est en train de devenir fou. Quand je pense à ces jeunes garçons qui perdent leur vie à la guerre, j’en ai mal au cœur.
La vie est cruelle, et elle l’est aveuglement. Elle s’est acharnée sur Jérém. Oui, Jérém est blessé. Mais au moins, il n’est pas à la guerre. Je ne me sens pas bien de penser à cela, mais je ne peux m’en empêcher.
J’ai eu l’occasion de voir le planning de Jérém, et je sais que ce n’est pas la peine d’arriver au Centre trop tôt le matin. Je profite de ma matinée pour ouvrir enfin les livres de cours.
Je retourne au Centre vers l’heure du déjeuner. Je retrouve Jérém dans la salle commune, comme convenu. Il n’a pas l’air ravi. La première séance de rééducation a été douloureuse.
— Ils t’ont fait faire quoi ?
— Piscine et vélo d’appart. Ils m’ont pris pour une mémé qui veut maigrir ! Je ne vais jamais récupérer avec ça !
— Patience, Jérém, patience !
Le lendemain, le moral de Jérém est toujours en berne.
— Regarde tous ces mecs en fauteuil roulant, en béquilles, avec des attèles, des pansements, il me lance, alors que nous prenons un café dans la salle commune. Il y a beaucoup de sportifs, et certains y sont depuis des mois. Ils triment du matin au soir, et beaucoup d’entre eux n’y arrivent pas, ils n’y arriveront jamais !
— Toi, tu y arriveras.
— Je ne veux pas rester ici des mois, il continue, sans prêter cas à mes mots. Cet endroit, c’est une putain de casse de luxe pour sportifs abimés. Cet endroit me fiche les boules !
— Pour quelques-uns qui n’y arrivent pas, tant d’autres y arrivent ! Autrement, la renommée de cet endroit ne s’expliquerait pas !
— J’ai entendu un mec qui disait que les clubs nous garent ici en attendant la fin de notre contrat.
La morosité et le pessimisme de Jérém perdurent pendant de longs jours. Ce n’est qu’au bout de presque deux semaines de rééducation que les choses semblent prendre un nouveau pli. Le jeune ailier semble prendre confiance dans le programme de rééducation, et il semble enfin voir des progrès.
J’ai même l’impression qu’il commencerait à reprendre espoir, même s’il s’en défend. Mais je sais désormais interpréter son attitude, sa communication non verbale. Et son regard. Et dans ce dernier, je revois enfin cette étincelle, cette flamme qui m’emplit de joie. Je vois dans ses yeux que, même s’il prétend le contraire, il a recommencé à y croire. Je n’ai pas oublié les mots du chirurgien rencontré dans le train, et je me rends compte à quel point ils étaient justes.
Oui, le moral de Jérém semble s’améliorer. Mais une visite surprise va le remettre sérieusement en pétard.
Mardi 22 avril 2003.
Le lendemain du week-end de Pâques, je me pointe au Centre sur le coup de midi, comme d’habitude. Lorsque Jérém débarque avec ses béquilles, je vois son regard s’assombrir en une fraction de seconde et devenir si noir que le ciel avant un orage violent.
Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que j’ai fait, encore ? Qu’est-ce que je vais prendre, encore ?
— P’tit Loup, je tente de l’amadouer.
— Qu’est-ce que tu fiches ici ? je l’entends rugir, la voix chargée de colère et d’agressivité, le regard ailleurs.
— Mais Jérém, qu’est-ce que…
— Pas toi, elle ! il me coupe sèchement.
C’est là que je remarque une dame assise dans un coin, à l’écart. Elle doit avoir une quarantaine d’années, elle est brune, et assez élégante. Jérém la regarde fixement et la fusille du regard.
— Jérémie, mon chéri. Je voulais savoir comment tu allais. Tu ne réponds pas à mes coups de fil.
— Si je ne réponds pas, c’est parce que je n’ai pas envie de te parler, et encore moins de te voir.
— J’ai le droit d’avoir envie de savoir comment va mon fils, non ?
Ah, voilà une bonne surprise. « Belle-mère » est là. Pas sûr que la réunion familiale sera pour bientôt.
— Ah, tu te souviens que tu as des fils que quand ils sont à l’hôpital !
— Jérémie, mon chéri…
— Arrête de m’appeler « mon chéri », ça fait dix ans que je ne le suis plus. Et ça fait dix ans que tu n’es plus ma mère ! Maintenant fiche le camp, je ne veux plus te revoir ici.
Jérém fait demi-tour et disparaît dans l’ascenseur.
Je regarde cette femme. Elle a l’air défaite. Jérém n’y est pas allé de main morte. Je connais l’animosité qu’il garde en lui vis-à-vis du fait que sa mère l’a abandonné pour refaire sa vie, mais je trouve qu’il a été très dur.
— Ça va, Madame ? je lui demande.
— Pas vraiment.
— Il n’est pas bien en ce moment.
— Je sais. Mais dites, vous connaissez Jérémie ?
— Oui, on était au lycée ensemble. Et on est restés potes depuis. Je m’appelle Nicolas.
— Et tu es venu lui rendre visite ?
— En fait, j’ai un appart pas loin, et je viens le voir de temps en temps.
— Je peux vous demander comment il va ?
— Il a eu beaucoup de mal après son accident. Là, depuis quelques jours, ça semble aller mieux. Les réparations au genou et à la cheville semblent bien évoluer et la rééducation commence à porter les premiers fruits.
— Je suis soulagée. Désolée que vous ayez dû assister à cette dispute.
— C’est rien.
— Vous savez, c’est compliqué entre mon garçon et moi.
— Je sais…
— Il vous a parlé de moi ?
— Oui, je sais que vous avez divorcé de son papa quand il était ado.
— Je sais que j’ai fait beaucoup de mal à mes garçons, et Jérémie en a souffert plus que son frère.
— Vous aviez certainement vos raisons.
— Je n’aimais plus leur père, et j’ai suivi l’homme que j’aimais. Et la vie m’a amenée sur d’autres chemins. Je me suis installée à l’autre bout de la France, j’ai monté une entreprise avec mon nouveau compagnon, et je suis très vite retombée enceinte. J’ai deux autres enfants, une fille de 9 ans et un garçon de 8. Mon choix peut paraître égoïste, mais je n’ai pas pu faire autrement. Je ne pouvais pas m’occuper de deux familles. Mais je n’ai jamais cessé de penser à Jérémie et à Maxime. Jamais. J’ai essayé de reprendre contact à plusieurs reprises, mais j’ai toujours rencontré l’hostilité de leur père, et la leur aussi. Avec Maxime, j’ai enfin pu rétablir un contact il y a quelques mois. Pas avec Jérémie. Ça me fend le cœur que Jérémie me déteste à ce point, elle s’exclame tristement.
— Il a énormément souffert parce que vous lui avez énormément manqué.
— Je sais. Mais dis-moi, quel genre de garçon est aujourd’hui, Jérémie ? Je veux dire… avant l’accident.
— Avant l’accident, ça faisait un moment que je ne l’avais pas vu. Il était très pris par le rugby et…
— Mais depuis qu’il joue dans des grandes équipes, il a l’air épanoui, non ? elle me coupe.
— Il l’est, oui. L’année dernière il a galéré, mais depuis qu’il est au Stade, ça lui réussit vraiment bien. Et ça lui apporte beaucoup de satisfaction.
— Et au-delà du rugby ? Est-ce qu’il est heureux ? Ou du moins serein ?
— Je pense qu’il l’est, oui. Mais Jérém est un garçon qui n’aime pas montrer qu’il ne va pas bien. Quand c’est le cas, il se renferme et il envoie tout valser, y compris ses potes.
— Il a toujours été comme ça, mon Jimmy, même quand il était petit. Quand on le grondait, il se cachait et on avait beau l’appeler, il n’y avait plus personne. Il ne revenait que quand il avait faim !
— Jérém est un garçon qui aime bien se montrer fort. Mais quand on le connaît un peu mieux, on s’aperçoit que sous la carapace qu’il s’est construite se cache un garçon sensible, à fleur de peau, un garçon touchant.
— Vous avez l’air de bien le connaître…
— Vous pouvez me tutoyer, Madame.
— Et toi aussi, et tu peux aussi m’appeler Alice au lieu de Madame !
— D’accord !
— Il a de la chance d’avoir un copain comme toi…
— Je ne sais pas, si vous le dites.
— Tu l’aimes, ça se voit.
— Oui, beaucoup.
— Allez, trêve de cachotteries ! Je sais qui tu es pour Jérémie, Nicolas. Maxime m’en a parlé.
— Ah… vous savez tout, alors.
— Oui, et je suis heureuse qu’il soit avec un garçon comme toi. Maxime m’a dit le plus grand bien de toi. Et je vois qu’il ne s’est pas trompé. Tu es ici pour le soutenir, tu ne laisses pas tomber. Tu es un bon garçon, Nicolas.
— Je fais ce que je peux…
— Je sais que je ne pourrais jamais rattraper les années que je lui ai volées, la souffrance que je lui ai infligée, elle enchaîne. Je voudrais juste pouvoir lui parler pendant quelques minutes sans qu’il me hurle dessus. Je voudrais lui demander pardon, et essayer de lui expliquer ma version des faits. Je voudrais lui faire comprendre que je n’ai jamais cessé de penser à lui et de l’aimer, quoique son père en dise. Mais je crois qu’il n’est toujours pas prêt et je commence à croire qu’il ne le sera jamais. J’ai fait le voyage pour rien. Enfin, non. J’ai pu rencontrer le garçon qui rend mon fils heureux. Et ça, ça me fait vraiment plaisir.
— Vous partez quand, Alice ?
— Maintenant. Je n’ai plus rien à faire ici.
— Vous pouvez attendre jusqu’à demain ?
— Pourquoi attendre ?
— Laissez-moi parler à Jérém ce soir.
Nous nous échangeons nos numéros de portable.
— Bien entendu, je ne vous promets rien. Mais je vais essayer de le raisonner.
— Ne mets surtout pas votre relation en danger à cause de moi.
— Je vais faire attention, promis.
— Je vais chercher une chambre pour cette nuit, alors.
— Je vous appelle ce soir.
Je ne suis pas sûr de pouvoir convaincre Jérém de faire un pas vers sa mère. Mais je sais que je m’en voudrais de ne pas essayer.
Je retourne au Centre en fin d’après-midi, comme d’habitude. J’attends jusqu’à 19 heures mais Jérém ne vient pas dans la salle commune. Je l’appelle sur son portable, il ne répond pas. Je demande à l’accueil, je m’entends dire qu’il doit être en train de dîner. J’insiste pour qu’on aille le prévenir que je voudrais le voir. Quelques minutes plus tard, on me répond qu’il n’est pas dans la salle de repas, et qu’il doit être monté dans sa chambre. Je m’y rends illico. Je tape à la porte. Le battant s’ouvre dans la seconde, et Jérém n’a pas du tout l’air surpris de me voir débarquer, comme s’il m’attendait. Il ne parle pas, il a le regard perdu.
— Je t’attendais en bas…
— Je suis monté de suite après la fin de la séance de kiné.
— T’as pas mangé ?
— J’avais pas faim.
— Tu ne devrais pas sauter de repas…
— Elle est partie ? il me coupe sèchement.
— Elle a dit qu’elle prenait une chambre pour cette nuit. Elle repartira demain.
— Bon débarras !
— Tu as été très dur avec elle.
— Elle le mérite !
— Tu ne penses pas que tu devrais lui laisser une chance de s’expliquer ?
— Certainement pas !
— Tu savais que Maxime s’était un peu rapproché d’elle ?
— Oui, mais ça le regarde. Moi, je ne peux pas.
— Tu ne voudrais pas entendre ce qu’elle a à te dire ?
— Ça m’intéresse pas ce que cette conasse a à me dire !!! il rugit. Je n’en ai rien à faire d’elle !!!
Son visage est parcouru par une expression de colère et de souffrance qui me peine énormément.
— Si vraiment tu n’en avais rien à faire, tu ne te mettrais pas dans cet état à cause d’elle !
— Fiche-moi la paix, toi aussi !
— Mais regarde dans quel état te met cette rancœur. Ça fait dix ans que cette colère est en toi, dix ans qu’elle te bouffe et qu’elle te rend malheureux.
— Ça, c’est mon problème.
— Au moins, tu admets que c’est un problème ! Et tu veux garder ce « problème » en toi encore combien de temps ? Tu ne crois pas qu’il a fait assez de dégâts ? Tu ne crois pas que t’as d’autres fardeaux à porter en ce moment, et que tu as besoin de toute ton énergie pour récupérer plutôt que pour être en colère ? Tu ne crois pas que pardonner te demandera moins d’énergie que de haïr ?
— Je n’y arrive pas. Dès que je la vois, tout remonte, et… et… et… je n’y arrive pas… je n’y arrive pas !
— Elle a fait mille bornes pour venir te voir. Elle a fait un beau geste, et elle l’a fait pour toi. Tu ne crois pas que ce serait l’occasion de mettre tout ça à plat et de te débarrasser une fois pour toutes de ce « problème » ?
— Si j’accepte de lui parler, elle va encore m’embobiner. Papa a toujours dit qu’elle était très douée pour embobiner les gens !
— Depuis quand tu accordes de l’importance à ce que dit ton père ? Ton père a été quitté pour un autre, il n’est sans doute pas très objectif sur le sujet !
Jérém se tait, l’air pensif, troublé.
— Ecoute-la, et fais-toi ton idée ! Laisse-la parler, tu la pourriras après si tu veux. Mais si tu la pourris d’entrée, si tu refuses de l’écouter, tu ne sauras jamais ce qu’elle a à dire.
— Je préfère autant qu’elle se tire et qu’elle ne revienne jamais.
Je rentre à l’appart lessivé et déçu. Au fond de moi, j’avais cru pendant un moment avoir réussi à trouver les mots pour convaincre Jérém de laisser une chance à sa mère. J’ai foiré. J’appelle Alice et je lui fais part du refus de son fils de lui parler.
— C’est pas grave. Je m’attendais à ça. Je te remercie d’avoir essayé, Nicolas. Je suis heureuse de t’avoir rencontré. Prends toujours soin de mon Jimmy comme tu l’as fait jusque-là, et donne-moi quelques nouvelles de temps en temps.
— Avec plaisir, Alice.
Cette nuit, je ne dors pas beaucoup. J’ai le cœur lourd. Je sais que ça ferait beaucoup de bien à Jérém de se débarrasser de cette haine ancienne. Je voudrais trouver le moyen pour le lui faire admettre. La venue de sa mère était une occasion en or, une occasion qui ne se reproduira peut-être plus jamais Et je ressens une impression de gâchis monumental.
Mercredi 23 avril 2003.
Le lendemain matin, je ne me réveille pas vraiment en forme. Je n’ai pas assez dormi. Et j’ai toujours le cœur aussi lourd que la veille. Il est 8h45. Je me dis qu’à cette heure, Alice doit déjà avoir pris la route.
Je passe la matinée à parcourir les photocopies des notes de cours que Monica m’a gentiment envoyées par la Poste. A midi, je me pointe comme chaque jour au Centre. J’attends de longues minutes, et mon bobrun ne vient pas. Je retourne à l’accueil. Je m’entends dire que Mr Tommasi a eu une permission de sortie pour ce midi et qu’il devrait rentrer avant 15 heures, pour sa séance de kiné.
Pourquoi a-t-il eu une permission de sortie ? Où est-il allé ? Il est déjà 13 heures. Depuis le temps, j’ai appris à mettre à profit les longues heures d’attente en faisant suivre mes cours dans mon sac de la fac.
En attendant que Jérém revienne, je révise.
Il manque une poignée de minutes avant 15 heures lorsque la porte vitrée automatique du hall d’entrée s’ouvre pour laisser rentrer le bobrun aux béquilles. Lui, mais pas lui tout seul. Il est accompagné. Alice se tient à côté de lui. Elle sourit, et Jérém a l’air tellement plus détendu qu’hier soir !
— Nicolas ! me salue la maman de Jérém, dès qu’elle me capte.
— Bonjour Alice. Salut Jérém.
— Je fais pas les présentations… lance Jérém, un brin moqueur.
— Non, on s’est débrouillés pour ça, je lui relance.
— Je n’ai pas du tout envie de partir, mais il faut que je prenne la route. Le travail m’appelle, fait Alice.
— Et tes gosses aussi !
— Oui, eux aussi. J’aimerais que tu viennes les rencontrer un jour. Ce sont tes demi-frères et sœurs.
— Je ne sais pas si je suis prêt pour ça.
— Si un jour tu l’es, tu seras toujours le bienvenu. Tous les deux, vous serez les bienvenus ! Jimmy, tu m’as fait un cadeau qui a une valeur inestimable pour moi.
— Ce n’était qu’un resto…
— Tu sais très bien de quoi je parle, petit filou ! Merci de m’avoir écoutée. Ça m’a fait un bien fou, tu peux pas savoir !
— A moi aussi !
— Viens-là, Jérémie ! fait Alice, débordée par l’émotion. Quel beau garçon tu es devenu ! Tu es un homme à présent ! Je suis tellement fière de ce que tu es devenu !
Alice est en larmes. Jérém a lui aussi l’air très ému, et je sens qu’il est en train de fournir un effort inouï pour retenir ses sanglots.
— Nicolas, encore une fois, très heureuse d’avoir fait ta connaissance. Et merci pour tout ce que tu fais pour mon garçon !
— Très heureux aussi. C’est un plaisir d’être là pour Jérém ! Je ne pourrais pas m’en dispenser !
— A bientôt, les garçons, elle nous lance, juste avant de passer la porte vitrée automatique du Centre.
Sa silhouette vient tout juste de disparaître dans le parking et Jérém est en larmes. Je le prends dans mes bras et je le serre très fort contre moi.
Je retourne voir Jérém le soir même. Il a l’air heureux. Sa séance de kiné s’est très bien passée. Après l’explication avec sa maman, son cœur est plus léger. Ce soir, il est de fort bonne humeur. Il me demande de monter dans sa chambre et de passer la nuit avec lui.
— Mais c’est pas interdit ?
— Si, mais je m’en bats les couilles !
Nous nous allongeons sur le lit l’un à côté de l’autre.
— Elle sait pour nous ! il me glisse.
— Oui, et elle l’a très bien pris.
— Je n’aurais pas cru.
— Tu es content de l’avoir écoutée ?
— Oui.
— Ça t’a fait du bien ?
— Je crois, oui.
Jérém vient se blottir contre moi.
— Merci Nico, tu es mon ange gardien ! je l’entends me souffler.
— Je t’aime, Jérémie Tommasi !
Cette nuit nous partageons des baisers, des caresses, beaucoup de tendresse. Je ne lui demande pas plus, je n’ai besoin de rien de plus. Je ne sais pas où il en est avec ses problèmes de libido, mais on affrontera cela le moment venu.
Jeudi 24 avril 2003.
Après une nuit passée clandestinement dans la chambre de Jérém au Centre, je rase les murs pour m’évader au petit matin sans être remarqué. Cette clandestinité est marrante, elle a un petit goût de transgression, de secret et de complicité qui me plaît beaucoup.
J’ai adoré passer la nuit avec Jérém. Et j’ai adoré les caresses et les baisers du matin. Et son sourire. Et son :
— Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Nico.
Le lendemain de cette nuit passée avec Jérém et de cette journée qui a marqué la réconciliation entre ce dernier et sa maman, le CD d’American life, l’album, fait son apparition dans les rayons du supermarché où je fais les courses. Évidemment, il tombe tout seul dans mon caddie. A partir de cet instant, mon impatience d’écouter ces nouvelles chansons devient chaque instant plus insupportable.
De retour à l’appart, je baisse les stores, je m’allonge sur le lit, j’éteins mon téléphone. J’insère la galette dans mon vieux poste, je mets mon casque. Avant de lancer la lecture, je feuillette le livret. Très graphique, très stylé.
Je le remets dans le boîtier, je pose le tout à côté de moi. Je résiste encore quelques instants à mon impatience de lancer la lecture. Je sais que cette impatience, que cet instant d’avant, sont le sel du bonheur. A une époque où la musique était « rare » car liée à un support physique, une sortie discographique de son artiste préféré était un événement.
Je lance enfin la lecture.
Do I have to change my name
L’album s’ouvre avec le single qui circule en radio depuis deux semaines (à cette époque, les radios mainstream passent encore du Madonna). Je ferme les yeux, et je me laisse approcher, pénétrer, enivrer par cette première écoute de l’enregistrement complet, en qualité CD. Je découvre les autres titres un à un. Je les savoure en essayant de me concentrer totalement sur la magie de cette première écoute, de cette première fois. Je sais que les écoutes suivantes n’auront plus cette magie, celle de la découverte. Certes, une autre magie prendra le relais, plus durable, celle des souvenirs qui vont s’accrocher à ces mélodies, à ces rythmes, à ces paroles, à cette voix.
Mais la magie de la première écoute est éphémère. Et c’est en cela qui réside toute sa beauté. Cette première écoute, c’est comme le premier baiser qu’on donne à un garçon qu’on aime, elle est unique. Les autres seront forcément différentes.
Après « American life », que je redécouvre en l’écoutant dans le casque, je retrouve « Die Another Day », souvenir d’une escapade à Paris commencée dans le bonheur et terminée dans la crainte que Jérém puisse être attiré par Ulysse. Crainte par ailleurs bien avérée par la suite.
Je suis touché par « Hollywood », « Nobody Knows me » et « Nothing fails ». Et bouleversé par la douceur et la puissance d’« Easy Ride ».
Ce soir encore, Jérém m’infiltre dans sa piaule. Nous nous embrassons, nous nous câlinons, comme deux adolescents. Jérém ne montre aucun désir d’aller plus loin, toujours pas. C’est à la fois frustrant et délicieusement excitant que cet échange de tendresse qui ne franchit pas la barrière de la sensualité.
La discussion prend la place du sexe. Jérém me parle longuement de son repas avec sa mère, et de son regret de ne pas lui avoir permis de s’expliquer plus tôt. Il dit se sentir soulagé d’un poids immense.
Nous parlons de plein de sujets. Je trouve même le moyen de le questionner sur cette histoire racontée dans la presse people au sujet de sa relation avec Alexia.
— Je suis étonné que tu ne m’aies pas posé la question plus tôt…
— T’as vu comment t’étais dans une humeur de chien jusqu’à il n’y a pas longtemps ? Je n’avais pas envie de me faire jeter encore !
— C’est pas faux ! J’ai été insupportable, hein ?
— Euhhh… je feins de réfléchir, avant d’asséner avec conviction : OUAIS !
— Cette histoire a été inventée de toute pièce pour me protéger.
— Mais te protéger de quoi ?
— Les derniers mois, je suis un peu sorti à Paris…
— Dans des boîtes gay ?
— Oui… et on m’a reconnu. Des bruits commençaient à circuler. Alors mon agent a eu cette idée.
— T’as couché avec cette meuf ?
— Mais jamais de la vie ! Cette meuf me rebute, elle est conne comme un manche à balais !
— Et Ulysse ?
— Quoi, Ulysse ?
— Tu en es où avec lui ?
— Nulle part.
— Il s’est passé quelque chose entre lui et toi ?
— Non, jamais. Et il ne se passera jamais rien. Ulysse n’est pas comme nous.
Au fond de moi, je suis un peu déçu qu’il n’ait pas cité la raison qui devrait le tenir à elle seule à bonne distance du beau blond. La raison dont j’aimerais être le sujet.
— Il n’a pas voulu, il précise.
— Tu lui as fait des propositions ? j’accuse la surprise.
— Je ne veux rien te cacher, Nico…
— J’apprécie.
— J’ai craqué un soir où j’avais trop bu.
— Et comment il a réagi ?
— Bien. Il m’a juste dit que les gars ce n’était pas son truc. Il a été super cool, mais ça m’a mis un putain de malaise ! Pendant des semaines j’ai eu beaucoup de mal avec ça, et même encore maintenant.
— C’était quoi alors, qui t’attirait vers lui ?
— J’étais impressionné par ce gars, et je le suis toujours. Il a une prestance, il dégage un tel charme…
— Ça va, ça va, je sais, je l’ai revu quand tu étais à l’hôpital à Paris, je le coupe.
— Mais surtout, il continue, Ulysse est un véritable ami, quelqu’un qui arrive à tirer le meilleur de moi, quelqu’un qui m’encourage, et qui me soutient à chaque fois où j’en ai besoin. Ulysse est quelqu’un qui me grandit…
— Et il marche sur l’eau ? je plaisante.
— Même si c’était le cas, ça ne changerait rien.
— Tu parles du fait qu’il est hétéro ?
— Non, je parle du fait que je ne suis pas amoureux de lui. Et que quand je suis seul, quand je ne vais pas bien, c’est à quelqu’un d’autre que je pense.
— Alexia ? je le cherche.
— Oui, exact !
— Petit con, va !
— Je ne sais pas comment tu t’es débrouillé, mais tu as volé un morceau de mon cœur.
Ah, la voilà la raison que j’attendais ! Il a fallu être patient pour l’entendre enfin ! Et comment ils me touchent, ces mots de mon bobrun !
— Je suis vraiment désolé de t’avoir planté avant Noël, et de t’avoir dit ce que je t’ai dit. Comme quoi tu n’étais pas un homme…
— C’est oublié, Jérém. L’important c’est que tu retrouves ta forme et que nous soyons ensemble.
— Je ne te laisserai plus jamais partir.
— Je n’ai pas l’intention de le faire.
— Nico, tu es un sacré bonhomme. Ton propriétaire a raison, un homme c’est un mec qui sait s’occuper de ceux qui comptent pour lui. Je sais que je compte pour toi, et je vois comment tu t’occupes de moi. Tu as des couilles, Nico, pour me supporter comme tu le fais.
C’est l’un des plus beaux compliments que l’on ne m’a jamais fait de ma vie. Et ça vient de Jérém. Je suis tellement heureux !
Tant que nous sommes lancés dans les confidences, j’en profite pour lui poser une autre question qui me brûle les lèvres depuis des mois.
— Le soir du Nouvel An, tu as essayé de m’appeler…
— Oui…
— Tu t’étais trompé ou tu avais regretté de l’avoir fait ?
— Ce soir-là, tu me manquais trop. Mais quand je suis tombé sur ton répondeur, je me suis dit que tu m’avais oublié, et que tu étais retourné avec ce gars de Bordeaux.
— C’est pour ça que tu n’as pas répondu à mes rappels et à mes messages ?
— Je me suis dit que je devais arrêter de foutre ta vie en l’air.
— J’aurais tellement aimé que tu répondes et que tu me dises que je te manquais.
— Et tu aurais fait quoi ? On était loin l’un de l’autre et…
— Je pense que je serais venu te rejoindre sur le champ !
— Mais tu n’étais pas avec ce gars ?
— Si, j’étais avec lui. Mais je n’ai pas arrêté de penser à toi pendant toute la soirée, et au réveillon à Campan de l’année dernière.
— Moi aussi je n’ai pas arrêté de penser à toi et au réveillon à Campan de l’année dernière !
— Quel gâchis ! je commente.
— C’est clair !
— Et tu en es où avec ce gars ?
— Je suis là, avec toi, Jérém. Je l’ai quitté quand je lui ai dit que je partais à Paris pour être avec toi après ton accident.
— Tu étais amoureux de ce gars ?
— Non. Quand j’étais avec lui, j’arrivais parfois à me cacher à quel point j’avais mal d’être séparé de toi. Être avec lui c’était une sorte de répit. Mais je n’ai jamais arrêté de penser à toi, jamais !
— Je te demande pardon aussi pour ce que je t’ai dit à l’hôpital à Paris. C’est pas vrai que je ne t’ai jamais aimé. Je ne le pensais pas, j’étais juste en colère.
Ce n’est pas un « je t’aime » franc, mais ne dit-on pas que le résultat d’une double négation est une affirmation ? Et même cette double négation me va droit au cœur.
— Je sais, je sais. Je t’aime aussi, Jérémie Tommasi !
Cette nuit encore, nous partageons beaucoup de tendresse, mais toujours pas de sensualité. Jérém semble réfractaire à toute caresse érotique. Lorsque j’essaie de passer mes mains sous son t-shirt, ou de caresser ses tétons par-dessus le coton, il trouve toujours un prétexte – l’envie d’une cigarette, une crampe, le besoin d’aller au petit coin, un cachet à avaler – pour s’éloigner.
Jérém n’est pas en demande de sexe. Je suis frustré, mais pas inquiet. Je ne suis plus inquiet. Je ne le suis plus depuis que j’en ai parlé avec Thibault.
— J’ai vécu la même chose quand j’ai eu mon accident il y a deux ans. Panne de libido totale. Je bandais plus. Mon médecin m’a dit que c’était courant après un traumatisme. Un traumatisme entraîne de la fatigue, la peur pour l’avenir, la déprime. Et les médocs n’arrangent rien non plus de ce côté-là. Il ne faut surtout pas lui mettre la pression, car il doit déjà bien se la mettre tout seul. Il faut juste lui laisser du temps, et ça va finir par s’arranger.
Je pense chaque jour aux mots de Thibault, et surtout à la nécessité de ne pas brusquer les choses. J’attends patiemment que le « bon moment » arrive.
Vendredi 25 avril 2003.
Ce matin, je me suis fait gauler en train de quitter la chambre de Jérém par l’une des infirmières de nuit, une nana plutôt sympa qui répond au prénom de Laetitia. Après m’avoir fait un petit rappel des uses et coutumes du Centre, elle conclut :
Tu peux dormir là quand je suis de garde. Tu te pointes discretos après 22 heures, et tu te tires tout aussi discretos avant 7 heures, avant le changement d’équipe et avant l’arrivée des médecins « lève tôt ». Il te suffit de regarder le planning.
Cette main tendue me met du baume au cœur.
Ce soir-là, Laetitia est à nouveau de garde.
Ce soir-là, alors que je reviens de la salle de bain après m’être brossé les dents, je trouve Jérém allongé sur le lit, devant la télé, en boxer. Son beau torse délicieusement poilu, ses pecs saillants et ses tétons, ainsi que la bosse saillante qui remplit la poche de son boxer aimantent mon regard et mon désir. Devant cette attitude, devant le regard qu’il me lance et dans lequel il me semble retrouver une petite étincelle lubrique, je me dis que le « bon moment » est enfin arrivé.
Ce désir que je vois dans son regard embrase instantanément le mien. J’ai envie de lui donner du plaisir. J’ai envie de le prendre en bouche et de le rendre dingue.
Je m’approche de lui, je me glisse entre ses cuisses. Je m’allonge sur lui, je le caresse, je l’embrasse, j’excite ses tétons. J’ai l’impression qu’il est un brin tendu, mais il se laisse faire. Rapidement, j’envoie ma bouche parcourir les reliefs saillants de son beau torse. Je plonge mon nez, ma bouche, mon visage entre ses pecs, entre ses poils. J’atterris sur ses abdos. Je m’enivre de la douceur intensément érotique des petits poils qui dessinent cette ligne droite qui descend de son nombril, s’abime derrière l’élastique de son boxer, et entraîne mon regard et mon désir tout droit vers sa virilité. Les petites odeurs de propre, de gel douche et de petit mec qui émanent de son boxer me rendent dingue.
Je laisse mes lèvres parcourir le tissu fin de son boxer, impatient de trouver sa queue raide emprisonnée par le coton.
Mais il n’en est rien, Jérém ne bande pas.
Je ne me décourage point. Je descends le boxer, je la retrouve enfin, après tant de mois. Belle, même au repos. J’approche mon nez de ses couilles, ça sent délicieusement bon.
Je la prends en bouche, et pendant un bon petit moment, je m’affaire avec entrain pour la réveiller. Mais rien ne se passe. Je tente le tout pour tout, je lèche ses couilles, je pousse jusqu’à sa rondelle, je la titille longuement avec ma langue. Je suis confiant, je sais que ça, ça l’a toujours rendu dingue.
Mais ma confiance est douchée au fil des minutes. Je n’arrive à obtenir aucune réaction. Jérém ne bande toujours pas.
— Laisse tomber, Nico.
Mais je ne l’écoute pas. Je redouble l’intensité de mes caresses, j’agace ses tétons, j’envoie ma langue s’occuper de son gland à bloc.
— Arrête, je ne vais pas y arriver, il me balance plus sèchement, et s’écartant de moi.
— On fera ça une autre fois, je tente de relativiser.
— Peut-être que ça aussi, c’est fini pour moi ! il fait, amer, en s’allumant une cigarette déjà à moitié fumée.
— Ne dis pas n’importe quoi ! Après tout ce qui t’est arrivé, c’est normal d’avoir des séquelles pendant quelque temps. J’ai entendu dire que ce genre de chose arrive après un traumatisme… Mais tout va finir par s’arranger, j’en suis certain !
Je voudrais lui dire que Thibault en est passé par là, et que tout s’est arrangé. Mais je ne veux pas prendre le risque qu’il prenne mal le fait que j’ai parlé à son pote de ses problèmes.
Mais mes mots ne semblent pas l’apaiser. Jérém fume sa cigarette lentement, en silence. Il a l’air frustré et déçu.
— Rien ne presse, Jérém, vraiment. Je n’aurais pas dû te proposer ça ce soir, c’est certainement trop tôt…
— Mais j’en avais envie, putain ! il s’exclame, sur un ton dépité. Mais ma queue ne marche plus.
— Quand tu iras mieux, tout s’arrangera, tu verras. Pour l’instant, concentre-toi sur ta rééducation.
— Tu vas pas m’aimer longtemps avec la queue en panne…
— Je t’aime comme tu es, Jérémie Tommasi !
Jérém revient au lit et s’allonge, tourné sur le flanc. Ce soir, je n’ai pas droit à d’autres bisous. Je m’approche de lui, je le prends dans mes bras et je le serre très fort contre moi.
Samedi 26 avril 2003, midi.
A la sortie de ses séances de ce matin, Jérém a à nouveau l’air détendu et de bonne humeur. Visiblement, la rééducation se passe de mieux en mieux. Mais j’ai l’impression qu’il y a autre chose. Je pense que le fait d’avoir mis des mots sur ses problèmes d’érection, et d’avoir senti que je le soutiens dans cette épreuve aussi, ça lui a fait du bien.
Les choses ont l’air de prendre un pli positif et je m’en réjouis. Je suis tellement heureux que je dois me faire violence pour ne pas l’embrasser là, sur le champ, dans la salle commune, alors que plusieurs personnes nous entourent.
Je rentre à la maison, j’écoute deux fois le CD d’American life. J’aime vraiment beaucoup. Je l’aime d’autant plus que ses chansons sont en train de se lier à des sensations d’espoir vis-à-vis de l’état de Jérém, ainsi qu’à des souvenirs pleins de tendresse vis-à-vis de notre amour.
Dimanche 27 avril 2003, 16h49.
C’est là, juste au moment où l’horizon semble se dégager, qu’un nouveau désastre survient.
Ce soir-là, pile au moment où je m’apprête à quitter mon appart pour aller retrouver Jérém après ses exercices de l’après-midi, mon portable se met à sonner. Lorsque je regarde l’écran et que je vois s’afficher le numéro du Centre, je ressens une profonde inquiétude s’emparer de moi. C’est la première fois que ça arrive. Au fond de moi, je sais immédiatement que ça ne sent pas bon.
Je décroche, assommé par un très mauvais pressentiment.
L’infirmière que j’ai à l’autre fil m’annonce que suite à un accident, Mr Tommasi est en train de passer des examens. Je suis à présent mort d’inquiétude et d’angoisse. J’essaie d’en savoir plus, mais l’infirmière ne peut pas m’aider et me renvoie vers le médecin en charge du patient.
Je quitte l’appart et je trace sur la plage comme un fou.
— Mr Tommasi était sur le tapis, il faisait de la petite course, et à un moment il a accusé de très fortes douleurs au niveau de la cheville, m’explique le praticien.
— Mais qu’est-ce qui s’est passé ?
— Les examens sont formels. Il a été victime d’une rupture itérative du tendon d’Achille.
— C’est quoi rupture itérative ?
— En gros, la réparation n’a pas tenu, et il a cassé à nouveau…
— OH, NON !!! je me désole.
J’ai l’impression de chuter du haut d’un immeuble de 100 étages. Le ciel qui semblait se dégager, me tombe sur la tête.
— Ces derniers jours je le voyais plus optimiste et impliqué. Mais aussi plus impatient. Je lui ai dit de ne pas trop forcer, je lui ai dit que le tendon était encore fragile. Mais il n’y a pas eu moyen.
C’est horrible. Cette catastrophe arrive justement au moment où Jérém recommençait à reprendre confiance, à se faire confiance. Il doit être encore plus mal qu’après le premier accident. Là, c’est retour à la case départ. Quel dommage, alors qu’il était si heureux de progresser ! Jérém doit à nouveau être à ramasser à la petite cuillère. Comment vais-je faire, maintenant, pour lui redonner espoir ?
— Et quelle va être la suite ? je veux savoir.
— Une nouvelle opération est nécessaire.
Je m’en doutais, mais j’avais espéré une solution magique. Et le fait d’entendre le médecin doucher mon illusion me plonge dans une tristesse infinie.
— Vous pensez l’opérer quand ?
— Je ne pourrais pas l’opérer…
— Comment ça ? je tombe des nues.
— La première intervention n’a pas été réalisée ici. Et nous ne pouvons pas prendre le risque d’aller à l’encontre de complications qui pourraient découler d’une opération précédente que nous n’avons pas effectuée. Si jamais ça se passe mal, les assurances ne nous couvriraient pas.
— Mais on s’en fout des assurances ! Je m’emporte.
— Non, on ne s’en fout pas. Cette deuxième opération est très risquée, plus que la première. Le résultat est incertain. Si on se rate sur un sportif de cette valeur, le club va nous tomber dessus avec ses avocats.
En entendant le chirurgien parler d’assurances, d’avocats, de « sportif de cette valeur », ça me donne envie de gerber.
— Mais putain, quand je vous écoute parler, j’ai l’impression de vous entendre discuter d’une putain de bagnole accidentée et non pas d’un garçon blessé qu’il faut soigner au mieux.
— Je sais, c’est triste. Mais j’ai des comptes à rendre, et il en va de la réputation du Centre.
— Et qui va l’opérer, alors ?
— Le chirurgien parisien qui a effectué la première opération, j’imagine. Nous sommes en train d’organiser le rapatriement à Paris en urgence. Il faut l’opérer au plus vite si on veut avoir une chance que ça marche.
— Et quelles sont les chances que cette nouvelle opération marche ?
— Je ne peux pas me prononcer officiellement. Mais, entre nous, elles sont très minces.
Ce que je viens d’entendre me déchire les tripes, c’est un coup de massue qui m’assomme. Le staff du Stade a été averti du nouvel accident de Jérém. Mais, en attendant de pouvoir aller le voir, la triste tâche de l’annoncer aux proches m’incombe.
J’appelle Maxime, Thibault, Ulysse, Papa. Ils sont tous tout autant dépités que moi.
En début de soirée, je peux enfin voir Jérém. Il est allongé sur le lit, le regard perdu. Il a l’air complétement défait. J’appréhende son humeur, son état d’esprit. Je sais qu’après ce nouvel accident il a reperdu tout espoir. Et je sais qu’il a besoin d’en retrouver au plus vite. Mais je sais aussi qu’essayer de lui redonner espoir sans me faire jeter, ça va être un sacré numéro d’équilibriste.
— Salut, je lui lance timidement.
— Salut, il me répond machinalement, sans presque me regarder.
Le ton de sa voix est bas, froid, dépourvu de toute émotion. Jérém a l’air vidé, éteint. J’hésite, je cherche les bons mots à utiliser pour savoir comment il va, sans pour autant lui donner l’occasion de me balancer l’évidence à la figure et de me faire jeter. Mais je n’ai pas besoin de chercher bien longtemps.
— Je suis foutu, cette fois-ci je suis vraiment foutu ! il me balance, en larmes.
— Ne dis pas ça. Ils vont t’opérer à nouveau, et cette fois-ci, ça va marcher, je tente de lui apporter du positif, tout en m’approchant pour le prendre dans mes bras.
Mais je sens qu’il n’est pas d’humeur. Je le sens à fleur de peau, et j’ai peur qu’il me jette au premier contact.
— Je ne me ferai pas charcuter à nouveau ! il rugit.
— Et tu vas faire comment pour récupérer ?
— Je vais rester comme ça.
— Mais tu seras diminué, et tu ne pourras plus jouer.
— Le rugby c’est fini pour moi. De toute façon, je l’ai su au moment même où le mec m’a percuté pendant le match.
— Mais la rééducation se passait bien, tu commençais à récupérer…
— J’ai voulu me voiler la face. Mais j’ai toujours su que ça se terminerait comme ça, il me balance, de plus en plus en colère.
— Tu es sous le choc, et je le comprends. Mais il faut continuer à y croire. Moi j’y crois, et je serai toujours là pour te soutenir, je tente de le réconforter.
Le voir pleurer me fait un mal de chien. Je tente de lui faire sentir ma proximité et mon empathie en le prenant dans mes bras. Mais le rejet que je redoutais tant finit par tomber.
— Putain, mais lâche-moi ! Casse-toi, Nico, casse-toi ! Casse-toi et fiche-moi la paix pour de bon !Merci à FanB pour les corrections.
Merci à Yann pour l'animation ci-dessus.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui lisent cette histoire, avec une mention spéciale pour celles et ceux qui ont commenté ou qui commenteront.
 12 commentaires
12 commentaires
-
Par fab75du31 le 31 Août 2022 à 17:22
Chers lecteurs, chères lectrices,
suite à la demande d’un lecteur concernant la possibilité de participer de façon discrète au financement de l'écriture de Jérém&Nico, je précise qu'il est possible de faire ça la plus discrètement du monde en cliquant sur le bouton "PAYPAL Ajouter au panier" dans la colonne à droite de ce site (il faut remonter en haut de la page pour le voir).Ou en cliquant ici même :
 financer Jérém&Nico sans inscription, en toute discrétion, en cliquant sur ce bouton :
financer Jérém&Nico sans inscription, en toute discrétion, en cliquant sur ce bouton :Ceux qui ont un compte PAYPAL seront alors redirigés vers la page de connexion PAYPAL. Le montant du don est libre, et c'est un don unique. Sur le révélé de banque, ce don apparaîtra simplement comme PAYPAL, sans aucune mention de Jérém&Nico.
Merci d'avance pour votre aide.Et bien sûr, les commentaires, même courts, sont toujours les bienvenus.
Fabien0321 Sous les vents redoutables, le Roseau plie…
Mars 2003.
[Tu étais sur une lancée magique, Jérémie Tommasi, et tout te réussissait. Pendant les matches, tu marquais des points à tour de bras. Tes coéquipiers t’admiraient, tes adversaires te redoutaient, le public du stade vibrait à chacun de tes essais. Et ça te donnait comme une sorte de délicieuse ivresse qui te portait, qui te donnait des ailes, qui te poussait à te surpasser, à aller toujours plus loin.
Sur le terrain, tu te sentais bien. Parce que tu te sentais à ta place. Parce que pendant deux fois quarante minutes, tu étais Tommasi12, un gars avec qui la moitié de la France voudrait jouer au rugby et être pote, et l’autre moitié coucher avec.
Sur le terrain, tu n’étais que puissance, aisance, talent insolent. Tu étais l’incarnation de l’image que tu voulais donner de toi. Tu construisais ta légende personnelle match après match. On t’annonçait une carrière fulgurante. Certains te prédisaient même des matches en équipe nationale dès l’année prochaine.
Chaque samedi, l’espace de deux ou trois mi-temps, tu oubliais tes doutes, tes interrogations, tes blessures. La peur qu’on découvre ton secret. Tu te sentais tout puissant, tu te sentais invincible, inarrêtable. Tu te sentais immortel. Et cette sensation était la plus grisante de toutes.
Mais ton bel élan et tes faux sentiments de toute puissance ont été stoppés net, un samedi de mars, à quelques minutes de la fin de la mi-temps. Tu t’étais envolé, tu étais monté très haut. Et soudain, tu es redescendu sur terre, brutalement, au sens propre comme au sens figuré. Et ça a fait un mal de chien. La douleur physique et morale a été insoutenable.
Aujourd’hui, tu es fracassé, dans ta chair et dans ton esprit. On t’annonce de longs mois de rééducation, loin du rugby. Huit mois, dans le meilleur des cas, loin de tout ce qui fait le sel de ta vie.
Huit mois, ça te paraît une éternité. Hier encore tu étais une star sportive montante, dans huit mois tu ne seras plus personne. Tu vas te démuscler, et beaucoup plus vite que tu t’es musclé. Tu vas perdre tous tes atouts. En huit mois, l’équipe va apprendre à se passer de toi. En huit mois, tout le monde va t’oublier. Tes coéquipiers, tes supporters, la direction de l’équipe. Ton contrat de joueur va-t-il seulement être renouvelé à la fin de la saison, alors que tu ne seras toujours pas revenu sur le terrain ?
A quoi bon, au fond, puisque tu te dis que tu ne reviendras jamais au niveau d’avant ! Tu te dis que tes blessures sont trop graves. Et que même si tout se passe bien, tes tendons ne seront plus jamais aussi résistants qu’avant l’accident. Et même s’ils l’étaient, le souvenir de la douleur que tu as ressentie te tétanise. Tu ne veux plus jamais ressentir cette douleur atroce. Tu ne sais même plus si tu vas oser courir à nouveau un jour.
Et encore moins jouer au rugby. Car depuis cet accident quelque chose a cassé dans ta tête. Jusqu’à ce jour, le contact avec les adversaires ne t’a jamais fait peur. Tu y allais avec insouciance, avec inconscience.
Aujourd’hui, tu réalises que ton corps est fait lui aussi de chair, d’os et de sang. Tu réalises qu’il est précieux, car il est fragile. Ce n’est que maintenant, trop tard, après cet accident qui remet tout en question, qui bouche ton horizon, que tu réalises le danger que tu courais à chaque action de match, à chaque entraînement.
Certes, tu avais entendu parler de joueurs blessés, de convalescences qui s’étirent, de joueurs qui ne reviennent jamais au niveau d’avant, tu as entendu parler de carrières brisées. Mais l’inconscience de ta jeunesse t’a toujours amené à penser que cela n’arriverait qu’aux autres.
Et puis, sans crier gare, c’est arrivé à toi. Et ça t’a conduit là où tu es maintenant, immobilisé dans ton canapé, en train de déprimer à fond. Tu sais que tu ne reviendras pas au rugby si tu es diminué, tu ne veux pas finir à jouer dans une petite équipe.
Alors, tu te dis que le sport professionnel c’est fini pour toi. Et cela te plonge dans une immense détresse. Car, après avoir goûté pendant un an et demi au monde étincelant du rugby, la perspective d’une vie ordinaire avec un petit boulot ça te fiche les boules.
Oui, si le rugby c’est fini pour toi, qu’est-ce qu’il te reste dans ta vie ? A quel rêve, à quelle ivresse tu vas pouvoir t’accrocher désormais pour faire taire tes démons intérieurs ?]
Jeudi 27 mars 2003, au soir.
C’est dur de voir Jérémie pleurer. Ses larmes passent de ses joues aux miennes, et elles me transmettent toute sa souffrance. Une souffrance refoulée, pleine de colère, une colère pleine de désespoir.
— Va-t’en, Nico, pars loin d’ici. Tu vois pas que je suis en train de couler ? Ne coule pas avec moi !
— Je ne partirai que quand tu iras mieux. Et personne ne coulera. Je te promets que tu iras mieux. Je te promets qu’un jour tu joueras à nouveau au rugby et encore mieux qu’avant l’accident. Je te promets qu’un jour tu gagneras le Top16 avec le Stade. Mais pour ça, il faut y croire. Pour cela, il faut continuer à croire en tes rêves.
Oui, je sais que je distribue de l’espoir à crédit, à découvert, sans prendre aucune garantie, en encourant un risque fou. Mais en voyant Jérémie dans cet état je ne peux faire autrement que lui donner quelque chose à quoi s’accrocher, coûte que coûte. J'ai besoin d'y croire et je veux qu'il commence à l'envisager.
Je pense aux mots du chirurgien du train :
« Et surtout, il faut s’arranger pour qu’il n’arrête jamais d’y croire, même s’il prétend le contraire. Car l’espoir est l’élément clé de la guérison. Il n’est bien évidemment pas suffisant, mais il est terriblement nécessaire. »
— Tout est possible, pourvu qu’on continue à rêver, je lui glisse, alors que mes sanglots se mélangent aux siens.
Les joues de Jérém sont encore humides lorsque Thibault et Maxime rentrent à l’appart. Le petit brun s’en rend compte. Il prétend avoir oublié de prendre le courrier, tout en faisant disparaître en catastrophe les enveloppes qu’il tenait à la main dans la poche arrière de son jeans. Quant à Thibault, il avance avoir oublié de faire des courses. Les deux adorables petits mecs quittent fissa l’appart, pour me laisser un peu plus de temps pour sécher les larmes de Jérém.
Ce soir-là, Thibault et moi prenons une chambre dans un hôtel. Elle comporte deux lits jumeaux, mais très vite nous les rapprochons pour nous câliner.
— Ça me fend le cœur de le voir dans cet état, me glisse Thibault, alors que ses gros bras me pressent contre son torse puissant et chaud.
— A moi aussi ça me fend le cœur, il est tellement abîmé !
— C’est vrai que tu peux passer du temps avec lui ? il me questionne.
— Oui, je peux, et j’en ai envie.
— Tu t’en sens le courage ?
— Je ne sais pas, mais j’ai envie d’essayer.
— Il faut être très fort, Nico…
— Je sais.
— Tu es sûr que ça ne va pas interférer avec tes études ?
— Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Je pense que mes camarades peuvent m’aider.
— Tu es vraiment un chouette gars, Nico.
— Toi aussi Thibault, tu es un gars en or.
— Ce qui me fait peur, c’est quand il va se retrouver seul à Capbreton. J’ai peur qu’il n’y mette pas tout son cœur, et qu’il ne fasse pas tout ce qu’il faut pour récupérer.
— J’aimerais pouvoir être à ses côtés quand il sera là-bas, mais je n’ai aucune idée de comment faire, j’avance.
— Si tu es vraiment sûr que tu peux passer du temps avec lui, je te propose quelque chose.
— Dis-moi…
— Je te paie le séjour à Capbreton. Tu prends une chambre ou un appart là-bas, et je règle tous les frais pendant tout le temps que tu seras à côté de Jé.
— Mais Thibault ! je m’exclame, touché pas sa générosité, ému par sa bonté.
— Il n’y a pas de « mais ». Si tu es prêt à t’occuper de lui, je peux te faciliter la tâche, et je veux te faciliter la tâche. Mais je te préviens que ça ne va pas être facile, il ajoute aussitôt. Les jours qui t’attendent ne vont pas être de tout repos. Il est démoli à l’intérieur, et il voit tout en noir. Il va te rendre malade, parce qu’il va très mal. Mais il a besoin de toi, même s’il va toujours prétendre le contraire.
L’admiration et l’immense tendresse inspirées par la grandeur d’esprit que Thibault vient de me montrer une fois de plus, n’ont jamais été si débordantes, si fortes à m’en donner des larmes. J’ai envie de lui, j’ai envie de faire l’amour avec lui. J’ai envie de lui offrir tout le plaisir qu’il mérite. J’ai envie de le câliner, j’ai envie d’offrir à cet adorable garçon toute la douceur qu’il mérite. Et putain je sais, à quel point il la mérite !
Thibault un véritable puits à câlins, un véritable aimant à bisous. Cette nuit, je lui donne toute la tendresse dont il a besoin, qui n’est sans doute qu’une fraction de celle qu’il m’inspire.
Nous savons le désir que nous partageons. Mais cette nuit la présence de l’autre nous suffit pour nous faire nous sentir bien.
Samedi 29 mars 2003.
Thibault et Maxime restent un jour de plus et rentrent à Toulouse dans le week-end. Quant à moi, je reste avec Jérém. Je reste malgré le fait qu’après notre rapprochement du premier soir, malgré qu’il ait accepté que je m’installe chez lui pour quelques jours pour permettre à Maxime de rentrer à Toulouse, Jérém s’est montré assez distant et froid. La cohabitation ne s’annonce pas vraiment sous les meilleurs auspices. Mais je prends sur moi, et j’essaie de garder un peu d’optimisme quant au fait que ça va s’arranger.
— J’attends ton RIB, me glisse discrètement Thibault, en me prenant dans ses bras, avant de partir. Et si c’est trop dur, tu m’appelles. Je viendrai vous voir, s’il le faut je ferai l’aller-retour dans la nuit.
Ce garçon est vraiment, vraiment adorable.
Début avril 2003.
Entendre raconter la détresse de Jérém par Maxime et la vivre en première ligne, au quotidien, ce sont deux choses complètement différentes. La tâche est ardue, et ça demande beaucoup d’énergie. De l’énergie mentale, morale en particulier.
En plus de son inquiétude pour son avenir au rugby qui se traduit par une mauvaise humeur constante et indécrottable, Jérém semble toujours essuyer les conséquences de son traumatisme crânien. Comme me l’avait annoncé Maxime au téléphone, mon beau brun souffre d’insomnies. Le peu qu’il dort, il dort mal, et il ne récupère jamais de sa fatigue qui commence à devenir chronique. Il sommeille toutes ses journées affalé sur le canapé, assommé par les médocs, l’air vidé de toute énergie. Il boit des bières, il fume. Le mal de tête ne le lâche jamais, il prend cachets sur cachets, il a toujours aussi mal. Il est très sensible à la lumière. Aussi, nous vivons dans la pénombre, et c’est lugubre. Le manque de lumière ne joue pas en faveur du moral. Son ouïe est hypersensible, et il m’engueule à chaque bruit un peu brusque dont je suis l’auteur.
Il est très irritable, et le peu que nous échangeons, je le trouve perdu, nerveux, parfois confus. Il a du mal à penser et réfléchir, et cela semble lui demander un effort immense. Aussi, il semble avoir du mal à se souvenir de certaines choses.
Et les innombrables cigarettes, joints, calmants et bières qu’il siffle chaque jour n’arrangent rien. L’accès permanent à ces Paradis Artificiels contribue à le maintenir dans le coltard, à étourdir ses capacités intellectuelles, à empêcher son esprit d’affronter la réalité, de reprendre sa vie en main, de puiser au plus profond de lui l’énergie pour rebondir.
J’ai beau lui dire que tout ce mélange peut être dangereux pour sa santé et que ça peut compromettre son rétablissement. Il m’envoie bouler en disant qu’il n’y aura pas de rétablissement.
Lorsque je le regarde, lorsque je l’entends parler, déprimer, je vois un garçon brisé. Quand je pense à la fierté qui brillait dans ses yeux lorsqu’il jouait et qu'il marquait un but, je ne reconnais plus le garçon renfermé et éteint qui est là sous mes yeux.
Je sens que quelque chose s’est brisé au fond de lui, quelque chose d’important, d’essentiel, de vital, même. Je crois que c’est le rêve de sa vie qui s’est brisé. Et il n’y a pas de douleur plus insoutenable que celle provoquée par un rêve qui se brise.
Je voudrais trouver les mots pour l’aider à aller mieux, mais je ne sais pas par où commencer. D’autant plus que dès que j’ose aborder le sujet « accident » ou « blessures » ou essayer de l’encourager, je me fais remballer comme un malpropre.
La dernière chose que je veux en ce moment c’est m’engueuler avec lui. Il n’a pas besoin de ça, et moi non plus. J’ai besoin de mettre toutes les chances de mon côté pour tenir le coup, et surtout ne pas me faire mettre à la porte. Mais à quoi bon rester avec lui si je ne peux l’aider à aller mieux ?
J’ai du mal à tenir le coup. Je tiens en prenant sur moi, je prends sur moi en repensant aux mots du chirurgien dans le train à propos de la souffrance du sportif blessé.
« J’ai vu passer pas mal de jeunes sportifs sur mon billard, rugbymen, footballeurs, handballeurs, avec des blessures graves. Et je peux vous dire que ceux qui s’en sont sortis, ce sont ceux qui ont eu du soutien pendant toute la durée de la rééducation. Il ne faut pas le lâcher, même s’il devient odieux. S’ils deviennent invivables, c’est parce qu’ils souffrent, et ils souffrent parce qu’ils ont peur d’avoir tout perdu. Il faut être forts. Il faut l’être pour vous, et pour lui. »
Je repense aussi aux mots d’Ulysse.
« Sous le vent contraire, le Chêne tente de résister et se fait déraciner. Alors que le Roseau plie, mais il tient bon, il récite par cœur. Sois Roseau, Nico ! La tempête va arriver, mais elle repartira. Et tu seras toujours debout après son passage. »
J’essaie, mais c’est tout sauf évident.
En attendant, je fais tout ce que je peux pour lui faciliter la vie. Je l’aide à se lever, même s’il ne voulait pas au début, à s’habiller. Je vais faire ses courses, y compris le shit (très beau garçon que son dealer, j’ai tellement envie de lui dire de changer de métier !), je lui fais à manger, je fais le ménage. J’œuvre discrètement. J’essaie d’être là pour lui, tout en me protégeant.
Malgré cela, ces quelques premiers jours de cohabitation se révèlent particulièrement difficiles. Jérém est sacrement amoché, meurtri par la vie. Il est en permanence sur les nerfs, et un rien suffit pour le faire exploser. Il peut être très blessant. Il peut aussi pleurer, parfois. Et là, inutile de penser à le prendre dans mes bras pour essayer de l’apaiser, sous peine de me faire encore jeter méchamment. Il vaut mieux que je parte dans la pièce d’à côté en attendant que ça passe. Ça me fend le cœur de ne rien pouvoir faire pour lui. Et je pleure de mon côté à chaudes larmes.
C’est dur, vraiment dur. Mais c’est décidé, je resterai à ses côtés malgré son humeur de chien rageur, à essayer de l’aimer malgré lui.
Le fait est que la mauvaise humeur, la morosité et le pessimisme sont des bêtes salement contagieuses. Je regarde Jérém se noyer jour après jour et j’ai l’impression qu’il m’entraîne vers le fond avec lui. Je réalise qu’il avait raison le soir où il m’avait dit qu’il était en train de couler. Et je réalise que quelque part, le fait de me dire de partir pour ne pas couler avec lui ressemblait à s’y méprendre à une preuve d’amour.
Alors je reste, bien qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'il me gueule dessus et qu'il m'ordonne de me casser et de lui foutre la paix.
Je sors tous les jours faire les courses, pour prendre l’air quand celui de l’appart devient trop irrespirable. Mais je pars la peur au ventre, et je rentre vite. Je ne peux me résoudre à le laisser seul plus qu’une demi-heure. Je n’arrive pas à me débarrasser de la peur qu’il puisse faire une connerie. Ma peur est peut-être infondée. Mais il est si mal que je préfère ne pas prendre le moindre risque.
Une infirmière vient chaque jour lui renouveler les pansements et l’aider à prendre soin de lui. Mathilde est une nana qui assume parfaitement ses rondeurs et qui a l’air on ne peut mieux dans ses baskets. Elle est dynamique et avenante. Elle est drôle et pétillante et sa venue est comme un rayon de soleil dans la triste monotonie de ces journées, de ce huis-clos qui devient de plus en plus pénible.
Chaque jour, elle fait ses observations positives sur la cicatrisation des blessures. Jérém fait mine de ne pas en faire cas. Ou balaie ses mots d’un revers de main. Pourtant, quelque chose me dit que le récit de cette évolution positive ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd.
Jour après jour, Mathilde garde son sourire malgré les réflexions chargées de pessimisme avec lesquelles Jérém réagit à ses encouragements.
En dehors de cette visite quotidienne, de ce rendez-vous à la fois amusant et rassurant, les seuls moments sereins ce sont ceux que nous passons en silence à jouer à la PS. C’est le seul moyen que j’ai trouvé pour partager du temps avec mon beau brun, sans le mettre en pétard, sans me faire jeter, le seul moyen pour l’obliger à faire un break cigarette-pétard-boisson.
Franchement, les jeux vidéo, et a fortiori des jeux vidéo de sports, ça m’intéresse autant que la sexualité des nanas. Mais je prends sur moi, je fais l’effort, je m’accoutume à cette activité que je perçois comme étant « contre nature ». J’apprends à jouer à FIFA pour le distraire. Je finis même par me défendre et même par lui mettre des raclées, lui qui jouait à FIFA déjà bien avant notre première révision.
Parfois j’y pense, pendant que nous jouons. Je pense à ce jour de mai d’il y a bientôt deux ans, où j’ai traversé une partie de la ville afin de réviser avec lui pour le bac. J’ai des frissons en repensant à son regard lubrique, à sa main qui attrape la mienne et qui la pose sur la bosse de son jeans. D’autres fois, en le revoyant debout, contre le mur, le t-shirt blanc taillant son torse comme un gant, la casquette à l’envers, la braguette ouverte, la bosse saillante, m’invitant à aller le sucer. Je vibre de nostalgie en repensant à la première fois où j’ai eu accès à sa virilité, la première fois où je l’ai pris en bouche. Et à ses mots : « Je vais jouir et tu vas tout avaler ». Et au bonheur avec lequel je m’étais exécuté.
Ce jour-là, il était aussi venu en moi, il m’avait possédé pour la toute première fois. Je découvrais un monde nouveau, fait d’un plaisir sensuel inouï.
Mais aussi de frustration. A la fin de cet après-midi de bonheur, alors que j’espérais un peu de tendresse, Jérém m’avait dit de partir et de fermer ma gueule au sujet de ce qui venait de se passer.
Je l’avais regardé, planté devant sa PS, en train de jouer à FIFA, la casquette à l’envers et torse nu, beau comme un Dieu. Un petit Dieu auquel j’avais offert tout le plaisir qu’il avait demandé.
Quand j’y pense, Jérém était un sacré petit con à l’époque, un petit macho imbu de sa queue et pour qui seul son plaisir comptait. Une sacrée tête à claques qui ne doutait de rien. Du moins en surface. En tout cas, à ce moment son effronterie était intacte, car une certaine insouciance l’était aussi.
Depuis qu’il est à Paris, j’ai l’impression que cette insouciance a été mise à rude épreuve par la pression liée à son statut, à son métier, à sa notoriété croissante. J’ai l’impression que la disparition progressive de l’insouciance est le lot que certains considèrent comme indissociable du package « Devenir adulte ». Ce qui est certain, c’est qu’elle a totalement disparu depuis son accident.
Je me sens nostalgique et ému par le souvenir de cette insouciance révolue, par le souvenir des révisions dans l’appart de la rue de la Colombette. A cette époque Jérém était certes un insupportable petit con. Mais il était serein, confiant en lui et en l’avenir. Tout ce qu’il n’est plus aujourd’hui. Je donnerais cher pour remonter le temps.
C’est pour cela que j’aime ces moments FIFA, car ils me ramènent au souvenir d’une époque somme toute heureuse (elle ne l’était pas totalement, mais le temps a dû commencer à faire le tri, je pense), et révolue.
Hélas, ces moments de partage ne durent jamais très longtemps, car la migraine finit toujours par revenir. Jérém est obligé parfois d’abandonner en pleine partie. Je le vois alors balancer sa manette, planter la partie, et s’affaler sur le canapé, l’air épuisé et souffrant.
En dehors de ces moments de détente, Jérém fume cigarette sur cigarette, pétard sur pétard, boit bière sur bière. Il mange peu, il dort beaucoup. Surtout le jour.
La nuit, Jérém dort dans son lit, et moi sur le canapé. J’ai trop peur de lui faire mal dans le sommeil.
Nous ne partageons plus aucun moment de tendresse. Et ça me manque terriblement. Je ne demande pas grand-chose. Une caresse, un baiser, une accolade me suffiraient pour me sentir moins seul, moins rejeté. Mais Jérém est très distant. Ça me rend malade. J’ai besoin de le toucher, de sentir sa présence avec mon corps, avec ma peau. J’essaie d’aller vers lui. Parfois, je passe ma main dans ses cheveux, je l’embrasse dans le cou furtivement. Mais il ne réagit pas. Je finis par avoir l’impression que ça le dérange plus qu’autre chose.
Le sexe me manque aussi. Je n’ose même pas aborder la question, de peur de me faire rembarrer méchamment. Bien sûr, il est convalescent, et j’attendrai autant qu’il faudra. J’en ai envie, et je me dis qu’il pourrait en avoir envie aussi, et que ça pourrait nous faire du bien. Je suis bien placé pour savoir à quel point un bon orgasme est capable d’apaiser un garçon.
Si je savais qu’il en a envie, je serais bien évidemment partant. Mais il ne manifeste aucun désir en ce sens. Alors, j’essaie de tâter le terrain sur le ton de l’humour. L’occasion se présente un soir, alors qu’il vient de passer de longues minutes à se faire sermonner au téléphone par son petit frère.
— Tu veux une glace ? je lui propose.
— Non !
— Une boisson ?
— Non !
— Un café ?
— Non !
— Une pipe ?
— Non plus.
— Une pipe, ça ne se refuse pas ! je tente de rigoler.
— Ça, tu oublies !
— Pourquoi tu dis ça ?
— Pour rien, laisse-moi tranquille.
— Je disais ça juste au cas tu en aies envie…
— J’ai pas envie !
— C’est pas grave, pas grave du tout, vraiment. Je rigolais !
Un long moment de silence suit ces derniers mots, un silence ponctué par plusieurs taffes de cigarette. Puis, après avoir écrasé son mégot, je l’entends me glisser, le regard ailleurs :
— Je n’ai pas bandé une seule fois depuis l’accident. Ça fait plus d’un mois, il précise.
Je n’avais pas soupçonné l’existence de ce point de frustration dans le corps et dans la tête de mon beau brun, un point qui doit se mélanger aux autres et les amplifier encore.
Jeudi 3 avril 2003.
Ça ne fait même pas une semaine que je cohabite avec Jérém, et j’étouffe. L’envie de partir est de plus en plus forte. Mais je ne peux pas le laisser tout seul. Dans trois jours il va partir à Capbreton, et je n’ai toujours pas trouvé l’occasion pour lui annoncer que j’envisage de l’accompagner.
Soudain, une idée traverse mon esprit. Je la peaufine au fil des heures.
Vendredi 4 avril 2003.
Et je la mets en pratique dès le lendemain.
— Ça te dit d’aller faire un tour en bagnole ? je lui balance en début de matinée, après le départ de Mathilde.
— Un tour où ?
— Il fait beau aujourd’hui, on pourrait faire une virée hors de Paris.
— T’as qu’à y aller seul.
— Je voudrais que tu viennes avec moi. Je pense que ça te ferait du bien de prendre l’air et de voir le soleil.
— Très peu pour moi.
— S’il te plaît, s’il te plaît, un tout petit tour. On sort de Paris, on se fait un resto, et on rentre pour la sieste. Je meurs d’envie de tester ta nouvelle bagnole, j’appuie mon propos pour le motiver.
— Tu me casses les couilles !
— Je t’aime moi aussi, je lui lance à contre-pied.
Quelques minutes plus tard, je m’installe au poste de conduite de sa belle allemande bleu métal.
— Elle est magnifique, on dirait une fusée !
— Vas-y mollo, c’est un petit bijou, et elle m’a coûté une petite fortune. Et si je ne joue plus, il y a de fortes chances que je doive la revendre.
— Tu ne la revendras pas, car tu n’en auras pas besoin.
— Roule et ferme-la ! il me balance, en s’allumant une clope.
Je démarre le petit bolide et je m’insère dans la circulation dense de la capitale. Le périphérique est saturé.
— Quelle connerie de prendre la route à cette heure-ci ! il râle dans son coin.
Je prends mon mal en patience et je finis par sortir de Paris. Le volant se laisse happer par la direction d’Orléans.
— Tu veux aller où, au juste ?
— Je ne sais pas encore. J’ai envie de rouler, cette bagnole est une pure merveille !
La belle allemande roule, roule, roule. A Orléans, elle réclame son dû. Nous nous arrêtons à une station-service pour faire le plein et boire un café. Je regarde mon téléphone et j’ai envie de pleureur de bonheur. Le SMS que j’attendais vient d’arriver. Tout est bon, la virée est bouclée. Pendant que nous buvons notre café, une bande de cinq mecs d’environ notre âge s’approche de nous, le regard rivé sur Jérém et sur ses béquilles.
— Tommasi ? C’est toi, tu es Tommasi ? l’interpelle l’un des mecs, un beau brun appartenant à la team « casquette à l’envers ».
— Non, c’est pas moi, fait Jérém, sur un ton vexé et peu engageant.
— Si c’est toi ! insiste le petit mec. Tu me signes ma casquette, s’il te plaît ?
— Je ne suis plus personne, je ne jouerai plus. Ma signature ne vaut plus rien, parce que c’est la signature d’un raté.
— Quand on a vu ce qui t’es arrivé à la télé, on était grave vener… ce type qui t’a dégommé, il l’a fait exprès, il mériterait qu’on lui casse la gueule !
— Ce qui est fait est fait, glisse Jérém, le regard fuyant et désabusé.
— Tu t’es fait opérer, mec ?
— Oui, j’ai du rafistolage partout.
— Tu reviens quand sur le terrain ?
— Jamais !
— Comment ça, jamais ?
— Les médecins tablent sur six mois de rééducation, j’avance.
— Les médecins ne savent rien !
— Tu vas revenir, et comment ! Tu es un magicien sur le terrain et tu nous emmènes avec toi quand tu marques un but. Tu n’as pas le droit de nous laisser en plan !
— La vie m’a laissé en plan…
— Toi t’es son pote ? s’adresse à moi le mec.
— Oui…
— Alors, tu le surveilles pour qu’il fasse tout comme il faut, pour qu’il revienne au plus vite et que tout se passe bien. Je te nomme responsable de son avenir au rugby. T’as intérêt à ce que tout se passe sans accrocs. Si ça foire, on te trouve et on te pète la gueule ! Eh, les gars, on lui pète la gueule s’il y a un problème ?
Ses potes acquiescent en rigolant.
Je sais que le gars plaisante. Mais en même temps, je ressens toute l’admiration qu’il éprouve pour Jérém et son souhait sincère de le voir revenir sur le terrain.
— C’est noté, je plaisante, à moitié amusé et à moitié ému par la spontanéité et la bienveillance de ce garçon.
— Tiens, signe la casquette, il insiste.
Jérém s’exécute en râlant. Il signe également un bout de papier, un ticket de métro, une boîte en carton contenant des chocolats.
— Ils étaient sympas ces gars, je lui lance, en reprenant l’autoroute.
— Surtout casse-couilles.
— Ça t’a pas fait plaisir d’être reconnu ?
— En ce moment, je m’en passe bien.
— Tu donnes de la joie à ces gars, et ils ont voulu te le montrer. J’ai trouvé ça très mignon.
Jérém ne répond pas. Mais quelque chose me dit que même s’il prétend le contraire, cette petite rencontre lui a mis du baume au cœur. Je le vois au fond de ses yeux, je le vois à cette étincelle, petite, faible, émoussée, mais bien présente, qui vient de s’allumer au fond de son regard.
La belle allemande semble désormais happée par la direction de Châteauroux.
— Tu vas me dire à la fin où tu veux aller ?
— J’ai envie de rouler, je reste vague. On va bientôt s’arrêter manger, puis on verra.
Nous prenons notre repas à proximité de Châteauroux. Jérém est taciturne et peu réactif aux efforts de conversation que j’essaie de faire. Pourvu que cette virée ne me pète pas à la figure. Il est 14h30 lorsque nous reprenons la route. La belle allemande semble toujours happée par le Sud.
— Il faut faire demi-tour, sinon on ne sera pas à Paris avant la nuit, me lance Jérém sur un ton agacé.
— Et pourquoi tu veux rentrer à Paris ?
— Parce que c’est chez moi !
— On pourrait dormir ailleurs…
— Mais où ?
— On va trouver !
— N’importe quoi ! Demain matin j’ai besoin de changer mes pansements, Mathilde va venir.
— Non, elle ne va pas venir.
— Comment ça ?
— Je lui ai dit que nous ne serions pas là.
— Et mes pansements ?
— J’en ai pris. Je l’ai regardé faire chaque jour et je peux me débrouiller.
— Ça me dit pas où tu veux aller dormir et à quoi ça rime toute cette route !
— Ça rime au plaisir de conduire cette merveilleuse bagnole, et à celui de t’entendre râler ailleurs que dans ton appart, et pour de nouvelles raisons !
— T’es con ! il me balance, un petit air amusé sur son visage.
— C’est la première fois…
— Quoi la première fois ?
— La première fois que je te vois sourire depuis l’accident.
— Je n’ai pas ri !
— Si tu as ri !
— Non, je te dis !
— Tu dis ce que tu veux. Moi, il m’a semblé te voir sourire. Et tu peux pas savoir combien ça me fait plaisir. J’aime tellement quand tu souris. Je t’aime, Jérémie Tommasi !
Nous faisons une nouvelle pause pipi café à proximité de Limoges. Le volant tient toujours le cap vers le Sud. Les panneaux TOULOUSE se font plus réguliers.
— Tu m’amènes à Toulouse ? me demande Jérém.
— Je t’amène quelque part.
Je ne peux pas encore lui dire qu’il chauffe, un peu.
Brives, Rocamadour, Cahors, Montauban, je laisse une à une ces villes derrière nous. TOULOUSE nous accueille. A l’approche de ma ville de naissance, le berceau de l’amour de ma vie, l’émotion me submerge. Toulouse, Papa, Maman, Elodie, vous me manquez, mais nos retrouvailles ne seront pas pour ce soir. Car la virée n’est pas terminée.
— Dis-moi où tu m’amènes, me glisse Jérém, alors que les sorties du périphérique défilent sous nos yeux.
— Tu vas vite comprendre.
La belle allemande quitte le périphérique et s’engage dans la direction Tarbes-Lourdes. Entre la sortie de Toulouse et le péage de Lestelle, Jérém demeure silencieux.
Ce n’est que lorsque nous avons passé la barrière que je l’entends me glisser :
— Tu sais que la maison va être froide et sale…
Ça me fait plaisir qu’il le prenne de cette façon. J’avais tellement peur qu’il me fasse un scandale !
— Qui t’a dit qu’on va à la maison ?
— Ah, voilà autre chose…
— Mais tu lui as dit au moins qu’on se pointait ? il enchaîne quelques instants plus tard.
— Oui, hier soir.
— Petit cachottier !
— Si je t’avais mis au courant, tu aurais dit non.
— C’est sûr.
— J’ai bien fait de ne rien dire alors !
— Il faut croire…
— Elle était tellement heureuse quand je lui ai annoncé que je t’amenais !
— Quel petit con tu es !
— Et toi non !
L’approche de Campan est elle aussi chargée d’émotion. Car ce petit village dans la montagne est l’endroit où j’ai depuis toujours été le plus heureux avec Jérém. Campan est notre refuge. C’est Jérém qui l’a dit un jour.
Il est près de 21 heures lorsque nous débarquons chez Charlène. Martine est là aussi. Les retrouvailles sont émouvantes. Les deux mamans de cœur de Jérém le serrent longtemps dans leurs bras, et elles pleurent de joie. Jérém pleure aussi. Mais cette fois-ci, j’ai l’impression que ses larmes le soulagent d’un grand poids.
Un bon petit dîner nous attend au coin du feu.
— Nico m’a prévenu un peu short, alors ce soir je n’ai pu rameuter que Martine, plaisante Charlène.
— Qu’un deuxième couteau, quoi, se marre l’adorable commerçante.
— Désolé, je glisse instinctivement.
— Ne le sois surtout pas ! Je suis tellement heureuse que tu aies eu cette idée ! J’imagine que vous êtes fatigués par la route et que vous avez envie de vous coucher de bonne heure. Mais demain soir, tu ne vas pas échapper à un bon gros repas au relais !
Évidemment, la conversation tourne longuement autour de l’accident de Jérém et sur l’avancement de sa guérison. Lorsque le jeune rugbyman évoque son départ prochain pour le Centre de rééducation de Capbreton, Charlène lui balance du tac-au-tac :
— Mais tu as quelqu’un qui t’accompagne là-bas ?
— Non, j’y vais seul.
Je ne lui ai toujours pas dit que j’ai prévu de le suivre à Capbreton. Charlène m’en offre l’occasion avec en prime un soutien prévisible qui ne sera pas de luxe. Un soutien dans lequel j’avais espéré en préparant ce voyage.
— Je pourrais t’accompagner, moi.
— Quoi ?
— Je peux rester quelques jours là-bas, le temps que tu prennes tes marques.
— Et tu vas crécher où ?
— Je prendrai une chambre.
— Et tu vas la payer comment ?
— J’ai un peu d’argent de côté…
— Voilà une riche idée ! s’exclame Martine. Au moins les premiers jours, le temps que tu t’habitues à ta nouvelle routine.
— Je me débrouillerai.
— Quand tu vas arriver là-bas, tu ne vas connaître personne, et tu ne vas voir que des gars accidentés comme toi, ou pire. Ça va te saper le moral. Tu n’auras pas de trop d’un visage connu, et de celui de ton petit copain qui plus est !
Jérém ne relève pas les derniers mots de Martine. Il ne les confirme pas. Mais il ne les infirme pas non plus. J’ai eu peur qu’il le fasse. Mais il ne l’a pas fait.
— D’ailleurs, si tu as besoin d’un peu de cash, je peux t’en filer, me lance Charlène.
— Je n’ai pas besoin de votre aumône ! s’exclame Jérém.
— Mais qui te parle d’aumône, espèce de petit con ! On veut seulement mettre toutes les chances de ton côté pour que ta rééducation se passe au mieux !
— J’ai assez d’argent pour rester quelques jours, je coupe court.
— Je ne t’ai jamais demandé de venir à Capbreton.
— Je sais. Je ne vais pas rester longtemps. De toute façon, tu vas finir par me rendre chèvre. Je vais rester quelques jours, une semaine au plus, je m’arrange avec la vérité. Et puis, si je ne viens pas, avec qui tu vas jouer à FIFA ?
Samedi 5 avril 2003.
Le lendemain soir, le relais accueille la foule des grandes occasions.
Une grande bannière composée d’autant de feuilles A4 que de lettres nécessaires pour composer le mot « Bienvenu, champion ! » est affichée sur le plus grand mur de la salle.
Tout le monde est là. Arielle avec sa spécialité, la quiche pas assez cuite. Martine avec sa bonne humeur contagieuse. Nadine avec son rire sonore et communicatif. Satine avec sa grande gueule. Les adorables aînés de l’asso, Ginette et Edmond, sont là aussi. Marie-Line et Bernard, collectionneurs de cas soc’ équins ont répondu également à l’invitation de Charlène. Daniel est là aussi, avec ses deux maîtresses, sa Lola et sa guitare. Loïc et Sylvain sont présents, et visiblement toujours ensemble. Je suis étonné de voir également Florian et son copain Victor. Vu l’animosité que nourrissait Florian vis-à-vis de son ex, je n’aurais jamais imaginé voir les deux couples dans une seule et unique pièce sans qu’il y ait du sang sur le dancefloor. Mais ainsi soit-il, tout est bien qui finit bien.
Jérém avance en s’aidant avec ses béquilles. Je me tiens derrière lui, au cas où il y aurait un souci, à cause des vertiges qu’il a parfois suite à son traumatisme crânien.
Jean-Paul, l’être le plus sage et bienveillant que je connaisse se tient devant la porte avec sa femme Carine, la nana la plus curieuse que je connaisse. Il a les yeux humides.
Dès que Jérém franchit le seuil, il le prend dans ses bras et le serre très fort contre lui.
— Salut, toi ! il lui glisse.
— Salut…
— Comment tu te sens ?
— Bien, maintenant que je suis ici, avec vous.
Je ne peux exprimer à quel point ces quelques mots me touchent.
— Et moi je suis heureux de te voir parmi nous. Bienvenu, Mr Tommasi !
— Putain, tu ne fais jamais les choses à moitié, lui balance Daniel en le prenant à son tour dans ses bras. Tu nous as fichu une trouille bleue encore une fois.
Chaque cavalier vient saluer le champion blessé à tour de rôle, et les « Comment ça va ? » pleuvent de toute part.
— Vous m’écoutez, s’il vous plaît une minute ? j’entends Jérém lever la voix à un moment pour attirer l’attention.
— Chut, chut, il va annoncer sa candidature à la présidentielle, plaisante Daniel.
— Ta gueule !
— Oui, merci ! Jé-ré-mie pré-si-dent ! Jé-ré-mie pré-si-dent ! Jé-ré-mie pré-si-dent !
— Mais tu la fermes un peu et le laisses parler, oui ? intervient Lola.
— Tu as oublié de prendre sa laisse, ce soir, non ? plaisante Satine.
— Je ne le dis qu’une fois et je ne le répéterai pas, reprend Jérém en donnant de la voix. J’ai été blessé et opéré aux ligaments croisés du genou et au tendon d’Achille. Apparemment, ça cicatrise bien. Je me suis cogné la tête sur le sol, et ça déconne encore un peu, mais ça a l’air de s’arranger aussi. Dans quelques jours, je vais en rééducation à Capbreton pendant quelques mois. Est-ce que je vais rejouer au rugby ? Je n’en sais foutrement rien. Inutile de me le demander ou de faire des pronostics. Je vous dirai quand je le saurai. En attendant, parlons de choses plus marrantes. J’en ai marre de parler bobos. Des tamalous, il y en a assez dans cette assos !
— Bien dit, fait Jean-Paul ! Jé-ré-mie pré-si-dent !
Toute l’assistance reprend le slogan lancé par Daniel et ça fait un joyeux bordel.
— Qu’est-ce qui se passe ici ? j’entends demander par une voix familière.
Maxime est là, et il n’est pas seul. Thibault a fait le déplacement avec lui.
Je n’oublierai jamais cette soirée. Cette première fois où, à la faveur de cette ambiance bienveillante et bon enfant dont cette assos a le secret, j’ai retrouvé un peu du Jérém d’avant l’accident. Un Jérém capable de sourire, de voir du positif, un Jérém plus apaisé. Un Jérém que je désespérais de pouvoir retrouver un jour. Je n’oublierai jamais les sourires que JP et Daniel ont pu lui tirer, les encouragements qu’ils ont pu lui apporter, et le regard ému et touché de Jérém.
Et ce que je n’oublierai jamais par-dessus tout, c’est le regard qu’il m’a lancé lorsque je l’ai rejoint à la cheminée, pendant qu’il fumait sa cigarette. Je n’oublierai jamais le « Merci » qu’il m’a glissé discrètement, les yeux humides, et sa main qui se pose sur ma nuque, ses doigts qui se glissent brièvement dans mes cheveux. Non, je n’oublierai jamais le premier geste de tendresse non seulement depuis l’accident, mais depuis notre séparation en décembre dernier.
Cette nuit, Jérém me manque beaucoup. Charlène nous a préparé deux chambres séparées pour laisser plus de place à Jérém. Quand la maison s’est tue, j’aurais voulu aller le rejoindre. Mais j’ai préféré le laisser se reposer. Il avait l’air si claqué, après toutes les émotions de la soirée ! Heureux, mais claqué.
Dimanche 6 avril 2003.
Demain, lundi, c’est je jour du départ de Jérém pour Capbreton. Avant de prendre la route ce dimanche, nous passons dire bonjour à Unico, Tequila et Bille. Charlène est très émue de voir Jérém répartir aussi vite.
— Vous auriez dû venir plus tôt ! elle nous gronde.
— Je n’avais pas le moral.
— Et ça va mieux maintenant ?
— On dirait…
— Prends bien soin de toi, mon grand. Et si ça ne va pas, appelle ta vieille copine ! Merci, Nico, de prendre si bien soin de lui.
Jérém demeure silencieux pratiquement jusqu’à Toulouse. Mais je suis heureux de voir qu’il a l’air bien plus dans son assiette que pendant le voyage aller. Ce bain d’affection, de tendresse, de bienveillance qu’ont su lui offrir ses amis cavaliers a l’air de lui avoir vraiment fait du bien.
— Tu es sûr de vouloir venir à Capbreton ? il me questionne de but en blanc.
— Sûr et certain.
— Tu vas louper tes cours.
— Je m’en fous.
— Mais pas moi !
— Tu loupes bien tes cours, toi !
— Moi je suis nul en cours, je suis un touriste à la fac. Mais toi, c’est du sérieux.
— Ma priorité, c’est toi, ta guérison.
— La fac devrait l’être aussi !
— J’ai pris des dispositions pour me faire aider par des camarades de cours. Et puis, Capbreton est à moins de deux heures de Bordeaux !
— Si ça se passe bien, tu pourras repartir.
Ah putain, qu’est ce que je suis heureux de l’entendre enfin envisager que ça pourrait bien se passer !
Je n’ai pas pu trouver, seul, le moyen pour rallumer cette flamme en lui, pour lui redonner l’espoir. Mais j’ai su trouver ceux qui ont su le faire à ma place. Et rien que ça, ça me donne une joie immense.
— C’était pas une idée idiote cette virée ! je m’entends réfléchir à haute voix.
— Pas idiote du tout. Merci encore. Ça m’a fait un bien fou.
Ses mots m’émeuvent aux larmes, sa main chaude qui se pose sur ma cuisse me donne des frissons. J’ai l’impression de retrouver peu à peu notre complicité perdue, et je suis aux anges.
— Je te rembourserai les frais que tu auras à Capbreton.
— T’en fais pas pour ça. Vraiment pas.
Évidemment, je me garde bien de lui dire que ce sont les sous de Thibault et d’Ulysse (ce dernier a voulu partager les frais de mon séjour à Bordeaux avec le premier) qui vont me permettre de m’installer à Capbreton et d’y rester le temps qu’il le faudra. Les deux rugbymen m’ont demandé de ne rien dire à Jérém pour ne pas qu’il se sente gêné par leur geste.
— L’important c’est que ça se passe bien. Je t’aime, Jérémie Tommasi !
Nous arrivons à Paris dans la soirée et nous dînons au restaurant. Pour la première fois depuis des mois, je dors avec Jérém. Pour la première fois depuis des mois, il me laisse le prendre dans mes bras. Pour la première fois depuis l’accident, je sens que la boule de rage qui était dans son ventre semble s’être dissipée. Cette nuit, Jérém dort du sommeil du juste.
Moi, en revanche, je dors très peu. Malgré le fait que Jérém m’ait dit que je ne risque pas de lui faire mal, je n’arrive pas à me détendre. Mais le fait de le tenir dans mes bras, et les quelques baisers que nous nous sommes échangés avant de nous souhaiter une bonne nuit, me mettent du baume au cœur.
Lundi 7 avril 2003.
Jérém est attendu pour son admission au Centre dans l’après-midi. Après avoir ramassé mes affaires et aidé Jérém à réunir les siennes, nous reprenons la route. Jérém semble soucieux. Dans sa tête, mille questions doivent fuser. C’est le début du moment de vérité. Il va faire un check up, avant l’étude du plan de rééducation. C’est là qu’il va savoir si tout se passe bien ou pas. Il doit appréhender les résultats des tests qui l’attendent. J’appréhende aussi. Il doit appréhender la réponse de son corps à la rééducation. Il doit avoir peur que les résultats se fassent attendre plus que prévu. Ou, pire, qu’ils ne soient jamais au rendez-vous. Les semaines, les mois à venir vont être déterminants pour la suite de sa carrière sportive. C’est là que tout se joue.
— Ça me rassure que tu sois là, je l’entends me glisser à un moment.
Je croise son regard et j’y vois une peur panique immense.
— Je suis là, et je serai là autant qu’il le faudra.
En passant à côté de Poitiers, j’ai un petit pincement au cœur en pensant à Ruben, à cette famille dont il m’a souvent parlé et que je ne connaîtrai jamais. Je ne regrette pas d’avoir volé au secours de Jérém, la seule chose que je regrette est de n’avoir pas été honnête plus tôt avec le petit Poitevin. Je l’ai été, dans une certaine mesure. Mais ça ne l’a pas empêché de tomber amoureux de moi et de croire en des rêves dans lesquels je n’ai jamais cru, des rêves que j’ai fini par briser, et par deux fois.
Sur la route vers Capbreton, nous faisons une halte à Bordeaux pour que je puisse récupérer d’autres affaires. Mes deux propriétaires viennent nous saluer. A nouveau, Jérém est accueilli avec une chaleur et une affection qui font vraiment du bien.
Lorsque je leur annonce que je vais m’installer à Capbreton pendant quelque temps pour rester aux côtés de Jérém pendant le début de sa rééducation, Albert n’hésite pas un instant.
— Pendant tout le temps que tu seras là-bas, tu n’auras pas à nous payer le loyer de l’appart. On te le garde jusqu’à l’automne, sans problème.
— On te le gardera le temps qu’il faudra, abonde Denis.
— Oui, le temps qu’il faudra, lui fait écho Albert.
— Merci beaucoup, merci de tout cœur ! je leur lance.
— On va dire que c’est notre contribution à la bonne cause de faire retrouver le meilleur de sa forme à ce beau et bon joueur, ainsi que le chemin du terrain de rugby.
— Merci, fait Jérém, l’air tout aussi ému que moi.
— C’est beau, ce que tu fais, Nico, avance Albert. Tout lâcher pour aider le garçon que tu aimes. Là, tu me plais, Nico. Certains avancent que nous, les pédés, ne sommes pas de hommes parce que nous ne sommes pas attirés par les femmes, il continue. Mais rappelle-toi ce que te dit un vieux croulant. Être un homme ne veut pas dire épouser une femme, aimer le foot ou le rugby, comme on veut nous faire croire dans le monde. Être un homme, c’est avant toute chose être droit et responsable, c’est protéger les siens, ceux qu’on aime, et qui nous aiment. Et là, Nico, tu n’as rien à envier à aucun soi-disant « homme ». Au contraire, il y a tant de guignols hétéros qui devraient prendre exemple sur toi.
— Le papi a raison, me lance Jérém, lorsque nous reprenons la route.
— Lequel ?
— Le plus âgé…
— Il a raison au sujet de quoi ?
— Un homme, c’est ce qu’il a dit.
Ulysse avait bien raison. Le roseau est toujours débout après le passage de la tempête.
Lundi 7 avril 2003, 17h12.
Le Centre de rééducation est situé juste derrière la plage. Depuis le parking, on entend le vrombissement des vagues, et on sent à plein nez les effluves d’eau salée.
Au check in, je suis touché que Jérém écrive mon nom et prénom et qu’il me demande mon numéro pour garnir la rubrique « Personne à appeler en cas d’urgence ».
Par ce simple geste, il acte le fait qu’il accepte ma présence, aussi longtemps que nécessaire, qu’il me fait confiance, qu’il apprécie que je sois là. Et ça me touche énormément.
La chambre de Jérém a vue sur l’Océan, sur le sable, sur le ciel. C’est magnifique. La chambre et le lit sont assez grands pour deux. Ça m’arrache le cœur de passer la nuit ailleurs. Mais pour l’aisance de Jérém, il est préférable que je m’en tienne aux plans, et que je trouve un hébergement dès ce soir.
Je demande à l’accueil, et la réceptionniste me donne les coordonnées d’un bailleur qui loue des meublés pour les accompagnants, à la semaine. Le prix n’est pas donné, mais j’ai pour consigne de ne pas m’arrêter sur ce genre de détail. C’est confortable de pouvoir compter sur la générosité désintéressée de mes deux jeunes et adorables sponsors. C’est dans le besoin, qu’on voit qui sont les vrais amis.
Le bailleur dispose de plusieurs studios à quelques centaines de mètres du Centre. J’en réserve un et je paie cash la première semaine de loyer.
Puis, Jérém et moi allons dîner au resto. C’est le dernier resto que nous allons partager pendant un bout de temps, parce qu’on nous a bien précisé à l’admission qu’à partir du début de la rééducation, l’alimentation de Jérém sera pilotée et surveillée afin d’optimiser ses chances de récupération. Alors je choisis un bon restaurant, et j’invite mon homme.
— Mais t’as vu les prix ? T’as gagné au loto, ou quoi ?
— T’inquiète, ça va aller.
Je passe une bonne soirée. Nous passons une bonne soirée. Jérém est favorablement impressionné par l’endroit et par l’accueil qui lui a été réservé. Tout dans ce Centre, la déco, les chambres, les tenues du personnel, dégage un côté professionnel et performant qui est très rassurant. Et la proximité de l’Océan, la puissance des éléments est un plus non négligeable.
Après le repas, je raccompagne mon beau au Centre. Je l’accompagne jusqu’à sa chambre, pour pouvoir lui faire un câlin et un bisou avant de lui souhaiter une bonne nuit.
Au moment de nous quitter, Jérém a l’air fébrile.
— Et si ça marche pas ? il me questionne, l’air complètement perdu et inquiet.
— Ça va marcher !
— Tu viens quand demain ?
— Je viendrai dans la matinée, j’attendrai que tu aies fini tes visites.
M’arracher de son étreinte, m’éloigner de ce garçon qui a besoin de moi et qui accepte enfin mon aide est une déchirure. C’est dur de le quitter. Mais il le faut. Je pleure pendant tout le trajet entre le Centre et le meublé.
Quelques minutes plus tard, je me retrouve seul dans cet appartement encore étranger. Je me sens perdu, et je ressens une boule au ventre à l’idée d’avoir laissé Jérém seul, lui aussi, seul avec ses angoisses. Il est 23 heures passées, mais j’ai besoin d’entendre une voix familière.
Je sais que Papa et Maman ne se couchent jamais avant minuit. J’appelle à la maison. Je tombe sur Papa.
— Tu as eu raison de l’accompagner, Nico, il va avoir besoin de toi, m’encourage Papa.
— J’espère arriver à suivre quand même mes cours, mes camarades m’ont promis de me passer leurs notes.
— Tu es assez doué pour y arriver.
Cette confiance et cette estime que Papa me témoigne depuis notre réconciliation me touchent toujours autant.
— J’espère.
— Des cours, ça peut se rattraper plus tard. Des blessures comme les siennes, il faut les panser maintenant.
— Hélas, je ne suis pas chirurgien, ni kiné…
— Je parlais des blessures intérieures, celles qui ne se voient pas, mais qui font le plus de dégâts.
— Je sais, Papa.
— Tu l’aimes, et il t’aime. Ta place est à ses côtés. Il a besoin de toi. Aide-le.
— J’espère qu’il va m’en laisser l’occasion…
— Dis-lui que c’est ton père qui t’envoie ! il plaisante.
Papa arrive à me tirer un sourire ému. Il me touche vraiment.
— Je suis fier de toi, Nico
— Merci Papa !
Ses encouragements me vont droit au cœur. Les mots de Maman vont dans le même sens, et je me sens compris et soutenu. Et ça fait un bien fou. 7 commentaires
7 commentaires
-
Par fab75du31 le 16 Août 2022 à 09:39
Cher lecteur,
l'épisode que tu vas lire a pris beaucoup d'heures pour être écrit, relu, peaufiné, corrigé. Si tu l'aimes, je te demande une faveur : laisse un petit commentaire, même un ou deux mots suffisent, histoire que j'aie un retour de ton ressenti, histoire que mon écriture ait un sens.
Merci d'avance.
Fabien
* * *
0320 Pourvu qu'on continue à rêver.
Samedi 8 mars 2003.
Le ralenti de l’accident de Jérém défile à l’écran et montre comment son genou a été malmené lors de la chute. Son pied a touché le sol dans une position décalée. Le poids de son corps, déséquilibré, démultiplié par la chute, s’est déchargé dessus, et le genou droit s’est plié vers l’avant. Les images sont incroyablement dures, cruelles. Je peux seulement imaginer la douleur qu’il a dû ressentir lorsque son genou a subi cette sollicitation inhumaine. J’en ai le vertige, j’en ai mal au cœur. Je suis tellement triste, j’ai mal pour lui. Je suis horriblement inquiet.
— Ah putain, putain, putain ! Il ne fallait pas ça, pas ça ! s’exclame Papa, toujours aussi choqué.
— Dis-moi ce qui se passe ! je l’implore.
— Attend une seconde…
Le direct revient, Jérém est toujours au sol. Il semble enfin être revenu à lui. Mais l’image qui se présente à mes yeux m’arrache les tripes, déchire mon cœur. Mon bobrun tient son genou droit entre ses deux mains, et il est en train de se tordre de douleur.
— Eh, merde ! lance papa, visiblement bouleversé, sonné, dégoûté.
— Dis-moi, Papa ! Dis-moi !
— C’est le genou qui a pris. Et à voir comment il a mal, les ligaments ont été arrachés.
— Et c’est grave, ça, non ?
— C’est grave, oui.
— Mais grave comment ?
— Au mieux, sa saison est foutue. Et peut-être même sa carrière au rugby.
— Non ! je m’entends crier à pleins poumons.
Non, pas ça, pas ça s’il vous plaît ! Ne faites pas ça à Jérém, il ne mérite pas ça !
Je me surprends à implorer, à crier intérieurement, paralysé par la panique, accablé par une impression d’injustice qui me désole, qui me révolte.
Le médecin injecte un produit dans le bras de Jérém, j’aime à imaginer que ce soit un calmant. J’aimerais tellement que ce soit un médicament miracle qui réparerait ses blessures comme par enchantement !
Le jeune ailier est enfin déposé sur la civière. La caméra le filme d’assez près pour que je puisse voir son visage. Et dans ses traits crispés, dans son regard hagard, je vois non seulement l’expression d’une douleur insoutenable, mais aussi, la déception, le désespoir, la colère, la peur panique de voir son rêve de rugby brisé à ses prémices. Et des larmes. Jérém pleure de douleur et de colère. Ça m’arrache le cœur. Un instant avant, il avait tout pour lui. Il était un espoir flamboyant du rugby français. L’instant d’après, il pourrait avoir tout perdu. Son avenir professionnel est désormais incertain. C’est un choc terrible. J’ose à peine imaginer ce qu’il doit ressentir au fond de lui à cet instant précis. Le destin est parfois si cruel.
Un autre ailier débarque sur le terrain. Le show doit continuer.
Je passe un après-midi horrible. Je me sens si mal, si impuissant face au drame qui vient de se produire dans la vie de Jérém, et sous mes yeux. Si seulement j’avais le pouvoir de tout arranger ! Je donnerais tout ce que je possède, et un peu plus encore, pour qu’il cesse de souffrir, pour le voir à nouveau gambader sur le terrain, pour le voir à nouveau filer comme le vent.
Les heures passent, et aucune information nouvelle ne filtre des différentes émissions de rugby qui démarrent après la fin des matches. Les images de son accident passent en boucle et ne m’apprennent rien de nouveau. Elles ne font qu’enfoncer inutilement un couteau dans une plaie. C’est moins de l’information que de la basse spéculation sur la souffrance d’un garçon blessé.
Je voudrais tellement être à ses côtés en ce moment horrible. Est-ce qu’il est seulement conscient ? Est-ce qu’ils l’ont sédaté ? Est-ce qu’ils vont l’opérer dans la foulée ? Est-ce qu’on me laisserait seulement l’approcher ? Est-ce qu’il me laisserait seulement l’approcher ?
En début de soirée j’arrive à avoir Thibault au téléphone et je le sens tout aussi désemparé que je le suis. Il me demande si j’ai envie de passer chez lui. Evidemment que j’ai envie. Lorsque je débarque à l’appart, nous nous prenons dans les bras et nous mélangeons nos inquiétudes, nos tristesses. Et ça nous fait un bien fou. Sa simple présence est apaisante.
— Mon coach connaît bien celui du Stade Français. Il m’a promis de l’appeler et de me tenir au courant dès qu’il y aura du nouveau.
Mais les heures passent et rien ne vient. Les examens médicaux doivent toujours être en cours. Je passe la nuit chez Thibault mais ni lui ni moi n’avons le cœur à envisager autre chose que de la tendresse. La présence et la proximité de l’autre est tout ce qu’il nous faut en ce moment si difficile.
Le portable du jeune pompier sonne au milieu de la nuit. Son radio-réveil indique 3h31. Thibault se réveille en sursaut, et moi avec lui. Il répond dans le noir. Le coup de fil ne dure pas très longtemps, et Thibault ne fait qu’écouter et pousser des soupirs de dépit. Je sens que ça ne s’annonce pas bien du tout.
Lorsqu’il raccroche, il prend une très longue inspiration. Il demeure assis dans le lit, l’attitude d’un gars perdu. Même dans le noir, je sens son inquiétude. Même avant qu’il ne prononce un mot, je sais que les choses sont graves, peut-être même plus graves qu’on l’imaginait.
— C’est pas bon…
— Qu’est-ce qu’ils ont trouvé ?
— Il y a rupture des ligaments croisés antérieurs. Sa cheville a pris aussi, il a une entorse carabinée. Ils craignent des microlésions. Mais ce qui les inquiète le plus pour l’instant, c’est la tête.
— Quoi, la tête ?
— Sa tête a heurté le sol. Il a perdu connaissance. Il a une commotion cérébrale. Depuis qu’ils l’ont pris en charge, il a eu des absences.
— Et ça va s’arranger ? je questionne, j’ordonne, je prie.
— Je ne sais pas, Nico, j’espère… fait Thibault, la voix faible, étouffée par les larmes.
L’horizon de Jérém s’assombrit un peu plus. Me revoilà, nous revoilà replongés dans le cauchemar d’il y a deux ans, lorsqu’il avait cogné la tête en tombant suite à une bagarre. Mon inquiétude, notre inquiétude grandit encore.
Thibault et moi ne dormons pas beaucoup plus cette nuit-là. Nous parlons de Jérém pendant des heures.
Dimanche 9 mars 2003, 9h48.
Après un crochet chez mes parents pour récupérer mes affaires, je débarque à la gare Matabiau. Je prends un billet pour Paris. Je ne sais pas bien ce que je vais pouvoir faire une fois là-bas, ni même si je pourrai le voir. Mais je ne peux pas rester à Toulouse, les bras croisés, ni même rentrer à Bordeaux. Je ne peux pas ne pas tenter d’aller le voir à l’hôpital, de m’approcher de lui. J’ai l’impression que si je ne m’approche pas physiquement, ou du moins géographiquement de lui, je vais devenir fou.
Thibault m’a promis qu’il viendrait lui-aussi, dès qu’il le pourrait. Il m’a demandé de le tenir au courant des moindres évolutions de l’état de son pote d’enfance.
Dans le kiosque à journaux dans le grand hall, la presse sportive fait les gros titres sur l’accident du jeune ailier. Je réalise que la photo de Jérém se tordant de douleur est imprimée en centaines de milliers d’exemplaires, au vu de la France entière. Cette photo me déchire les tripes.
Sur le quai, je regarde les autres passagers qui attendent immobiles. Sans que je ne sache rien d’eux, je me dis que leur vie me paraît tellement plus belle, plus calme et heureuse que la mienne en ce moment.
Le départ du train pour Paris Montparnasse est annoncé. Je m’apprête à rentrer dans la rame, lorsque je vois débouler sur le quai un beau petit mec brun. Il court vite, il a l’air super à la bourre. Visiblement, il cherche une rame pas trop remplie.
Une fraction de seconde plus tard, je reconnais dans le beau petit brun Maxime, le frérot de Jérém. Je lui fais un grand signe. Il me reconnaît à son tour, et il court direct vers moi.
— Nico ! Ça fait du bien de te voir, fait le petit brun en me claquant deux bonnes bises.
— Moi aussi je suis content de te voir, même si j’aurais préféré que ce soit dans d’autres circonstances.
— Tu sais pour l’accident de Jérém ?
— Oui, je l’ai vu en direct à la télé.
— Quelle rogne ! Il ne fallait pas ça !
— Non, il ne fallait pas, je commente.
— Tu vas bien ? j’enchaîne, lorsque nous avons pris place côte à côte dans la rame.
— Non, pas vraiment.
— Question bête, désolé. Je m’en doute bien que ça ne va pas.
Le train sort lentement de la gare.
— Je ne sais même pas si je vais pouvoir le voir, mais je ne peux pas rester ici. J’ai besoin d’être près de lui, je lui glisse.
— Moi pareil, je ne peux pas rester là sans rien faire. Ça me déchire tellement le cœur !
— Sinon, tu as des nouvelles, Maxime ?
— Papa a eu le coach ce matin au téléphone. A priori la nuit s’est bien passée, les médecins lui ont donné des trucs pour calmer la douleur et pour dormir. Tu as appris ce qu’ils lui ont trouvé après aux radios ?
— Oui, gros problème au genou et à la cheville. Thibault a pu se renseigner. Et la tête ?
— Ils vont lui faire passer d’autres tests aujourd’hui pour surveiller l’évolution. A l’heure actuelle, c’est ça le plus inquiétant. T’imagines qu’il pourrait avoir des séquelles à vie ?
— A vie ? Des séquelles comme quoi ?
— Le neurologue dit que ce genre d’accident peut provoquer des pertes d’équilibre et de coordination musculaire pendant longtemps, ou même pour toute la vie. Sa carrière serait fichue ! Sa vie tout entière serait fichue !
— Il ne faut pas penser au pire, Maxime. Je pense qu’il est dans de bonnes mains. Et puis, c’est un garçon solide. Il faut rester confiant.
— Je n’y arrive pas, Nico, je n’arrête pas de retourner tout ça dans ma tête. Et ça me rend fou !
Ce petit mec en détresse me touche immensément, tout comme il m’avait touché lors du premier accident de Jérém. L’amour fraternel est un sentiment si pur et si beau.
— Il n’a pas de chance mon frérot ! il s’exclame, en sanglotant.
Je le prends dans mes bras et je tente de le calmer.
Le train vient tout juste de passer Montauban lorsque le téléphone de Maxime se met à sonner.
— Oui, Papa, décroche le petit brun, l’air effrayé.
— …
— Ah putain… et ils n’ont pas vu ça hier, après l’accident ?
— …
— Ils l’opèrent ce matin ?
— …
— Je suis dans le train. Tu viens quand ?
— …
— Fais vite, à tout.
— Qu’est-ce qui se passe ? je l’interroge dès qu’il raccroche son portable.
La frustration et l’inquiétude provoquées par cette conversation à moitié entendue, ainsi que par l’attitude de plus en plus agitée du beau petit brun, sont insoutenables.
— Ce matin les médecins lui ont trouvé un hématome sous-dural, et ils vont tenter de le lui évacuer au plus vite.
— Je n’arrive toujours pas à croire ce qui s’est passé. Un instant avant il courait comme un lièvre, l’instant d’après, il était KO, je m’entends gémir.
— Il faisait une saison d’enfer, il allait casser la baraque au Stade. Putain, quel con ce joueur de Biarritz ! Je te jure que si je l’avais devant moi, je lui péterais la tête !
Le petit brun est hors de lui, sa frustration se traduit dans une colère à la fois touchante et virile.
— Excusez-moi, nous glisse un gars assis dans le siège de l’autre côté du couloir.
Il doit avoir une cinquantaine d’années. Ses cheveux sont grisonnants, ses lunettes stylées, son regard pénétrant. Il est habillé avec une chemise blanche, une veste et un jeans, et il dégage une classe certaine.
— Je n’ai pas pu m’empêcher d’entendre votre conversation, il enchaîne après avoir attiré notre attention. Vous parliez de Tommasi, le joueur du Stade qui a été blessé hier en plein match ?
— Oui, pourquoi ? fait Maxime, sur un ton agacé.
— Vous êtes des proches ?
— Oui.
— Je peux vous demander comment il va ?
— Nous n’avons pas plus de nouvelles que celles que vous avez entendues, fait Maxime, encore plus sèchement.
— Désolé, je ne veux pas m’immiscer dans votre vie privée. C’est juste que j’admire énormément ce garçon. Son jeu est brillant, son aisance sur le terrain dégage un panache fou. Ça se voit qu’il aime ce qu’il fait et c’est vraiment beau de voir quelqu’un qui a réussi à faire de son travail des vacances. Ça me peine de le savoir blessé. Ça me peine que tout se soit arrêté si soudainement pour lui.
— A qui le dites-vous ! C’est une cata ! fait Maxime, le regard perdu, la voix émue.
— Vous êtes des amis ?
— Je suis son frère.
— Je suis… un ami, j’ajoute.
— Ecoutez-moi, les garçons. Dites-vous bien que pour qu’il ait une chance de s’en sortir, il va avoir besoin de vous qui êtes les plus proches. Pour remonter la pente, la route va être longue, parsemée d’obstacles qui vont sembler insurmontables. Il va vouloir renoncer, tout envoyer balader. Et il va avoir besoin d’être encouragé et soutenu, surtout à ces moments-là.
— Et qu’est-ce que vous en savez, vous ? fait Maxime, sur un ton emporté.
— J’ai oublié de me présenter : je m’appelle Marc Dupuy. Et, en plus d’être un grand amateur de rugby, je suis chirurgien orthopédiste au CHU de Toulouse. J’ai vu passer pas mal de jeunes sportifs sur mon billard, rugbymen, footballeurs, handballeurs, avec des blessures graves. Et je peux vous dire que ceux qui s’en sont sortis, ce sont ceux qui ont eu du soutien pendant toute la durée de la rééducation. Il ne faut pas le lâcher, même s’il devient odieux. S’ils deviennent invivables, c’est parce qu’ils souffrent, et ils souffrent parce qu’ils ont peur d’avoir tout perdu. Il faut être forts. Il faut l’être pour vous, et pour lui. Et surtout, il continue, il faut s’arranger pour qu’il n’arrête jamais d’y croire, même s’il prétend le contraire. Car l’espoir est l’élément clé de la guérison. Il n’est bien évidemment pas suffisant, mais il est terriblement nécessaire. Tout est possible, pourvu qu’on continue à rêver.
— Pour l’instant il a une commotion cérébrale et une poche de sang dans le ciboulot !
— J’imagine qu’il est dans les mains des meilleurs médecins à Paris. Il faut être confiant.
Le train ralentit et l’arrivée en gare de Montauban est annoncée.
— Moi je descends ici, fait le chirurgien, en se levant. Tenez, les garçons, il nous glisse, en nous tendant une carte. Je vous ai marqué mon numéro de portable direct, si jamais vous avez besoin d’avoir un autre son de cloche. Parfois, il est intéressant de recueillir plusieurs avis.
— Merci, fait Maxime sèchement, mais il est déjà pris en charge.
— Je n’en doute pas. Mais sait-on jamais.
— Merci, je lui glisse, touché par sa gentillesse, en saisissant la carte que Maxime a refusé de prendre.
— Avec plaisir. Vous pouvez m’appeler à n’importe quelle heure. Passez mes amitiés à Mr Tommasi quand il sera réveillé.
Maxime et moi n’avons jamais eu l’occasion de passer autant de temps ensemble. Nous employons le reste du voyage à discuter. Maxime me parle de leur enfance difficile après le départ de leur mère. Il m’avoue avoir repris contact avec cette dernière depuis quelques mois, un choix que son frère aîné n’approuve pas et qui a été source de dispute avec lui.
Puis, il me questionne sur Jérém et moi. A priori, le petit brun n’a jamais eu ce genre de conversation avec son grand frère. Maxime veut savoir comment nous nous sommes trouvés, comment son frère est passé des nanas aux garçons, comment ça se passe entre nous avec la distance. Ça me fait du bien de parler de Jérém. Alors, je me prête au jeu.
Maxime est surpris lorsque je lui apprends que nous nous étions déjà « ensemble » avant le bac, et pendant tout l’été après notre bac.
— Avant de me voir à l’hôpital de Toulouse il y a deux ans, tu ne t’es jamais douté que Jérém regardait les mecs ?
— Jamais !
— Pourtant, il y a eu d’autres gars avant moi. Des aventures, certes…
— Non, je ne me suis jamais douté de rien. Il a bien caché son jeu. C’est quand je t’ai vu à l’hôpital, quand j’ai vu comment tu lui tenais la main, comment tu le regardais, comment tu étais mal, que j’ai compris.
Maxime est peiné quand je lui apprends à quel point son grand frère a eu du mal à s’accepter, et à accepter de se laisser aimer.
Il a l’air heureux d’apprendre qu’il a changé peu à peu, qu’il a appris à s’écouter, à se connaître, et que nous avons passé de très bons moments ensemble, à Campan, à Paris.
Et il a l’air très déçu lorsque je lui apprends que Jérém et moi nous ne sommes plus ensemble depuis plus de trois mois.
— Mais qu’est-ce qui s’est passé ?
— Quand il y a de la distance, ce n’est jamais simple. Et quand il faut rester caché, c’est encore plus difficile. Jérém a peur pour sa carrière.
— Je sais qu’il a peur. Au fait, tu as vu ce ramdam dans les journaux ?
— Au sujet de lui et de cette greluche siliconée ?
— C’est n’importe quoi cette histoire !
— Quoi, cette histoire n’est pas vraie ?
— Inventée de toute pièce !
— Comment tu sais ?
— Il me l’a dit ! C’est une idée de son agent pour lui donner une bonne image. Et ça le faisait tellement chier de devoir se prêter à ce jeu malsain. Mais son agent lui a forcé la main et il n’a pas pu refuser.
— Pourquoi il aurait besoin d’une bonne image ? Il s’est passé quelque chose ?
— Ça, je ne sais pas, il ne me l’a pas dit. Il m’a juste dit que c’était une idée de son agent.
Le train arrive en gare de Montparnasse vers 14 heures. Et mon téléphone se met à sonner.
« Ruben » s’affiche à l’écran.
Je ne réponds pas, je n’ai pas la tête à ça.
A l’hôpital, seul Maxime est autorisé à parler aux médecins.
Lorsqu’il revient, il a le regard empli de tristesse et les yeux humides.
— Qu’est-ce qu’ils t’ont dit ?
— L’hématome est résorbé, et le saignement a cessé.
— C’est une bonne chose, non ?
— Oui, mais le pronostic vital est toujours engagé.
— Non !
— Si, pendant encore 48 heures. Ils attendent de voir comment ça évolue. Ils ont peur que l’hémorragie reprenne, ils ont peur des séquelles neurologiques. Putain, c’est pire que ce que je pensais !
— Un pas à la fois, ils vont le sortir de ce merdier ! je tente de le rassurer.
Et pourtant, au fond de moi, j’ai du mal à croire à ce que je viens d’avancer. J’ai terriblement envie de le voir. Mais je ne suis pas autorisé à le faire pour l’instant. J’ai beau l’aimer, je ne fais pas partie de sa famille.
En sortant de l’hôpital, nous allons manger un bout. Je crève de fatigue, la nuit quasi blanche commence à me peser horriblement. J’ai un mal de tête des plus carabinés.
— J’y retourne, m’informe le petit brun.
— Je viens avec toi.
— Tu as l’air claqué, il considère.
— Toi aussi tu as l’air claqué.
— Va te reposer un peu. Inutile qu’on s’épuise à attendre à deux. Tu vas venir me relayer un peu plus tard, si tu veux bien.
— Je veux bien, oui.
— Tu as un point de chute à Paris ? il me questionne.
— J’ai un peu d’argent pour prendre une chambre.
— Tiens, il me lance, en me tendant un trousseau de clés.
— Ce sont les clés de…
— De son appart, oui. Je t’appellerai s’il y a du nouveau.
Pénétrer dans l’appart de Jérém trois mois après la dernière fois, ça me fait un drôle d’effet. Et savoir que Jérém ne rentrera pas parce qu’il est dans un lit d’hôpital, inconscient, blessé, me serre le cœur.
Le séjour est plongé dans un joyeux bazar. Jérém n’a jamais été un fan de ménage, et ça n’a pas changé. Dans la salle de bain, posée sur le rebord du miroir, la chaînette que je lui ai offerte pour l’anniversaire de ses 20 ans. Et son parfum qui flotte dans l’air. J’ai envie de pleurer.
Dans la chambre à coucher, le lit défait, des capotes sur la table de nuit, un emballage ouvert. Je n’arrive même pas à être jaloux.
Où que mon regard tombe, j’ai l’impression de voir dans cet appart l’instantané d’une tranche de vie. Une tranche qui s’est arrêtée soudainement, violemment. Dans ces pièces où rien ne bouge, où tout est silence, je ressens une désolation lugubre. J’ai l’impression que tout est figé, et que le temps s’est arrêté.
Un t-shirt blanc abandonné sur le canapé attire mon attention. Je plonge mon nez dedans, je retrouve son parfum, son odeur. Je pleure.
La sonnerie de mon téléphone retentit dans la pièce sinistrement silencieuse.
« Ruben ».
J’ai oublié de le rappeler. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? Je sais qu’il ne comprendrait pas que je lui dise la vérité, que je suis monté à Paris pour être près du gars que j’aime plus que tout. J’ai besoin de retrouver mon souffle avant de l’appeler. J’ai besoin de trouver le courage et la force. Je suis assommé par cette situation et par le manque de sommeil. Avant de l’appeler pour lui annoncer que je ne rentrerai pas à Bordeaux le lendemain, j’ai besoin de trouver quelque chose de vraisemblable et d’acceptable à raconter. J’ai aussi besoin de me ressaisir. Je sais qu’il devinerait à ma voix que je viens de pleurer. Je sais que je n’aurais pas la force d’affronter sa suspicion, ses doutes, sa tristesse.
« Je t’appelle dans quelques minutes » je lui envoie par texto.
Pendant ces quelques minutes, j’appelle Papa pour lui donner des nouvelles. Papa se veut rassurant, et il sait trouver les mots pour m’apaiser. En vrai, c’est surtout le fait de le sentir proche et concerné dans cette épreuve qui m’apaise.
J’appelle Ruben en suivant. Je me suis un peu calmé et j’ai trouvé du vraisemblable et de l’acceptable. Je lui raconte que ma mère est tombée dans la cuisine, qu’elle doit rester immobilisée pendant quelques jours. Et que, par conséquent, je vais rester à Toulouse pour m’occuper d’elle.
Ce n’est pas beau de mentir, mais je n’ai pas le courage d’affronter la vérité ce soir, et encore moins de prendre les mesures qui s’imposent. La vérité étant que, malgré la profonde affection que je ressens pour Ruben, je ne suis pas amoureux de lui. Parce que je suis toujours amoureux de Jérém.
Et la seule mesure qui s’impose, c’est celle de lui rendre sa liberté pour qu’il ait une chance de rencontrer un gars qui le rendrait heureux.
Mais pas ce soir. La journée a été assez éprouvante comme ça. Le mensonge est une façon de me protéger. Je m’arrange avec la réalité pendant de longues minutes, et Ruben n’y voit que du feu.
Les heures passent, le soir arrive, et toujours pas de coup de fil de Maxime. J’essaie de l’appeler plusieurs fois, mais je tombe toujours sur son répondeur. Mon inquiétude grandit au fil des heures silencieuses. Je n’ai pas envie de manger, je n’ai pas envie de regarder la télé. Je tourne en rond, comme un animal en cage. Je reste de longues minutes allongé sur le canapé à fixer le plafond.
La sonnette de l’appart retentit vers 22 heures. Le petit brun débarque enfin, l’air complètement lessivé.
— Ça va ? je le questionne.
— Je suis KO.
— Je comprends. Et ton frère ?
— Ils ont refait un scanner, et il n’y a pas eu d’autres hémorragies.
— C’est bien, ça, je me réjouis.
— L’activité cérébrale semble convenable.
— Un autre pas en avant !
— Ils ont dit que les 24 prochaines heures vont être décisives.
— Ça va aller, j’en suis sûr !
— Ça me rassure de savoir que Papa est près de lui cette nuit.
Maxime part à la douche. Il revient quelques minutes plus tard, torse nu, enveloppé par un délicieux nuage olfactif chargé de la fraîcheur humide du gel douche. Il sent divinement bon. Une serviette autour de la taille, les cheveux bruns encore humides, il est beau comme un petit Dieu. A peine un peu plus petit en taille que son grand frère, mais tout aussi bien bâti, avec de beaux pecs et des abdos finement dessinés. La ressemblance avec Jérém est troublante. Adorable et beau petit mec.
Maxime insiste pour prendre le canapé et me laisser le lit.
Cette nuit-là non plus je ne dors pas beaucoup. Je n’arrive à trouver le sommeil qu’en serrant le t-shirt de Jérém contre mon visage et en imaginant qu’il soit là, à côté de moi. Qu’est-ce qu’il me manque !
Lundi 10 mars 2003.
Le lendemain, nous nous rendons à l’hôpital de bonne heure. A notre arrivée, le père de Jérém est en train de s’entretenir avec le neurologue. Lorsqu’il revient, il nous rapporte que la nuit s’est bien passée, qu’il n’y a pas eu de nouvelles complications. Un autre pas en avant. Et que si tout va bien, ils vont le laisser émerger tranquillement en fin de journée. L’horizon semble s’éclaircir un peu, enfin, après 48 heures d’inquiétude et de désarroi.
— J’ai aussi parlé avec le chirurgien orthopédiste…
— Il a dit quoi ?
— Les ligaments croisés antérieurs sont déchirés. Il va falloir opérer au plus vite. Sa cheville est en vrac aussi, le tendon d’Achille est arraché.
— Putain, la totale ! fait Maxime, l’air bouleversé.
— Il va devoir affronter de longs mois de rééducation…
— Il pense qu’il pourra rejouer un jour ?
— Il ne m’a pas semblé très optimiste à ce sujet.
— Oh putain !!! Putain !!! Putain !!! s’emporte le petit brun.
— J’en ai un dégoût, tu peux pas savoir, fait Mr Tommasi, l’air épuisé, perdu, ahuri, prenant appui des épaules contre la cloison du couloir. Je ne sais même pas comment on va pourvoir lui annoncer tout ça quand il se réveillera.
— On va l’aider, on ne va pas le lâcher d’une semelle, et il va revenir au top ! fait Maxime, dans une soudaine démonstration d’optimisme qui n’est en fait que le reflet parfaitement symétrique de son inquiétude.
Les mots du petit brun ressemblent en effet à une réaction au désarroi de son père, à une façon de refuser une réalité trop dure à accepter.
— Je m’en veux tellement de ne pas lui avoir dit à quel point je suis fier de ses exploits au Stade ! se morfond Mr Tommasi.
— Et pourquoi tu ne l’as pas fait ? l’apostrophe Maxime. Tu peux pas savoir à quel point il attendait que tu lui montres que tu étais fier de lui ! C’est pourtant pas faute de te l’avoir dit !
— Tu sais bien que depuis le départ de votre mère, entre Jérém et moi ça n’a jamais été facile. Et puis, je n’ai jamais été doué pour montrer ce que je ressens…
— C’est ton fils, et tu dois te démerder pour lui dire que tu es fier de lui, si tu es fier de lui, putain !
— Je suis fier de lui, et je suis fier de toi. Vous êtes deux garçons merveilleux.
Une infirmière vient annoncer que la famille est autorisée à aller voir le patient.
— Je laisse ses frères y aller d’abord, ment le père sans hésiter.
— Vous avez trois beaux garçons, elle commente, en n’y voyant que du feu.
— Je ne me plains pas…
Je laisse le vrai frère y aller avant moi. Il en revient en larmes.
C’est à mon tour d’y aller. J’ai l’impression de revivre l’angoisse du premier accident de Jérém, en pire. J’ai les jambes en coton, le cœur en fibrillation, je ressens une oppression étouffante dans mon torse, j’ai du mal à respirer.
Jérém est allongé sur le lit médicalisé, les yeux fermés, un masque respiratoire sur la bouche. Moi non plus je ne peux retenir mes larmes. Pourvu qu’il se réveille, pourvu qu’il n’en garde aucune séquelle.
Et en même temps, je me surprends à redouter l’instant où il se réveillera, où il apprendra la gravité de ses blessures, et le long parcours difficile qui l’attend pour remonter la pente. Est-ce qu’il pourra seulement la remonter ? Je sais que ça va le démolir.
Mr Tommasi y va en dernier. Lorsqu’il revient, je suis seul, Maxime est parti prendre l’air pour essayer de se calmer.
— Merci d’avoir menti pour me permettre d’aller le voir, je lui glisse.
— C’est normal. Tu as fait le déplacement de Toulouse pour venir le voir, alors tu méritais de le voir. Tu es un bon gars. Tu es un ancien copain de lycée, c’est ça ?
— Oui.
— Je t’avais vu la dernière fois qu’il avait été à l’hôpital après une bagarre…
— Voilà.
— Nico, si je me souviens bien…
— Oui, c’est ça.
— Et vous avez gardé contact même après que Jérém soit parti à Paris ?
— Oui, on s’appelle de temps à autre, je mens.
— C’est important les bons copains. Les nanas, ça ne fait pas tout, il commente.
— Non, ça ne fait pas tout, je confirme.
A 19h30, la nouvelle qu’on attendait depuis 48 heures tombe enfin : Jérém est conscient. Nous poussons tous ensemble un profond soupir de soulagement. Pour la première fois depuis que nous sommes à Paris, je vois le beau visage de Maxime se décrisper et amorcer un petit sourire.
A 19h55, l’infirmière vient nous annoncer que nous pouvons à nouveau aller le voir l’un après l’autre.
— Je vais y aller en premier. C’est à moi de faire le sale boulot, annonce Mr Tommasi.
— Vas-y mollo, Papa… s’il te plaît ! fait Maxime, le regard redevenu soudainement pensif et préoccupé.
Mr Tommasi disparaît dans la chambre de Jérém. Les secondes s’égrènent lentement, lourdes comme des pierres. Maxime et moi tendons l’oreille. Mais rien ne vient.
Ce n’est qu’au bout de quelques minutes qu’on entend la voix de Jérém se lever, rugir sa détresse. Mr Tommasi revient l’air défait.
Maxime disparaît à son tour dans la chambre de Jérém. L’adorable frérot est certainement le plus à même de réconforter le rugbyman blessé. Au fil des minutes, je ressens une grande angoisse monter en moi. Après ce qu’il vient d’apprendre, Jérém doit être au fond du trou, et d’une humeur massacrante. Je me demande comment il va réagir quand il va me voir, je me demande si je ne vais pas me faire jeter direct.
Maxime revient une demi-heure plus tard, l’air lui aussi complétement défait.
— Comment il va ?
— Mal. J’ai essayé de lui remonter le moral, mais rien n’y fait. Je lui ai parlé pendant de longues minutes, et il n’a pas dit un mot. Il regardait le mur. Il est complètement sous le choc. Tu veux y aller ? il me questionne.
— Tu lui as dit que je suis là ?
— Oui.
— Il a réagi comment ?
— Il a dit qu’il ne veut voir personne.
— Alors je ne vais pas le déranger.
— Vas-y quand même, je suis sûr que ça lui fera plaisir de te voir.
Je prends une profonde respiration et je marche jusqu’à sa chambre. Lorsque je passe le seuil de la porte, mon bobrun est en position demi assise, le dos soutenu par une pile d’oreillers. Il a le regard figé, absent. Il a l’air complètement sonné. Les secondes passent, et aucune réaction ne vient de sa part. Je ne sais même pas s’il s’est rendu compte que quelqu’un est rentré dans sa chambre.
— Jérém, je l’appelle après une nouvelle longue inspiration.
— Quoi ? il finit par réagir, après plusieurs secondes.
— Comment tu vas ?
— Tout va bien. Ça ne se voit pas ? il me lance, sur un ton sarcastique et amer.
— Je suis désolé pour ce qui t’es arrivé.
— Oui, c’est bien. Maintenant tu peux repartir.
— Je suis venu pour te voir.
— Tu m’as vu, là, maintenant casse-toi !
— Je sais que c’est dur pour toi…
— Non, tu te trompes. Je vais super bien. Je suis fracassé de partout, mais je vais super bien ! Tire-toi !
— Je voudrais tellement pouvoir t’aider.
— Je n’ai pas besoin d’aide, j’ai besoin d’un miracle. Si tu ne sais pas faire des miracles, tu n’as pas à être là.
— Tu comptes énormément pour moi, je ne peux pas repartir et te laisser seul dans cette situation.
— Laisse tomber, Nico, casse-toi !
— Mais je ne peux pas te laisser tomber ! Je t’aime Jérém ! je lui crie tout bas pour ne pas être entendu en dehors de notre intimité.
— Eh ben, pas moi. Je ne t’aime pas, je ne t’ai jamais aimé ! rugit Jérém, sa colère lui faisant oublier la discrétion.
— Tu dis n’importe quoi !
— Tu crois que quand je te baisais j’en avais quelque chose à foutre de toi ?
— Va te faire voir !
— Qu’est-ce qui se passe ici au juste ? j’entends demander derrière moi Mr Tommasi, sur un ton remonté.
— Ça ne te regarde pas ! lui crie Jérém.
— Je veux que ce dégénéré quitte cet hôpital sur le champ !
Je crois qu’il a entendu nos échanges sonores. Je crois que c’est moi qu’il traite de dégénéré. En quelques secondes, j’ai perdu le titre de « bon gars » et celui de « bon copain », pour être estampillé de « dégénéré ». Il faut beaucoup de temps pour gagner l’estime de quelqu’un, mais l’espace d’un battement d’aile de papillon suffit pour la perdre. A fortiori lorsque cette dégringolade est provoquée par des préjugés fondés sur le néant.
— Et moi je veux qu’il reste ! C’est toi qui vas te casser, maintenant ! fait Jérém, soudain agité par une colère noire, par une agressivité effrayante.
— Et moi qui croyais enfin pouvoir être fier de toi…
— Tu ne l’as jamais été, alors aujourd’hui je n’en ai plus rien à faire !
— Tu me dégoûtes…
— Ça tombe bien, toi aussi tu me dégoûtes !
— Mais putain, Papa, tu ne vas pas recommencer à lui casser les couilles ici, maintenant ! j’entends Maxime intervenir.
— Tu savais que ton frère était pédé ?
— Et alors ? C’est quoi le problème ?
— Tu ne vois pas de problème ?
— Bah, non !
— Moi j’en vois un, et un gros.
— Papa, j’ai une question pour toi, lâche Maxime sans se démonter.
— Quelle question ?
— Tu es bien sûr que tu aimes tes enfants ?
— Mais qu’est-ce que tu racontes ?
— Tu vois, quand je te regarde faire, moi j’en suis de moins en moins sûr. Si tu les aimais, tu devrais juste te féliciter de ce qui les rend heureux. Et les soutenir, toujours, et encore plus quand ils sont à terre, au lieu de les emmerder !
— C’est quoi tout ce raffut ? gronde l’infirmière qui vient à son tour de débarquer dans la chambre.
— Je vous laisse une minute pour débarrasser le plancher ! Mr Tommasi a besoin de repos, elle nous intime avant de quitter la chambre.
Mr Tommasi senior se tire sans lâcher un mot de plus.
— Pense à toi, pense à guérir, ne te soucie pas de ce qu’il pense, fait Maxime à l’attention de son grand frère. Il est trop con, ne te prends pas la tête à cause de lui.
Le petit brun prend Jérém dans ses bras et le caresse longuement dans le dos.
— Repose-toi bien frérot !
Jérém ne répond pas, l’air abasourdi, absent.
Maxime quitte la chambre à son tour. Mais moi je ne peux me résoudre à en faire de même. Pas avant d’avoir éclairci un point qui me tracasse.
— Jérém…
— Tu es encore là, toi ?
— Tu veux vraiment que je reste ?
— Pas du tout !
— Mais tu as dit que…
— J’ai juste dit ça pour emmerder mon père, il me coupe sèchement. Je veux que tu te casses aussi, j’ai pas besoin de toi, j’ai besoin d’être seul.
— Jérém…
— Mais qu’est-ce que tu ne comprends pas dans les mots « casse-toi ! » ?!?!?!?!
Je quitte la chambre en larmes. Je retrouve Maxime dans le couloir. Il passe un bras autour de mon cou, et tente de me réconforter.
— Pense à ce qu’a dit le type de ce matin dans le train. S’il est invivable, c’est parce qu’il est sous le choc, et parce qu’il a peur pour son avenir, il me glisse. Ce n’est pas lui qui envoie tout chier, c’est la panique qu’il ressent au fond de lui. Et désolé aussi pour le comportement de mon père, il ajoute, il s’est encore comporté comme un crétin !
— Tu n’as pas à t’excuser pour lui.
— Je sais, mais quand-même. C’est mon père, mais parfois il me fout la honte. Comment il peut enfoncer son fils blessé, alors qu’une minute plus tôt il disait regretter de ne pas l’avoir encouragé par le passé ?
— Mon père aussi a mal réagi quand il a appris que j’étais gay.
— Ce qui me fait le plus mal dans sa réaction, c’est qu’il l’ait montrée là, alors que Jérém a le moral au fond du seau. En ce moment, il n’a certainement pas besoin d’affronter l’hostilité de Papa en plus.
— C’est sûr…
La maturité et l’ouverture d’esprit de ce jeune garçon me touchent beaucoup. L’amour inconditionnel qu’il porte à son frère est profondément émouvant.
Nous allons déjeuner et il retourne aussitôt à l’hôpital. Il me demande de le laisser y aller seul, pour qu’il puisse parler à Jérém de frère à frère, et essayer de le calmer.
Le petit brun rentre à l’appart en début de soirée et m’annonce que la double opération de Jérém aura lieu le lendemain matin.
— Comment il va ?
— Il est toujours à cran et très remonté. Il a mal au genou et à la cheville. Et il a surtout peur, très peur.
— Il veut toujours que je parte ?
— Je ne sais pas. Il ne raisonne qu’à travers sa colère, il ne faut pas prendre sa réaction au pied de la lettre. On verra ça demain, après son opération. Si ça se passe bien, peut être que ça lui fera envisager les choses autrement.
— Oui, tu as probablement raison, j’admets.
— Est-ce qu’il a son portable avec lui ? je le questionne.
— Oui.
— Tu crois que je peux lui envoyer un message ?
— Je pense que ça lui fera plaisir. Même s’il ne veut pas l’admettre.
Je lui envoie un SMS aussitôt.
« Bon courage pour l’opération de demain. Je penserai à toi à chaque instant. Je prierai pour toi. Tout va bien se passer, ça ne peut pas se passer autrement. Je t’aime, p’tit Loup ! »
Je passe une nuit d’inquiétude, d’insomnie, de questionnements. Bien évidemment, aucune réponse ne vient de sa part. Pourvu que les opérations se passent bien !
Mardi 11 mars 2003.
J’ai encore très peu dormi de la nuit. La fatigue commence à s’accumuler. Je le ressens physiquement et moralement. Tous mes gestes et mes mouvements semblent me demander un effort décuplé, mes nerfs sont soumis à rude épreuve. J’ai l’impression d’être plongé dans un coltard épais. J’ai l’impression que le mal de crâne ne m’a pas quitté depuis l’accident de Jérém, et qu’il est de plus en plus carabiné.
Quand on n’est pas bien, on a du mal à être optimistes. Ce matin je ne suis pas bien, et je me sens très peu optimiste. La peur m’envahit, s’infiltre partout en moi, dans mon corps, ma tête, mon esprit. L’angoisse me tétanise. Je panique à l’idée que les opérations de Jérém puissent mal se passer. J’ai envie d’être à ce soir. Je donnerais cher pour pouvoir appuyer sur un bouton et zapper une à une les heures de cette journée qui s’annonce longue, comme je le ferais pour accéder à la dernière chanson d’un cd sans devoir écouter toutes celles qui précèdent.
Maxime est lui aussi tendu, et incroyablement silencieux. La peur doit happer son esprit tout autant que le mien.
Nous arrivons à l’hôpital juste avant que le jeune patient soit conduit au bloc. Maxime part le saluer en vitesse. Moi je n’en ai pas le temps. Je vois son lit passer dans le couloir poussé par deux infirmiers.
— Ça va bien se passer, je lui glisse, la voix coupée par les sanglots.
Mais aucune réaction ne vient de sa part. Le lit disparaît dans l’ascenseur, et mon Jérém avec.
L’opération dure une bonne partie de la matinée. Je trouve le temps terriblement long. Je tente de lire les magazines dans le hall, mais je n’arrive pas à focaliser mon attention.
A 11 heures, Jérém n’est toujours pas sorti du bloc.
Il est midi passé lorsque le lit médicalisé de Jérém réapparaît poussé par les deux infirmiers.
— Alors, comment ça s’est passé ? s’impatiente Maxime.
— Le médecin va venir vous voir bientôt.
— C’est quelle chambre déjà ? demande l’un des infirmiers, un petit brun au regard doux et charmant, à son collègue.
— La 401 ! Je t’ai connu plus appliqué, Damien !
— Je suis un peu fatigué… hier soir j’étais de permanence au SDIS.
— Infirmier et pompier volontaire, je tire mon chapeau, mec !
— Merci.
Le chirurgien se pointe une heure plus tard. Il s’entretient avec Maxime pendant de longues minutes.
— Il a dit que les deux opérations se sont bien déroulées, m’annonce le petit brun dans la foulée.
J’ai l’impression qu’un énorme poids s’est envolé de mon cœur. Je prends une longue inspiration et soudain la vie me paraît plus belle.
— Pour la sortie de l’hôpital, il doit voir ça avec le neurologue qui suit le traumatisme crânien.
— Et pour la suite ?
— Pour la suite, il préconise quatre semaines de repos total, puis un transfert au centre à Capbreton pour une rééducation qui va durer plusieurs mois.
— A Capbreton dans les Landes ?
— Oui, c’est ça. Il y a un centre spécialisé pour la remise en état des sportifs blessés.
— Et il a dit quelque chose sur ses chances de rejouer au rugby ?
— Il m’a dit que c’est trop tôt pour se prononcer là-dessus. Il faut voir comment évoluent ses blessures, et les réparations des blessures, dans les semaines à venir. A ce stade, tout reste possible, mais rien n’est gagné non plus.
Le neurologue reçoit Maxime en début d’après-midi. Il lui explique qu’étant donné que Jérém avait déjà eu un traumatisme crânien par le passé, il souhaite le garder en observation pendant encore quelques jours.
— Il semblerait que pendant quelques semaines la commotion cérébrale puisse provoquer un certain nombre de symptômes, il m’explique.
— Comme quoi ?
— Comme des étourdissements, des insomnies, des maux de tête, des angoisses, des pertes de mémoire, la déprime.
— Putain… je souffle, dépité.
— Pendant un certain temps, il va être à fleur de peau. Il va falloir le ménager. Et il faut se blinder… car il risque de tirer à boulets rouges.
Jérém se réveille en fin d’après-midi. Je retourne le voir avec Maxime. Malgré la mise en garde de ce dernier, je ressens au fond de moi un petit espoir qu’il soit dans de meilleures dispositions que la veille. Mais, malgré la bonne réussite de ses opérations, il ne s’est pas calmé, et il est toujours aussi remonté.
— Mais qu’est-ce que vous avez tous à me casser les couilles ? il nous lance, en guise de bonjour. Je n’ai besoin de personne, à part de bons médecins. J’ai envie de voir personne, vous pouvez comprendre ça, oui ou non ? Quand j’aurai besoin de voir quelqu’un, je vous sonnerai, ok ?
— Mais frérot, si on est là, c’est parce qu’on t’aime !
— Je ne veux pas que vous me voyiez dans cet état, c’est si dur à comprendre ? Je ne veux pas voir la pitié et la trouille dans vos yeux ! J’en ai assez en moi, de trouille ! J’ai pas besoin d’ajouter les vôtres, sinon je me jette par la fenêtre !
Jérém est hors de lui. Ça m’arrache le cœur de devoir le laisser dans cet état, mais je comprends son souhait.
— C’est quoi encore ce raffut ! fait la même infirmière qui nous avait déjà grondés hier. Mr Tommasi vient de subir deux opérations lourdes, il lui faut du calme et du repos. Alors je vous demande de sortir. Sortez !
— Voilà, fait Jérém, faites-les sortir, moi ils ne m’écoutent pas !
— Vous êtes bien des gars du Sud, bien sanguins, toujours en train de vous bagarrer ! elle plaisante.
En sortant de la chambre, j’ai le cœur lourd et les joues humides. Je regarde Maxime, et je pense qu’il est aussi triste que je le suis. J’attrape sa main, instinctivement, pour essayer de l’apaiser, pour essayer de m’apaiser.
Nous n’avons pas fait dix pas en dehors de la chambre, lorsque je capte au loin dans le couloir une silhouette masculine aux proportions parfaites, avançant vers nous d’un pas léger, souple, cadencé, élégant. Sa chevelure et sa barbe blonde si reconnaissables me percutent à l’instant où elles traversent ma rétine. Son sourire me frappe de plein fouet. Il m’a reconnu aussi.
— Salut Nico ! me lance Ulysse lorsqu’il arrive près de nous.
— Salut…
— Salut, fait Maxime. Tu es Klein, c’est ça ?
— Oui, lui-même. Et toi tu es ?
— Le frère de Jérém.
— Ah, Maxime, c’est ça ? Ton frère parle beaucoup de toi.
— Nous sommes très proches.
— Alors, comment sont les nouvelles ?
— A priori, l’opération s’est bien passée. C’est le moral qui ne va toujours pas.
— Les blessures au moral ce sont les plus difficiles à réparer, commente le beau rugbyman blond.
— Tu tiens le coup, Nico ? il me questionne, alors que Maxime vient de partir boire un café.
— Ouais…
— Je suis content de te revoir, même si c’est pas pour une occasion joyeuse.
— Ouais…
— Tu lui as parlé ?
— Il ne veut plus me parler, il ne veut plus me voir. Il m’a crié dessus, il veut que je me casse !
— Jérémie n’est pas dans son état normal, il ne faut pas lui en vouloir. Mais tu comptes beaucoup pour lui.
— Il prétend le contraire…
— Il ne faut pas croire les conneries qu’il peut raconter alors qu’il est dans un lit d’hôpital avec une jambe en vrac et la peur de ne plus jamais jouer au rugby au ventre !
— De toute façon, tu le connais mieux que moi désormais ! je lui balance sèchement.
Le fait de le voir là, devant moi, si gentil, si calme, si beau, si viril ravive violemment la blessure encore ouverte au fond de moi. La blessure provoquée par les mots de Jérém, lorsqu’il m’avait balancé à la figure qu’il était attiré par son co-équipier parce que ce dernier était un « homme », celui dont il avait besoin et que je ne suis pas. Ulysse est un homme, et comment il l’est, je le ressens si fort au fond de moi, alors qu’il est tout proche. Il dégage un magnétisme, une aura, un charme fou, auxquels je suis fort sensible, et dont je me sens totalement dépourvu. Je comprends parfaitement pourquoi et comment Jérém puisse se sentir attiré par ce gars. Et en même temps, ça me déchire les tripes de ne pas me sentir à la hauteur de ses attentes.
Ces deux pensées se mélangent dans ma tête avec la violence d’un tambour de machine à laver en plein essorage. Leur mouvement incessant me donne le vertige. Je me sens très mal à l’aise. Il y a quelque chose d’humiliant dans le fait de se trouver nez-à-nez avec celui qui a pris la place que vous occupiez dans le cœur de l’être aimé. Celui qui vous a été préféré. Celui qui possède ce que vous ne possédez pas, les arguments pour retenir celui que vous n’avez pas pu retenir. Je suis aussi terriblement fatigué. Alors, je n’ai pas la force de prendre sur moi. Ce qui me rend distant, sec et cassant.
Ulysse doit sentir mon animosité, puisqu’il finit par se lancer dans une petite mise au point.
— Ecoute-moi, Nico. Je ne sais pas ce qu’il t’a dit, et je ne sais pas ce que tu imagines s’il ne t’a rien dit. Mais il faut que tu saches qu’il ne s’est rien passé entre ton mec et moi.
— Ce n’est plus mon mec !
— Bien sûr qu’il l’est toujours. Ce n’est pas parce que vous vous êtres brouillés pour une connerie que votre histoire est finie. Jérém t’aime à s’en rendre malade.
— C’est toi qu’il kiffe !
— Allons, Nico, ce n’est pas moi qu’il kiffe !
— Il me l’a dit !
— Je lui fais peut-être de l’effet, ok. Mais ce qu’il kiffe par-dessus tout, c’est notre amitié et notre complicité. C’est mon regard qui le porte et qui le pousse à se dépasser. Voilà ce qu’il kiffe chez moi. Jérémie est un grand garçon, mais au fond de lui il a besoin d’être entouré, rassuré, soutenu, encouragé. Dans notre amitié, je tiens plutôt le rôle de « grand frère », comme l’a fait auparavant ce Thibault dont il me parle souvent. Tu dois le connaître, il joue à Toulouse…
Me voilà ému par les mots du beau blond. En quelques secondes, mon esprit passe d’un état de frustration et de jalousie à celui d’une profonde tendresse.
— Oui, je le connais très bien. C’est un garçon formidable, je finis par admettre, enfin un brin détendu.
— Je te promets qu’il ne s’est rien passé entre Jérémie et moi, il revient à la charge. De toute façon, je te mets à l’aise, je ne suis pas gay. Je respecte tout le monde et je ne juge personne, mais les gars, c’est pas pour moi. Et même si c’était le cas, je crois qu’il ne se serait rien passé quand-même. Mélanger le rugby, l’amitié et le sexe, ça ne me paraît pas une bonne idée. Ça risquerait de tout gâcher.
— Je te crois, Ulysse. Mais je ne suis pas du tout certain pour autant qu’il soit encore amoureux de moi.
— Je le répète et je signe, il continue sur un ton calme mais de plus en plus ferme, ce garçon est profondément amoureux de toi, quoi qu’il puisse raconter comme connerie. Et à partir de maintenant, il va avoir besoin de toi comme jamais. Si tu l’aimes, et je suis certain que c’est le cas, ne le laisse pas tomber, surtout pas maintenant.
— Mais comment veux-tu que je l’aide, alors que je ne peux même pas l’approcher sans me faire jeter !
— Tiens bon. Dis-toi toujours et encore qu’il ne t’en veut pas à toi, mais à sa blessure. Il n’est pas en colère contre toi, mais contre le fait qu’il ne pourra pas terminer la saison qu’il avait si bien démarrée. Mais il va finir par se calmer. La colère finit toujours par fatiguer son homme. Tu connais la fable du Chêne et du Roseau ?
— Je crois, je ne sais plus…
— Sous les vents redoutables, le Chêne tente de résister et se fait déraciner. Alors que le Roseau plie, mais il tient bon, il récite par cœur. Sois Roseau, Nico ! La tempête va arriver, mais elle repartira. Et tu seras toujours debout après son passage.
Les mots d’Ulysse me touchent énormément. Ce garçon a l’air sincère, et mon instinct me dit que c’est un chouette type. Un type vraiment formidable, comme Thibault justement.
Malgré tout, je passe une nuit horrible. Je ne sais pas comment me comporter. Rester à Paris, pour quoi faire ? Si je retourne voir Jérém, je suis sûr de me faire jeter. Et si je n’y retourne pas, à quoi bon rester ? Pour faire quoi ? Pourquoi rater mes cours ?
Mais repartir de Paris, alors que Jérém est dans cet état de détresse physique et psychologique me semble inconcevable. L’idée de rentrer à Bordeaux maintenant me donne envie de crever.
Mais comment retourner auprès de lui, après qu’il m’a crié qu’il ne m’a jamais aimé ?
J’ai beau me dire que c’est la frustration, le choc, la souffrance qui lui font dire ces mots qu’il ne pense pas. C’est quand même sacrément rude à encaisser.
J’ai encore oublié de rappeler Ruben, alors qu’il m’a appelé deux fois dans la journée. Je m’en veux de lui mentir, d’être absent. Mais pour l’instant, ça c’est le cadet de mes soucis.
Mercredi 12 mars 2003 au matin.
Le lendemain matin, je ne sais toujours pas ce qu’il convient de faire. Ou plutôt comment il convient de le faire. Je sais que je ne peux pas rentrer à Bordeaux. Mais quel comportement adopter vis-à-vis de Jérém ? Comment arriver à lui faire accepter ma présence ?
J’en parle avec Maxime. Le petit brun est plutôt de l’avis de lui laisser un peu le temps d’encaisser le choc.
— Rentre à Bordeaux, Nico. De toute façon Jérém est trop en pétard en ce moment, ça ne servirait à rien d’aller le voir et de le contrarier. Je vais rester quelques jours, je vais essayer de lui parler. Je t’appellerai quand il se sera un peu calmé, et tu reviendras le voir si tu veux bien.
Ça me fend le cœur de partir alors que Jérém sort tout juste de l’opération, alors qu’Ulysse m’a certifié qu’il aurait besoin de moi plus que jamais en ce moment. Mais Maxime a raison, ça ne servirait à rien de le contrarier et de me faire jeter.
Mercredi 12 mars 2003 au soir.
De retour à Bordeaux, je ne cesse de penser à Jérém, à son état d’esprit, à sa colère, à sa souffrance, à ses craintes pour son avenir sportif. Je voudrais tellement être à ses côtés, je voudrais tellement qu’il m’ait permis de rester.
Je sais que ma place est à côté du garçon que j’aime, un garçon blessé dans sa chair, dans son esprit, dans son rêve de gosse. Le fait que son frérot soit resté à ses côtés me rassure un peu mais n’enlève rien à ma frustration et à ma tristesse.
Je n’ai pas la tête à mes cours, je déprime dans mon petit studio comme un animal en cage.
Je suis trop mal, je n’ai pas le cœur à aller voir Ruben. Le jeune Poitevin commence à s’impatienter, à poser des questions. Je lui dis que je ne vais pas bien et que j’ai besoin de quelques jours pour aller mieux. Il me dit qu’il m’attendra.
Chaque soir Maxime m’appelle pour me donner des nouvelles de son frère. Les derniers examens neurologiques sont plutôt rassurants, Jérém va sortir de l’hôpital dimanche matin. Ils vont l’envoyer à la maison pendant trois semaines, puis direction Capbreton pour une prise en charge par une équipe de professionnels.
De temps en temps, j’envoie des SMS à Jérém.
« J’espère que tu vas bien. Je t’aime, p’tit Loup ! ».
« Je te souhaite que tout se passe bien. Je pense toujours à toi, p’tit Loup ! ».
« Je suis sûr que tout va s’arranger, mon amour ».
« Je suis heureux que tu sortes de l’hôpital, p’tit Loup ».
Mais jamais un seul message ne vient de sa part.
Les semaines suivantes, je retrouve le chemin des cours. Mais sans grande motivation. Je revois Ruben, là aussi sans grande motivation. Je n’ai pas envie de coucher avec lui, je n’ai pas du tout la tête à ça. Il me trouve triste et soucieux et il veut savoir ce qui se passe. Je n’ai plus la force de mentir.
— Il faut que je te dise quelque chose.
— Tu n’étais pas à Toulouse, hein ?
— Non…
— Tu es encore allé retrouver ton rugbyman comme l’été dernier ?
— Oui, mais c’est pas ce que tu penses…
— T’as encore couché avec lui ?
— Non, pas du tout. Je suis allé le voir parce qu’il a eu un très grave accident au rugby.
— Grave comment ?
— Il a le genou et la cheville en vrac.
— Et tu es parti lui remonter le moral ?
— L’accident était tellement horrible, je ne pouvais pas ne pas aller le voir. Mais je n’ai rien pu faire, il ne veut plus me voir.
— Pourquoi tu m’as encore menti ? Il me semble qu’on avait dit qu’il n’y aurait plus de mensonges entre nous.
— Je sais. Mais ça a été tellement soudain. Tout s’est enchaîné très vite. J’ai paniqué et j’ai encore pris la mauvaise décision. Je suis impardonnable. Je suis désolé.
— Tu es toujours amoureux de ton ex. Tu as voulu être proche de lui dans cette épreuve, et je le comprends. Mais moi je ne peux pas t’attendre indéfiniment, et je ne peux pas me contenter de ce mode de fonctionnement. Je t’aime, Nico, mais nous deux ce n’est vraiment pas possible, il faut se rendre à l’évidence. Je te souhaite tout le bien possible pour la suite, mais moi je dois avancer, j’ai besoin d’un mec qui soit à 100% avec moi.
— Je comprends. Tu es un garçon formidable Ruben, et tu vas trouver un garçon aussi formidable que toi et qui va te rendre heureux. Je regrette de ne pas pouvoir être ce garçon.
Jeudi 20 mars 2003.
Après des mois d’annonces et de révélations au sujet de l’arsenal militaire de Saddam, l’offensive en Irak est lancée. Des Boys vont partir à la guerre, y laisser leur jeunesse, leur santé physique, mentale, leur vie. Ils vont y aller de leur propre chef, mais poussés par une machine de propagande bien huilée. L’oncle Sam n’a pas encore fini de raconter l’histoire comme il l’entend et de faire croire que sa version est La Vérité. Des populations démunies vont souffrir à cause d’enjeux géopolitiques qui les dépassent et dont elles ne sont que des pions.
La guerre en Afghanistan est toujours là, dix-huit mois après son lancement. Cette chasse au terrorisme qui selon ses promoteurs devait être rapide et chirurgicale s’enlise dans ces montagnes désertiques, et les résultats se font attendre. Houssama est toujours aux abonnés absents, et le coût humain ne cesse de grimper de jour en jour. Et encore, on ne sait certainement pas tout.
Le traumatisme des avions du 11 septembre est toujours présent dans l’esprit collectif. La peur des attentats est partout, dans les médias, dans le débat public, dans la tête de tout un chacun.
Petit Portoricain, bien intégré quasiment New-Yorkais
(…) Petite fille Afghane, de l'autre côté de la Terre
Vendredi 21 mars 2003.
Dix jours après les interventions chirurgicales subies par Jérém, le printemps ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Les nouvelles de Paris rapportées par Maxime ne sont pas vraiment rassurantes.
— Son moral est de pire en pire. Il dort très peu, et parfois il est confus, il a du mal à se rappeler les choses. Il est taciturne, nerveux, irritable. Et puis il y a ces terribles migraines qui ne le lâchent pas. Il n’a envie de rien. Il ne fait que fumer, boire des bières à longueur de journée et regarder la télé.
J’entends des bruits de voiture derrière lui. Visiblement le petit brun est dans la rue, j’imagine qu’il m’appelle en cachette de son frère pour ne pas se faire engueuler.
— Le neurologue dit que ce sont des symptômes normaux après une commotion cérébrale et qu’ils vont progressivement disparaître en quelques semaines. Mais en attendant, je ne reconnais plus mon frère. J’essaie de garder le moral, j’essaie de me montrer optimiste devant lui. Mais c’est dur d’être à ses côtés.
Je sens que le petit brun est à bout de nerfs et qu’il a du mal à tenir le coup.
— Dans quelques jours il va partir à Capbreton, et il ne veut surtout pas entendre parler que je puisse le suivre là-bas. Mais ça m’arrache le cœur de le laisser partir seul, dans cet état.
— Il va être pris en charge par les meilleurs spécialistes, je tente de le rassurer.
— Je sais. Mais s’il va toujours aussi mal, il ne se donnera pas à fond pour remonter la pente. Le fait est qu’il n’y croit pas. Il pense qu’il est foutu et que plus jamais il ne jouera au rugby. Il est tellement négatif qu’il me fiche les boules à moi aussi. Il ne me parle plus. Parfois, j’ai l’impression de voir un animal blessé qui se laisse mourir.
— Tu as beaucoup de mérite à rester à ses côtés.
— Je ne lui apporte rien, il est de plus en plus mal.
— Si, tu lui apportes beaucoup. Il t’adore, et si tu n’étais pas avec lui, il serait encore plus mal. J’aimerais tellement venir te relayer pour que tu te reposes un peu… j’ajoute.
— Il ne veut voir personne. Il tolère juste ma présence, et encore !
— Et il ne veut surtout pas me voir, moi, j’imagine…
— J’avoue que j’ai du mal à comprendre ce qui se passe dans sa tête. Je veux bien qu’il ait sa fierté, qu’il ne veuille pas se montrer diminué. Mais putain, on l’aime, et c’est tout ce qui compte !
Lorsque je raccroche mon portable, j’ai un goût très amer dans la bouche. Jérém est au plus mal, et même Maxime commence à perdre pied. Je me sens impuissant, frustré, consterné.
J’ai envie de pleurer. La solitude de mon petit studio me pèse. J’ai besoin d’entendre une voix familière, bienveillante, rassurante.
J’appelle Thibault. Je discute longuement de l’état de Jérém avec lui, ainsi que du fait que Maxime a de plus en plus de mal à tenir le coup. Au bout d’une demi-heure de conversation, le beau rugbyman me lance :
— Tu peux te libérer jeudi prochain ?
— Oui, pourquoi ? je bafouille, surpris.
— Je monte le voir à Paris. Tu viens avec moi ?
— Mais avec grand plaisir !
Jeudi 27 mars 2003.
Lorsque j’arrive à la gare Montparnasse, Thibault m’attend à côté de la ligne de métro. Ça fait du bien de retrouver un visage connu dans cette ville où tout m’est inconnu. Le jeune pompier me fait la bise et me serre fort dans ses bras. Sa présence, son attitude, son torse, ses bras sont tellement rassurants !
Après un passage par le métro, nous débarquons à l’appart de Jérém par surprise. En fait, la surprise n’est que pour ce dernier, car Maxime est au courant.
— Il va de soi que ce n’est pas le bon moment pour que Jé apprenne ce qui s’est passé entre nous, me glisse Thibault alors que nous montons par l’ascenseur.
— Il va de soi…
— Je ne regrette toujours pas, au contraire. Je dis juste que ce n’est pas le bon moment, il s’empresse de préciser.
— J’avais bien saisi, et je te suis à 100%.
Thibault sonne à la porte. Un instant plus tard, le petit brun nous accueille avec un sourire dans lequel il n’est pas difficile de deviner une insistante note de tristesse.
— C’est qui ? j’entends Jérém le questionner depuis le séjour.
— C’est quelqu’un qui vient te voir.
— Je ne veux voir personne.
Ça promet…
Maxime nous fait rentrer. L’appart empeste la fumée de cigarette et le joint. Jérém est affalé sur le canapé, la jambe enserrée dans une botte de maintien, posée sur la table basse. Il est tout habillé avec un jogging blanc à bandes noires. Deux béquilles sont posées contre le canapé, à côté de lui. Sur le meuble à sa droite, un cendrier rempli à ras bord de mégots trône juste à côté d’innombrables bouteilles de bière vides.
— Jé, mon pote ! lui lance Thibault.
— Thib !
Jérém a l’air surpris de voir son pote débarquer, mais pas contrarié. Il a même l’air très touché. Et ému. Thibault se penche vers lui et le prend dans ses bras. Il l’embrasse deux fois sur la joue et lui caresse le cou et la nuque.
— Salut, Jérém, je lui lance, lorsque l’accolade entre les deux potes prend fin.
— Salut… il me lance assez froidement, le regard ailleurs.
Ce n’est pas encore un accueil qu’on caractériserait de chaleureux, mais il y a du mieux par rapport à la dernière fois. Déjà, je ne me suis pas fait jeter !
— Ça vous dit si je fais des pâtes ? nous demande Maxime.
— Parfait ! lui répond Thibault.
— Comment tu vas, mon petit Jé ? enchaîne l’adorable pompier.
— Comme tu le vois, comme une épave !
— Mais qu’est-ce que tu racontes ! Tu oublies que j’ai été mécano et que je sais très bien reconnaître une épave d’une belle voiture accidentée. Toi, tu es une très belle voiture accidentée. Une fois réparé, tu vas être comme neuf.
— Non, tu te trompes, je suis une épave. Je ne serai jamais comme neuf.
— Tu crois que tu es le premier joueur de rugby à subir ce genre des blessures ? Et qu’il n’est pas possible d’en guérir et de revenir au top ?
— Le chirurgien n’y croit pas lui-même ! Et quand même le mécano ne croit pas en la réparation de la voiture qu’il vient de passer sur le pont, je te fais pas un dessin !
— Le chirurgien n’a jamais dit qu’il n’y croit pas, intervient Maxime. Il dit juste qu’il a besoin de voir comment tes lésions guérissent avant de pouvoir faire un diagnostic fiable.
— Il y a des réparations qui demandent du temps, avance Thibault.
— Ouais, ouais.
— Là, il ne se passe rien parce que tu es en phase de cicatrisation et que tu ne peux rien faire, avance le demi de mêlée. Tu te fais chier et tu ne vois aucun progrès. Mais quand tu seras à Capbreton, tu vas progresser.
— J’espère qu’ils ont un service spécialisé dans les miracles, fait Jérém, l’air complétement désabusé.
— Pour guérir, il faut y croire. Je suis passé par là, après mon accident à AZF. Oui, ma blessure était moins grave que la tienne. Mais j’ai eu des doutes comme toi, j’ai eu peur comme toi. Et pour m’en sortir je me suis raccroché à un but, celui de retrouver ma forme d’avant et de retourner jouer. Il faut être patient, et ne pas vouloir que les choses aillent trop vite.
— Oui, oui, allez, parlons de choses plus marrantes, j’entends Jérém balayer le sujet d’un revers de main. Avant d’enchaîner sur un tout autre sujet : Tu as des nouvelles de Thierry et de Thomas ?
Thibault n’insiste pas, et il suit Jérém sur ce nouveau terrain. Pendant l’apéro et le repas, les deux potes d’enfance renouent avec leur complicité d’antan en évoquant leurs potes de Toulouse, leur vie d’avant, leurs expériences communes, leurs souvenirs du rugby. Jérém s’anime peu à peu au contact de Thibault. Ce dernier sait le faire réagir, et même le faire sourire. Il le connaît tellement bien. Et il est tellement sensible, avisé, psychologue.
Son tact est tel qu’il arrive à tout lui dire sans le braquer.
— Jérém, ton frère à l’air fatigué, il lui balance au détour d’une conversation.
— Je sais, je suis un véritable boulet en ce moment. Et mon frérot est un ange, il a du mérite à rester ici avec moi.
— Dans quelques jours je pars pour Capbreton, je te libère, il lance à Maxime.
— Ça va être long, fait le petit brun, à moitié en rigolant, à moitié sérieux.
— Si Maxime doit reprendre ses cours, je peux rester quelques jours jusqu’à ton départ à Capbreton… je lance.
Jérém me regarde de travers.
— Et tes cours ? me questionne Thibault.
— Je les rattraperai plus tard.
— Je n’ai pas besoin de ton aide, je me débrouillerai tout seul, me balance Jérém sèchement.
— « Tout seul », tu vas déprimer à fond, lui glisse Thibault.
— Je sais me gérer, merci, il s’agace.
— Pourquoi tu ne veux pas que je reste ? je le questionne.
— Je ne veux pas de ta pitié ! il me crie dessus.
— Je n’ai aucune pitié pour toi, je veux juste te filer un coup de main ! je m’emporte à mon tour.
— Bon, vous nous cassez les couilles tous les deux, fait Thibault, l’air facétieux. Hein, Maxime, qu’ils sont insupportables ces deux-là ?
— Un peu…
— Nous on va prendre un café, et vous vous arrangez pour vous calmer d’ici que nous soyons revenus, continue le jeune pompier.
— Avec grand plaisir ! fait le petit brun qui a de toute évidence compris le but de la manœuvre de Thibault, celui de permettre à Jérém et moi de rester un peu seuls pour régler nos histoires entre nous.
La porte vient tout juste de se refermer derrière les deux adorables petits mecs, que déjà le silence devient assourdissant. Je sens sa colère, sa mauvaise humeur, sa contrariété, son hostilité jamais dissipées. Bref, que des ondes négatives. J’ai envie de briser ce silence de plomb, mais j’ai peur de me faire rembarrer. Je choisis d’attaquer par un truc marrant.
— Tu sais que depuis que tu joues au Stade, mon père est ton premier fan ?
— Qu’est-ce que tu veux que ça me fasse ?
— Il adore te regarder jouer, il dit que tu es un sacré ailier !
— Maintenant je ne suis plus qu’une merde. Tu peux lui dire qu’il ne me reverra plus jamais jouer.
— Pourquoi tu dis ça ?
— Parce que c’est vrai ! C’est foutu pour moi, je suis foutu.
— Non, tu es juste convalescent.
— Je ne rejouerai plus jamais au rugby.
— Je te promets que si !
— Casse-toi, Nico, qu’est-ce que tu fiches encore ici ?
— J’aimerais rester là pour t’aider, et pour que tu ne sois pas seul.
— Je t’ai déjà dit que n’ai pas besoin de ton aide. De toute façon tu ne peux pas me rendre mon genou et ma cheville !
— Non, c’est sûr. Mais je pense que je peux te faire à manger, t’aider à t’habiller, aller te chercher les cigarettes. Et te faire des câlins si tu en as envie. Tiens, je peux même essayer de jouer à la PS si vraiment tu insistes…
— Tu serais nul à chier, et je m’ennuierais à mort !
Ah, voilà enfin un point d’accroche pour le faire réagir. Il a fallu chercher longtemps !
— Tu vas m’apprendre…
— Tire-toi, Nico, oublie-moi, c’est ce que tu as de mieux à faire ! Va retrouver ton type à Bordeaux !
— Il n’y a plus de type à Bordeaux.
— Il y en aura d’autres. Vas-y, vis ta vie et fiche-moi la paix !
— Ma vie, c’est toi, Jérémie Tommasi. J’ai beau essayer de m’éloigner de toi, de t’oublier, je n’y arrive pas. En fait, je ne le veux pas.
— Si tu restes, je vais te pourrir l’existence, je vais te rendre fou !
Dans sa voix, je sens que la colère laisse peu à peu la place au désarroi, à la désolation. Jérém n’a plus la force de se battre. Il est en train de se noyer.
— Ça fait cinq ans que tu me rends fou !
— Je vais encore te faire du mal, je finis toujours pour te faire du mal !
Je sens que sa tension intérieure va bientôt éclater.
— Je tiens le coup, comme tu le vois…
Soit il va me gueuler dessus, soit…
— Si tu savais comme je suis mal ! je l’entends me glisser, la voix cassée par des sanglots étouffés, refoulés.
… soit, il va lâcher prise et laisser les larmes diluer sa souffrance.
J’avais pressenti que ce coup-ci la colère laisserait la place aux larmes. Pendant nos échanges, Jérém ne m’a pas trop donné l’occasion de croiser son regard. Mais du peu que j’ai pu en capter, j’ai vu à quel point cet accident l’a affecté. C’est dur de voir que quelque chose s’est brisé au fond de son regard. Que son assurance, sa confiance en l’avenir, et une certaine insouciance de jeunesse ont disparu en laissant la place à la peur.
Je m’approche un peu plus de lui, je le prends dans mes bras. J’ai toujours peur d’un rejet inopiné, mais je prends sur moi.
Jérém tente d’abord de me repousser, de se débattre. Mais le cœur n’y est plus. Le beau brun dépose vite ses armes, visiblement épuisé. C’est un épuisement mental, moral, plus que physique. Je le serre très fort contre moi. Je le caresse doucement, je pose quelques baisers légers dans son cou. Les sanglots deviennent plus sonores, ils secouent son torse.
C’est dur de voir Jérémie pleurer. Ses larmes passent de ses joues aux miennes, et elles me communiquent toute sa souffrance. Une souffrance refoulée, pleine de colère, une colère pleine de désespoir.
— Va-t’en, Nico, pars loin d’ici ! Tu vois pas que je suis en train de couler ? Ne coule pas avec moi !
— Je ne partirai que quand tu iras mieux. Et personne ne coulera. Je te promets que tu iras mieux. Je te promets qu'un jour tu joueras à nouveau au rugby et encore mieux qu’avant l’accident. Je te promets qu’un jour tu gagneras le Top16 avec le Stade. Mais pour ça, il faut y croire. Pour cela, il faut continuer à croire en tes rêves.
Oui, je sais que je distribue de l’espoir à crédit, à découvert, sans me couvrir d’aucune garantie, en prenant un risque fou. Mais en voyant Jérémie dans cet état je ne peux faire autrement que tenter de lui donner de l’espoir, coûte que coûte. J'ai besoin d'y croire et je veux qu'il commence à l'envisager lui aussi.
Je pense aux mots du chirurgien du train :
« Et surtout, il faut s’arranger pour qu’il n’arrête jamais d’y croire, même s’il prétend le contraire. Car l’espoir est l’élément clé de la guérison. Il n’est bien évidemment pas suffisant, mais il est terriblement nécessaire ».
— Tout est possible, tant qu’on continue à rêver, je lui glisse, alors que mes sanglots se mélangent aux siens.
If I Can Dream.
And while I can think, while I can walk/Et tant que je peux penser, tant que je peux marcher
While I can stand, while I can talk/Tant que je peux me tenir debout, tant que je peux parler
While I can dream, please let my dream/Tant que je peux rêver, s’il vous plaît laissez mon rêve
Come true…. Right now !/Devenir réalité…. Maintenant !
Let it come true right now !/Laissez-le se réaliser, maintenant ! 16 commentaires
16 commentaires
-
Par fab75du31 le 30 Juillet 2022 à 14:37
Samedi 1er mars 2003.
Le bus vient de s’arrêter pile devant nous. Les portes s’ouvrent et laissent sortir un peu de monde.
— C’est très gentil, Nico, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée.
— Pourquoi ce ne serait pas une bonne idée ?
— Parce que j’ai trop peur de ce qui pourrait se passer si je viens chez toi.
J’avais vu juste. Thibault a lui aussi envie de passer la nuit avec moi. Mais il a peur des conséquences, tout autant que moi.
— Moi aussi, j’en ai peur, j’enchaîne, mais j’en ai très envie aussi !
— Moi aussi j’en ai envie… mais je crois que nous ferions du mal à trop de monde.
— Tu as certainement raison. Au fond, je pense la même chose.
Les portes du bus se ferment et l’engin reprend sa course.
— Ah, crotte, il est reparti ! il s’exclame. Tant pis, je prendrai le prochain. Je ne veux pas causer encore des problèmes, il continue, tu comprends ? J’ai déjà foutu assez le bazar la dernière fois quand j’ai craqué avec Jé. Ça m’a presque coûté l’amitié avec mon meilleur pote, et j’ai failli te perdre toi aussi. Avec Jérém, ça s’est un peu arrangé depuis. Mais s’il se passe quelque chose toi et moi et s’il l’apprend, je vais le perdre définitivement. Et puis, tu as quelqu’un…
— Ruben ne compte pas vraiment…
— Et Jé ? Il compte, lui, non ?
— Bien sûr qu’il compte. Il me manque tellement, si tu savais ! Mais je n’ai pas la moindre idée de ce qu’il fait en ce moment, ni avec qui il est, ni si je le reverrai un jour.
— Je suis certain que vous allez vous revoir.
Le bus suivant se pointe au loin et avance tout aussi vite que le précèdent.
— Et puis, de toute façon, tu as quelqu’un aussi, je considère. Passe une bonne soirée, j’ajoute, en essayant de retenir mes larmes.
Des larmes qui sont le symptôme d’une tristesse dans laquelle se mélangent le manque de Jérém, qui est si loin, et la frustration de ne pas pouvoir retenir Thibault, qui est pourtant tout près de moi.
Le beau rugbyman me prend dans ses bras et me serre fort contre son torse solide. Je plonge mon visage dans son cou, il en fait de même. Ce contact physique et olfactif provoque d’intenses frissons en moi.
— Eh, merde, j’ai vraiment pas envie de partir, je l’entends me glisser à l’oreille.
— Alors, reste.
[Mardi 28 janvier 2003, 2h06.
Tu as horreur de la paperasse. Tu n’ouvres ta boîte aux lettres que lorsqu’elle déborde. Et tu ne tries ton courrier que quand tu as besoin de faire de la place sur la table de ton séjour. Ou quand tu fais des insomnies.
L’enveloppe arrivée de Bordeaux est restée ignorée avec tant d’autres pendant de nombreux jours. Elle était coincée dans un encart publicitaire, et elle a failli partir à la poubelle avec. Heureusement, elle est tombée pile à tes pieds, et du côté de l’adresse. En voulant la ramasser, ton regard est tombé dessus. Tu as immédiatement reconnu son écriture. Et ton cœur a fait un bond dans ta poitrine.
Inutile de prétendre le contraire, Jérémie. La lettre que Nico t’a envoyée t’a énormément touché, et depuis les tout premiers mots. Au fur et à mesure que tu les lisais, tu as senti ta poitrine se serrer si fort que tu as fini par avoir l’impression de ne plus pouvoir respirer.
Cette lettre, totalement inattendue, carrément bouleversante, tu l’as lue et tu l’as relue, et elle t’a tiré des larmes. Car c’est la première fois que tu lis « je t’aime ». Et tu réalises que, si te l’entendre dire c’est merveilleux, le lire, c’est encore autre chose. Les mots dits passent. Et même s’ils résonnent dans ton esprit, leur souvenir n’est pas aussi saisissant que la présence durable de ceux qui sont écrits, et que tu peux relire à chaque fois que tu en as envie. Les mots écrits ne disparaissent pas. De plus, ils sont chargés de l’intention de celui qui les a écrits, de les faire arriver jusqu’à toi.
Pendant qu’il écrivait cette lettre, Nico était loin de toi. Et, pourtant, il a pensé à toi. Il a pensé à toi avant de l’écrire, pendant qu’il l’écrivait, en la postant, et encore après l’avoir postée. Il a dû se demander, et il doit probablement toujours se demander, ce qu’elle allait t’inspirer.
Cette lettre a traversé son esprit, sa main, puis des centaines de bornes pour arriver jusqu’à toi. Et maintenant, ces mots sont à toi, tant que tu voudras les conserver.
Et ce sont des mots d’amour, de bien beaux mots d’amour. Une preuve tangible de l’existence, de la persistance de son amour. Cet amour qui te manque à en crever. Et le fait de le retrouver intact, après l’avoir tant malmené, te vrille les tripes.
Si ses mots te touchent tant, c’est parce qu’ils pourraient être les tiens. Si seulement tu avais le cran de les exprimer.
Parce que pour toi aussi quelque chose de spécial a commencé au lycée, la première fois que tu as capté son regard. Tu as d’abord senti qu’il était impressionné par toi, comme pas mal de monde, d’ailleurs. Tu as senti son désir, timide, gêné, et pourtant brûlant. Mais tu as vite compris qu’il n’y avait pas que ça dans son regard.
En fait, tu as surtout senti qu’il avait vu que sous ta carapace de frimeur insolent, de petit con, de petit macho, se cachait un garçon sensible avec un énorme besoin d’être aimé. Et ça, c’était la première fois que tu le ressentais. Pour la première fois, tu avais l’impression que quelqu’un t’avait percé à jour.
Cela t’avait d’abord mis en pétard. Depuis ton adolescence, tu avais tout fait pour cacher tout ça, ce que tu considérais comme tes faiblesses. Tu avais fait des pieds et des mains, des milliers d’heures de muscu et d’entraînement au rugby, de dizaines de nanas baisées et jetées juste après pour être considéré comme un « vrai mec », pour être respecté, jalousé, envié. Et tu y étais parvenu.
Et là, en croisant le regard de Nico, tu avais l’impression d’être mis à nu. Tu avais l’impression que ce regard anéantissait tous tes efforts pour te créer une image dans laquelle tu te sentais à l’aise.
Il t’a fallu trois ans pour trouver le cran de laisser ce garçon t’approcher.
Ses demandes de câlins, lors de vos premières « révisions » dans l’appart de la rue de la Colombette, tu les ressentais comme la preuve qu’il savait que tu en avais envie autant que lui. Et ça te braquait. Tu en avais envie, bien sûr, mais tu ne pouvais pas l’admettre. Tu voulais être fort, tu voulais n’avoir besoin de personne.
Il t’a fallu longtemps pour lâcher prise, pour faire confiance. Il t’a fallu un clash, il t’a fallu ressentir la peur, le vertige de l’avoir perdu, pour y parvenir.
C’est à Campan, lorsque tu as vu Nico apparaître sous la halle malgré la pluie battante, malgré tout le mal que tu lui avais fait subir, que tu as enfin su ce qu’être heureux signifiait. C’est quand tu lui as fait l’amour dans la petite maison dans la montagne, et que tu as accepté sa tendresse et sa douceur, que tu t’es enfin senti en phase avec toi-même.
Ça t’a fait un bien fou de laisser s’exprimer cette partie de toi, celle que Nico a appelé dans sa lettre « cette douceur qui est en toi et que tu caches trop souvent ». Dans ses bras, après l’amour, tu as enfin eu l’impression de respirer à pleins poumons. Tu n’avais jamais ressenti cela auparavant.
Depuis tes toutes premières expériences sexuelles, tu n’avais jamais supporté aucun contact physique, ni avec une nana, et encore moins avec un mec, après avoir joui. Te réveiller le matin à côté de celle ou de celui que tu avais baisé la veille t’était tout simplement insupportable.
Nico a changé pas mal de choses dans ta vie. Avec lui, tu as connu le bonheur d’un câlin après le sexe, celui de sentir sa présence dans ton lit la nuit, et celui de te réveiller à côté de lui le matin venu. Tu as connu celui de le voir heureux en l’appelant « Ourson ». Et celui de l’entendre t’appeler « P’tit Loup ».
Tu as pendant longtemps essayé de te convaincre qu’il ne t’aimait que parce qu’il te trouvait bogoss, et bon baiseur. Mais au fond de toi, tu as toujours su que son amour ne s’arrêtait pas là, qu’il n’était pas qu’attirance, qu’il y avait bien plus que ça. Il te l’a montré en restant près de toi malgré tout ce que tu lui as fait endurer. Il te l’a montré lors de ton accident de voiture à Paris, lorsqu’il a pris les choses en main et qu’il t’a vraiment sorti du pétrin. Là, il t’a carrément impressionné.
Et toi, tu l’as blessé et déçu. Tu sais que tu as été injuste avec lui quand tu l’as comparé à Ulysse, qui a pas mal d’années de plus que lui. Tu sais que tu as été odieux lorsque tu lui as dit qu’il n’était qu’un gamin et en sous-entendant qu’il ne sera jamais « un homme ». Qu’il ne sera jamais assez bien pour toi.
« Je t’aime tel que tu es. Je t’aime pour tout, je t’aime tout le temps », « je t’aime malgré toutes nos différences ».
Ce sont les plus beaux mots qu’on t’ait jamais adressés. Et tu sais que ce ne sont pas des mots en l’air. C’est pour cela qu’ils te touchent autant.
Toi non plus tu n’aurais jamais pensé que c’était possible d’être aimé si fort. Et Nico t’a prouvé le contraire. Et il t’a montré aussi que c’était possible d’aimer un garçon, et de l’aimer d’une façon dont tu ne te serais jamais cru capable.
Après avoir lu sa lettre, tu as eu envie de l’appeler sur le champ. Mais il était deux heures du mat’ et tu t’es dit que ce n’était pas une heure pour renouer le contact avec le gars que tu aimes après l’avoir rejeté si brutalement. Tu t’es dit que tu le ferais le lendemain matin. Tu t’es endormi heureux et plein d’espoir.
Le lendemain matin, tu étais à la bourre et tu n’as pas pris le temps de le faire. Tu aurais dû. Parfois, il faut prendre le temps quand on en envie, avant que la vie nous mène sur des chemins imprévus. Car ce qui allait se passer ce jour-là, allait couper tes ailes et stopper net ton élan.
Mais au matin de cette journée qui allait se terminer d’une façon particulièrement pénible, tu te sens tout léger. L’envie de reprendre contact avec Nico te suit pendant tout le trajet vers le centre d’entraînement, et elle grandit en toi pendant tes exercices du matin. A midi, tu ne tiens plus en place. Tu te dis que c’est un gâchis monumental que de gaspiller tant d’amour et de bonheur. Car cet amour et ce bonheur sont trop rares et précieux pour passer à côté. Tu te dis que tu as été un vrai con de le jeter comme tu l’as fait, et que tu dois te rattraper avant que ce ne soit trop tard.
Tu te dis que ce béguin que tu avais pour Ulysse n’était rien comparé à ce qu’il y a entre Nico et toi. Et ce n’est pas parce qu’Ulysse t’est inaccessible. Tu sais que jamais Ulysse t’écrirait une lettre comme celle que t’a écrit Nico.
Pendant le match de l’après-midi, tu te demandes à quel moment de la soirée tu vas l’appeler, comment tu vas t’y prendre pour t’excuser, et pour éviter de te faire jeter. Car tu as peur de te faire jeter. En fait, tu as peur que ce soit déjà trop tard.
Mais ce jour-là, en fin d’après-midi, quelque chose allait se passer à la sortie des douches, quelque chose qui contrarierait complètement tes plans.
Juste avant que tu partes du centre d’entraînement, ton agent t’appelle et te demande de passer à son bureau au plus vite. D’après le ton de sa voix, tu sens qu’il se passe quelque chose de grave. Tu lui demandes ce qui se passe, mais il te dit qu’il t’en parlera de vive voix. Tu cogites. Tu t’inquiètes.
— Je t’ai fait venir parce que je dois te parler d’un truc un peu délicat… il te balance direct, le regard planté sur toi.
— Quel truc ? tu lâches, soudainement inquiet.
— Alors voilà : hier soir j’ai reçu un coup de fil d’une amie qui travaille dans un torchon à scandales. Il s’agit du plus con et en même temps du plus vendu de tous les torchons dans son genre…
— Et ?
— Apparemment, l’un de leurs journalistes aurait eu vent de certains bruits qui courent sur toi.
— Quels bruits ?
— Il semblerait qu’il t’arrive de traîner dans des lieux un peu douteux.
— Quels lieux douteux ?
— Allez, Jérémie, on va jouer cartes sur table, ça nous fera gagner du temps.
— Mais de quoi vous parlez ?
— On t’a vu traîner dans des boîtes à pédé.
— N’importe quoi !
— Tu sais, il n’y a pas que des avantages à être connu. La vie privée, tu oublies. Surtout maintenant qu’on te voit presque à poil à la télé et partout dans la rue ! Ton corps attire les regards, ta belle tronche aussi, alors on commence à te reconnaître.
Ce que tu avais redouté est en train d’arriver. Tu te sens humilié, tu as envie de disparaître dix mètres sous terre. Tu as l’impression d’avoir le visage en feu, la poitrine resserrée sur tes poumons.
— Ça a dû arriver une fois… tu tentes de minimiser.
— D’après ce qu’elle a entendu, c’est arrivé plusieurs fois.
Tu ne sais plus quoi répondre, tu essaies de donner des explications confuses. Mais tu sens que tu t’enfonces un peu plus à chacun de tes mots, comme quelqu’un qui essaierait de s’extirper de sables mouvants en se débattant.
— T’inquiète pas mon garçon, je ne te veux aucun mal, bien au contraire. Je te trouve sympathique, et je veux t’aider, si tu m’en laisses l’occasion.
— Comment voulez-vous m’aider ?
— Il y a une solution à tout, pour peu qu’on se donne la peine de l’envisager. D’abord, saches que perso, je m’en fous que tu te tapes des mecs. C’est ton droit, tu fais ce que tu veux de ta vie. Ça ne change rien pour moi, et cette conversation ne sortira pas de ce bureau. Mais il vaudrait mieux pour toi que ces bruits cessent au plus vite, il continue. Si tu veux être respecté par tes coéquipiers, le staff, tes adversaires, le public, il ne faut pas que ça se sache que tu es… comme ça. Si tu veux mener à bien ta carrière, il ne faut pas que ça se sache. Si ça se sait, tu seras confronté à des regards suspicieux, moqueurs, hostiles. Tu connaîtras le rejet, les insultes. On te fera la misère. Et si tu as tout ça à gérer, tu ne seras pas assez concentré sur le rugby. Et si tu n’es pas à 200 % dans le rugby, tu vas foirer ta carrière. Si tu es déstabilisé par ce genre de conneries, tu ne pourras plus avancer. Ce serait comme être lesté d’un poids de 50 kilos en permanence sur tes épaules. Tu serais en permanence sous pression, et tu ne tiendras pas jusqu’à la fin de la saison. Tu comprends, mon grand ?
— Ouais, ouais, ouais…
— Il faut aussi penser aux sponsors. Si ça s’ébruite, je ne donnerais pas cher de ton contrat avec les boxers. Ils filent beaucoup de blé, à toi et au club, et ce serait dommage de rater ça.
— Alors, qu’est-ce que vous proposez concrètement ? Tu t’impatientes, t’inquiètes, t’irrites.
— Je t’explique, c’est très simple. La meilleure défense, c’est toujours l’attaque. Mon amie du torchon me propose un marché gagnant-gagnant.
— Un marché ?
— Elle voudrait raconter une histoire dont tu serais le protagoniste.
— Quelle histoire ?
— L’histoire d’un rugbyman connu qui a une idylle avec une nana connue.
— Quelle nana connue ?
— J’imagine que tu ne regardes pas la Star Ac…
— Non, pas du tout !
— Je m’en doutais. Donc tu ne sais pas qui est Alexia…
— C’est pas la blonde aux gros nichons ?
— Ah, je vois que tu connais les émissions télé avec les critères du public masculin ! T’es sûr que t’es pédé ? Je rigole, je rigole. Oui, c’est pile-poil elle. Tu vois, cette conasse ne sait pas chanter pour un sou, elle a l’éducation d’un marcassin, l’intelligence d’un poulpe, mais justement, elle a de gros nichons. Alors la prod de l’émission cherche à en faire une people pour capitaliser sur sa popularité par ailleurs inexplicable. Et quoi de mieux pour cela, que de la maquer avec un rugbyman en pleine ascension ?
— Tu veux dire que…
— Qu’ils inventeraient une histoire de toute pièce entre vous deux. Ils organiseraient un shooting soi-disant « volé », et ils échafauderaient votre idylle sur 3 ou 4 numéros, avant d’annoncer votre rupture dans quelque(s) temps. Ça va leur faire vendre du papelard, et ça va couper l’herbe sous les pieds aux bruits qui courent sur toi. Ça va être bon pour ton image et pour celle de l’équipe. Gagnant-gagnant…
C’est ça, gagnant-gagnant ? Tu sais que dans cette histoire, tu vas perdre plus que tu vas gagner. Tu penses à Nico, à sa lettre, à son amour, à ton envie de l’appeler pour renouer le contact avec lui. Tu sais que si ce shooting va sortir, il va encore souffrir. Tu sais que tu vas le perdre pour de bon, et ça te déchire le cœur. Tu es hors de toi et ça doit se voir.
— Ne fais pas la tête, mec ! Il vaut mieux ce genre d’exposition médiatique que de laisser courir des bruits qui peuvent te nuire, non ? Les gars de l’équipe et les supporters ne vont y voir que du feu, tu vas être leur héros. Ils adorent les mecs qui se tapent des bonnes pétasses. Et là, avec Alexia, on tient le pompon dans le genre. Après ça, si des bruits continuent à courir sur toi, ils seront perçus comme des conneries.
— Pense à ton contrat avec le club. Il ne court que jusqu’à la fin de la saison pour l’instant…
En oscillant en permanence entre bienveillance et mise en garde, ton agent te fait comprendre que tu n’as pas le choix. Tu acceptes à contrecœur, parce que tu te sens dos au mur. Et tu es même obligé de le remercier, de voler à ton secours pour rattraper le coup de ton imprudence, alors qu’au fond de toi, tu sais que tu n’as rien fait de mal. Ton projet d’appeler et de renouer tombe à l’eau. Et ça t’arrache les tripes.
— Cette fois-ci on va t'arranger le coup, il te glisse avant que tu partes. Mais sois davantage prudent à l'avenir. Ne laisse pas cette partie de ta vie éclipser tout le reste. C’est pas ce que tes coéquipiers et tes supporters ont envie de savoir de toi.
— Je vais me faire nonne pour leur faire plaisir !
— Allons, Jérémie, tu gagnes assez d’argent pour te payer des beaux gars qui te feront tout ce que tu veux et qui savent la boucler, en prime. J’ai des contacts partout, je peux t’avoir des numéros de téléphone si tu le souhaites.
— Non, merci, ça ira.
— Comme tu voudras. Mais, surtout, surtout, surtout, je t’en supplie, si tu couches avec des gars, mets toujours une capote. Je t'aime bien Jérémie. Je crois en toi. En fait toute l'équipe croit en toi, y compris la direction. Tu as une carrière très prometteuse devant toi. Ne la gâche pas à cause du cul, ok ?
Sur le shooting, tu es mal à l’aise. Cette Alexia est une vraie teigne. Elle se prend pour une star, alors qu’elle est creuse comme une coque de bateau après déchargement. Le photographe te demande de la prendre dans tes bras. Il fait chaud, et son parfum envahissant te remplit les narines et te donne envie de gerber. Sa présence t’irrite, le contact avec sa peau te donne de l'urticaire. De loin, tu la trouves vulgaire. De près, tu la trouves rebutante. Et pourtant, dans le passé, tu t’es tapé des nanas dans ce style. Plus elles étaient haut-placées dans « l’échelle de la cagolerie », selon l’expression de ton pote Thierry qui avait des origines marseillaises, plus elles te tapaient dans l’œil. En fait, tu cherchais des nanas qui tapaient dans l’œil de tes potes, pour leur en mettre plein la vue. Mais ça, c’était avant. Avant que tu arrêtes de te mentir. Avant que Nico t’apprenne à écouter tes envies, à te respecter.
Tu es obligé de passer de longues heures à coté de cette sombre pétasse, alors que la seule personne que t’as envie de prendre dans tes bras, c’est Nico, justement. Tu n’arrêtes pas de te demander ce qu’il va ressentir quand ces images vont sortir dans la presse. Tu voudrais l’appeler pour lui expliquer, mais tu es si mal que tu ne t’en sens pas le courage. L’appeler pour lui dire quoi ? Que tu es désolé de l’avoir jeté, que finalement Ulysse n’a pas voulu de toi, que tu t’es tapé quelques mecs, que tu t’es fait gauler, que tu te fais prendre en photo avec une conasse pour te protéger, mais que tu ne te sens pas le courage de le revoir parce que, plus que jamais, tu te sens en danger ? C’est trop de choses à expliquer, à avaler, à pardonner, à accepter. Tu ne peux lui en demander autant.
Le photographe te demande de sourire comme un gars heureux de se taper une femme que tant d’hommes désirent. Le fait est que tu ne la désires pas, pas du tout même. Elle a l’air de te kiffer, elle n’arrête pas de te chauffer. Tu ne sais plus comment la recadrer poliment, alors que tu as envie de l’envoyer chier sans ménagement.
Mais tu continues de ronger ton frein. Tu sais que tu as trop à perdre en envoyant tout bouler. Alors, même si tu as du mal à sourire, et à supporter cette mise en scène grotesque, tu prends sur toi et tu t’efforces de donner le change. Tu te sens comme pris en otage, ou plutôt comme un condamné en sursis. On t’a évité la sanction une fois, et on t’a bien fait comprendre que la récidive pourrait t’être fatale. Alors, tu te dis que renouer avec Nico, ce n’est pas la meilleure façon d’éviter la récidive. Tu as besoin de montrer patte blanche, tu as besoin de laisser ces ragots derrière toi. Tu ne pourras plus sortir dans une boîte gay, ni dans un lieu de drague. Ton agent a raison, tu as assez d’argent pour payer des mecs qui te garantissent la discrétion. Mais tu devines que payer, ça va t’enlever tout le plaisir de te sentir désiré.
Tu te sens bridé, entravé, censuré. Tu touches du doigt le fait qu’en tant que sportif de premier plan et gay, ta liberté est restreinte. Tu te sens étouffer. Tu as envie de prendre Nico dans tes bras, de lui faire l’amour.
Tu sors de ce shooting complètement lessivé. L’invitation d’Alexia à aller chez elle finit de t’achever. Tu prétextes une grosse migraine pour t’en débarrasser. Encore un mensonge. Mentir te fatigue au plus haut point. Et avec ce shooting, tu mens à la terre entière. Un mensonge fait de mots, comme ceux de la lettre de Nico, qui resteront. Des mots imprimés avec des images, et tirés à de centaines de milliers d’exemplaires. Tu penses au mal que ces mots, ces images, ce mensonge, vont faire à Nico et ça te brise le cœur. Mais déjà, ce mensonge de taille industrielle, c’est à toi qu’il fait du mal. Tu n’es à nouveau plus en phase avec toi-même, plus du tout.
Mais tu as besoin de cette histoire. Tu en as besoin pour te protéger.
« Imaginer ma vie sans toi m’est tout simplement impossible », « Cette sensation d’inachevé que je ressens au plus profond de moi, est ce qu’il y a de plus insupportable. Ce regret permanent, cette certitude qu’on est passé à côté de notre histoire, de notre vie, de notre amour, du bonheur. C’est si triste de me dire qu’on a eu la chance de nous rencontrer, de connaître l’amour, mais qu’il nous est impossible de le vivre sereinement.
Ses regrets, ce sont les tiens aussi. Mais tu finis toujours par lui faire du mal. Alors, tu te dis que le mieux c’est de ne plus essayer de renouer. Le mieux, c’est qu’il t’oublie. Mais il t’a écrit qu’il ne t’oubliera pas. Alors, la seule façon de le pousser à tourner la page, c’est de lui faire croire que tu ne l’aimes plus. Peut-être que ces images, que ces mensonges, vont atteindre ce but.
Toi non plus, tu ne l’oublieras pas].
Samedi 1er mars 2003.
Le bus suivant arrive, mais il repart alors que Thibault et moi nous sommes déjà loin. Je suis très content qu’il ait accepté mon invitation à venir chez moi. J’ignore ce qui va se passer cette nuit. Je sais ce dont j’ai envie. Mais je ne veux pas forcer les choses. Car cette nuit, j’ai avant tout besoin de la compagnie d’un pote, d’un garçon adorable et touchant comme Thibault.
Et pourtant, j’ai l’impression d’avoir déjà forcé les choses. Et je n’ai pas envie que Thibault pense que l’intensité de mon attirance pour lui dépasse l’intensité de mon amitié. Je sais qu’il a envie de passer cette nuit avec moi. Mais je sais aussi que, si je ne lui avais pas proposé, lui il ne l’aurait pas fait. Parce que Thibault est un garçon qui sait mieux que moi contrôler ses désirs.
Pendant que le jeune papa et moi marchons en direction de mon studio, il commence à pleuvoir. D’abord quelques gouttes, puis carrément des cordes. Nous traversons la cour au sol rouge en courant. Après avoir cherché mes clés et les avoir fait tomber deux fois dans la précipitation, nous nous mettons enfin à l’abri dans mon petit studio. Nous sommes alors trempés. Thibault enlève sa veste dégoulinante. Sa chemise est trempée aussi. Le coton adhère à son torse massif, et c’est furieusement sexy.
Je fais un tour par la salle de bain pour me changer. Je cherche un t-shirt sec et une serviette pour Thibault. Lorsque je reviens dans mon séjour, le beau rugbyman commence à déboutonner sa chemise mouillée.
Je savoure cet instant, cet instant qui me prépare à une belle claque visuelle. Je savoure cet « instant d'avant ». Avant que cette belle chemise soit complètement ouverte, avant de me laisser aveugler par l’intense mâlitude de ce beau garçon. Chaque bouton ouvert me dévoile un peu plus de ce torse solide. Ce n’est pas la première fois que je le vois torse nu, mais à chaque fois, je suis cueilli par la même intense émotion qui me vrille les tripes et embrase mes sens.
Les deux pans de la chemise sont désormais complètement séparés. Thibault fait pivoter lentement son torse dans un sens et dans l’autre, avance une épaule puis l’autre pour décoller le tissu mouillé de sa peau. C’est terriblement sensuel. La chemise finit par tomber et par dévoiler ce qu’elle était censée dissimuler. Dissimulation on ne peut plus délicieusement ratée, tant sa coupe épousait déjà bien ce torse lorsqu’elle était sèche, et a fortiori lorsque le tissu a été mouillé.
La vision de ce torse finement poilu, de cette peau sans aucun tatouage, de ses pecs saillants, de ses beaux tétons, de ses abdos en bas-relief, de ses gros bras aux biceps rebondis, de son cou puissant – bref, de sa demi-nudité– me renvoient au plaisir que j’ai pris avec lui la dernière fois qu’il m’a fait l’amour à Campan, lorsqu’il s’était joint à Jérém et à moi pour une nuit magique. Ce souvenir fait grimper mon désir à des sommets insoutenables.
Le petit brillant à l’oreille lui va furieusement bien. La note intense de parfum de mec qui se dégage de sa peau se mélangé à l’humidité de sa peau et finit de m’achever. J’ai envie de lui à en crever.
Le jeune papa s’essuie longuement les cheveux, me laissant tout aussi longuement admirer la beauté de son torse. Lorsqu’il passe le t-shirt que je lui ai ramené, je me dis que c’est dommage de cacher une plastique pareille. Encore que, en ayant pioché dans la précipitation un t-shirt blanc, involontaire malice, sa sexytude ne s’en trouve que décuplée. Ainsi, ce t-shirt, qui est bien de deux tailles trop grandes pour moi, et dans lequel je ne ressemble à rien, trouve sa véritable vocation en habillant les pecs, les épaules et les biceps du jeune rugbyman avec une précision redoutable. Ah putain, qu’est-ce qu’il est sexy !
Soudain, le beau pompier réalise qu’en rentrant, il a laissé des traces sur le sol. Et il amorce le mouvement pour se déchausser. Il est vraiment trop mignon. Mais il n’a pas à faire ça, non. Et là, sans vraiment réfléchir, dans un simple reflexe pour l’empêcher de se déchausser, je pose ma main juste en-dessous de la manchette tendue, pile sur l’arrondi de son biceps. Et lorsque je sens dans ma paume la douce chaleur et la puissante fermeté de sa peau, je ressens un puissant frisson d’excitation. Et de malaise. Je quitte instantanément le contact avec cette peau douce, tiède, avec ce muscle ferme, très ferme. Contact de bonheur que seul un mec sait offrir.
Contact bref, et pourtant piquant comme une brûlure, vif comme une décharge électrique, mais délicieux comme le désir. Un contact qui laisse longtemps son empreinte dans ma main et dans mon esprit, contact qui provoque un frisson que je ressens par toutes les fibres de mon corps.
Je croise son regard. Thibault semble amusé de voir à quel point ce simple contact m’a troublé. Il me sourit, et un petit bout de sa langue se glisse entre les dents, là, pendant qu'il sourit. Je trouve ce petit détail à craquer, ça me rend fou. J’ai l’impression qu’il lit dans mes désirs comme dans un livre ouvert, je trouve ça à la fois excitant et gênant.
— Tu veux boire quelque chose ? Je lui demande, pour me sortir de ce malaise.
Mais le beau pompier ne répond pas, son regard a verrouillé le mien et le tient avec insistance. C’est la première fois qu’il me regarde de cette façon, la première fois que je ressens son désir aussi clairement, aussi intensément.
— J’ai du jus de fruit, du café… je continue, de plus en plus perdu.
Mais le beau pompier ne m’écoute plus. Il avance vers moi, il passe ses gros bras autour de ma taille, tout en me glissant :
— Viens-là, toi…
Et il m’embrasse. Ses lèvres se posent sur les miennes et mille frissons se déchaînent dans ma colonne vertébrale. J’ai terriblement envie de lui.
A cet instant, je pense à l’adorable Ruben, et je me sens nul de lui faire ça. Et je pense surtout à Jérém, malgré tout ce qui s’est passé. Et je ne peux empêcher d’être submergé par un immense malaise.
J’ai terriblement envie de continuer à embrasser Thibault. Et pourtant, j’ai un mouvement de recul instinctif.
— Désolé… fait Thibault, l’air mortifié. Je n’aurais pas dû…
Et là, devant son malaise sincère, je sens en un instant mes réticences s’évaporer une à une, jusqu’à la dernière. Le contact avec ses lèvres me manque déjà. Et je ne peux pas laisser ce gars adorable penser qu’il vient de faire quelque chose de déplacé.
— Si, tu aurais dû… je lui réponds, tout en l’embrassant à mon tour.
Nous nous embrassons, nous nous câlinons longuement. Thibault est un garçon très viril, et pourtant, il dégage une douceur touchante. Le jeune papa est un véritable puits à câlins. Sa main se glisse dans mes cheveux, descend lentement vers les bas de ma nuque. Ses caresses sont si douces qu’elles me donnent envie de pleurer. Par ce simple contact de sa main à cet endroit de ma peau, je suis comme sous hypnose, dans un état second, un état de bonheur pur et bouleversant. Ses baisers sont à la fois tendres et sensuels, ils m’apportent une sorte d’ivresse délicieuse. Je bande comme un fou. J’ai tellement envie de ce garçon !
Thibault me serre très fort contre lui et plonge son visage dans le creux de mon épaule. Je pose ma paume sur son cou, je le caresse doucement. Je l’entends pousser un long soupir. Je continue, tout en guettant les variations de sa respiration, les variations du bonheur que j’arrive à lui offrir avec de simples caresses. Le jeune pompier a l’air de vraiment apprécier, je trouve cela très émouvant.
Les deux fois où j’ai fait l’amour avec Thibault, je l’avais trouvé incroyablement doux et attentionné. Mais jamais sa tendresse à mon égard n’a été aussi débordante. Jamais ses câlins n’ont été aussi doux et fougueux à la fois. Et jamais je ne l’ai trouvé autant en demande d’affection.
— Ça fait du bien ça… je l’entends me glisser à l’oreille.
Puis, quelques instants plus tard, le jeune pompier rompt ce contact délicieux. Nos regards se croisent à nouveau. Dans le sien, je vois les mêmes réticences que celles tapies au fond de moi : la peur des conséquences, la peur des remords.
Cela ne dure qu’un instant, qui me paraît pourtant une éternité. Une éternité qui prend fin lorsque nous nous élançons l’un envers l’autre, pile au même instant, comme si on nous avait donné le top départ. Nous nous embrassons à nouveau. Finalement, nous tombons tacitement, physiquement d’accord sur le fait qu’il vaut encore mieux avoir des remords que des regrets.
Peu à peu, la douceur laisse place à la sensualité. Je sens ses mains se glisser dans mon dos, sous mon t-shirt. Je laisse les miennes se glisser sous le sien, je laisse mes doigts effleurer et compter ses abdos.
Les baisers se font de plus en plus audacieux, les caresses de plus en plus érotiques.
Thibault recule d’un pas et attrape le bas de son t-shirt. Je vois se profiler un autre « instant d’avant », encore plus bouleversant que le précèdent. Car celui-ci, n’est pas seulement l’instant d’avant que sa bogossitude m’aveugle, que le parfum de sa peau m’assomme, que le désir s’embrase et échappe à mon contrôle. Cet instant, c’est « l’instant d’avant » de goûter à la virilité de Thibault, de me dévouer avec délice à lui donner le plaisir qu’il mérite.
Alors, cet « instant d’avant », j’ai envie de le faire durer. Aussi, je trouve le coton blanc tendu sur son torse rudement sexy. Je pose mes mains sur les siennes, je l’empêche d’ôter le t-shirt. Je le serre très fort contre moi. Je recommence à l’embrasser et je caresse ses pecs saillants par-dessus le coton. Quel bonheur exquis, que de le sentir frissonner ! Je presse mon bassin contre le sien, et nos queues raides se rencontrent, s’aimantent. Même au travers le quadruple tissu de nos pantalons et de nos boxers, je ressens la douce chaleur de sa virilité.
Ah putain ! Je réalise pleinement à cet instant à quel point le contact avec un corps solide, à la sexualité virile m’a manqué !
Je ne peux plus résister. J’attrape le bas de son t-shirt et je libère enfin son torse. Ça ne fait pas cinq minutes que je l’ai vu. Mais cette nouvelle vision est une claque tout aussi intense que la précédente. Je suis hypnotisé par tant de beauté masculine. Et son parfum, putain, son parfum fait vriller mes narines, mes tripes, mes neurones, mon esprit. Il aimante mon désir.
Quant à ses poils, ils m’inspirent une folle, irrépressible, indécente envie de plonger mon nez, mon visage, entre ses pecs, dans ses poils, de humer sa peau douce, tiède, parfumée. C’est ce que je fais, incapable d’attendre davantage. Je plonge mon nez entre ses pecs et ses poils, je m’enivre de son parfum, de la douce tiédeur de sa peau. Approcher la nudité d’un beau mâle viril, qu’est-ce que ça m’a manqué ! Putain, qu’est-ce que j’ai envie de lui !
A son tour, Thibault attrape mon t-shirt par le bas et le retourne le long de mon torse. Ses doigts frôlent ma peau et ça embrase mes sens un peu plus encore.
Il s’approche de moi, nos torses nus se frôlent. Mes lèvres sont attirées par son cou, par ses pecs. Ma langue brûle d’envie de lécher ses beaux tétons. Je sens le beau rugbyman frissonner, trembler.
— Viens, je lui glisse en l’attrapant par la main, incapable de résister plus longtemps au désir qui me ravage.
Un instant plus tard, Thib est allongé sur le lit, sur le dos. Je me glisse entre ses cuisses musclées et je défais sa braguette. La bosse saillante de son boxer noir déformé par son érection décuple mon excitation. Approcher l'intimité sensuelle d'un mâle viril, qu'est-ce que ça m’a manqué !
Je me penche sur son entrejambe et je titille sa queue à travers le coton élastique. D’abord avec mes lèvres, puis avec ma langue humide. Le jeune papa frissonne de plaisir.
Je ne peux attendre davantage pour libérer sa queue frémissante de sa prison de coton. Je ne peux attendre davantage pour la revoir, pour la sentir, pour la prendre en bouche, pour la pomper. Dès l’instant où mes lèvres se posent sur son gland, je réalise combien ça m’a manqué de sentir un beau garçon frémir dans ma bouche. Car c’est l’une des sensations les plus exquises que je connaisse.
Pendant que je m’affaire à son plaisir, je regarde mon bel amant du coin de l’œil. Thib est accoudé sur le lit, et il me regarde faire, il me regarde en train de le sucer. Comment il me rappelle à cet instant, certaines révisions dans l’appart de la rue de la Colombette !
C’est un fait. Même le bonheur sensuel de cet instant n’a pas le pouvoir de me faire totalement oublier la tristesse à l’idée d’avoir perdu Jérém. Mais il a quand-même celui de l’anesthésier provisoirement. Et ça, c’est déjà pas mal.
Thibault se laisse tomber sur le dos. Et alors que ses ahanements augmentent d’intensité, ses doigts caressent mes tétons. Lorsqu’à mon tour je caresse les siens, il pousse un long soupir d’extase.
Et il ne tarde pas à reprendre appui sur ses coudes. Il entreprend alors d’envoyer de petits coups de reins. Je ralentis mes va-et-vient, je le laisse faire, je m’offre totalement à ses envies. Son souffle saccadé m’apporte la preuve de son plaisir. Le jeune pompier se lâche, et c’est terriblement excitant. Et je ne suis pas au bout de mes surprises.
— Lèche-moi les… je l’entends soupirer, la voix cassée par l’excitation.
Mais il s’arrête là, comme s’il n’osait pas aller au bout de ses envies, comme s’il avait honte. Mais je n’ai pas besoin de lui demander de terminer sa phrase pour deviner ce dont il a envie. Et je suis bien décidé à le lui offrir.
Je quitte sa queue pour aller m’occuper de ses couilles. Je les lèche en douceur, puis de façon plus appuyée. Les nouveaux soupirs de mon bel amant me confirment que je ne me suis pas trompé, que c’est bien de ça dont il avait envie.
Transporté par son excitation montante, je sens venir en moi l’envie irrépressible de tout donner pour embraser encore un peu ses sens. Je laisse mes lèvres et ma langue glisser lentement entre ses fesses. La surprise du jeune pompier se traduit par un ahanement sonore. Son plaisir certain, par un souffle bas et prolongé. Est-ce que quelqu’un lui a déjà fait ça auparavant ?
— Ah putain, qu’est-ce que c’est bon… ce truc ! je l’entends gémir.
Thibault se lâche de plus en plus, et je kiffe ça ! Cette nuit, comme jamais, j’ai envie de faire exulter son corps, de galvaniser son ego de mec, de lui faire prendre conscience à quel point il est sexy et viril. J’ai terriblement envie de le faire jouir.
Comme ivre, je le reprends dans ma bouche, et je recommence à le pomper.
— Attends, Nico…
Mais je n’attends pas. Je sais ce que cela signifie, et je veux le faire jouir.
— Attends, ne me fais pas venir si vite… il insiste.
Je cesse alors de le pomper.
— Lèche-moi les boules encore un peu.
Le jeune papa a l’air de vraiment aimer ça, et je m’exécute à satisfaire ses envies avec un bonheur non dissimulé. Du moins jusqu’à ce qu’il manifeste à nouveau d’autres envies :
— Vas-y, pompe-moi, maintenant…
Ah, putain, il a décidé de me rendre dingue, en me parlant de cette façon ! Je m’exécute illico, avec un entrain décuplé. Je sens ses mains se poser sur mes épaules, ses doigts se crisper dans ma peau. Ça me donne des frissons inouïs. Là encore, il me rappelle drôlement Jérém. Définitivement, qu’est-ce que j’aime ce Thibault qui se lâche !
— Ça vient… ça vient…putain… Nico !
Un long râle à la fois puissant et contenu s’échappe de son torse, alors que de longues giclées copieuses, puissantes, bouillantes jaillissent dans ma bouche. Leur goût est enivrant, tout aussi enivrant que cette attitude inédite de Thib.
C’est à cet instant que je réalise à quel point faire jouir, sentir jouir un beau mâle dans ma bouche, le voir repu et satisfait après l’orgasme que je viens de lui offrir, ça m’a manqué.
Le temps de se remettre de ses émotions, le jeune rugbyman me prend dans ses gros bras et m’enveloppe avec son torse puissant. Vraiment, le contact avec un corps solide ça m’a manqué.
— Ça va ? je le questionne.
— Qu’est-ce que j’ai kiffé !
— Moi aussi, j’ai kiffé.
— Chaque fois que je couche avec toi, tu me fais des trucs de dingue !
— Et Paul, il ne te fait pas des trucs de dingue ?
— Entre nous, c’est plutôt safe, et plutôt soft…
— Ah, d’accord…
— Je ne dis pas que c’est pas bon, au contraire. Mais jamais il ne m’a fait ce « truc »… tu vois ?
— Je vois, je vois.
— En fait, Paul est plutôt actif. Et je prends mon pied. Mais certaines choses me manquent.
— Ce qui te manque, c’est qu’on s’occupe de toi comme je viens de le faire…
— Voilà !
— A moi aussi certain trucs me manquent.
— Avec ton mec ?
— Oui. Il est passif, et uniquement passif.
— Et tu es actif avec lui ?
— Oui, et je prends mon pied aussi. Mais c'est pas ce que je kiffe le plus.
— Ça veut dire que si j’ai envie de te sucer, là, maintenant, tu dirais non ?
— T’as qu’à essayer pour voir…
Ça me fait toujours un sacré effet de voir un mâle comme Thibault ou Jérém me sucer. C’est grisant. Je sens mon excitation monter en flèche. Je sens mon orgasme arriver au grand galop, et je ne veux pas qu’il arrive si vite. Parce que j’ai envie d’autre chose avant.
— J’ai envie de toi, Thibault !
— Moi ça fait toute la soirée que j’ai envie de toi !
— Moi aussi, ça fait toute la soirée que j’ai envie de toi !
Le beau pompier vient en moi et me fait l’amour. Je réalise violemment à cet instant combien la sensation d’être possédé par un mâle viril m’a manqué aussi.
L’amour avec Thibault est un mélange subtil et délicieux de douceur et de sensualité. Ses coups de reins sont lents, espacés, et pourtant ils dégagent une puissance inouïe.
Thibault a toujours été un merveilleux amant. Mais force est de constater que cette nuit, quelque chose a changé chez lui. Une fougue inédite anime ses regards, ses caresses, ses attitudes. Cette nuit, j’ai l’impression de découvrir un autre Thibault, un autre amant. Un amant que je vois littéralement vibrer de plaisir. Au point que j’ai l’impression qu’il n’a jamais autant joui auparavant. En tout cas, pas avec moi.
Je ne peux m’empêcher de me demander si c’est Paul qui lui a appris à laisser son corps s’exprimer davantage. Ou bien, si c’est la frustration de ne pas pouvoir jouer le rôle communément appelé « actif » avec Paul qui lui a donné cette fougue, cette envie, ce besoin de se lâcher.
Mais je me demande avant tout si c’est l’absence du regard de Jérém sur lui qui le libère ainsi. Les autres deux fois où il m’a fait l’amour, c’était sur invitation de son meilleur pote. Les autres fois, il faisait l’amour au mec de son pote, sous les yeux de son pote. Et cette nuit, confronté à ce « nouveau Thibault », je me demande si l’« ancien Thibault » ne se bridait pas dans l’expression de ses envies et de son plaisir.
Cette nuit, sans ce regard de Jérém sur lui, ce regard qui pourrait le juger, qui pourrait exprimer de la jalousie, se montrer contrarié, il doit se sentir davantage libre d’exprimer ses envies, ses besoins, ses désirs.
J’imagine que c’est ça. En tout cas, je sais que ça l’est pour moi. Cette nuit, sans le regard de Jérém sur moi, j’ai envie de montrer à cet adorable petit mec à quel point il me touche. J’ai envie de lui donner toute la tendresse dont il a besoin, j’ai envie de lui donner tout le plaisir dont il a envie.
Je le regarde en train de me faire l’amour, le torse droit comme un « I », tous pecs et abdos dehors, les biceps épais, bien rebondis, le cou puissant. Je suis aimanté par cette belle gueule de mec traversée par des frissons. J’adore comment il me manipule avec ses bras puissants, j’adore sentir ses belles paluches sur moi, elles me remuent comme une brindille. J’adore sa façon de me faire sentir à lui, de me posséder.
Cette nuit, le jeune papa ose enfin aller au bout de son plaisir de mec. Et c’est terriblement beau pour mes yeux, c’est terriblement bon pour ma chair. Le sentir prendre autant son pied en moi, ça me rend dingue. Comment ça m’a manqué cette puissance de bras musclés, le contact avec la puissance sexuelle d’un garçon solide !
Mais Thibault n’oublie pas non plus de s’allonger sur moi, de venir m’embrasser, de plonger son visage dans le creux de mon épaule. Son souffle excité sur ma peau me rend dingue. Le mélange de virilité et de tendresse qui se dégage de ce garçon musclé est tout simplement explosif. J’ai envie de lui à en crever.
Il n’y a rien de plus beau au monde que regarder un beau garçon en train de vous faire l’amour, ivre de plaisir. Pendant un instant, je ferme les yeux, et j’ai l’impression de revoir Jérém en train de me faire l’amour, lors de nos retrouvailles à Campan, à Paris.
Oui, rendre heureux un gars qui suscite notre désir et qui nous comble de tendresse, est l’un des grands bonheurs de la vie. Et lui montrer à quel point il est bon amant, ça en est une autre. Que je ne veux pas bouder non plus cette nuit.
— Qu’est-ce que c’est bon ! je lui glisse, dans un long soupir, tout en laissant mes mains parcourir et tâter sa plastique de fou, épaules, biceps, pecs, tétons.
Le jeune rugbyman est secoué par d’intenses frissons. Ses coups de reins cessent alors. Sa queue, profondément enfoncée en moi, me remplit, me domine, me fait jouir. Son regard plein d’excitation et de désir, me fait me sentir complètement à lui. Mais là non plus je ne suis pas au bout de mon bonheur.
— Tu aimes comme je te fais l’amour… je l’entends me glisser.
Thibault a prononcé ces quelques mots sur un ton qui les font ressembler davantage à un constat qu’à une question. Il veut me rendre dingue !
— Oh, putain, oui ! Tu fais ça trop bien Thibault !
— Tu me fais beaucoup d’effet, Nico !
— Et toi, alors !
Le beau rugbyman pousse un long soupir, il baisse la tête, son corps se raidit. Je sais ce que ça veut dire. Il essaie de se retenir.
— Oh, putain, Nico… je l’entends lâcher, la voix essoufflée.
— Vas-y, ne te retiens pas ! je l’encourage.
Thibault pose un dernier bisou sur mes lèvres, ce bisou que je connais bien et qui signifie « nous nous reverrons après mon orgasme ». Puis, il relève son torse et il recommence à me limer lentement. Ses coups de reins sont courts, sa queue toujours bien enfoncée en moi, ses couilles effleurent mes fesses.
— Je viens…
— Fais-toi plaisir, beau mec !
Voir et sentir un beau mâle viril atteindre son orgasme, profondément emboîté en moi, le voir débordé par son orgasme, le savoir en train de me remplir de sa semence, c’est la sensation la plus enivrante que je connaisse.
Avant de se déboîter de moi, le jeune pompier me branle et me fait jouir. Lorsque mon orgasme vient, j’ai l’impression que mon ventre est en feu, que ma conscience va s’évaporer à tout jamais. Il n’y a qu’avec Jérém que j’ai ressenti ça auparavant.
Nous nous allongeons sur le lit, tournés l’un vers l’autre. Nos regards se cherchent. Je lui souris, il me sourit en retour. En fait, il n’y a rien de plus beau au monde qu’un garçon qui vous sourit après vous avoir fait l’amour.
Tout est craquant chez ce garçon. Y compris le fait que, tout en étant si déraisonnablement beau, il donne l’impression de ne pas se rendre compte de l’effet qu’il fait autour de lui.
— Ça va ? je ne trouve pas mieux pour entamer une conversation.
— Je crois que je n’ai jamais pris autant mon pied !il me balance, après un long soupir.
J’adore son regard, cette expression de jeune mâle repu et satisfait.
— Et toi ? il me questionne.
— C’était trop bien.
— Tu es un merveilleux amant, Thibault, je continue après un instant de silence.
— Toi aussi, Nico, toi aussi…
Ça fait du bien de se l’entendre dire.
— J’ai toujours beaucoup aimé faire l’amour avec toi, je lui glisse. Mais cette nuit je t’ai trouvé différent, comme…libéré…
— J’ai ressenti la même chose vis-à-vis de toi.
— C’est assurément vrai, je considère.
— C’est la première fois que nous ne sommes que tous les deux, il me glisse.
Nous n’avons pas besoin d’aller plus loin dans ces considérations. Je sais que nous pensons à la même chose, à la même personne. Je ressens un malaise insistant m’emparer de moi, à l’évocation de Jérém juste après avoir fait l’amour avec Thibault. Mais je n’arrive pas à regretter. Ça fait des mois que je n’ai pas des nouvelles de Jérém, que je n’ai pas fait l’amour avec lui. Et ça m’a fait un bien fou de faire l’amour avec Thibault.
— C’est celle de Jé, non ? me questionne le jeune papa, en saisissant doucement ma chaînette.
— Oui, c’est bien la sienne. Il me l’a donnée il y a deux ans, après son accident.
— Je n’aurais jamais cru qu’il se sépare un jour de cette chaînette.
— Je sais ce que cette chaînette représente pour lui.
— Tu es conscient que c’est un cadeau d’une grande valeur qu’il t’a fait, là.
— Oui, je sais. Il m’a dit que tant que je portais cette chaînette, il serait toujours avec moi.
— Et si tu l’as toujours, c’est parce qu’il le veut bien.
— C’est-à-dire ?
— S’il pensait vraiment que tout est fini entre vous, il t’aurait demandé de la lui rendre. Elle est trop précieuse à ses yeux.
Soudainement, je me sens submergé par l’émotion suscitée par cette évidence que je ressentais au fond de moi mais que Thibault vient de me rappeler et de rendre encore plus tangible. Le jeune rugbyman doit s’en rendre compte, car il m’enveloppe avec ses bras puissants, avec son corps massif et chaud, avec ses muscles rassurants.
Dans ses bras, comme dans son regard, je me sens protégé. Je me sens aimé, mais sans possessivité. Comme si ce moment de sensualité n’était que le prolongement de notre belle amitié.
Pendant la nuit, nous refaisons l’amour. Son torse glisse sur mon dos avec une douceur inouïe, son souffle chaud chatouille mon cou, embrase mon désir. Ses coups de reins ont une douceur exquise. Lorsque je l’entends souffler son nouvel orgasme, je viens à mon tour. Et je me rendors en tenant ce beau mâle puissant dans mes bras.
Il n’est pas encore 7 heures du matin lorsque nous nous apprêtons à traverser la petite cour au sol rouge pour aller prendre un petit déj en vitesse. Thibault a décidé de prendre le premier train pour Toulouse. Le jeune papa a envie de passer un peu de temps avec son petit Lucas dans l’après-midi. Il est vraiment, vraiment touchant.
Oui, il n’est même pas 7 heures, un dimanche matin, qui plus est. Et pourtant, mes proprios sont déjà debouts et en poste de surveillance. Et nous ne pouvons pas échapper au « contrôle ».
— Bonjour, Nico, me lance Albert. Alors, tu nous présentes ce charmant garçon ?
— Voici Thibault, un pote de Toulouse, et voici Albert et Denis, mes propriétaires. Thibault joue au Stade Toulousain.
— Au Stade ? Attends un peu… mais je te connais, toi… lance Denis.
— Il connaît tous les beaux garçons de la terre, celui-là ! plaisante Albert.
— Mais tu ne serais pas… voyons… ah, oui ! Pujol… numéro… 9… et… demi de mêlée !
— Vous avez tout bon, Monsieur !
— Et vous avez joué ici à Bordeaux hier après-midi !
— C’est ça.
— Et vous avez fait des misères à nos gars !
— C’est le but du jeu, plaisante Thibault.
— Trêve de plaisanteries, j’ai regardé le match à la télé, et vous avez très bien joué. Vous avez une sacrée équipe à Toulouse. Je pense que cette année, vous avez toutes vos chances de gagner le TOP.
— Je l’espère !
— A mon sens, il n’y a qu’une autre équipe qui peut vous faire de l’ombre…
— Laquelle ?
— L’autre Stade, voyons ! Les Parigots ! Ils ont eux aussi une équipe de tonnerre !
— Ah, oui, ça c’est bien vrai !
— Mais je parierais sur les Toulousains quand-même. Enfin, on verra bien dans quatre mois. Il reste pas mal de taf d’ici là, et il peut se passer pas mal de choses. Les voies du rugby sont impénétrables.
— Il n’y a bien que les voies du rugby qui le sont ! balance Albert, avec un sourire malicieux.
Incroyable clairvoyance de Denis. Il aurait dû parier en effet. Car il avait tout bon. Vraiment tout bon.
Thibault et moi prenons le petit déj dans un bar au bout de ma rue. Mon corps frémit encore du plaisir que nous nous sommes donné, mon esprit des caresses que nous nous sommes échangées. J’ai passé une soirée et une nuit fabuleuses avec ce garçon. Je le regarde en train de boire son café, et je n’ai pas envie qu’il parte. J’ai encore envie de le serrer dans mes bras, de le câliner.
Lorsque je croise son regard, je me sens noyé dans ses yeux vert-marron qui dégagent une douceur et un calme qui sont autant de caresses pour l’esprit. Son regard a gardé la pureté d’un enfant. Et pourtant, il porte le charme d’un homme.
Thibault me sourit. Et dans ce sourire, charmant et plein de douceur, j’ai l’impression que tout est dit. Dans ce sourire, je lis que Thibault a passé un bon moment lui aussi, mais qu’il ne me demande rien de plus. Je sens qu’il ne regrette rien, parce que nous nous sommes juste fait du bien à un moment où nous en avions tous les deux besoin.
J’en ai la confirmation quelques minutes plus tard à la gare, lorsque le jeune pompier qui s’apprête à monter dans le train pour aller rejoindre son petit bout de chou à Toulouse, me serre une dernière fois dans ses bras pour me dire au revoir.
— J’ai passé un très bon moment, Nico, il me glisse.
— Moi aussi, un très bon moment.
— Il faut pas regretter ce qui s’est passé cette nuit. Je sais que tu es toujours amoureux de Jé. Mais il n’y a pas de mal à se faire du bien. Nous en avions envie tous les deux. Et nous sommes assez grands pour l’assumer.
— Tu as raison, je pense la même chose.
— Je t’aime beaucoup, Nico.
— Moi aussi, Thibault, je t’aime beaucoup, je lui réponds, comme une évidence, le ventre remué par mille émotions.
J’ai envie de l’embrasser. Même si je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Mais le jeune rugbyman, quitte notre étreinte, et me lance, avec un sourire qui me fait fondre :
— Quand tu reviens sur Toulouse, passe me voir à l’appart !
— Ce sera avec grand plaisir !
Sa main qui enserre mon épaule, qui effleure mon oreille et qui caresse furtivement ma nuque, ce sont les derniers contacts que j’ai avec le jeune papa avant qu’il ne monte dans le train pour aller retrouver le petit Lucas.
Je rentre chez moi et sa présence me manque déjà. Mon t-shirt blanc, celui que Thibault a porté pendant la nuit, abandonné sur le lit, me fait de l’œil. Le coton porte son parfum, mélangé à des délicieuses petites odeurs de transpiration et de sexe.
Je passe le dimanche à repenser à cette délicieuse nuit. Et je bande à chaque fois. Sacré petit mec que ce jeune pompier ! Trois fois, je me branle pour m’apaiser.
En début de soirée, Ruben m’appelle pour me dire qu’il vient de rentrer de chez ses parents. Je prétexte un mal de tête carabiné (ça m’arrive d’en avoir, alors c’est tout aussi facile à prétendre pour moi qu’à croire pour lui) pour déclarer forfait à son envie de me voir.
Lundi 3 mars 2003.
Le lundi, le souvenir de l’amour avec Thibault me porte toujours. Je suis de bonne humeur.
Du moins jusqu’à la fin des cours. C’est en milieu d’après-midi, sur le retour vers la maison, que je découvre les nouveaux affichages. La marque de boxers déploie de nouveaux clichés sur les panneaux publicitaires. Sur l’un d’entre eux, Jérém est seul, le ballon entre ses mains. Il est debout, torse nu, un genou légèrement plié. Le bassin, les épaules, le cou négligemment penchés vers la droite. Le travail des couleurs et des contrastes de lumière fait ressortir la couleur mate de sa peau, l’éclat de ses tatouages, les magnifiques reliefs de sa plastique. Il est à tomber à la renverse.
Je repense à la nuit que j’ai passée avec Thibault et j’ai l’impression qu’elle m’a définitivement éloigné de Jérém. De toute façon, cette pub, ces images aussi, en plus de celles qui continuent de tourner à la télé, m’éloignent définitivement de lui. Je me dis qu’avec cette exposition médiatique de sa bogossitude, il pourrait baiser une nana ou un gars différents chaque soir.
A priori, ce n’est pas ce qu’il fait. Du moins, si on en croit ce torchon qui pour l’énième semaine consécutive tient la France entière à jour sur l’idylle entre le beau rugbyman et la poufiasse de la Star Ac’, version moderne et inversée du mythe de la belle et la bête.
Dans le numéro en kiosque cette semaine, il est question d’un week-end sur l’Ile de Ré et d’une relation qui devient « solide ». Solide, mon cul ! Il baise peut-être cette pétasse pour garder les apparences, mais ce sont les gars qui l’intéressent. Et de ce côté-là, il y a fort à parier qu’il ne se prive pas.
Pas un seul instant, je ne me doute que sa soudaine exposition médiatique est à la base de gros soucis pour lui, plus que d’opportunités. Et que l’histoire racontée dans ce torchon est une façon de se protéger.
Je me fie aux apparences, et je me dis qu’il m’a complètement oublié.
Le lundi soir, je ne peux me soustraire à mes obligations avec Ruben.
— J’étais trop impatient de faire l’amour avec toi, il me glisse, alors que nous venons de jouir.
— Moi aussi j’étais impatient…
Oui, j’étais impatient, et je le suis toujours, même juste après avoir joui, de refaire l’amour avec Thibault.
Samedi 8 mars 2003.
Ce samedi, je monte à Toulouse dans un double but. Primo, pour souhaiter à Maman une bonne fête de la femme (quand on y pense, le fait que les femmes aient besoin d’une date particulière pour qu’on pense à elles, ça veut dire qu’on ne pense pas assez à elles). Deuxio, pour fêter l’anniversaire de Papa.
Nous ne sommes que tous les trois, et Maman nous a concocté un bon petit déjeuner. Pour l’anniversaire de Papa, elle a fait mon dessert préféré, une croustade de fruits divers. Je l’adore.
A l’approche de 14 heures, Papa quitte la table pour aller allumer la télé dans le salon. Je redoutais cet instant.
— Viens un peu avec ton vieux père, on va regarder ton copain Jérémie faire la misère aux Biarrots !
Entendre Papa appeler Jérém « mon copain », le plus naturellement du monde, me ferait tellement plaisir, si seulement c’était encore le cas. Ça ne l’est plus. Bien sûr, cette petite attention me touche, car il croit bien faire. Mais elle ravive violemment ma tristesse.
— Ce n’est plus mon copain, Papa.
— Ah bon ? Et qu’est-ce qu’il s’est passé ?
Je n’ai pas envie de parler de l’homophobie ambiante dans le monde du sport, de son besoin de vivre caché pour vivre serein, et encore moins du fait que Jérém regarde désormais vers un autre gars qui lui semble mieux correspondre à l’homme qu’il recherche.
Alors, je me contente de lui répondre :
— C’est la distance qui nous a fait du tort…
— Tu m’en vois vraiment désolé, j’étais si content de te savoir avec un gars comme Tommasi !
— Merci Papa.
— Et de quoi ?
— Merci d’avoir su changer ton regard sur moi et de m’avoir accepté tel que je suis.
— Il me faut un peu de temps pour comprendre les choses, parfois, il plaisante.
— Et tu crois que c’est vraiment irrattrapable avec Tommasi ? il enchaîne.
— Je ne sais pas. Je n’ai pas de ses nouvelles depuis trois mois.
— Tu ne l’as pas appelé ?
— Il ne veut plus me parler.
— J’imagine que ça doit être dur pour lui de vivre sa vie dans ce milieu.
— Il y a de ça, oui.
— Mais il y a autre chose ?
— Je crois qu’il est amoureux d’un gars de son équipe, je finis par lâcher le morceau.
— Ah, zut, alors. Mais il est amoureux de qui ?
— Uly… enfin, Klein.
— Klein ? Lui aussi il est… ?
— Je ne crois pas… enfin, je ne sais pas, et ça ne m’intéresse pas de savoir. Regardons le match, tu veux ?
— C’est pour ça qu’on est là ! il me lance sur un ton enjoué, comme pour me signifier qu’il respecte mon besoin de changer de sujet.
Le trombinoscope des Basques défile à l’écran. Les visages des Biarrots se succèdent devant mes yeux comme un compte à rebours, un décompte au bout duquel apparaîtra le visage qui va me vriller les tripes. Je suis tellement happé par l’impatience et l’appréhension de le voir apparaître à l’écran, que je n’ai même pas le cœur à recenser les bogossitudes des joueurs du sud-ouest.
Le portrait du dernier Biarrot est suivi par celui du premier stadiste. Là ce n’est plus un compte à rebours, mais une roulette russe. Chaque visage peut être suivi par celui de mon bobrun. Ma respiration est comme suspendue, les battements de mon cœur avec.
Et BAM !
Jérém apparaît à l’écran et j’ai l’impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Les beaux cheveux bruns à peine un peu plus longs que dans mon souvenir, insolente crinière de jeune loup, tenus dans un véritable brushing de bogoss peigné vers l’avant, retombant légèrement sur son front. Le sourire ravageur, le maillot particulièrement flatteur vis-à-vis de sa plastique. Jérém est indiciblement beau. Je suis heureux de le voir souriant, l’air si épanoui.
Mais au fond de moi j’ai très mal à l’idée de le savoir si loin de moi, à l’idée de l’avoir perdu.
L’image de mon bobrun ne s’affiche à l’écran que pendant une ou deux secondes, mais elle reste longtemps imprimée dans ma rétine. Ulysse apparaît quelques joueurs plus tard. Lui aussi est indiciblement séduisant avec ses beaux cheveux et sa belle barbe, avec cette belle blondeur de jeune nordiste qui entoure son visage aux traits virils. Je n’arrive même pas à lui en vouloir du fait que Jérém se soit détourné de moi parce qu’il est attiré par lui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas Ulysse draguer Jérém. Quant à la fascination que Jérém peut ressentir pour lui, je la trouve parfaitement naturelle. Je me demande où ils en sont, s’il s’est passé quelque chose entre eux.
Les joueurs déboulent sur le terrain. La caméra s’attarde sur Jérém. Le commentateur évoque le nombre remarquable de points marqués par la jeune recrue du Stade depuis le début de la saison, tout en parlant de lui comme d’un « joueur remarquable, d’un espoir pour le rugby à tout juste 21 ans ».
L’arbitre siffle le début du jeu. Le ballon est lancé et les actions s’enchaînent. Dès la 6ème minute, Jérém va au but. Le stade exulte comme un corps traversé par un orgasme. Un orgasme sportif provoqué par le beau brun toulousain adopté par la capitale. Jérém marque de nouveaux points quelques minutes plus tard. Il est rapide comme l’éclair, il file à travers les joueurs de l’équipe adverse comme une rafale de vent. Il plonge, et il met le ballon au-delà de la ligne de but. Le stade jouit à nouveau. Jérém se relève, comme s’il était monté sur ressorts. Il a l’air de n’avoir rien fait, et surtout pas de venir tout juste de se taper un sacré sprint pour atteindre le bout du terrain. Son jeu a l’air si naturel, si facile, si cousu de fil blanc, qu’on a l’impression que c’est tellement facile, qu’on en oublie que cette aisance, que cette dextérité, cette apparente « facilité » sont le résultat d’un travail acharné et de longue haleine, et de pas mal de sacrifices.
Le jeu reprend. La mi-temps approche. Le ballon traîne un peu au milieu du terrain. Il finit par se dégager grâce à une passe d’Ulysse. Réception parfaite de Jérém, par ailleurs stratégiquement placé en bord de terrain, plutôt à l’écart des joueurs basques.
Le bel ailier fonce alors vers la ligne de but. La moitié des Biarrots se rue dans sa direction pour essayer de l’intercepter. Un premier joueur tente de lui barrer le chemin, mais Jérém arrive à lui filer entre les doigts.
— Il est terrible, ce gosse, fait Papa, euphorique, emporté par la performance spectaculaire du jeune ailier.
Un deuxième obstacle humain tente de se mettre en travers de son envolée vers le but. Jérém est touché, il est déséquilibré, mais se rattrape et il continue sa route, comme un lapin Duracell.
— Incroyable, il est incroyable, je te dis !
Il ne lui reste que quelques mètres avant d’atteindre la ligne de but. Ça paraît dans la poche.
Mais le destin en a décidé autrement.
Sorti de nulle part, un jouer de l’équipe adverse arrive comme un fou, et percute Jérém de plein fouet. Mon beau brun est éjecté en l’air et retombe lourdement sur le sol, sur sa jambe droite. Et sur sa tête.
Je suis abasourdi par la violence de cet instant, par sa vitesse sans appel, sa brutalité, sa soudaineté. Et pourtant, il me paraît interminable. Au plus profond de moi, je sens que quelque chose de grave est en train de se passer. Mais mon cerveau bugge, refuse de croire, ne réalise pas à quel point une poignée de secondes sont en train de tout faire basculer.
Jérém gît au sol, immobile. L’impensable se produit devant mes yeux. Sa magnifique trajectoire qui semblait inarrêtable a été stoppée net par un bourrin de joueur qui s’est jeté sur lui comme une brute. L’inquiétude me submerge et je me tourne instinctivement vers papa pour être rassuré.
Mais Papa a décollé son dos de son fauteuil, il a enlevé ses lunettes et scrute l’écran d’un air très préoccupé. Et son attitude ne me rassure pas vraiment, pas du tout.
Jérém demeure allongé sur le sol, il semble inanimé. Le jeu est arrêté. Les instants qui suivent me paraissent s’étirer à l’infini.
— Oh putain, putain, putain ! jure Papa.
— Qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qui se passe ?
Désespéré, je me remets à son expertise en matière de rugby. Et, par extension, en matière de blessure au rugby.
— Je ne sais pas, mais ça ne sent pas bon. On dirait qu’il a perdu connaissance.
« Tommasi ne se relève pas » glisse le commentateur, visiblement tout aussi déboussolé que Papa et moi « une équipe de secours est en train de rentrer sur le terrain ».
En effet, un petit groupe de personnes avec une civière vient de débarquer sur la pelouse. L’une d’entre elles, certainement un médecin, se penche sur Jérém et semble essayer de lui parler. Mais il n’obtient visiblement aucune réaction. Jérém ne répond pas à ses sollicitations et il demeure inanimé. Le médecin saisit alors le masque à oxygène que son collègue lui tend et le place sur la bouche du jeune rugbyman blessé.
Je suis hors de moi lorsque le direct laisse la place aux images de replay. Je m’en fous du replay, je veux voir Jérém !!!
« A vitesse réelle, le plaquage du numéro 13 est un placage imprudent, avance une deuxième voix off. Il arrive sur Tommasi avec beaucoup de vitesse, il ne contrôle pas sa puissance. Il s’est délibérément jeté sur son adversaire pour le stopper coûte que coûte, pour l’empêcher de marquer à nouveau. Pour moi, c’est pénalité et carton rouge contre le 13 ».
« Avant la sanction, tempère le commentateur principal, il y a l’inquiétude au sujet de l’état de santé de Tommasi ».
Le ralenti de l’accident de Jérém défile à l’écran et montre comment son genou a été malmené lors de la chute. Son pied a touché le sol dans une position décalée. Le poids de son corps, déséquilibré, démultiplié par la chute, s’est déchargé dessus, et le genou droit s’est plié vers l’avant. Les images sont insoutenablement dures, cruelles. Je peux seulement imaginer la douleur qu’il a dû ressentir lorsque son articulation a subi cette sollicitation inhumaine. J’en ai le vertige, j’ai mal au cœur. Je suis tellement triste, j’ai mal pour lui. Je suis horriblement inquiet.
— Ah putain, putain, putain ! Il ne fallait pas ça, pas ça ! s’exclame Papa, toujours aussi choqué.
— Dis-moi ce qui se passe… je l’implore.
— Attends une seconde…
Le direct revient, Jérém est toujours au sol. Il semble enfin être revenu à lui. Mais l’image qui se présente à mes yeux m’arrache les tripes, déchire mon cœur. Mon bobrun tient son genou droit entre ses deux mains, et il est en train de se tordre de douleur.
— Eh, merde ! lance Papa, visiblement bouleversé, sonné, dégoûté.
— Dis-moi, Papa ! Dis-moi !
— C’est le genou qui a pris. Et à voir comment il a mal, les ligaments ont été arrachés.
— Et c’est grave, ça, non ?
— C’est grave, oui.
— Mais grave comment ?
— Au mieux, sa saison est foutue. Et peut-être même sa carrière au rugby. 3 commentaires
3 commentaires
-
Par fab75du31 le 16 Juin 2022 à 20:25
Janvier 2003
Jérém.
Pour toi, ailier vedette de l’une des équipes les plus puissantes du Top16, la nouvelle année démarre comme sur des roulettes. Dès le premier match à la reprise du championnat, tu renoues avec une belle forme sportive et de belles prestations. Et ce, malgré l’absence d’Ulysse sur le terrain. Ton coéquipier n’est pas encore complètement remis de sa blessure, les médecins lui ont conseillé de prendre deux semaines de repos supplémentaires. Mais tu arrives quand même à marquer. Une fois, deux fois, trois fois. Tes coéquipiers te félicitent. A la mi-temps, le coach a l’air tout excité comme quand la victoire se profile. Le stade exulte à chacun de tes exploits. Tu te sens bien, tu te sens à ta place. Être admiré, reconnu, aimé, c’est tout ce que tu as toujours voulu par-dessus tout. Et là, ce stade en fibrillation, cette foule qui chante, qui encourage, qui te porte, qui génère cette vibration puissante que tu sens sous tes pieds et qui remonte jusqu’à ton cœur, tout cela ressemble à une sorte d’ivresse, comme l’effet d’un joint, qui te fait perdre pied, et foncer, planer, foncer toujours plus.
Le coup de sifflet scelle la première victoire de l’équipe depuis un mois. Une victoire franche, spectaculaire. Une victoire dont tu n’es pas le seul auteur, mais à laquelle tu as largement contribué. Une très belle façon de démarrer la nouvelle année.
— Tu as fait un match splendide, Jé ! te balance Uly, venu carrément te féliciter sur le terrain, en te prenant dans ses bras et en t’enivrant avec la puissance de son corps et la douce virilité de son parfum.
C’est la première fois qu’il te prend dans ses bras depuis des semaines. Depuis le petit accident avant Noël, tu évites le contact physique avec lui. Pour ne pas qu’il pense que tu le harcèles. Pour ne pas le mettre mal à l’aise. Pour ne pas te mettre mal à l’aise.
Uly a été super avec toi quand tu lui as montré que tu avais envie de lui. Il ne t’en a pas voulu le moins du monde. Mais le malaise que cela a provoqué en toi ne s’est toujours pas complètement dissipé. Même après l’explication au réveillon de la nouvelle année.
Et de toute façon, même si tu sais désormais qu’il t’est définitivement inaccessible, ton attirance pour lui est toujours là. Ça ne t’est pas arrivé souvent qu’on te résiste. Et tu le trouves encore plus sexy, comme si c’était possible. Et cette accolade amicale dans l’élan de la liesse de la victoire te fait du bien autant que ça te vrille les tripes. Quand tu penses tout le bien que tu voudrais lui faire et tu ne pourras jamais… tu te dis, quel gâchis !
— Tu as vu ? Tu te débrouilles très bien sans moi ! il te glisse à l’oreille.
Son souffle chaud sur ton oreille te donne des frissons.
— Imagine ce qu’on aurait pu faire tous les deux !
— T’inquiète, je vais pas tarder à revenir !
Une caméra et un micro t’attendent une fois de plus en embuscade à l’entrée des vestiaires. Tu sais que c’est encore pour ta gueule. Tu détestes ça, tu n’as vraiment pas envie de te prêter à cet exercice. En fait, t’as juste envie de passer à la douche. Mais la direction a été claire, on ne refuse jamais une interview. Alors, tu sais que tu ne peux pas y échapper.
— Quel match, Jérémie ! te lance le journaliste, comme s’il était ton pote.
Il est pas mal, tu te dis que tu le baiserais bien.
— Euh… merci…
— Il semblerait que le Stade retrouve enfin sa forme. De beaux matches en perspective ?
— L’avenir nous le dira. Pour l’instant, on se contente de travailler et de nous préparer au mieux.
— Le tandem avec Klein t’a moins manqué que lors des derniers matches, on dirait…
— Le Stade est une grande équipe avec de grands joueurs. Mais Ulysse est un très bon élément, et il apporte énormément à notre jeu.
— Il doit te tarder qu’il retrouve le chemin du terrain !
— Evidemment !
— C’est pour bientôt ?
— C’est aux soignants de le dire !
— Merci Jérémie ! Et encore félicitations pour ton match !
— Merci.
Nico.
Pour moi, l’année 2003 démarre dans une morosité persistante. Je pense toujours à Jérém. Il me manque, chaque jour un peu plus. Je repense souvent à ce mot, « un homme », qu’il a si clairement et si sonorement prononcé au sujet d’Ulysse. « Un homme », c’est ce qu’était mon cousin Cédric aux yeux de Papa un jour de la Toussaint il y a quelques années déjà, alors qu’il me voyait toujours comme un gamin à ce moment-là. « Un homme », c’est ce qu’est Ulysse aux yeux de Jérém, alors qu’il ne me voit probablement lui aussi que comme un gamin immature. « Un homme », c’est ce dont il semble avoir besoin. Ça avait l’air si clair dans sa tête ! Je me dis qu’il doit ressentir et ressasser cela depuis un certain temps. Ça fait un mal de chien de réaliser qu’on n’arrive pas à combler les attentes et les besoins de celui qu’on aime.
Ça fait mal, mais le pire c’est que je n’arrive même pas à lui en vouloir.
Je repense au chemin parcouru par ce garçon, d'abord tombeur de nanas, qui au début de notre relation ne voulait que me baiser et qui refusait catégoriquement d’assumer son penchant pour les garçons. Même s’il n’est toujours pas prêt à vivre tout ça au grand jour (et pour ça, je ne peux pas lui en vouloir, son contexte familial, et plus encore le contexte professionnel, n’étant pas vraiment propices à cela), il a fini par accepter sa vraie nature.
J’ai le sentiment que le plaisir et les bons moments que nous avons vécus ensemble n’y sont pas pour rien dans ce cheminement. Je pense que notre relation lui a montré qu’il pouvait être aimé, qu’il le méritait, et que son destin n’était pas d’être toujours abandonné par ceux qu’il aime.
Mais aujourd’hui, je ne lui suffis plus.
J’ai toujours pensé que Jérém et moi étions plutôt différents. Au final, je réalise que nous sommes semblables dans ce besoin que nous avons d'être rassurés par l’autre. En avançant dans ma vie, je finirai par comprendre qu’au fond de soi, tout le monde a besoin d’être rassuré. Certains le montrent, d’autres pas.
Jérém a le mérite d’avoir été franc. Je comprends tout à fait qu’il puisse être fasciné par un gars comme Ulysse. Un gars qu’il voit chaque jour, alors que je suis loin.
Parfois j’ai envie de monter à Paris pour aller le voir, pour tenter de lui rappeler à quel point l’histoire d’Ourson et de P’tit Loup était belle. Mais au fond de moi je sais ça ne servirait à rien. L’attirance ne se commande pas, ne se raisonne pas. Pas plus que les sentiments. Et aujourd’hui, l’une et les autres l’amènent vers son coéquipier.
Je préfère le savoir heureux loin de moi que malheureux avec moi. Je l’aime et je sais qu’il m’aime. Mais parfois s’aimer ne suffit pas pour se rendre heureux.
J’essaie de me réconforter en repensant aux mots de Thibault : « Parfois, il faut faire de grands détours pour arriver là où on est destinés à nous rendre ».
Mais cela ne suffit pas à calmer ma tristesse, le sentiment de manque, le sentiment de terrible gâchis.
Janvier avance, et ma morosité ne fait que s’installer chaque jour un peu plus. Notamment lorsque je me retrouve seul. Voilà pourquoi j’accepte si volontiers la main tendue de Ruben, ses élans vers moi, sa tendresse.
Pour ne pas vivre seul…
https://www.youtube.com/watch?v=5WKGwRqRok8
Un soir, le petit Poitevin me propose de mater un DVD. Dès les premières images, ce dessin animé me ramène deux ans en arrière, dans une autre ville, dans un autre appartement, à un autre garçon. Ruben lance le DVD d’Aladdin et je me retrouve propulsé au printemps 2001, à Toulouse, dans un appart au rez-de-chaussée non loin de la Halle aux Grains, en compagnie d’un adorable garçon prénommé Stéphane. Ainsi que de Gabin, son labrador noir, cet être tout poils et amour qui a permis notre rencontre.
Je me souviens de la douceur de ce garçon. Jérém a été mon premier. Mais Stéphane a été le premier à me montrer que l’amour et le plaisir entre garçons pouvaient être plein de tendresse. Thibault me le montrera également par la suite. Bien avant les premières retrouvailles de Campan, bien avant que Jérém ne me laisse entrevoir que derrière le mâle baiseur se cachait un garçon sensible et adorable.
Je me souviens que je m’étais endormi devant Aladdin. Et je me souviens qu’à mon réveil, Stéphane était en train de cuisiner un risotto.
Ça fait un moment que je n’ai pas eu de ses nouvelles. J’espère que sa vie en Suisse se passe bien. Je me demande s’il a rencontré quelqu’un.
Cette fois-ci, c’est Ruben qui s’endort devant Aladdin, la tête appuyée contre mon épaule. Je le regarde dormir, les lèvres entrouvertes, les paupières abandonnées, une expression enfantine sur le visage.
Ruben est un garçon vraiment touchant. Il m’attendrit. Il est aux petits soins avec moi, et son enthousiasme vis-à-vis de notre couple est touchant. Car il considère que nous en sommes un. J’aimerais pouvoir ressentir la même chose, avec le même enthousiasme, avec le même entrain. Hélas, ce n’est pas le cas.
En attendant, de l’entrain le petit Poitevin, en a pour deux. Il est adorable, et il fait tout ce qu’il peut pour me faire me sentir bien avec lui. Je sens qu’il tient vraiment à moi. Ça me touche. Mais ça ne m’empêche pas de penser à Jérém dès que je suis seul. Et parfois même quand je suis avec lui. Même lorsque nous nous faisons des câlins, ou lorsque nous faisons l’amour, il m’arrive de penser à mon beau brun. Il me manque à en crever.
Je n’arrive pas à arrêter de me questionner sur le sens de ce coup de fil le soir du réveillon du 31, suivi de son mutisme après mes rappels et mes messages du lendemain et des jours suivants. Et de ce message, « oublis c était un erreur », qui ne me satisfait pas, auquel je n’arrive pas à croire.
Est-ce qu’il m’a appelé à un moment où il était saoul, et il a regretté de l’avoir fait une fois ses esprits retrouvés ? Qu’est-ce qui s’est passé dans sa tête lorsqu’il a composé mon numéro cette nuit-là ? Que se serait-il passé si j’avais décroché ? Que m’aurait-il dit ? Je ne le saurai jamais.
Alors, je ne peux m’empêcher de regretter amèrement de ne pas avoir pu lui répondre, d’avoir éteint le téléphone pour ménager Ruben. Je sais pertinemment que si Jérém essayait de revenir vers moi, Ruben ne ferait pas le poids, malgré tout son amour. Je m’en veux de ne pas savoir l’aimer comme il le mérite. L’idée de le faire souffrir un jour me meurtrit.
Non, l’attirance ne se commande pas, ne se raisonne pas. Pas plus que les sentiments. Et aujourd’hui, l’une et les autres m’amènent toujours vers le seul garçon qui a su ravir mon cœur.
Jérém.
Les matches des journées de janvier sont tous bons. Fin janvier, ton pote Ulysse revient enfin sur le terrain. Le Stade semble lancé comme une fusée et personne ne semble pouvoir vous résister. Dans la presse sportive, on commence à envisager que ton équipe puisse soulever le Brennus au mois de juin.
L’entraîneur est content, les dirigeants viennent vous féliciter dans les vestiaires à la fin des matches. D’importantes rallonges de salaire sont à la clé. Jamais tu n’aurais cru gagner autant d’argent à 21 ans. Tu ne sais même pas quoi en faire. Alors tu claques sans compter. Tu achètes une nouvelle voiture, une allemande aux quatre anneaux entrelacés, sportive, coupée, d’un beau bleu métallique. Elle peut monter jusqu’à 270 km/heure. Tu envoies aussi de l’argent à Maxime.
Oui, en ce début d’année, tout semble te réussir. Parfois, tu ressens la sensation d’être invincible. Qu’elle est grisante cette illusion propre à la jeunesse ! Fausse, mais grisante.
Alors, la fac, tu t’en branles désormais. Tu te dis que ça ne sert à rien, et que tu n’as pas de temps à perdre pour ces conneries. Quand tu n’es pas aux entraînements ou aux matches, tu n’as qu’une envie, celle de faire la fête.
Il a fallu que le coach menace de ne pas te mettre titulaire pour que tu reviennes sur ta décision d’abandonner les études.
— Tu verras, petit con, tu me remercieras plus tard !
— C’est ça, oui !
— Tu sais, Tommasi, aujourd’hui tu as du mal à l’envisager, mais un jour tout ça pourrait bien s’arrêter. Mais je te le dis, tout ça, ça va bien s’arrêter un jour. Et le pire, c’est que personne ne peut dire quand cela va se produire. Et quand ce moment vient, si tu n’as pas un plan B pour rebondir, tu vas être complètement largué. J’en ai vu des jeunes joueurs comme toi qui ne voulaient que taper dans le ballon et faire la fête. Quand ça s’est arrêté pour eux, ça a très mal tourné. Prépare-toi une voie de secours, mec, juste au cas-où. Tu sais, il suffit de si peu pour que tout s’arrête d’un coup.
Mais tu ne crois pas ses mots. Tu reprends le chemin des cours, mais à contrecœur. De toute façon, tu t’en fiches. Tu n’en branles pas une, tu triches aux exams, ça passe. Tu es un sportif de haut niveau, et à la fac tu as une sorte de pass coupe-file. Les autres étudiants en cursus normal savent qui tu es et que tu as un traitement de faveur parce que tu sais taper dans un ballon. Tu sens leur hostilité. Mais tu t’en tapes, tu n’es pas là pour te faire des potes.
Tout ce qui compte pour toi aujourd’hui, c’est le rugby. Entendre ton nom annoncé dans le stade à chaque fois provoque en toi une sensation de dingue. Au fond de toi, tu n’arrives toujours pas à croire que tu es titulaire dans la plus puissante équipe du championnat. C’est incroyable, oui, mais jouissif.
Nico.
En début d’année, je valide de nouveaux partiels. Je révise avec Monica et Raph et ça ne se passe pas trop mal. Je me demande si Jérém a validé les siens. Je me demande surtout s’il va toujours à la fac. Je me demande ce qu’il fait. Je me demande s’il s’est passé quelque chose entre Ulysse et lui. Je me demande s’il pense à moi. Je me demande si je lui manque parfois un dixième du centième de combien il me manque.
Je ne peux arrêter de me demander pourquoi, alors que nous nous aimons comme des fous, nous n’arrivons pas à nous rendre heureux. Pourquoi je n’arrive pas à le rendre heureux, à le combler ? Pourquoi je n’arrive pas à trouver les mots pour lui expliquer combien je l’aime ?
Peut-être parce que c’est difficile de parler à ceux qu’on aime.
Soudain, je pense à ce qui s’est passé entre Papa et moi, à notre dispute, à notre éloignement. Et à notre réconciliation récente. Nous n’avons jamais su nous parler. Mais j’ai su lui écrire. Et nous nous sommes retrouvés, alors que notre incompréhension semblait insurmontable.
Ma lettre semble avoir eu le pouvoir d’amorcer ce petit miracle. Elle a réussi, là où les mots de visu ont échoué. Peut-être que je suis meilleur à l’écrit qu’à l’oral. Je suis meilleur là où je peux tout contrôler, là où je peux me reprendre autant de fois que nécessaire, là où la pression du regard de l’autre ne me fait pas perdre tous mes moyens. D’ailleurs, ça a toujours été le cas à l’école.
Peut-être que je devrais écrire à Jérém. Mais pas un SMS. Je pense plutôt à une lettre. Une lettre sur laquelle je prendrais le temps d’exprimer ce que je ressens au plus profond de moi. Une lettre écrite de ma main, noir sur blanc. Une lettre pour marquer le coup, pour marquer son esprit.
C’est ce à quoi je m’attèle à la mi-janvier.
Je sais que Jérém n’est pas un fou de lecture, alors je sais que je dois faire court. Une page au plus, si je veux qu’il la lise. Ça prend beaucoup d’énergie que de mettre des mots sur ses propres ressentis, d’ouvrir son cœur. J’écris longtemps. A la fin de la première session, j’ai gratté douze pages. Je reprends tout depuis le début, et j’arrive à réduire à sept. Je reprends encore, j’arrive à cinq. Puis trois. Je relis sans cesse mes phrases, je réorganise, j’affûte mes tournures, jusqu’à leur donner une cohérence qui me satisfait. Au final, je parviens à seulement deux pages. Je suis épuisé, je ne peux pas faire moins. C’est énormément de travail que de faire court et simple.
Salut Jérém, « mon » p’tit Loup,
J’espère que tu vas bien, et que tout se passe bien pour toi.
Je sais que tu casses la baraque au Stade et je suis heureux pour toi.
Je sais aussi que tu n’as pas vraiment envie de me parler, mais il y a des choses que j’ai envie de te dire. Elles me brûlent les lèvres, elles tournent dans ma tête, elles me réveillent la nuit. Alors, j’ai choisi de les écrire. J’aimerais que tu les lises, même si tu n’y répondras pas.
La première chose que j’ai envie de te dire, Jérém, c’est que je t’aime.
Je t’aime parce que j’ai l’impression que ma vie a commencé le jour où je t’ai vu au lycée pour la première fois.
Je suis tombé amoureux ce jour-là et je n’ai rien pu faire pour empêcher que cela arrive. A vrai dire, je n’ai rien fait pour empêcher que cela arrive. Parce que cet amour m’a réveillé, m’a fait me sentir vivant, heureux comme jamais auparavant.
Je pense que j’ai eu beaucoup de chance. La vie t’a mis sur mon chemin. Hasard, coïncidence, destin, je ne sais pas comment on peut appeler cela, à part une évidence. Tout était réuni pour que toi et moi ça le soit.
Tu es arrivé, tu as tout chamboulé. Mon emploi du temps, mes priorités, ma perception du monde, ma vie tout entière. Je n’ai rien compris à ce qu’il se passait, je n’ai surtout pas cherché à comprendre. Pour la première fois de ma vie, je me suis complètement laissé aller. Comme un grand saut dans le vide.
Et je suis tombé amoureux de toi. Je n’aurais jamais pensé que c’était possible d’aimer si fort et tu m’as prouvé le contraire.
Je t’aime quand tu es heureux, je t’aime quand tu es triste, je t’aime quand tu es fort, je t’aime quand tu te renfermes sur toi-même, je t’aime quand tu me fais l’amour et tu me fais me sentir entièrement à toi, je t’aime quand tu me repousses, je t’aime quand tu m’en veux, je t’aime quand tu as la rage, je t’aime pour cette douceur qui est en toi et que tu caches trop souvent.
Je t’aime quand tu me fais l’amour et qu’après tu te colles contre moi, je t’aime aussi quand tu veux que je me colle contre toi. J’aime te regarder dormir, et écouter ta respiration. Je t’aime quand je me réveille dans la nuit et que je sens ta présence à côté de moi.
Je t’aime au réveil quand j’entrouvre les yeux et que je vois ton visage, je t’aime quand je te vois te préparer le matin, prendre ton café, fumer ta cigarette. Je t’aime quand tu m’appelles « Ourson ». Je t’aime quand tu souris alors que je viens de t’appeler « P’tit Loup ».
Je t’aime parce que tu fais battre mon cœur plus vite que lors d’un sprint. Je t’aime tel que tu es. Je t’aime pour tout, je t’aime tout le temps.
Aujourd’hui, je me demande comment était ma vie avant ce jour de mai où je suis venu « réviser » à l’appart de la rue de la Colombette. Imaginer ma vie sans toi m’est tout simplement impossible.
Cette sensation d’inachevé que je ressens au plus profond de moi, est ce qu’il y a de plus insupportable. Ce regret permanent, cette certitude qu’on est passé à côté de notre histoire, de notre vie, de notre amour, du bonheur.
C’est si triste de me dire qu’on a eu la chance de nous rencontrer, de connaître l’amour, mais qu’il nous est impossible de le vivre sereinement.
En fait, je ne crois pas que ce soit impossible. Je me refuse à le croire. Je n’arrive pas à me résigner. C’est plus fort que moi.
Alors, sois assuré que si tu m’appelais demain pour me dire « j’arrive », je t’ouvrirais grand ma porte, mes bras, mon cœur, ma vie.
Quoi que tu décides, tu es et tu resteras l’homme de ma vie. Alors, peu importe la distance, peu importe le temps qui passe, je serai toujours près de toi, je t’emporterai avec moi. Je penserai à toi chaque jour, et à tous ces beaux souvenirs de Toulouse, de Campan, de Paris, de Montmartre, ici à Bordeaux, à l’hôtel, ces souvenirs qui sont les plus beaux des trésors pour moi. Je ne garderai que les plus heureux, parce que je veux me souvenir à quel point j’ai été heureux avec toi.
Je m’endormirai chaque soir en imaginant nos retrouvailles, comme dans les films.
J’ignore si nous nous reverrons un jour. Ce dont je suis certain en revanche, c’est que je ne t’oublierai jamais.
Alors, je souhaite que cette année apporte le meilleur pour toi, et pour ceux qui comptent pour toi.
Sois heureux et fais de beaux matches, p’tit Loup.
Je t’aime, Jérémie Tommasi, je t’aime malgré toutes nos différences, malgré toutes mes maladresses.
Nico
Je dépose cette lettre dans la boîte jaune les mains tremblantes, comme une bouteille à la mer. C’est le 17 janvier.
Jérém.
Janvier 2003
Les matches s’enchaînent, et les petits bobos aussi. C’est le revers de la médaille de ton succès insolent. Tu es l’homme à abattre avant qu’il ne marque des points. Tu reçois des coups, tu tombes, tu te fais plaquer. Rien de grave pour l’instant. Le plus souvent, ce sont les épaules, les cuisses, le dos qui prennent. Tu as des bleus et de petites douleurs partout. Mais tu serres les dents comme un bonhomme et tu avances.
Les bandes chauffantes, les anti-inflammatoires, les massages, la bringue de la troisième mi-temps, l’alcool et la baise t’aident bien à oublier que ton corps souffre.
Tu as vingt et un ans, tu es l'ailier vedette du Stade Français. Paris est à toi, et les portes des boîtes les plus huppées s’ouvrent à toi. Tu te régales.
Il t’arrive de te faire sucer ou de mettre un coup vite fait à des nanas qui veulent à tout prix se faire baiser par un rugbyman. Mais quand tu veux vraiment prendre ton pied, tu sais où te rendre pour baiser un mec. Près de la fac, dans une résidence étudiante.
Tu as croisé le regard de Joris dans les chiottes de la fac. Tu as connu l’entrain de sa bouche sur ta queue dans l’une des cabines des chiottes de la fac, quelques instants plus tard. Tu as connu la douceur de son cul dès le lendemain. Et, depuis, c’est quand tu veux. Tu le sonnes, et il vient chez toi se faire baiser. Ça te rappelle bien quelque chose, tout cela, n’est-ce pas, Jérémie ?
Lundi 20 janvier 2003, envoi lettre + 3 jours.
Les heures et les jours suivant l’envoi de ma lettre sont empreints d’une euphorie fébrile. L’attente ralentit les heures, l’impatience m’empêche de me concentrer sur mes révisions. J’essaie de m’imaginer quand sa lettre arrivera chez lui, à quel moment il la découvrira, à quel moment il l’ouvrira.
J’essaie d’imaginer sa réaction lorsqu’il lira mes mots. Je me demande si j’ai su exprimer ce que je ressens, je me demande si je n’aurais pas pu faire mieux, si je n’ai pas oublié quelque chose d’essentiel.
Et je me dis que j’ai ouvert grand mon cœur et que je n’aurais pas pu faire davantage.
Je m’imagine qu’il soit touché, ému et qu’il m’appelle dans la foulée. L’espoir renouvelé a le pouvoir de chasser ma mélancolie et ma morosité.
Trois jours après, je n’ai toujours pas de nouvelles. Je me demande si la lettre est bien arrivée. Est-ce qu’elle a été ralentie par le week-end ? Est-ce qu’elle s’est perdue dans la masse du courrier et n’arrivera jamais à destination ? Il est bien possible que Jérém n’ouvre que rarement sa boîte aux lettres. Est-ce qu’il a repéré ma lettre parmi les autres courriers ? Est-ce que, s’il a découvert ma lettre, il a eu envie de la lire ?
J’espère au moins que ma démarche ne va pas le contrarier.
Lundi 27 janvier 2003, envoi lettre + 10 jours.
Hélas, les jours passent et deviennent une semaine sans qu’un quelconque signe ne vienne de sa part. Mes illusions s’évaporent, mon euphorie avec. Je dois me rendre à l’évidence. La lettre est certainement arrivée, il l’a certainement vue, lue, et il n’a pas cru bon y répondre. Pourquoi ?
En fait, je crois que je n’existe plus pour lui. Je retrouve ma morosité d’avant, en pire.
Samedi 1er février 2003, envoi lettre + 15 jours.
Il est 14h30, je suis chez Ruben et nous venons de faire l’amour. Son téléphone sonne. C’est sa mère. Le petit Poitevin part dans la chambre pour discuter tranquille. Non pas que ma présence le dérange, mais comme ces coups de fil peuvent durer longtemps, il a pris par habitude de s’isoler.
Seul devant la télé, je zappe. Et je tombe sur lui. Sa tête en plan serré à l’écran. Ses cheveux bruns, ses beaux traits de mec, son sourire incendiaire. Il vient de marquer. Le regard intense, le front perlant de transpiration, son maillot, ses pecs ondulant au rythme de la respiration sous l’effort, il est beau à en pleurer. J’ai envie de lui. J’ai envie d’être possédé et rempli par sa virilité. J’ai envie de le faire jouir. J’ai envie de le voir jouir. J’ai envie de pleurer. Mais j’ai surtout envie de le prendre dans mes bras et de le serrer très fort contre moi. Juste ça. Je donnerais cher, juste pour passer une heure avec lui et le tenir dans mes bras.
Jérém lève les bras, le stade exulte, ses coéquipiers se jettent sur lui. Je suis heureux de le voir heureux. Mais son bonheur ne fait que souligner mon malheur.
Ulysse se jette à son cou et le serre très fort contre lui. Qu’est-ce que ressent mon Jérém à cet instant ? Est-ce que ce contact lui rappelle le bonheur de l’instant où il a pu enfin accéder à la virilité du beau blond ?
J’entends Ruben approcher, et je zappe aussitôt. J’ai plus que jamais envie de pleurer mais je ravale vite mes larmes prêtes à couler sur mes joues. Et j’écoute le récit que Ruben me fait du coup de fil avec sa mère en faisant semblant d’en avoir quelque chose à carrer.
Jérém.
Février 2003.
Mais dans ta vie tout n’est quand-même pas que bling bling, soirées arrosées, et parties de jambes en l’air. Le rugby c’est aussi une bonne tranche de pression sur les épaules des joueurs. Il faut rester au top, toujours, et il n’y a pas de droit à l’erreur. Il faut gagner, coûte que coûte.
Avant de quitter les vestiaires, la tension est palpable. Personne ne moufte.
Quand les joueurs de l’équipe adverse débarquent sur le terrain, ils te font parfois penser à ces taureaux qui déboulent dans les rues de Pampelune (mais peut-être bien que les joueurs adverses vous perçoivent de la même façon, tes coéquipiers et toi), qui écrasent tout sur leur passage et qui parfois embrochent des mecs. Tu as assisté à ça, une fois plus jeune, et ça t’a traumatisé. Tu as peur des blessures. Pour toi, mais pour les autres aussi, pareil. La souffrance physique t’inspire un malaise insupportable.
Le laps de temps entre l’entrée sur le terrain et le début du match, l’attente avant que l’arbitre ne siffle le coup d’envoi te paraît sans fin. Tu retiens ton souffle. Tu as envie d’en découdre, mais tu es inquiet.
Tu te dis que c’est con, que tu ne vas pas quand même à la guerre, que dans l’affrontement qui va avoir lieu il n’y aura pas d’armes. Et pourtant, si, il y en a. Ces armes s’appellent vitesse, masse, envie de gagner à tout prix. Tu sais que les autres, tout comme tes coéquipiers et toi, vont tout donner pour gagner le match. Tu sais qu’ils ne reculeront pas, et que vous ne reculerez pas non plus. Sur le terrain, il y aura de la sueur, des coups, du sang, des blessures.
Lorsque le coup d’envoi est enfin donné, tu as l’impression de sauter du haut d’une falaise. Tu ne sais pas ce qui t’attend.
Le physique est sous pression, mais aussi le mental. Il faut gagner pour rester au top et pour ne pas se faire remonter les bretelles par le staff. Gagner, c’est piétiner les gars de l’équipe adverse, au sens propre comme au sens figuré. Des gars qui ont la même pression que tes coéquipiers et toi pour gagner.
Tu es affolé par les applaudissements, par la musique et les bruits qui s'entrechoquent. Le stress te donne le tournis. Parfois, la scène se fige. Tu n'entends plus rien. Tu te revois, ado, à Toulouse, lorsque tu jouais seulement pour t'amuser. Tu te revois serrer Thib dans tes bras, admirant ton meilleur pote et capitaine de l'époque brandir une coupe devant cinq spectateurs. C’était le plaisir de jouer avant tout.
Jouer dans une grande équipe, ça n’a rien à voir. On joue pour se faire applaudir, on joue pour l’argent, on joue pour ne pas se faire engueuler par le staff et pour ne pas être virés.
Il est où le plaisir dans tout ça ?
Pas étonnant qu’à la fin du match tes coéquipiers et toi ayez tous très envie de boire et de baiser pour décompresser.
Mercredi 5 février 2003, envoi lettre + 19 jours, toujours sans nouvelles de sa part.
Près de trois semaines se sont écoulées depuis l’envoi de ma lettre. J’ai perdu tout espoir d’une réponse. Ça fait deux mois que je ne l’ai pas vu, deux mois que je n’ai pas eu de ses nouvelles. Un soir, je trouve le courage d’appeler Charlène. Elle n’en a pas non plus. Depuis des mois.
— J’imagine que le rugby doit bien l’accaparer, elle me glisse.
— J’imagine aussi.
Elle me parle de son intention désormais arrêtée de fermer sa pension équestre à la fin de l’année pour partir à la retraite. Elle me dit qu’elle n’a pas encore eu l’occasion de l’annoncer à Jérém. Je pense que quand il va l’apprendre, ça va lui mettre un sacré coup au moral.
Un peu plus tard ce soir-là, alors que je regarde un film sur la 6, la première page de pub démarre avec des images qui me soufflent comme si j’avais reçu un coup de poing en plein ventre. Un spot que je n’avais pas encore vu, et qui doit tout juste venir de sortir.
Première image, trois bogoss rugbymen, arborant avec une aisance impressionnante leurs corps de fou, faits d’épaules solides, de pecs saillants, de tétons on ne peut plus invitants, de torses imberbes ou rasés de près, de tablettes de chocolat dessinées à l’équerre, de cuisses musclées, de plis de l’aine marqués et de délicieux chemins de petits poils s’abimant derrière l’élastique du boxer.
Car c’est le boxer qui est le sujet de cette pub, seul « vêtement » porté sur ces plastiques inspirant un désir intense, épais, par ces trois petits mâles qui ne semblent être venus au monde que dans le but exclusif de faire l’amour. Une magnifique brochette de beaux jeunes mâles, trois rugbymen assumant leur demi-nudité, leur intense virilité devant caméra avec un naturel déconcertant.
Un châtain, un blond, un brun. Un boxer bleu, un noir, un blanc. Un inconnu, Ulysse, Jérém.
Il y a tant de bogossitude à l’écran, tant de virilité, que ça en donne le tournis. Essayer de compter toutes ces tablettes de chocolat réunies dans un seul plan, c'est comme essayer de mesurer l'Univers, ça donne le vertige. On ne sait plus où regarder en premier, on ne sait plus qui désirer en premier. Chacune de ces beautés masculines est déjà insoutenable prise isolément, la somme l’est infiniment plus encore. C’en est trop pour un seul gourmet.
Ils sont tous beaux à en pleurer, mais mon regard ne s’attarde que sur celui qui l’aimante le plus, sur ce visage qu’il connaît mieux que tous les autres, sur ce sourire qui lui fait plus d’effet que tous les autres, sur ce corps qu’il a pu caresser et désirer plus que les autres, et le voir jouir.
Je détaille sa petite barbe de quelques jours, sa peau mate, ses tatouages, son grain de beauté dans le creux du cou, si sensuel. Et je remarque qu’il ne porte plus la chaînette que je lui ai offerte pour ses vingt ans. Est-ce qu’il l’a juste enlevée pour ce petit tournage, comme il l’enlève pendant les matches, pour ne pas se blesser, ou est-ce qu’il l’a enlevée pour de bon pour mieux me rayer de sa vie ?
Moi, la mienne (en fait, la sienne, celle qu’il a toujours eu autour de son cou et qu’il m’a offerte à la fin du premier séjour à Campan), je ne peux me résoudre à la quitter. Cette chaînette, je me surprends très souvent en train de la tripoter. La toucher, l’enrouler autour de mon doigt, ça me fait tu bien. En même temps que ça me donne envie de pleurer.
Je me souviens des ondulations de cette chaînette la première fois où Jérém m’a baisé dans l’appart de la rue de la Colombette. Je me souviens de ses ondulations en tant d’autres occasions lorsqu’il m’a fait l’amour.
Je sais ce que cette chaînette représentait pour lui. Et le geste de me la donner en me disant « comme ça, je serai toujours avec toi » m’a ému aux larmes.
Je me souviens de la première sensation lorsque je l’avais mise autour de mon cou, je me souviens de son poids, de la chaleur et du parfum qu’elle avait accumulés au contact de la peau mate de Jérém.
Aujourd’hui que nous sommes loin l’un de l’autre, que nous sommes séparés, est-ce que ça a encore un sens de porter cette chaînette si chargée en souvenirs heureux, mais appartenant désormais à une époque révolue ?
Dans le premier plan, les garçons posent devant caméra, l’un contre l’autre, les torses en rang d’oignon, les bras de l’un autour du cou de l’autre. Les torses se frôlent, les bras enlacent les épaules, les regards, les sourires s’échangent dans une complicité qui se veut presque suggestive.
Plan suivant, on ajoute du mouvement. De la chorégraphie sportive. D’abord le ballon pivote dans la main d’Ulysse, il a l’air d’un Dieu tenant la Terre en lévitation au-dessus de sa paume. Lorsqu’il est lancé, les corps bondissent avec puissance et dextérité féline, puis plongent pour le rattraper. Les images au ralenti tournées devant un fond clair permettent de capter la beauté des corps avec une précision redoutable. La violence sensuelle des images est inouïe.
Dans les plans suivants, très rapides, ça court, ça s’attrape par la cuisse, ça se plaque. Les pecs, les épaules, les tétons, les cuisses se frôlent lors d’une action de jeu simulée mais néanmoins très sensuelle. Dans l’un des plans, les boxers sont filmés de près, et ils moulent des culs d’enfer. Quant aux paquets à l’avant, ils sont bien suggérés et bien suggestifs grâce au profil de la poche.
Gros plan sur l’élastique du boxer blanc (avec contraste saillant avec la peau mate), et de la lisière de poils bruns juste au-dessus. Une image si familière à mes yeux qui l’ont si souvent vue de très près. La nostalgie et le désir me submergent.
Lorsqu’un simple bout de coton élastique arrive à la fois à mettre autant en valeur ce qu’il est censé dissimuler, moi j’appelle ça de l’œuvre d’art.
A la fin du spot, les garçons posent à nouveau devant l’objectif, arborant à nouveau leur presque nudité avec un naturel qui laisse rêveur. Leur complicité, ces gestes, ces poses, ces attitudes, les regards, certainement très chorégraphiés, semblent néanmoins suggérer une complicité qui déborderait presque dans la sensualité.
Certes, ce sont des rugbymen, des coéquipiers, ils se voient à poil chaque jour, ils prennent des douches ensemble.
Et (…) Les garçons ont dit-on/L'humeur parfois légère/Dans les vestiaires.
Dans le lot, il y en a au moins un pour sûr qui aime les garçons, et qui en pince pour un autre du lot, un blond qui n’aime a priori que les nanas. Mais est-ce qu’un soir, après l’euphorie d’une victoire, après une troisième mi-temps bien arrosée, ils n’auraient pas connu cette humeur légère qui adoucit les mœurs ?
Est-ce que ces corps ont déjà connu le plaisir que peut donner celui du coéquipier ? Jérém, avec Ulysse, et pourquoi pas avec ce bogoss châtain au physique solide et ramassé, lui aussi beau comme un Dieu ?
Je me prends à imaginer Jérém en train de se faire posséder par le beau blond, jusqu’à se faire gicler dans le cul (il a envie de ça, avec Ulysse, il me l’a balancé à la figure), puis de chevaucher le magnifique châtain, jusqu’à lui gicler dans le cul (je pense bien qu’il aurait besoin de ça, juste après, pour rebooster son égo de mâle).
J’imagine les trois jeunes rugbymen mélanger leurs corps musclés, leurs déos, leurs parfums, leurs plaisirs, leurs fougues, leurs semences, jusqu’à plus d’envie (ce sont des fantasmes, et on fantasme rarement avec des capotes, même si ces dernières demeurent obligatoires en dehors de relations stables et de tests fiables).
J’imagine les corps moites de transpiration, et pas seulement. J’imagine les délicieuses petites odeurs qui flotteraient dans l’air après de longs ébats virils. J’imagine les corps abandonnés, repus, les torses ondulant au rythme de la respiration après l’effort. J’imagine les esprits assommés par le plaisir, les ventres brûlants après d’intenses orgasmes. Ce sont des fantasmes qui me donnent une furieuse envie de me branler.
Pendant une poignée de secondes, il est question de maintien, de confort ultime, de seconde peau, de galbe sans couture, d’élastique à la tenue infaillible mais qui ne marque pas la peau, d’accompagnement des mouvements, de fibre de coton extensible qui s’étire et revient en place naturellement.
Ce que je vois, moi, c’est un hymne sublime et hypnotique à la jeunesse, à la puissance masculine et à la virilité. Et éventuellement à l’homoérotisme.
La pub suivante enchaîne, alors que l’image de mon bobrun impressionne encore ma rétine. Soudain, j’ai envie de me branler. Et je me branle. Pour ne pas pleurer, pas tout de suite.
Jérém.
Tu as vingt et un ans, et tu as du succès au rugby. Un succès insolent. Tu voyages de ville en ville chaque week-end à jouer à la baballe devant des stades bondés. Et en plus tu marques des points, de plus en plus de points, et ton équipe gagne. On écrit sur toi dans les journaux sportifs. On t’annonce une carrière fulgurante.
Les sponsors te font les yeux doux. Un fabricant de sous-vêtement te propose un bon paquet de fric pour un après-midi de tournage. Ta gueule est dans les journaux, à la télé, dans les grands affichages dans la rue.
Tu as une femme de ménage, des fringues et des pompes gratuites, des restos payés, des bouteilles offertes et des nanas jamais loin. Avec elles tu simules, il faut garder les apparences.
Tu es un enfant avec la possibilité d’obtenir tous les jouets dont il rêve. Alors, ça te monte peu à peu à la tête. Tu n’as pas le temps de penser. Tu es dans une bulle dorée. Tu n’es pas dans la réalité mais tu ne t’en rends même pas compte.
Tu sors trop et en même temps l'impression de solitude t'étouffe. Certaines nuits, tu es un gosse ivre mort qui erre dans Paris.
Lundi 11 février 2003, envoi lettre + 25 jours, toujours et encore sans nouvelles de sa part.
J’ai beau essayer de ne pas penser à Jérém, désormais son image me suit partout. La campagne de pub télé est accompagnée d’une campagne d’affichage dans les journaux et dans l’espace public. Jérém et ses potes sont partout en 4 mètres sur 3 dans la rue. Tout le monde connait désormais la beauté plastique de mon bobrun et un paquet de nanas et de mecs vont être émoustillés par son aveuglante bogossitude. Les occasions de coucher vont être infinies.
Le spot passe en boucle à la télé, ou du moins c’est l’impression que j’en ai car je tombe dessus au moins une fois par jour. Albert me demande s’il a bien reconnu Jérém dans la pub des boxers. Il me dit que si seulement son corps répondait encore, ça lui donnerait une furieuse envie de se branler. Même Ruben a reconnu Jérém dans la pub. Ça a l’air de le contrarier un peu.
J’ai envie d’envoyer un message à Jérém pour lui dire que je le trouve super beau dans cette pub. J’ai envie de lui redire à quel point il me manque. Mais à quoi bon, alors qu’il n’a même pas daigné réagir à ma lettre ?
Oui, son coup de fil raté de la nuit du réveillon était peut-être une erreur. Peut-être que ma lettre aussi était une erreur. En fait, peut-être que toute notre histoire n’était qu’une erreur. Au fond de moi, je sais que ce n’est pas vrai, car nous avons vécu beaucoup de bons moments ensemble. Mais mon malheur actuel me fait dire parfois que si je ne l’avais pas connu, je ne souffrirais pas comment je souffre aujourd’hui.
La Saint Valentin arrive et je la fête avec Ruben, l’esprit très loin, le cœur complètement en vrac. Je m’en veux parce que Ruben a préparé un bon petit repas, et même un cadeau, et pas n’importe lequel : un bon d’achat d’un grand disquaire. Je lui ai parlé du fait que la sortie du nouvel album de Madonna est imminente. Il a pris les devants.
Quant au casque de vélo que je lui ai offert, il semble lui avoir fait vraiment plaisir.
Jérém.
La bonne séquence sportive continue au mois de février. Tu deviens peu à peu le protégé de ton entraîneur. Tu sens dans son regard sa confiance grandissante en toi. Il te demande de t’amuser, et ça te met vraiment à l’aise. Ses tapes sur l’épaule pour t’encourager te font un bien fou.
Oui, professionnellement, tout va bien pour toi. Mais dans ton cœur, ce n’est pas ça du tout. Malgré tes excellents résultats sportifs, malgré une vie à 1000 à l’heure, malgré l’argent, la notoriété, les soirées, l’alcool, les baises, tes démons ne te quittent pas.
Tu es toujours attiré par Ulysse. Et même si vous vous êtes rabibochés, tu as l’impression qu’une partie de votre complicité s’est envolée à cause de ton faux pas. Pour toujours. Tu essaies de garder les apparences, mais le cœur n’y est pas. Au fond de toi, le malaise est toujours présent. Tu arrives à en faire abstraction sur le terrain. Mais en dehors, c’est autre chose. Ça a été dur de ne rien laisser transparaître de ce malaise et de ton désir persistants sur le tournage de cette pub de sous-vêtements.
Mais il y a autre chose qui te hante. C’est le fait de recevoir des témoignages d’estime de tout le monde, sauf de la part de celui dont tu l’attends le plus, dont tu les attends depuis toujours.
Ton père ne t’a jamais félicité pour tes exploits au Stade. Tu essaies de te dire que tu t’en fiches. Mais ce n’est pas vrai. Au fond de toi, tu espères le voir dans les tribunes à chaque match. Mais il n’est jamais là. Tu espères toujours recevoir un coup de fil, entendre un mot de sa part qui te montrerait qu’il est enfin fier de toi. Mais ça ne vient pas. Tu lui en veux. Tu lui en veux tellement que tu n’as même pas fait le déplacement pour Noël.
Ce qui te hante aussi, c’est de ne pas réussir à comprendre pourquoi ta mère est partie quand tu n’étais qu’un gamin, pourquoi elle vous a abandonnés, Maxime et toi. D’elle aussi, tu attends depuis longtemps un signe qui ne vient pas.
Aussi, ce qui te manque, au quotidien, c’est la sérénité, le sentiment d’être bien dans ta peau et en harmonie avec les autres. Car tu es constamment sur tes gardes. Ce décalage entre celui que tu es et celui que tu prétends être t’empêche d’être serein. Ça te fatigue. Et la peur que ce décalage puisse sortir au grand jour te stresse et te mine le moral. Tu sais que si ça arrivait, tu perdrais tout. Il s’en est fallu de peu, il y a quelques jours. On t’a sauvé le cul de justesse.
Mais au fond de toi tu sais que ce qui te manque dans ta vie par-dessus tout, c’est quelqu’un avec qui partager le bonheur de tes exploits, quelqu’un qui soit heureux de te voir réussir. Quelqu’un qui te fait te sentir bien, quelqu’un qui rend ta vie plus belle. Tu avais Nico, et il te faisait du bien. Mais Nico n’est pas là.
Tu es impressionné par Ulysse, mais Ulysse t’est inaccessible. Et la gifle morale que tu as prise en essayant de le draguer t’a remis les idées en place. Elle t’a aidé à voir clair dans ton esprit. Tu regrettes d’avoir comparé Nico à Ulysse, et de lui avoir laissé entendre qu’il n’était pas à la hauteur de tes attentes.
Il te mettait un peu la pression, certes, mais tu sais qu’il tenait vraiment à toi. Et puis, à l’occasion de cet accident de voiture l’année dernière, il t’a bien montré qu’il était à la hauteur. Il l’a même été pour toi, là tu as vraiment merdé. Tu sens que tu as été très injuste avec lui. Tu as parlé sur le coup de l’ivresse, celui de l’alcool, celui du béguin que tu avais pour Ulysse. Tu t’en veux terriblement.
Sa lettre t’a bouleversé. T’as même pleuré. Ça a été un déchirement de ne pas l’appeler. C’est dur de renoncer à lui, mais c’est mieux ainsi. Car tu te dis que le quitter pour de bon est le prix à payer pour lui rendre sa liberté et pour lui donner une chance d’être heureux. Car au fond de toi, tu as l’impression que tu ne le rendras jamais vraiment, durablement heureux.
Pour l’instant, tu prends sur toi et tu as assez d’énergie en toi pour assurer tes exploits, et les mensonges nécessaires pour te protéger. Jusqu’à quand vas-tu réussir à te convaincre que tu peux tenir à ce rythme en traînant toutes ces blessures sans essayer de les soigner ? Combien de cuites, combien de baises, combien d’argent jeté par la fenêtre va-t-il te falloir pour continuer à faire illusion devant toi-même ?
Mercredi 20 février 2003, envoi lettre + un nombre certain de jours dont j’ai fini par perdre le compte.
Un après midi, alors que je rentre chez moi à pied, je m’arrête à un kiosque à journaux pour regarder les sorties de musique classique périodiques. C’est une bonne façon de découvrir les grandes œuvres à un prix abordable.
Et là, je tombe sur une image qui me décontenance encore plus que les pubs en boxer. Sur la couverture d’un magazine people au graphisme low cost et aux couleurs criardes, je retrouve mon bobrun photographié en compagnie d’un sacré morceau de pétasse.
Blonde, gros seins, maquillage haut en couleur, cette pimbêche tient mon bobrun, t-shirt blanc et blouson en cuir, à hauteur de la taille. Et alors que ma tête se met à tourner comme un tambour de machine à laver à l’essorage et qu’une irrépressible envie de gerber se saisit de moi, j’ai du mal à lire les mots qui tentent d’expliquer l’irréparable :
Titre : Sandrine P., de la Star Ac au rugby, il n’y a qu’un pas.
Sous-titre : La belle lilloise se console de sa victoire manquée dans les bras de Jérémie Tommasi, l’étoile montante du Stade Français.
J’achète le torchon pour lire l’article à l’intérieur. Une double page montre des photos volées des deux vedettes dans une brasserie huppée. Dans l’une d’entre elles, mon bobrun est pris de dos, et il semble embrasser cette caricature de nana. J’ai envie de mourir.
En vrai, l’article ne fait que spéculer sur une rencontre lors d’une soirée, tout en suggérant qu’il y aurait eu des étincelles dans l’air et qu’il y aurait peut-être eu coucherie.
Une partie de moi me dit de ne pas prêter attention à ce torchon, car ce genre de publication ne vaut pas mieux que du PQ. Même moins, puisque le papier n’est même pas bon pour se torcher. Et pourtant, cette « « « info » » » me fait un mal de chien.
Peut-être qu’ils ont bel et bien couché ensemble, ou que ça va arriver. Je sais que Jérém est capable de coucher avec une nana pour conserver son image d’hétéro tombeur. Et le fait de coucher avec une nana connue, au vu et au su du public, peut assurément servir son propos.
S’ils savaient, les gens qui le contemplent au stade, à la télé, dans les matches ou dans la pub, sur les panneaux publicitaires, dans les journaux sportifs, et maintenant les journaux people, à quel point il a été bon amant, avec un garçon !
Je suis tellement dégoûté que je déchire le journal et je le jette dans une poubelle avant d’arriver à l’appart.
Mes derniers espoirs que Jérém puisse m’appeler après ma lettre s’évaporent devant ces photos que je n’arrive pas à me sortir de la tête. L’attente s’était déjà transformée en frustration. Et la frustration se mue alors en tristesse et mélancolie.
Avant ce maudit article, j’arrivais à faire semblant. Mais là, je n’ai plus la force de faire illusion. Cette nouvelle gifle me plonge dans un étant d’amertume et de morosité profonds. Mes camarades de fac remarquent que je ne vais pas bien. Même Ruben finit par le remarquer et par me questionner. Je rétorque que je suis tout simplement fatigué, et que tout va bien par ailleurs. Ruben fait mine de se contenter de mon explication, mais je sais que ce n’est pas le cas. Je pense qu’il se doute de quelque chose. Je pense qu’il a remarqué que mon changement d’humeur est venu avec l’apparition de Jérém dans la pub. Il n’ose pas poser des questions directes, mais je sens que ça le démange.
Je sais que j’ai déjà commencé à le faire souffrir.
Jeudi 27 février 2003.
C’est ce jour-là, alors que je suis au plus mal, que je reçois le coup de fil de Thibault. Le jeune pompier m’annonce que le Stade Toulousain va se déplacer à Bordeaux pour un match de championnat le samedi suivant, c’est-à-dire deux jours plus tard. Il m’explique qu’ils ont prévu de rester à Bordeaux le soir et de ne repartir que le dimanche matin. Il me propose d’entamer le début de troisième mi-temps avec ses potes, puis de venir me rejoindre vers 21 heures pour dîner.
Ça tombe bien, ce week-end Ruben a prévu d’aller voir sa famille. Je n’ai pas envie de l’accompagner, même si cela a l’air de bien le décevoir. Mais je n’ai pas non plus envie de le passer seul avec la pub et la vie sexuelle de Jérém qui me hantent à chaque bout de chemin. J’aurais pu passer le week-end chez mes parents, mais j’ai prévu d’y aller le prochain pour l’anniversaire de Papa.
Alors, l’idée de voir Thibault me met du baume au cœur. Et j’accepte avec plaisir.
Samedi 1er mars 2003.
Le match Stade Toulousain-Bordeaux/Begles était télévisé. Les Haut-Garonnais se sont battus comme des lions et ont eu raison des Girondins. Thibault est vraiment très beau dans son maillot blanc et noir. La match Stade Français-Castres Olympique se jouait dans le sud. Il ne passait pas à la télé, mais j’ai appris par la radio qu’il avait été remporté par les Parisiens.
Je retrouve Thibault dans une brasserie du centre-ville. Chemise, costard, cravate, chaussures de ville, brushing soigné, le demi de mêlée est vraiment très élégant, et tout en beauté. Définitivement, le petit brillant à l’oreille ajoute un je-ne-sais-quoi de furieusement sexy à sa personne, le rendant définitivement craquant.
— Eh, beh, tu es très beau ! je ne peux m’empêcher de lui lancer.
— Merci. C’est la ténue réglementaire de l’équipe pour l’après match.
— Ils ont bien choisie…
Je me retiens de justesse d’ajouter que sur un physique comme le sien, même un sac de patates ressemblerait à de la haute couture. Et que la petite traînée de parfum de mec qui flotte autour de lui titille mes narines et vrille mes neurones.
Le jeune pompier sourit, avant d’ajouter :
— Mais toi non plus t’es pas mal du tout !
C’est vrai qu’avec ma chemise grise et mon jeans pas trop mal coupés, je me sens plutôt bien dans mes baskets. Ruben m’a dit et répété qu’il me trouve beau dans cette tenue. Une fois il m’a même sucé dans cette tenue. Et le compliment de Thibault finit de me convaincre que je suis à mon avantage dans ces fringues.
— Si tu permets, je me mets à l’aise, il poursuit.
— Je t’en prie…
Le beau rugbyman ôte sa veste, défait sa cravate, ouvre deux boutons de sa belle chemise bleue, laissant ainsi apparaître quelques petits poils, ainsi qu’un soupçon de la naissance de ses pecs. C’est terriblement sexy.
La compagnie de Thibault est des plus agréables. J’aime l’amitié qui s’est créée entre nous depuis deux ans, j’aime notre complicité. J’aime le fait de me sentir à l’aise pour parler de (presque) tout avec lui. J’aime sa façon de vivre sa vie, bien que si atypique. J’aime sa façon d’assumer son enfant, un enfant qui est arrivé sans vraiment être prévu, mais certainement pas sans être aimé. Car ce petit garçon qui va bientôt avoir un an est à l’évidence le plus grand bonheur de sa vie.
— Et alors, toujours bien avec Paul ? je le questionne après qu’il m’a longuement parlé de Lucas.
« Oui, toujours. Le seul problème, c’est que nous ne nous voyons pas souvent. Une ou deux fois par mois, tout au plus.
— Ah, zut…
— Et depuis le début de l’année, c’est encore plus compliqué. Ça tombe toujours mal. Un coup c’est lui qui ne peut pas, un coup c’est moi. Ça fait plus d’un mois que je ne l’ai pas vu.
— C’est difficile de former un couple avec ce genre d’obstacles… je réfléchis à haute voix.
— Je ne sais pas si nous sommes vraiment un couple. Je sais qu’il m’aime beaucoup et qu’il ferait tout pour moi. Tout comme je ferai n’importe quoi pour lui. Mais il ne m’a jamais rien promis et il m’a toujours laissé toute la liberté de vivre ma vie comme je le sens.
— Et tu n’as pas envie d’autre chose ?
— Comme une vraie vie de couple ?
— Oui, par exemple…
— Pour l’instant, ça me va. Je prends comme ça vient, je profite des bons moments. Je ne veux pas lui mettre la pression.
Je suis touché par sa façon d’aimer, sans jamais regretter de ne pas pouvoir vivre cela en pleine lumière. Par sa façon d’accepter les choses, sans jamais se plaindre, sans jamais proférer un seul mot amer. Par son côté lumineux, positif, cette philosophie qui est la sienne, « l’important ce n’est pas ce qu’on fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu’on fait de vous », ou encore « il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions ».
J’aime son côté bien masculin, j’aime sa droiture. Et j’adore sa profonde gentillesse et sa douceur exquise. Le tout parsemé par une certaine fragilité qui le rend émouvant au possible.
Quand je le regarde, j’ai à la fois envie d'être rassuré par ses bras virils et très envie de le prendre dans les miens pour le rassurer à mon tour. Définitivement, ce gars est un véritable puits à câlins. Je sais à quel point il est bon amant, fringant et doux, viril et tendre. Et je me dis qu’en amour, il doit être adorable au possible.
— Et toi, Nico, tu en es où avec Jé ? il finit par me questionner.
— Je n’ai pas de ses nouvelles depuis près de trois mois.
— Oh, merde ! Il ne t’a même pas appelé pour te souhaiter la bonne année ?
— Non… enfin, je ne sais pas…
— Comment, ça, tu ne sais pas ?
— Le premier janvier, il a essayé de m’appeler dans la nuit. J’avais éteint le portable pour ne pas être dérangé par les messages de vœux. Je n’ai vu son appel en absence que le lendemain. J’ai essayé de le rappeler plusieurs fois, mais il ne m’a jamais répondu. Je lui ai envoyé des messages, et il a fini par me répondre que ce coup de fil était une erreur.
— Comment, ça, « une erreur » ?
— Je ne sais pas. Je ne sais pas s’il voulait dire que l’erreur c’était le fait de m’avoir appelé à la place de quelqu’un d’autre, ou bien si c’est le fait de m’appeler tout court qui était une erreur. Au fait, il t’a appelé pour la bonne année ?
— C’est moi qui l’ai appelé. Mais il était pressé, et nous avons peu discuté. On s’est dit qu’on se rappellerait plus tard, mais nous ne l’avons pas fait.
— Il ne t’a pas parlé de moi…
— Non. Je voulais lui demander de tes nouvelles, mais je n’ai pas eu le temps.
— Je lui ai envoyé une lettre.
— Quand, ça ?
— Il y a un mois et demi environ.
— Et il ne t’a pas répondu…
— Non… et il ne me répondra pas. Je crois que ce coup-ci, il a vraiment tourné la page.
— J’ai du mal à croire ça.
— T’as vu cette histoire avec cette nana de la télé ? je le questionne.
— J’ai vu, oui. Mais à ta place je ne m’inquiéterais pas pour ce genre de sottises. Ça, ce n’est que du marketing, Nico. Les dirigeants se servent de la popularité des joueurs et de la presse people pour essayer d’intéresser un nouveau public au rugby. Et au Stade Français ils sont champions en la matière. C’est eux qui ont inventé le calendrier des joueurs à poil !
— Quoi qu’il en soit, la dernière fois il m’a bien fait comprendre que je ne lui suffisais pas…
— Je trouve qu’il a été injuste avec toi. Quand il a eu son accident de voiture à Paris, tu as pris les choses en main, et tu lui as évité bien des problèmes. Tu as bien agi, tu as agi comme un homme l’aurait fait. Et tu l’as impressionné. Il m’en avait même parlé.
Je regrette de ne pas avoir pensé à lui rappeler cet épisode lorsqu’il m’a balancé que je n’étais qu’un gamin. Je regrette de ne pas avoir su lui rappeler ça et sa gratitude de l’avoir sorti de la merde.
— Il a l’air d’avoir oublié cet épisode…
— Malheureusement, je n’ai pas de solution à te proposer, Nico. Désormais Jérém a pris son envol, et mon avis n’est plus aussi important pour lui qu’il a pu l’être auparavant. Bien sûr que j’aimerais vous voir ensemble et heureux que séparés et malheureux. Bien sûr que ça me démange de l’appeler et de lui dire qu’il me semble qu’il fait une connerie monumentale en te laissant tomber. Mais s’il ne vient pas me solliciter mon avis, il continue, j’estime que je n’ai pas le droit de le lui donner. Jérém a le droit de faire ses propres choix. Je n’ai pas à les juger, à décider s’ils sont bons ou pas. Je pense qu’il a besoin de vivre sa vie, de faire des erreurs.
— Tu as certainement raison…
— Et Ruben dans tout ça ? Tu le vois toujours ? il enchaîne.
— Oui, toujours.
— Et comment ça se passe ?
— Je suis bien avec lui, mais je ne sais pas bien où notre histoire nous mène.
— Fais comme moi, prends le bon qu’il y a à prendre chaque jour.
— J’essaie. Mais je n’arrête pas de penser à Jérém. Et quand j’y arrive, je tombe sur un match, sur cette putain de pub, ou sur cette histoire à la con dans les journaux…
— Il est beau notre Jérém dans cette pub, hein ?
— Il est plus que beau, il est fabuleusement beau ! Quand je le vois à moitié à poil dans cette pub avec Ulysse, je me dis qu’il est impossible qu’il ne se soit rien passé entre eux.
— Je doute fort qu’il se passe quelque chose entre eux, le gars m’a l’air bien branché nanas.
— Admettons. Mais ce qu’il ressent pour Ulysse est bien réel…
— J’imagine qu'il faut vivre des expériences pour pouvoir faire ses choix et ne pas les regretter par la suite. Peut-être que justement de ces expériences il ressortira que le bon choix pour lui c'est toi. Moi, en tout cas, à sa place, je ne te laisserais pas filer !
— T’es mignon, Thibault.
Nous buvons nos cafés et un petit silence s’installe entre nous. Par-dessus le bord des tasses, nos regards s’accrochent, s’aimantent. Je le trouve vraiment sexy à mourir. Et les deux petits verres de vin que j’ai bus un peu trop vite à l’apéro me donnent cette petite ivresse sur laquelle le désir glisse sans freins. Peut-être que je prends mes désirs pour des réalités, mais j’ai l’impression que dans le regard de Thibault une petite lueur sensuelle pétille également.
Je le trouve insupportablement désirable. J’ai très envie de lui ce soir. Ça fait un moment que je ressens une certaine attirance entre nous. A chaque fois que je le revois, j’ai l’impression que nous refusons de la voir. Mais jamais je n’ai ressenti cette attirance aussi intensément, aussi violemment que ce soir. J’ai envie de lui, mais les conséquences d’une aventure entre nous me font peur. Vis-à vis de Jérém, de Ruben, de Thibault lui-même, et probablement de Paul aussi.
— Je dois y aller, sinon les gars vont se demander où je suis passé, m’annonce le beau demi de mêlée en reposant sa tasse sur la table.
La perspective de rentrer seul ce soir me paraît bien triste. L’idée de laisser partir Thibault me déchire les tripes.
— Comme tu voudras… je finis par lâcher, la mort dans le cœur.
Je l’accompagne à l’arrêt du bus. Nous parlons de choses et d’autres, mais je n’ai pas le cœur à la discussion. J’ai une folle envie de lui dire de ne pas partir, de venir chez moi. Mais j’ai peur de sa réaction. Et si je me trompais quant à ses envies à mon égard ? Il est possible que si je lui propose de passer la nuit ensemble, il refuse. Il est possible que je puisse le décevoir. Il est possible que ça mette à mal notre amitié.
— Ça m’a fait plaisir de te revoir, Nico.
— A moi aussi, ça m’a fait plaisir.
— Ça a été un peu court, mais on se rattrapera la prochaine fois. Passe me voir quand tu viens à Toulouse.
— Je viendrai avec plaisir.
— Tiens, il arrive, fait Thibault en voyant l’engin apparaître au loin dans la rue.
La rame avance vite. Dans une poignée de secondes elle sera là, et Thibault disparaîtra de ma vue, sa compagnie me fera défaut, et je m’ennuierai de lui.
Je ne peux me résoudre à être privé de sa présence qui me fait autant de bien. Je ne peux me résoudre à le laisser partir sans rien tenter pour le retenir.
— Tu es vraiment obligé de retrouver tes potes ce soir ?
— Euh… oui… pourquoi ?
— Tu pourrais venir boire un verre chez moi, et dormir chez moi. Je peux te laisser mon lit, j’ai un sac de couchage pour moi, je m’empresse de préciser, devant la moue dubitative du beau pompier.
Le bus vient de s’arrêter pile devant nous. Les portes s’ouvrent et laissent sortir un peu de monde.
— C’est très gentil, Nico, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée .
— Pourquoi ce ne serait pas une bonne idée ?
— Parce que j’ai trop peur de ce qui pourrait se passer si je viens chez toi.
J’avais vu juste. Thibault a lui aussi envie de passer la nuit avec moi. Mais il a peur des conséquences, tout autant que moi.
— Moi aussi, j’en ai peur, j’enchaîne, mais j’en ai très envie aussi !
— Moi aussi j’en ai envie… mais je crois que nous ferions du mal à trop de monde.
— Tu as certainement raison. Au fond, je pense la même chose.
Les portes du bus se ferment et l’engin reprend sa course.
— Ah, crotte, il est reparti ! il s’exclame. Tant pis, je prendrai le prochain. Je ne veux pas causer encore des problèmes, il continue, tu comprends ? J’ai déjà foutu assez le bazar la dernière fois quand j’ai craqué avec Jé. Ça m’a presque couté l’amitié avec mon meilleur pote, et j’ai failli te perdre toi aussi. Avec Jérém, ça s’est un peu arrangé depuis. Mais s’il se passe quelque chose toi et moi et qu’il l’apprend, je vais le perdre définitivement. Et puis, tu as quelqu’un…
— Ruben ne compte pas…
— Et Jé ? Il compte, lui, non ?
— Bien sûr qu’il compte. Il me manque tellement, si tu savais ! Mais je n’ai pas la moindre idée de ce qu’il fait en ce moment, ni avec qui il est, ni si je le reverrai un jour.
— Je suis certain que vous allez vous revoir.
Le bus suivant se pointe au loin et avance tout aussi vite que le précèdent.
— Et puis, de toute façon, tu as quelqu’un aussi, je considère. Passe une bonne soirée, j’ajoute, en essayant de retenir mes larmes.
Des larmes qui sont le symptôme d’une tristesse dans laquelle se mélangent le manque de Jérém, qui est si loin, et la frustration de ne pas pouvoir retenir Thibault, qui est pourtant tout près de moi.
Le beau rugbyman me prend dans ses bras et me serre fort contre son torse solide. Je plonge mon visage dans son cou, il en fait de même. Ce contact physique et olfactif provoque d’intenses frissons en moi.
— Eh, merde, j’ai vraiment pas envie de partir, je l’entends me glisser à l’oreille.
— Alors, reste. 1 commentaire
1 commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Jérém&Nico - Saison 1