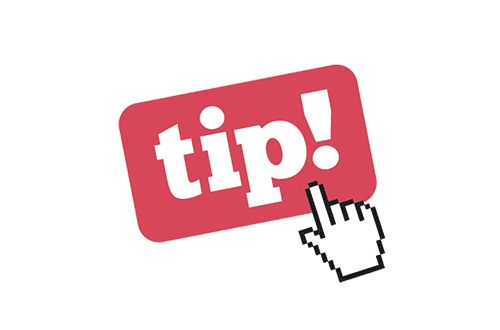-
Par fab75du31 le 12 Avril 2023 à 21:42
Février 2007.
La Saint Valentin arrive, mais Jérém ne semble pas du tout y prêter attention. Déjà, en temps normal, il n’est pas vraiment friand de ce genre de récurrence et de célébration. Et cette année, après ce qui nous est arrivé, avec son angoisse vis-à-vis de son retour sur le terrain qui l’accapare jour et nuit, je peux tout à fait concevoir qu’il n’ait pas du tout la tête à ça.
Mais moi, j’ai envie de marquer le coup. J’ai envie, j’ai besoin de lui montrer, de nous montrer, malgré la difficulté flagrante à retrouver notre complicité d’avant l’agression, que je suis toujours là, que nous sommes toujours Ourson et P’tit Loup.
Pour le 14, je monte à Paris et je nous prépare un petit dîner tranquille à l’appart.
Jérém a l’air d’apprécier, le repas, ma présence, et surtout le fait que ça se passe à l’appart. Je sais qu’il n’aurait pas accepté que je lui propose un resto, car le fait de s’afficher avec moi à cette date particulière le mettrait mal à l’aise. Et de toute façon, je sais qu’il refuserait, car cela risquerait de raviver les rumeurs le concernant depuis l’agression.
Je suis conscient que depuis le triste soir de son dernier anniversaire, mon beau brun vit sur le qui-vive, et que la relative liberté de nous montrer tous les deux en public que nous nous sommes autorisées depuis quelques années appartient désormais au passé. Je sais que le mot d’ordre est désormais de ne prendre aucun risque. D’ailleurs, ai-je l’ai bien senti lorsque je lui ai annoncé ma venue sur Paris. Je l’ai senti réticent. J’ai senti que ça lui faisait plaisir de me voir, mais qu’il avait peur. J’ai senti qu’il était déchiré entre son bonheur et sa peur. J’ai trouvé ça immensément triste.
Après le repas, nous avons fait l’amour. Ou je devrais plutôt dire, nous avons couché ensemble. Car j’ai senti que là aussi Jérém était écartelé entre son plaisir, son envie de me faire plaisir, et cette peur, ce malaise qui le tourmente. Et, une fois encore, ça a tout gâché.
Certes, Jérém était excité pendant que je le suçais, et certes, il a joui dans mon cul. Mais le plaisir ne se prend pas qu’avec la queue, ça se prend aussi et pour beaucoup avec l’esprit. Quand l’esprit n’est pas en phase avec le corps, le plaisir est court et mécanique. Et son esprit était une fois de plus ailleurs. Son corps avait envie, mais son esprit disait « non ».
J’ai l’impression de ne plus être qu’une ombre à ses yeux, tout comme ses amis, sa famille, le rugby, sa vie tout entière. Jérém n'est plus qu'une silhouette sans plaisir ni joie. Il essaie de jouer son propre rôle pour qu’on lui fiche la paix. Mais il n’arrive plus à faire illusion, son mal être est flagrant.
A 22h30, nous étions au lit. Je l’ai pris dans mes bras et je l’ai serré contre moi. Je l’ai entendu soupirer. J’ai senti que lui aussi a perçu que notre complicité était partie, et j’ai aussi senti son inquiétude. J’ai voulu lui parler, mais j’y ai renoncé. Je n’ai pas voulu nous gâcher la Saint Valentin. Enfin, je n’ai pas eu envie de la gâcher davantage. Et, surtout, je n’ai pas eu le courage d’affronter une discussion au sujet de notre présent et de notre avenir, une discussion qui me fait peur.
Fin février 2007.
La reprise des entraînements se poursuit pour Jérém. Mais ce n’est pas un processus facile. J’ai l’impression que depuis notre agression, les entraînements pour mon beau brun sont comme le sexe avec moi. Le physique y est, mais le mental n’est toujours pas là. Et sans le mental, point de réussite.
Jérém scrute avec amertume tous les matches qu’il ne peut pas jouer, avec le Stade, en Top 14, avec le XV de France, pour le Tournoi des Six Nations. Son retour sur le terrain est enfin envisagé. Mon beau brun est à la fois impatient et mort de trouille à l’idée de retrouver le chemin des pelouses.
Mars 2007.
C’est le 17 mars, à la faveur d’un remplacement, que Jérém retrouve enfin la pelouse du Stade de France. Je suis si heureux pour lui, si impatient de le voir marquer ses premiers points pour sceller son grand retour, et pour faire fermer la gueule aux colporteurs de ragots.
Mais très vite, il faut se rendre à l’évidence, mes espoirs, et les siens par la même occasion, sont douchés. Jérém n’est pas du tout dans son assiette. Comme après son accident au rugby, son assurance a disparu. On dirait un lapin pris dans les phares d’une voiture. Il n’ose pas aller au charbon. Par ailleurs, il n’arrive pas à la mettre à profit la seule passe qu’il reçoit d’Ulysse.,.
A la fin de la mi-temps, on le remet sur le banc de touche. Je le regarde quitter le terrain, déçu et en colère. Je sais qu’à cet instant il en veut à la terre entière.
Avril 2007.
Il s’écoule près d’un mois avant que Jérém retourne sur le terrain. Contrairement au match précédent, il apparaît plutôt en forme. Il parvient même à marquer un but, sur une passe de l’irremplaçable Ulysse. Tout semble bien parti, je retrouve l’espoir de voir Jérém revenir au top, et retrouver son bonheur.
C’est un peu plus tard dans la première mi-temps qu’un incident fâcheux se produit. Un joueur de l’équipe adverse fait un méchant croche-pied à mon beau brun, qui le fait s’étaler de tout son long. Heureusement, Jérém se relève aussitôt, il a l’air de s’en sortir sans mal. Le geste du joueur paraît délibéré, gratuit, et pourtant il n’est sanctionné que par un carton jaune. D’ailleurs, la moitié de l’immense enceinte siffle et hue l’injustice arbitrale évidente.
C’est là que l’incident se produit. La caméra montre Jérém en train de s’approcher du jouer indélicat et lui hurler dessus. Le joueur semble se laisser alpaguer sans réagir, tout en affichant un léger sourire narquois qui a sans doute le don de faire monter encore plus Jérém dans les tours.
Les joueurs du Stade tentent de calmer Jérém sous le regard sévère de l’arbitre. Et semblent y parvenir. Mais le joueur fautif se charge de mettre de l’essence sur le feu. Il balance quelque chose à Jérém, et ce dernier redémarre comme une fusée et lui décoche une beigne en pleine figure.
Le mal est fait. Pendant qu’Ulysse arrive à maîtriser son co-équipier, le carton rouge est aussitôt dégainé par l’arbitre. Jérém quitte le terrain, défait. Les commentateurs parlent immédiatement de geste impardonnable, de sanctions, de suspension pendant plusieurs journées.
De retour à l’appart, Jérém est toujours hors de lui, dégoûté, remonté comme une pendule. Les 5 journées d’exclusion dont il a écopé vont l’empêcher de jouer jusqu’à la fin de la saison.
— Pourquoi tu l’as frappé ? Qu’est-ce qui t’a pris ?
— Il m’a pris que ce fils de pute m’a dit « ferme ta gueule, pédé » !
Au plus profond de mes tripes, une petite voix hurle très fort : tu as bien fait de le cogner, tu aurais même dû lui en mettre un deuxième !
Mais je ne la laisse pas s’exprimer, et le « moi » rationnel s’inquiète des conséquences de ce geste. Et surtout, de sa signification. Visiblement, la réalité de notre agression a fuité dans le milieu et la connerie humaine veut que lorsqu’on a la possibilité de donner des coups bas, on ne s’en prive pas.
Visiblement, Jérém ne le supporte pas. Visiblement, Jérém est toujours à fleur de peau. Visiblement, il ne va toujours pas aussi bien qu’il voudrait le faire croire.
— Et tu y as gagné quoi ? C’est toi qui es puni !
C’est triste de voir que le fait d’être gay est toujours une cause de déshonneur et de honte et qu’au final, c’est la victime qu’on traite de coupable.
— Et il aurait fallu que je fasse quoi, que je le laisse dire sans broncher ?
— L’envoyer chier, mais pas le cogner.
— Ça m'a mis hors de moi, j’ai perdu tous mes moyens. Heureusement qu’Ulysse était là pour me retenir, sinon je lui aurais cassé la gueule et ça aurait été un désastre pour l'équipe. Putain, je ne suis qu’une merde !
— Non, tu n’es pas une merde. Au contraire, tu es un garçon formidable qui a subi une violence injustifiée !
— Et pourtant, je me sens comme une merde !
— Ce type qui t’a insulté est un sale con, et il ne mérite pas que tu t’infliges ça !
— Oui, c’est un sale con, mais ce sale con a dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Des réflexions comme celle d’aujourd’hui, j’ai pas fini d’en entendre !
Une immense angoisse s’empare de mon esprit lorsque je réalise avec une violence inouïe que, pendant l’agression Jérém m’a probablement sauvé la vie, mais que ça lui a probablement coûté sa carrière et son bonheur.
Mai 2007.
A l’occasion de l’un des ponts du mois de mai, je retrouve Jérém au domaine, chez son père. Il s’y est installé depuis sa suspension et il donne un coup de main dans la vigne. Le travail physique au grand air semble lui faire du bien.
Mai, c’est le printemps. Mai, c’est le mois qui marque le 6ème anniversaire de nos premières révisions, des voyages à toute heure entre Saint-Michel et la rue de la Colombette. Ce devrait être un anniversaire à célébrer comme il se doit. En réalité, cette année il n’y a rien à célébrer. Cette année, à l’anniversaire de nos premières révisions, je sens que Jérém m'échappe.
Depuis la Saint Valentin, nous n’avons plus couché ensemble. Sa libido est toujours au point mort. Jérém n’a toujours pas envie de sexe.
— J’ai envie de toi, Jérém, je lui glisse un soir, dans le noir, sur l’oreiller.
— Je sais, il me glisse, sans rien ajouter de plus.
— Et toi, est-ce que tu as toujours envie de moi ? je m’entends lui demander après un long silence assourdissant.
— Ce n’est pas la question.
— Et c’est quoi la question ?
— La question c’est que j’ai plus envie de baiser. Et puis, je le vois bien, je n’arrive plus à te faire jouir…
— Mais t’inquiète pas pour ça, Jérém, je vois bien que toi non plus tu ne prends pas ton pied. Tu es trop stressé, et le traumatisme de ce qui nous est arrivé est encore en toi, et en moi aussi.
— Je n’arrive plus à rien !
— Ne dis pas ça, mon amour, je crois que tu as juste besoin de temps.
— Tu parles…
— Tu as essayé de coucher avec d’autres mecs ? j’ai envie de savoir.
— Arrête, Nico !
— Dis-moi !
— Oui !
— Et alors ?
— Ça n’a pas plus marché qu’avec toi. Ce n’est pas toi le problème, le problème c’est que j’ai pas envie, c’est tout.
— J’ai même essayé de coucher avec des nanas… il ajoute, après un blanc.
— Et ça a mieux marché ?
— Non.
— Pourquoi des nanas ?
— Parce que je me suis dit que si ça se trouve, je fais fausse route. Au fond, plus jeune, je me tapais des nanas…
— Mais tu as toujours préféré les mecs, non ?
— Je ne sais plus. Plus personne ne me fait envie, plus personne ne me fait bander.
— Même pas moi ?
— Ne le prends pas mal. C’est pas toi, c’est moi. Vraiment.
— Ces connards qui nous ont agressés t’ont fait assez de mal, ne leur laisse pas te faire cette violence aussi, ne les laisse pas te faire douter de qui tu es et de ce qui te rend heureux. Tu es un garçon qui est attiré par les garçons !
— Je ne sais plus où j’en suis…
— Par rapport à ta sexualité ?
— Par rapport à tout !
— Et le psy ne t’a pas aidé ?
— Non.
— Ça me fait de la peine de voir que tu vas si mal…
— Je ne veux pas de ta pitié !
— Je n’ai pas pitié de toi, je lui lance haut et fort, alors que les larmes coulent sur mes joues. Nous avons vécu la même agression, et je pense que nous ressentons les mêmes choses.
— Ta vie n’a pas été bouleversée autant que la mienne après cette nuit.
— C’est vrai. Mais je ne te reconnais plus, Jérém ! Et ça me fait mal, tu ne sais pas comment ça me fait mal ! Je vois que tu ne vas pas bien et je n’ai aucun moyen de t’aider à aller mieux…
— Je sais que je te fais du mal. Mais je n’arrive pas à faire autrement. Je me sens comme sonné, vidé de toute énergie.
— Tu te rends seulement compte de ce que tu as fait ce maudit soir ?
— Je me suis fait tabasser comme un con !
— Si ce connard s’est autant acharné sur toi, c’est parce que tu l’as provoqué sciemment… et tu l’as provoqué parce que tu voulais qu’il s’en prenne à toi et pas à moi…
— T’as fait la même chose, juste avant.
— Mais je ne pouvais pas le laisser te démonter la gueule !
— Et moi, donc, tu crois que je pouvais ?
— Tu es mon héros, Jérémie Tommasi !
— Je n’ai pas su te protéger, il me glisse tristement.
— Et comment, tu as su me protéger, tu as risqué ta vie pour moi, tu n’as pas hésité un seul instant à te mettre en danger pour me sauver !
— J’aurais tellement voulu faire plus, t’épargner les coups… il insiste.
— Moi non plus je n’ai pas pu te protéger. On a fait comme on a pu, à deux contre cinq. Mais ce qu’on a pu, on l’a fait, on l’a fait !
Il pleure. Je pleure.
— Tout ça, c’est de ma faute !
— De quoi tu parles, Jérém ?
— C’est moi qui nous ai mis dans cette merde !
— Mais de quoi tu parles ?!
— C’est moi qui t’ai embrassé cette nuit-là ! Si je ne t’avais pas embrassé, rien ne se serait passé !
— Arrête de dire ça, ok ? Avec les « si », on ne va nulle part. Une fois de plus, tu n’as rien à te reprocher. Les seuls à blâmer dans cette histoire ce sont ces cons malbaisés qui s’en prennent à des gars comme nous parce que nous sommes heureux, et pas eux !
A aucun moment j’ai pensé que c’était de sa faute si nous avions été agressés. Pas plus que de la mienne.
Mais sur un point il a raison. C’est bien ce baiser qui a entraîné tout ce désastre. C’est inconcevable, et c’est pourtant la vérité.
Comment imaginer qu’un simple baiser, sublime manifestation de l’amour entre deux êtres, puisse provoquer le dégoût et l’hostilité au point d’entraîner ce qui nous est arrivé cette nuit-là, ainsi que ce sinistre effet domino qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd’hui ?
Comment concevoir que, nous les victimes, soyons punis à cause de ce que nous avons enduré ?
Quand je regarde son visage, quand je regarde son nez au profil désormais un peu cassé, son arcade avec cette cicatrice où les cils n’ont toujours pas repoussé, je revois les marques de la violence que nous avons subie. Je revis l’instant où mon Jérém a failli se faire tuer pour me sauver la vie. Une belle preuve d’amour.
Oui, un simple baiser d’amour a fait basculer notre vie.
Comment aurais-je pu imaginer que ce baiser ce serait notre dernier véritable baiser ?
Comment aurais-je pu imaginer que cette nuit ce serait la dernière fois où nous serions Ourson et P’tit Loup ?
Juin 2007.
Juin, c’est le mois des finales du Top 14.
Le vendredi premier, la demi-finale se joue à Bordeaux, entre le Stade Français et Biarritz. Jérém n’a pas souhaité faire le déplacement. Nous avons regardé le match à la télé, et j’ai vu mon beau brun triste et frustré de ne pas être sur le terrain et ne pas contribuer à cette belle victoire. Les Parisiens s’imposent en effet face aux Biarrots avec un score confortable de 18 à 6.
La semaine suivante, le 9, c’est l’heure de la grande finale. Le Stade Français rencontre Clermont au Stade de France. Cette fois-ci, Jérém accepte l’invitation d’Ulysse d’assister au match. Un match qui se révèle particulièrement difficile. Finalement, au bout de deux mi-temps éprouvantes, les Parisiens s’imposent une nouvelle fois sur un score de 23 à 18.
Le Stade Français est champion du Top 14. Quelques minutes après le coup de sifflet final, les joueurs en rose et bleu s’agglutinent au beau milieu de la pelouse et soulèvent le bouclier de Brennus devant une assistance en délire. Jérém refuse de les rejoindre, malgré la demande d’Ulysse.
— Tu vois, ils gagnent quand même, ils n’ont pas besoin de moi ! me lance Jérém, sur un ton agacé mais surtout plein de désespoir, les yeux emplis de larmes retenues de justesse, partagé entre la joie de voir son équipe gagner et la tristesse de la voir gagner sans lui.
— Tu as toute ta place dans cette équipe, je tente de le réconforter.
— Je suis un jouet cassé, je ne sers plus à rien !
— Tu rejoueras quand tu iras mieux.
— Non, le rugby c’est fini pour moi, il assène tristement.
— Je vais avoir des vacances autour du 14 juillet, j’annonce à Jérém au lendemain de la finale du Top14. Et si on repartait quelques jours en Italie ?
Il me semble que parmi les bons moments que nous avons partagés depuis quelques années, ceux passés au Bel Paese ont été les plus doux. J’aimerais tant retrouver le Jérém insouciant, bien dans sa peau, amoureux de ces vacances transalpines. J’aimerais tant retrouver notre complicité et je me dis que c’est là que j’ai le plus de chance de la raviver .
— Je crois que j’ai envie de partir seul cet été…
— Seul ?
— J’ai besoin de faire le vide dans ma tête.
— Et on ne prend pas de vacances tous les deux ?
— Toi tu as des vacances en juillet, et moi j’ai besoin de partir maintenant.
— Et tu veux aller où ?
— Je ne sais pas encore, je vais improviser.
— Et en juillet, on pourra partir ensemble ?
— Je ne sais pas, on verra.
Juillet 2007.
Juillet arrive, mes vacances avec. Après avoir passé un mois de juin sans pratiquement aucun signe de vie de la part de Jérém, après m’être forcé à respecter son besoin de prendre l’air, après trois semaines à tenter en vain de me convaincre que cette morosité n’est qu’une passade et qu’Ourson et P’tit Loup ne sont pas en danger, je me décide enfin à l’appeler pour avoir de ses nouvelles. J’ai également besoin de savoir ce qu’il en est finalement de ma proposition de partir en Italie, ou là où bon lui semblera, n’importe où, l’important pour moi étant d’être avec lui. Je le suivrais au bout du monde, et même au-delà.
J’essaye de l’appeler une fois, deux fois, trois fois. Je tombe directement sur son répondeur. Je laisse des messages, d’abord sur un ton neutre, en essayant de cacher mon besoin de savoir comment il va, mon besoin de plus en plus urgent de le revoir. Puis, au fur et à mesure que les jours passent et que mes messages n’ont pas de réponse, c’est mon inquiétude qui prend le dessus. Alors mes messages commencent à ressembler à des supplications de me donner des nouvelles, de me dire s’il va bien, et tant pis pour les vacances. Les jours passent sans retour de sa part et je commence sérieusement à m’inquiéter.
J’appelle Maxime pour savoir si de son côté il a plus de nouvelles. Il n’en a pas beaucoup plus que moi. Si ce n’est la destination des vacances en solitaire de son grand frère. Et un dernier message rassurant reçu de sa part quelques jours plus tôt, puis plus rien. Jérém a choisi une destination à l’autre bout du monde. Ce qui explique sans doute en partie l’absence de nouvelles. Car je n’ai aucun doute sur le fait que son silence s’explique également par son besoin de faire le vide dans sa tête, de passer à autre chose, d’oublier. Pourvu qu’il n’oublie pas tout, pourvu qu’il n’oublie pas notre amour, pourvu qu’il n’oublie pas qu’Ourson ne va pas sans P’tit Loup et que P’tit Loup ne va pas sans Ourson.
Dans combien de temps va-t-il revenir ? Va-t-il seulement revenir de cette terre au charme envoûtant qui attire tant une certaine jeunesse assoiffée d’un nouveau départ ? Et s’il croise la route d’un beau surfeur blond capable de faire chavirer son cœur et sa braguette ?
C’est la veille du 14 juillet que je reçois enfin un message de sa part. Mais pas de son numéro habituel. Le message porte un numéro commençant par +61. Croyant d’abord à une erreur de destinataire, la curiosité me pousse cependant à en lire le contenu.
« Salut. Je sui bien, je voyage, je travaille. Dsl pas avoir donné des nouvelles + tot. J espere que tu vas bien. Je revien en aout. Bisous de canberra ».
Oui, Jérém a eu besoin de mettre 20.000 bornes entre lui et ses nouveaux fantômes. Cette distance me donne le vertige. Mais au moins, je sais qu’il va bien et qu’il compte revenir. Pourvu qu’il ne change pas d’avis.
Je traverse le mois de juillet dans une morosité sans fin. C’est bien beau d’avoir des vacances, si on n’a pas l’état d’esprit pour en profiter, ça ne sert à rien. Je suis inquiet quant au retour de Jérém. Et s’il ne revenait pas ? Et s’il revenait changé du tout au tout ?
Le 14 juillet, les feux d’artifice de la fête nationale m’agacent plus qu’ils ne me réjouissent. A Gruissan, malgré la présence d’Elodie, je tourne en rond. J’ai besoin de me changer les idées, et j’en viens à croire que me sentir désiré, ou du moins convoité, m’aiderait à me sentir moins mal, à oublier mes peurs.
Je sors dans une boîte gay, je me perds parfois dans les buissons des plages où rôdent les hommes qui cherchent d’autres hommes. Entre les dunes, je couche avec un brun pas mal du tout. Il est plutôt sensuel pendant qu’il me tringle, il est même prévenant. Il est très beau lorsque sa belle gueule se crispe sous la vague de l’orgasme. Il me branle, me fait jouir. Mon torse parsemé de mes traînées brillantes, sa queue aussitôt retirée d’entre mes cuisses, je le regarde enlever sa capote bien remplie et faire un nœud pour la rendre étanche. L’excitation passée, au moment de se dire au revoir, ou plutôt « adieu », je retrouve ma solitude et mon angoisse.
Le fait est que c’est de Jérém dont j’ai envie, dont j’ai besoin. Aucun gars, aucune aventure ne saura combler cette envie, ce besoin, ce manque.
Août 2007.
Juillet se termine enfin et août arrive. Je salue la reprise du taf comme une délivrance. Car je n’en peux plus de tourner en rond, j’ai besoin de m’occuper l’esprit.
Ma mission jusqu’au mois de septembre est de passer de ferme en ferme pour relever les index des compteurs d’eau des irrigants. Je suis heureux d’être sur le terrain, heureux de découvrir le réseau secondaire découlant du Canal de Saint Martory, cet ouvrage impressionnant qui a révolutionné l’agriculture de la Haute Garonne.
Je passe mes journées à chercher des fermes, des lieux-dits aux assonances patoises, à traquer des agriculteurs et des cabanes d’irrigations, à emprunter des chemins en terre, à me perdre dans la campagne, entre les champs de maïs qui bouchent la vue, à demander à droite et à gauche, à me tromper de chemin, à faire demi-tour, à prendre des jets d’eau sous pression sur le parebrise.
Mais j’aime ça, on dirait un jeu de l’oie géant. J’adore l’odeur de la terre humide, du maïs fraîchement arrosé. J’aime le contact avec ce monde de producteurs, d’agriculteurs discrets et travailleurs qui produisent, il faut bien le rappeler, les biens les plus essentiels qui soient. J’aime cette nature calme, où l’on entend le vent et le chant des oiseaux, l’écoulement de l’eau et le bruissement des feuilles. J’aime cette campagne qui me rappelle Campan, mais aussi le domaine de M. Tommasi. Est-ce que je reverrai un jour ces endroits ? Est-ce que Jérém m’y amènera à nouveau ? La nostalgie me tire parfois les larmes.
Où es-tu, mon Jérém ?
Jeudi 23 août 2007.
Hier, Jérém m’a appelé. Il était au domaine, chez son père. Il était rentré deux jours plus tôt et il n’avait fait que dormir depuis. Il m’a proposé de nous voir ce soir pour dîner ensemble.
Ce soir, je suis très heureux de le retrouver. Et pourtant, au fond de moi, j’ai la sensation que ces retrouvailles ne vont pas se passer comme je les imagine. J’ai l’impression que Jérém a quelque chose à m’annoncer. Et j’ai peur d’entendre ce qu’il a à m’annoncer.
D’ailleurs, le vent d’Autan s’est levé ce matin. Et sa caresse insistante m’inquiète, beaucoup.
Je retrouve mon beau brun dans un resto du centre-ville. Ça fait plus de deux mois que je ne l’ai pas vu. Je le retrouve là, beau comme un Dieu, le teint halé, le bronzage marqué, un peu plus sec que la dernière fois, ce qui met en valeur sa masse musculaire, les cheveux assez courts, la barbe d’une semaine, ce qui met en valeur sa sensualité radioactive. Ce soir, il fait très chaud. Le bogoss est habillé d’une chemisette à fines rayures portée bien près de son torse et de ses biceps, les boutons du haut ouverts jusqu’à dévoiler la naissance de ses pecs.
Les stigmates de notre agression marquent toujours sa belle petite gueule, mais elles me paraissent moins choquantes, moins insupportables.
Ce soir, Jérém est beau à en pleurer. C’est peut-être l’effet des retrouvailles, après deux mois à redouter qu’elles ne se produisent jamais. C’est peut-être le changement dans son regard, son allure, son attitude, son sourire. C’est sa nouvelle sérénité empreinte de gravité. A bientôt 26 ans, Jérém semble transfiguré. Ce voyage semble l’avoir changé, fait mûrir. Oui, il y a quelque chose dans son regard et dans son allure qui n’était pas là avant. Comme des nuances de maturité. Il me semble que désormais, l’homme prend le pas sur le petit con.
Je regarde le menu mais rien ne me fait envie. C’est Jérém qui me fait envie, une envie déraisonnable. Et lui, est-ce qu’il a toujours envie de moi ? Est-ce que nous sommes toujours Ourson et P’tit Loup ?
Pendant le dîner, Jérém me parle de son road trip en Australie.
— J’ai fait du stop, j’ai travaillé dans des fermes, j’ai tondu des brebis.
— J’ai traversé le désert, j’ai longé l’océan pendant des centaines de miles.
— J’ai fait du cheval sur la plage.
— J’ai appris à faire du surf.
— J’ai été voir comment on joue au rugby là-bas, j’ai joué au rugby là-bas.
— J’ai vu des requins blancs et des baleines.
— J’ai vu des kangourous et des koalas.
— Je me suis saoulé la gueule, j’ai été impliqué dans une bagarre et j’ai passé une nuit en cellule.
En évoquant toutes ces expériences nouvelles pour lui, Jérém a les yeux qui brillent. Ça a l’air de lui avoir fait vraiment du bien de changer de décor, je suis heureux pour lui et en même temps triste de ne pas avoir pu partager ces moments avec lui.
— J’ai fait de belles rencontres, j’ai dormi chez l’habitant… il continue.
— Et tu as baisé avec l’habitant ? je ne peux m’empêcher de lui glisser.
— Aussi…
Je ne suis même pas jaloux, il a bien fait d’en profiter. J’espère seulement qu’il a pensé à se protéger.
— Alors, tu as retrouvé l’envie de coucher ?
— Il a fallu que je parte à l’autre bout du monde pour me retrouver.
— Eh, bien, tu en as fait des choses ! Je me suis demandé si tu allais seulement revenir un jour ! je le cherche.
— Je n’ai pas arrêté de penser à toi…
— Ah, bah, c’était pas flagrant !
— Désolé de ne pas avoir donné plus de nouvelles. Mais j’avais besoin de me couper de tout.
— De moi aussi ?
— Ne le prends pas mal, il me glisse, la voix douce, en saisissant ma main, ce qui provoque en moi un intense frisson. J’avais besoin de cette pause, de ces espaces, j’avais vraiment besoin de changer d’air. Tu comprends, Nico ?
Je comprends que Jérém avait besoin de prendre de la distance de tout ce qui le ramenait à cette terrible nuit, et je réalise que je fais sans doute partie des « choses » qui le ramènent à cette nuit, que je suis même la « chose » principale.
— Je crois que je comprends, oui. Et ça t’a fait du bien ?
— Un bien fou.
Une question me titille l’esprit depuis début août, depuis le début du top14. Mais où en est Jérém par rapport à sa carrière de rugbyman ? La question clignote de façon encore plus insistante dans ma tête ce soir.
— Et le rugby ? Tu vas jouer où cette saison ? j’ai besoin de lui demander.
— Je vais régler l’addition, tu m’attends dehors ?
Quelques instants plus tard, Jérém me rejoint dans la rue et me propose d’aller marcher sur les quais de la Garonne.
J’ai le souffle coupé, je tremble. Au fond de moi, j’ai l’intuition que cette marche est un préambule à une discussion que je redoute. Le vent d’Autan souffle toujours. J’ai peur d’entendre ce que Jérém a à me dire.
La proximité du fleuve est l’occasion pour Jérém de me questionner sur mon taf, et pour moi de lui raconter à quel point je suis heureux d’avoir choisi cette voie. Après une longue tirade passionnée de ma part, le silence s’installe entre nous.
Mon beau brun me paraît désormais soucieux. Je sens qu’il a quelque chose à me dire mais que ça ne sort pas. Je crève d’envie et je meurs de peur de savoir.
C’est à l’approche du Pont Neuf que ça vient enfin. Le beau brun s’arrête de marcher, me saisit par le poignet, m’obligeant à m’arrêter à mon tour. Et là, il me glisse, la voix étouffée :
— Asseyons-nous.
Assis sur la pelouse rase, je fixe les arcades et les larges trouées qui ont permis à ce pont de devenir le plus vieux pont de Toulouse. Du coin de l’œil, je capte la présence de mon beau brun. Elle a sur moi l’effet d’un aimant ultrapuissant. Je meurs d’envie de me glisser sur lui, de l’embrasser, de le serrer contre moi, de lui montrer à quel point je suis heureux de le retrouver. Mais je sais que ce n’est ni le moment, ni le lieu. J’attends avec impatience et angoisse qu’il me dise ce qu’il a sur le cœur.
— Je vais arrêter le rugby, il finit par me lancer, comme une bombe, après un long instant de silence.
— Quoi ? T’es pas sérieux ?
— J’y ai longuement réfléchi et ma décision est prise.
— Mais pourquoi ?
— Parce que je ne me sens plus à l’aise dans les vestiaires et sur le terrain.
— C’est à cause de ce qui nous est arrivé ?
— Peu importe, Nico. Je n’ai plus le mental. Et un joueur sans un mental solide, ne sera jamais un bon joueur. Alors, autant arrêter les frais avant de me faire humilier davantage. Je n’ai pas envie de terminer ma carrière comme un looser. Si j’arrête maintenant, il y a des chances qu’on se souvienne de moi pour mes exploits. Si je continue, on se souviendra de moi comme d’un joueur qui a planté sa carrière.
— Mais le rugby c’est toute ta vie !
— Il l’était…
— Et tu crois que tu vas réussir à être heureux sans ?
— Il va bien falloir.
Il va bien falloir. Ces quatre mots résonnent à mes oreilles comme un fardeau insupportable à porter. Je le sens au choix des mots, je le sens au ton sur lequel ils sont prononcés. Sans le rugby, il va être malheureux comme les pierres. Quel gâchis, quel horrible gâchis !
— T’es vraiment sûr qu’il n’y a pas moyen ?
— Oui, sûr et certain.
— Mais la proposition de Toulouse tient toujours, non ?
— Je l’ai refusée.
— Mais tu débloques ou quoi ? C’est une occasion en or !
— Je sais. Mais ça ne changerait rien. Où que je joue, je ne serai plus jamais à l’aise. Il y en a qui ont su ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là, et ils ne s’en sont pas privés pour en parler. Le rugby est un petit monde. Les ragots vont très vite et ont la vie longue. Ils vont me suivre, où que j’aille. Il y aura toujours un con pour sortir une réflexion à la con dans un match ou dans une soirée. T’as vu ce qui s’est passé la dernière fois ? Ça s’est terminé avec un carton rouge et cinq journées d’interdiction de jeu…
— Mais ça s’est produit une fois, et…
— Et ça se reproduira ! il me coupe net. Et quand ça arrivera, je réagirai de la même façon. Et le rugby ce sera fini pour moi, de la pire des façons. Et même si ça ne se reproduit pas, j’aurais toujours l’impression qu’un me scrute, qu’on se fout de ma gueule dans mon dos. Ça me prendra toute mon énergie et je n’arriverai plus à jouer comme il faut.
— Mais Jérém ! je proteste, sans trop savoir quels arguments opposer à son analyse que je comprends parfaitement par ailleurs.
— Regarde, Thib a arrêté le rugby, et il est heureux.
— Mais lui l’a fait par choix, pas par peur !
— Le choix, je ne l’ai pas, il lâche tristement, et surtout pas ici, en France…
— Pourquoi, il y aurait mieux ailleurs ?
Je le vois hésiter, pousser un long soupir, comme combattu entre l’envie de parler et celle de se taire.
— Il y a autre chose ? je tente de le mettre à l’aise.
— Laisse tomber !
— Dis-moi, s’il te plaît, je peux tout entendre, tu sais ?
— Je te dis de laisser tomber !
— Tu en as trop dit et pas assez dit. Tu ne peux pas me laisser comme ça ! Tu as eu une autre proposition ?
— Ouais.
— Quel club ?
— C’est pas…
— C’est pas quoi ?
— C’est pas en France.
— Et c’est où ?
— En Angleterre.
— Quoi ?
— Je pourrais jouer dans l’équipe des Wasps.
— C’est qui ces Was… ?
— Les Wasps. C’est une grande équipe anglaise. J’ai sympathisé avec certains joueurs lors des matches des Tournois des Six Nations. Et avec leur entraîneur. Un jour, il m’a dit qu’il y aurait toujours une place pour moi dans son équipe.
— Et si tu partais jouer là-bas, tu pourrais revenir au top ?
— J’aurais plus de chances d’y parvenir qu’en restant ici. Là-bas, personne ne sait pour ce qui m’est arrivé.
Mon cœur bat à tout rompre. Je tremble. J’étouffe.
— De toute façon, ma décision est prise, le rugby c’est fini pour moi.
— Et tu comptes faire quoi si tu arrêtes le rugby ?
— J’ai un diplôme, je vais le mettre à profit. J’ai trouvé une offre d’emploi qui a l’air pas mal. J’ai postulé pour un poste de commercial dans une boîte qui vend des équipements informatiques. J’ai passé un entretien et mon profil leur a plu. Il y a de fortes chances que j’arrive à avoir le job.
— An bon ? Et c’est où ça ?
— A Paris.
— Ah… et tu vas rester à Paris, alors ?
— Oui, mais je vais pas mal voyager.
— Tu es sûr de ton coup ? Tu penses que ce job va te convenir ?
— Il va bien falloir…
Il va bien falloir. Deuxième du nom.
Mille questions s’agitent dans ma tête. Elles tapent si fort que l’une d’entre elles finit par glisser sur mes lèvres.
— Pourquoi tu ne veux pas donner suite à la proposition de l’équipe anglaise ?
— Parce que je n’en ai pas envie !
— Je vois bien que tu crèves d’envie de rejouer et de foutre le camp d’ici !
Puis, au prix d’un effort dont je ne me serais pas cru capable, je lui lance :
— Si tu restes pour moi…
— Arrête, Nico ! il me coupe net.
— Ecoute moi, Jérém, je reviens aussitôt à la charge. Si tu restes pour moi, c’est pas le bon choix. Tu vas te rendre malheureux et tu vas nous rendre malheureux.
Et là, après un silence qui me paraît interminable, je l’entends me glisser, la voix pleine d’émotion :
— Et nous deux ?
Soudain, je repense aux mots du pauvre M. Charles de l’hôtel à Biarritz, à son regret de ne pas avoir suivi l’amour de sa vie au bout du monde. Et je lui balance, sans hésiter un seul instant :
— Amène-moi avec toi !
— Nico… ici tu as un travail qui te plaît, tu as ta famille, tes amis. Tu ne vas pas quitter tout ça pour venir avec moi.
— Je peux le faire, il suffit que tu en aies envie.
— Je ne suis même pas certain que ça marcherait là-bas, je ne peux pas te demander de me suivre alors que je ne sais pas où je vais.
— L’Angleterre n’est pas à l’autre bout du monde, nous trouverons le moyen de nous voir, j’arrive à articuler de justesse, alors que les larmes coulent déjà sur mes joues.
Jérém me prend dans ses bras, me serre très fort contre lui et me chuchote, les lèvres très près de mon oreille :
— Je t’aime, Ourson. Et je crois bien que je ne t’ai jamais autant aimé qu’à cet instant.
— Ne m’oublie pas, Jérém, je lui glisse, comme une bouteille à la mer, comme une prière.
— Je ne sais pas encore si je vais accepter, je dois y réfléchir.
— Quoique tu décides, ne m’oublie pas !
— Ça, ça ne risque pas. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivé dans la vie. Tu seras toujours avec moi ! Je ne t’oublierai jamais ! Jamais !
Et, ce disant, il glisse ses doigts dans l’ouverture de sa belle chemisette, il saisit la chaînette que je lui ai offerte pour ses vingt ans et il me la montre.
Pendant que nous remontons vers la place du Capitole, l’air frais de la nuit caresse ma peau, m’apportant un étrange frisson, une sensation de vide, de manque, de déchirement. Jérém est encore là, il marche à côté de moi, mais j’ai l’impression qu’il est déjà loin. J’ai l’impression que je suis en train de vivre un adieu.
Mercredi 23 août 2017.
Aujourd’hui, ça fait dix ans que Jérém est parti. Et ce soir, il me manque horriblement. Ce soir, après ma journée chargée au bureau pour décider de la réduction du débit du Canal et des restrictions d’usage suite à la sécheresse, je n’ai pas eu le cœur de rester seul dans mon appart. Alors, je suis allé dîner chez Papa et Maman, et je compte bien y rester dormir.
Mais, après le dîner, le vent d’Autan s’est levé. Il a tapé à la fenêtre de ma chambre d’enfant, insistant, inlassable, violent. Comme s’il m’appelait, comme s’il voulait me dire quelque chose. Je l’ai écouté, je suis sorti. Je suis parti me balader.
Mes pas m’ont conduit sur ceux des souvenirs des derniers jours avant le bac. Et, en particulier, à ce mercredi 2 mai 2001 où j’ai traversé les allées pour aller à la rencontre de Jérém, le bogoss sur qui je fantasmais depuis le premier jour du lycée. Le garçon qui avait ravi mon cœur depuis le premier jour du lycée.
C’était le printemps, c’était la première année du nouveau millénaire. Mais c’était surtout et avant tout l’année de mes 18 ans.
Ce jour-là, le vent d’Autan soufflait très fort dans les rues de la ville Rose. Puissant, insistant, il caressait ma peau, chatouillait mes oreilles, me parlait du printemps, un printemps qui se manifestait partout, dans les arbres des allées au feuillage triomphant, dans les massifs fleuris du Grand Rond, dans les t-shirts qui mettaient en valeur la plastique des garçons.
J’ai le net souvenir de la sensation de ce vent dans le dos, accompagnant mes pas, encourageant ma démarche, comme pour faire taire mon hésitation.
Ce jour-là, le vent d’Autan me poussait à aller au bout de mon trajet, il me poussait à marcher tout droit vers la première révision de maths avec Jérém, vers la première révision de ma vie sentimentale, et de ma vie d’adulte.
J’avais filé sur le Boulevard Carnot, je m’étais engagé dans la rue de la Colombette, comme sur un nuage. C’était le début de cette histoire, de mon histoire.
On n’oublie jamais son premier amour, son seul amour. Mais où es-tu, Jérém ? Au fond de moi, je sais que nous nous retrouverons, que le destin nous réunira un jour. On se l'est promis tous les deux, on se l'est promis sans mots, sans formule. C’est une promesse que j’ai lue dans tes yeux, une promesse que je serre à moi depuis longtemps déjà. On se l'est promis par une belle soirée d'été d’il y a dix ans, après avoir fait l’amour pour la dernière fois avant de nous quitter.
Tout était beau, tout était parfait ce soir-là. Et je n’ai qu’un seul, immense regret. Celui de ne pas avoir su trouver les mots qui auraient pu t’apaiser, ce petit rien qui aurait pu te retenir.
Il m’a fallu longtemps pour comprendre que ces mots n’existaient pas, et que ce petit rien était en réalité un immense tout qui n’était pas à ma portée.
J’ai parfois regretté de pas m’être battu davantage pour te suivre au bout du monde. J’ai essayé de te détester pour le fait d’avoir pris ta liberté si facilement après avoir reçu ma bénédiction. Je n’ai pas réussi. Car, au fond de moi, je suis heureux d’avoir d’une certaine façon contribué à t’offrir quelques belles années de rugby supplémentaires.
Non, je n’ai jamais oublié la puissance du vent d’Autan cet après-midi de mai d’il y a seize ans. Pas plus que j’ai oublié celle du même vent d’Autan le soir où nous avons marché le long de la Garonne, il y a dix ans déjà. Tout comme je n’ai jamais pu t’oublier, mon Jérém. Bien que depuis tant de temps déjà, nos vies ne marchent plus ensemble.
Ce soir le vent qui frappe à ma porte
Me parle des amours mortes
Et je pense aux jours lointains
(...)
Que reste-t-il de nos amours
Que reste-t-il de ces beaux jours
Une photo, vieille photo…
FIN DE LA SAISON 3 de Jérém&Nico.
Le premier épisode de la saison 4, « JN0401 Le temps apaisera la blessure », est prévu pour le courant du mois de juin 2023.
Alors, à l'occasion de ce dernier épisode de saison, lâche toi, cher lecteur, chère lectrice, je t'invite chaleureusement à t'exprimer, à me dire ce qui t'a poussé à suivre Jérém et Nico depuis bientôt 9 ans, à lire des milliers de pages.Dis moi, dis nous, ce que tu as aimé, et même ce que tu as moins aimé. Raconte moi ce que tu penses de ce final de saison et ce qu'il t'inspire pour la suite.
Au plaisir de vous lire, Fabien, avril 2023
 31 commentaires
31 commentaires
-
Par fab75du31 le 31 Mars 2023 à 23:52
Après l’agression homophobe dont nous avons été les cibles, je reviens voir Jérém chaque après-midi à l’hôpital. Jour après jour, je constate avec une immense tristesse que ce que je redoutais est bel et bien en train de se produire. Jérém est distant, absent, amorphe. Et notre parfaite complicité des derniers mois semble s’être envolée.
J’essaie de me dire que c’est l’effet du choc, et aussi que le fait de se refermer sur lui-même dans l’adversité est un réflexe typique de mon beau brun, et que tout reviendra bientôt comme avant. J’essaie de me dire également que le milieu hospitalier, où l’intimité est presque impossible, doit provoquer en lui un certain malaise, une certaine réticence à se montrer proche de moi.
Mais au fond de moi, j’ai peur que nous ayons perdu la connexion qui nous liait. Et de ne pas arriver à la retrouver de sitôt.
Au bout d’une semaine d’hospitalisation, Jérém est autorisé à rentrer chez lui. Avec toute une panoplie de consignes.
Déjà, celle d’éviter toute activité physique pendant six semaines, ceci afin de permettre à ses côtes cassées de guérir. Mais aussi pour prévenir le moindre coup à son nez encore fragile, ce qui pourrait aggraver son état. Bon, le repos, ça ne devrait pas être trop compliqué à tenir, vu la douleur visiblement provoquée chez mon Jérém par le moindre mouvement.
Autre consigne, celle d’avoir quelqu’un à ses côtés pour l’aider au quotidien, comme pour se lever du lit ou du canapé, pour se déplacer en toute sécurité. Je me suis évidemment porté candidat, et Jérém a validé ma candidature sans broncher.
Et, dernière consigne, ou plutôt une chaude recommandation, d’aller voir un professionnel qui pourrait l’aider à surmonter le traumatisme de l’agression.
D’ailleurs, j’ai moi aussi reçu cette recommandation à l’occasion de ma sortie. Et je l’ai suivie. J’ai pu ainsi me rendre à une première séance chez un psy indiqué par l’hôpital. Et ça m’a fait du bien.
Le type ne m’a pas demandé de parler de l’agression. Il m’a juste demandé comment je me sentais. J’ai parlé pendant une heure. Je me suis laissé aller à un long monologue, ponctué de temps en temps par une question, un commentaire, un simple mot de mon interlocuteur. Une sorte de tutorat verbal et mental. Au bout de la séance, une fatigue vertigineuse s’était emparée de mon corps et de mon esprit. Comme si un rouleau compresseur m’était passé dessus.
Ce qui était vrai, dans un certain sens. Pour aller mieux, il faut laisser s’exprimer ce qui fait mal. Pour retrouver le sourire, il faut parfois passer par les larmes.
Le lendemain de la sortie de Jérém de l’hôpital, Maxime retourne lui aussi dans le Sud-Ouest, M. Tommasi et Alice ayant quitté Paris depuis quelques jours déjà, appelés par leurs obligations professionnelles respectives. Maxime est rassuré par le fait que je puisse passer quelques jours à côté de son grand frère. Ça me rassure aussi, même si je redoute la lourdeur de la tâche. L’expérience me rappelle qu’il n’est pas aisé de s’occuper de Jérém quand il ne va pas bien.
L’expérience ne se trompe pas.
De retour à l’appart, Jérém est en plein dans le déni. Il n’admet pas qu’il va mal, et il se renferme comme une huître. Les maux de tête sont à nouveau là, avec les insomnies. Et les angoisses dont il ne veut pas me parler, dont il nie l’existence même.
— Je vais bien, très bien même, arrête de me casser les couilles tout le temps avec tes questions !
Bien évidemment, il ne veut même pas entendre parler d’aller voir un psy.
Je sens que c’est parti comme il y a trois ans, je vais devoir endurer de longues journées à essayer de passer entre ses sautes d’humeur, outre sa morosité hostile, d’éviter le clash et l’épuisement. Je sais qu’il va mal, et je vais tout faire pour être là pour lui. Je vais prendre sur moi, je vais être aux petits soins
Oui, Jérém va mal. Déjà, physiquement. Je partage avec lui la douleur sourde des coups reçus, dont nos visages et nos corps sont toujours marqués. Mais aussi psychologiquement. Je partage également avec lui le traumatisme d’avoir été agressés en raison de notre orientation sexuelle. C’est-à-dire, gratuitement, sans raison valable. Nous n’avons pas mérité ce qui nous est arrivé, nous n’avons rien fait de mal. Nous avons été les cibles d’une violence inouïe, injustifiée, intolérable.
Oui, nous avons vécu la même agression. Mais Jérém est plus mal en point que moi. Il a enduré plus de violence que moi. Ses côtes lui rendent la vie impossible, le rendent invalide. Et alors que je m’en sors relativement à bon compte, Jérém risque de porter de lourdes séquelles de cette agression.
Six semaines d’immobilisation, ce sont autant de semaines de rugby perdues, sans compter le temps de remise en forme avant de revenir sur le terrain. Et quand je vois ce gros pansement qui défigure sa belle gueule et qui ne doit pas être facile à supporter non plus, je ne peux m’empêcher de me demander si son nez va guérir correctement.
Toutes ces questions, Jérém doit se les poser en boucle H24. Alors, je peux comprendre qu’il n’aille pas bien du tout.
Jours après jour, les bleus évoluent, changent de couleur, se résorbent peu à peu. Le temps calme les douleurs, la chair efface les traces des coups. Mais le traumatisme reste. Je suis persuadé que Jérém est lui aussi hanté par les images de notre agression. Son sommeil est agité, ponctué par des spasmes, peuplé de cauchemars. Ses réveils en sursaut au beau milieu de la nuit sont courants. Je ne peux même pas le prendre dans mes bras, au risque de lui provoquer des souffrances intolérables. Je me blottis tout doucement contre lui, mais je sens qu’il ne supporte pas que je sois témoin de sa souffrance.
L’alcool revient dans son quotidien. Tout comme la cigarette, abandonnée plus d’un an auparavant lors de notre retour du voyage en Italie, moment si heureux. Tout comme le joint, abandonné depuis sa récupération au centre de Capbreton, au moment où il retrouvait espoir dans son avenir.
Je reconnais cette attitude, c’est la même qu’il avait adoptée lors de son accident au rugby. Comment le sortir de cette spirale autodestructrice ?
J’essaie de lui dire que ça nous ferait peut-être du bien de parler de ce qui s’est passé. Mais il balaie ça du revers de la main, avec un agacement agressif.
Jérém est de plus en plus taciturne, de plus en plus distant, de plus en plus irritable, de plus en plus négatif, de plus en plus hostile à mes attentions. Ce qui me rassure, c’est que malgré tout, il accepte ma présence, il accepte que je m’occupe de lui.
Mais jusqu’à quand ? Je sais que je ne suis pas à l’abri du fait qu’il me demande de partir sur un coup de sang. En attendant, j’ai demandé à retarder ma prise de poste à Toulouse de deux mois et cela a été accepté. Ça me laisse du temps pour rester aux côtés de Jérém. Même si j’ai l’impression de le regarder aller de plus en plus mal, et que je me sens impuissant pour l’aider à aller mieux.
Les séances chez le psy m’aident à tenir le coup. C’est surtout le fait de me sentir pris en charge qui me fait du bien. Et d’avoir quelqu’un qui m’aide à remettre de l’ordre dans mes pensées désordonnées et perturbées. J’ai pu me voir dans le regard de ce professionnel comme dans un miroir, un miroir m’obligeant à me regarder tel que je suis, dans mon plus simple appareil psychique.
Je sais que le chemin va être long pour retrouver la sérénité, mais je sais désormais qu’un chemin existe et que je l’ai emprunté. Je ne peux m’empêcher de vanter les bienfaits de la thérapie auprès de Jérém, et de l’inviter à entreprendre cette démarche fortement conseillée aux victimes d’agression.
Mais mon beau brun se montre très agacé :
— Arrête de me les briser avec ton psy ! Tu peux aller en voir dix si ça te chante, je n’irai pas !
Fin octobre, le pansement au nez de Jérém est enfin retiré. Ce que je craignais se confirme. Son arête nasale est désormais légèrement mais définitivement cassée, ce qui lui confère un profil typiquement « rugbyman ». C’est un détail qui n'enlève rien du tout à sa superbe beauté. C’est un détail qui n’aurait presque pas d’importance, et qui ajouterait presque un charme supplémentaire s’il n’était que la conséquence d’un accident au rugby.
Mais ce n’est pas le cas. Car ce détail, au beau milieu de sa belle petite gueule, est la conséquence de notre agression. Alors, c’est un détail qui change tout. Jérémie va porter à vie les stigmates de ce qui nous est arrivé. Il va les avoir sous les yeux chaque fois qu’il se regardera dans une glace, chaque jour de sa vie. Moi aussi je vais les avoir sous les yeux, chaque fois que je vais le regarder.
— Je vais me faire opérer, il annonce solennellement au médecin qui tente de le convaincre en vain que cette petite cassure est presque imperceptible.
— Pour ça, il faudra attendre quelques mois que tout soit bien cicatrisé. D’ici là, vous vous y serez peut-être fait…
— Ça ne risque pas !
Le constat de ce changement physique plonge un peu plus Jérém dans sa morosité. J’ai beau essayer de le réconforter, de lui dire qu’il est toujours aussi beau, je n’y gagne que plus d’agacement de sa part.
Dans cette ambiance étouffante, un rayon de soleil se pointe tous les deux ou trois jours. Ulysse vient régulièrement à l’appart avec des pizzas ou des plats de traiteur.
Lors de l’une de ses visites, le beau blond amène une copie du calendrier et du DVD. La photo de couverture me frappe comme à la première découverte. La beauté, l’insolence, l’assurance et la sensualité bouillantes dégagées par ce garçon qui étire l’élastique de son boxer comme pour inviter à plonger le regard dedans sont juste insoutenables.
J’ai envie de pleurer. Je donnerais tout pour retrouver cette attitude, cette assurance, cette insolence, pour retrouver ce Jérém là, un Jérém conquérant. Je donnerais tout pour retrouver le Jérém qu’on voit sur les images filmées, le Jérém qui fait le con avec ses coéquipiers, qui blague avec les techniciens du studio, qui a un fou rire en essayant de prendre la pose devant l’objectif. Dans ces images filmées, Jérém a l’air si épanoui, si heureux, et ça me fait mal au cœur qu’on l’ait privé de tout ça.
Devant ces images filmées quelques semaines plus tôt, mais appartenant presque à une autre vie, devant le Jérém « d’avant », le Jérém « d’après » a l’air de plus en plus triste et dégoûté. A un moment, il s’arrache du canapé en se contorsionnant, tout en refusant que je l’aide, et disparaît dans le couloir. L’imaginant aux toilettes, Ulysse et moi attendons son retour pendant de longues minutes. Ne le voyant pas revenir, je l’appelle. N’ayant pas de réponse, je pars à sa recherche, Ulysse à mes baskets. Nous le retrouvons au lit, dans le noir.
— Eh, Jérém, ça va pas ? l’interroge Ulysse.
— Je suis fatigué, laissez-moi dormir !
— Tu n’es pas fatigué, tu es blessé, tu es en colère, tu as peur. C’est normal après ce qui t’es arrivé.
— Occupe-toi de ton cul !
— Arrête de te torturer l’esprit, Jérém ! Dans quelque temps, tu vas rejouer, et quand tu retrouveras le bruit du stade, tout ça ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
— Je ne rejouerai pas.
— Ne dis pas de bêtises. Tes blessures ne sont pas si graves. En tout cas, beaucoup moins que celles de l’accident au match il y a trois ans. Ta convalescence ne va pas être aussi longue, d’ici le printemps tu pourras rejouer.
— Non, je n’y arriverai pas.
— Et pourquoi, ça ?
— Parce que je n’y arriverai pas ! Fiche-moi la paix !
— C’est dur ce que tu as vécu, et il faut du temps pour s’en remettre. Mais c’est pas en restant enfermé chez toi que tu vas aller mieux. Tu es fait pour fouler les pelouses, pour marquer des points. C’est là que tu es heureux ! Tu n’as pas pu oublier ça ! Et si tu l’as oublié, compte sur moi pour te le rappeler !
— Est-ce que ça jase dans les vestiaires ?
— De quoi tu parles ?
— Est-ce que tout le monde a cru à cette histoire de vol ?
— Je pense que oui…
— Tu me caches quelque chose, Uly, je le sais !
— Ok, il y a des bruits qui courent. Mais personne n’y croit. Et je travaille dur pour les faire taire.
— Tu vois, c’est foutu pour moi.
— Tu dois revenir. L’équipe a besoin de toi et tu as besoin de l’équipe. Repose-toi bien, et reviens plus fort qu’avant. Quand tu marqueras à nouveau des points, personne n’osera te casser les couilles.
— Je n’y arriverai pas, je te dis, ils ne m’en laisseront pas l’occasion.
— Concentre-toi sur toi-même et sur ta récupération, et ignore le reste.
Soudain, je repense aux mots d’Ulysse après l’accident de Jérém lors du match contre Biarritz :
— Les blessures les plus difficiles à guérir ce sont celles qui ne se voient pas, celles à l’intérieur.
Et la blessure que Jérém porte à l’intérieur semble vraiment profonde, et pas prête de cicatriser.
— Tu es si beau sur la couverture du calendrier, tu es à tomber, tu es le plus beau de tous ! je lui glisse après le départ d’Ulysse.
— Je l’étais…
— Tu l’es toujours !
— Non, je ne le suis plus. Et je ne le serai plus jamais.
Novembre 2006.
Un mois après l’agression, Jérém passe une journée à l’hôpital pour un check-up complet. D’après les médecins, son corps récupère vite et bien. L’épaule démise guérit correctement, les côtes et le nez aussi. On lui annonce qu’il pourra reprendre la musculation dans une quinzaine de jours, et même des entraînements aménagés. Mais Jérém ne semble pas plus ravi que ça. Sa réaction ressemble plutôt à de la peur.
Quelque chose semble s’être brisé au plus profond de lui. Je préférerais de loin le voir éructer sa rage, sa colère, plutôt que de le voir si apathique, si démissionnaire.
Un soir, au lit, j’ai envie de lui donner du plaisir. Mais je ne peux même pas glisser ma main dans son boxer. Dès que mes doigts effleurent son pubis, son corps a une réaction immédiate et violente. Il bondit carrément, comme un ressort. Action, réaction, sa main attrape la mienne et l’éloigne aussitôt.
— Je n’ai pas envie.
— C’est pas grave. Je peux au moins te prendre dans mes bras ?
— Ouais…
La tendresse est tout ce que j’aurai ce soir, et ceux qui suivront. Mais une tendresse à sens unique, sans retour de sa part. Je tente de faire bonne figure, mais j’ai envie de pleurer.
Début décembre 2006.
Les jours passent, et son abattement est de plus en plus flagrant. Ça me fait un mal de chien de le voir dans cet état et de ne rien pouvoir faire pour l’aider à aller mieux. J’ai pensé à une nouvelle excursion à Campan, mais il a refusé catégoriquement.
Puis, un jour, ce que je redoutais depuis des semaines se produit.
— Tu devrais rentrer à Toulouse, il me balance sur un coup de colère, au beau milieu d’une dispute.
Un accrochage parti d’une réflexion que je n’ai pas pu me retenir de lui balancer sur sa façon de se laisser aller, de se fermer en boule et de refuser de l’aide.
— Tu plaisantes, j’espère !
— Pas du tout !
— Mais qui va s’occuper de toi ?
— L’aide-soignante.
— Mais elle ne vient qu’une heure !
— Ça suffit !
— Une heure, ça suffit ? Et le reste du temps, si tu as besoin de…
— Non, toi, ça suffit ! il me coupe net.
— Tu en as marre de moi ?
— J’en ai marre que tu me voies comme ça.
— Pourquoi tu refuses de te faire aider ?
— Parce que je ne suis pas prêt.
— Tu ne le seras jamais ! C’est justement parce que tu n’es pas prêt qu’il faut y aller.
— Arrête, Nico !
— Tu veux vraiment que je parte ?
— Oui. J’ai besoin d’être seul. J’ai besoin de faire le point…
— Le point… sur quoi ? je m’inquiète.
— Sur tout !
— Et sur moi aussi ?
— Va-t’en, Nico ! ce sera son dernier mot.
Quand il va mal, Jérém se renferme sur lui-même et fait le vide autour de lui. Et dans ce ménage radical, Nico est dégagé avec tout le reste. C’est son mode de fonctionnement et je sais que je ne pourrais pas m’y opposer, car ça ne servirait à rien. J’essaie de me rassurer en me disant qu’il y a eu d’autres clashes, d’autre séparations, d’autres moments où Jérém n’allait pas bien. Et qu’il a toujours fini par revenir vers moi.
Et pourtant, quelque chose au fond de moi me dit que cette fois-ci, c’est plus grave, beaucoup plus grave.
C’est un déchirement de partir et de le laisser dans cet état. L’idée qu’il se retrouve seul me terrorise. Il me semble que des idées noires tournent par moments dans sa tête. Pourvu qu’il ne fasse pas de bêtises. Si ça arrivait, je ne me le pardonnerais pas.
Toulouse, décembre 2006.
Comme je l’avais imaginé, Jérém n’est pas vraiment assidu au téléphone. Heureusement, j’arrive à avoir de ses nouvelles par Ulysse qui a intensifié la cadence de ses visites depuis mon départ. Il passe désormais voir son coéquipier chaque soir. Ce gars est vraiment adorable.
A Toulouse, je me fais un sang d’encre. Je ne suis pas bien. A la tristesse et à la frustration engendrées par la distance de Jérém s’ajoute le fait d’avoir de fait interrompu la thérapie avec le psy parisien. Je n’ai pas envie d’aller voir un autre psy, de devoir tout recommencer.
Heureusement mes parents, ma cousine, Thibault et Julien, le beau moniteur d’auto-école, sont là pour me soutenir.
Cependant, ce mois de décembre semble passer au ralenti, plombé par l’inquiétude et la morosité. Noël approche, les illuminations éclairent la ville, le marché éphémère se déploie sur la place du Capitole, l’ambiance de Noël s’installe. L’ambiance est à la fête, mais pas dans mon cœur. Le silence de Jérém m’inquiète horriblement.
Mercredi 20 décembre 2006.
Quelques jours avant le réveillon, sans nouvelles de Jérém depuis près d’une semaine, je suis à deux doigts de prendre le train pour aller le rejoindre à Paris.
Mais le jour même où cette résolution s’impose dans ma tête, le beau brun m’appelle enfin. Il m’appelle pour m’annoncer qu’il va passer Noël chez son père et pour m’inviter à aller le rejoindre.
En voilà une bien bonne nouvelle ! Je suis si heureux. Peut-être que ces dernières semaines n’ont pas été inutiles, peut-être qu’il avait vraiment besoin d’être seul, de faire le point, de se retrouver. Peut-être que ça lui a fait du bien. Peut-être que nous allons enfin retrouver cette complicité que nous avons perdue depuis l’agression.
Samedi 23 décembre 2006.
Je débarque au vignoble l’avant-veille de Noël. Jérém a l’air content de me voir. Il vient m’accueillir dans la cour, il me serre très fort dans ses bras, il m’embrasse. Quant à moi, je suis tellement ému que j’ai du mal à retenir mes larmes.
Les bleus sur son visage ont enfin disparu. Mais son nez a gardé cette légère cassure.
Depuis mon départ de Paris, Jérém a repris la musculation, mais toujours pas les entraînements. Au premier abord, il semble aller mieux.
Pourtant, au fil des heures, je réalise que ce n’est toujours pas ça. Après le sursaut des retrouvailles, Jérém redevient très vite taciturne, distant. J’ai l’impression que s’il m’a fait venir, c’est parce qu’il espérait que ma présence l’aiderait à aller mieux. Visiblement, ce n’est pas le cas.
En attendant, je ne fais rien pour le brusquer, et je m’associe à la bonne humeur de Maxime pour créer l’ambiance la plus festive et décontractée possible.
Le réveillon de Noël arrive, et c’est plutôt un bon moment. Sophie, la belle-mère de Jérém, a mis les petits plats dans les grands, elle nous a concocté un repas raffiné. La conversation à table est riche, amusante. Maxime a toujours quelque chose de drôle à raconter, il est vraiment marrant.
Tout le monde semble se régaler, s’amuser. Tout le monde, sauf Jérém. Mon beau brun semble complètement ailleurs. Il ne décroche pas un mot, et il sourit encore moins. Quand il parle, c’est vraiment parce qu’il y est obligé, parce qu’on le questionne directement. Et le plus souvent, ses réponses sont laconiques. Quand il sourit, c’est pour faire bonne figure. Mais on voit bien que le cœur n’y est pas. Sa morosité m’affecte énormément. Et ça me gâche mon réveillon. Je suis inquiet pour lui. On dirait que la joie des autres le rend d’autant plus triste.
Minuit n’est passé que depuis quelques minutes lorsque mon bobrun annonce son intention d’aller se coucher. Maxime le charrie, lui dit qu’il l’a connu plus fringant, plus fêtard, « avant ».
— Avant, c’était avant, lâche tristement Jérém, avant de disparaître dans l’escalier.
— Je me fais du souci pour ce garçon, j’entends Sophie glisser à M. Tommasi.
— Moi non plus je n’aime pas le voir comme ça, admet ce dernier. Mais ça va lui passer. Il va surmonter ça.
— Ce qu’il a vécu est trop dur, il ne s’en sortira pas tout seul ! considère Maxime avec inquiétude.
— Et toi, Nico, comment ça va ? m’interroge M. Tommasi.
— Pas trop mal. J’ai toujours des flashes de ce qui s’est passé, il m’arrive d’en faire des cauchemars. Mais ça m’a fait du bien d’aller voir un psy.
— Tu peux pas essayer de lui en toucher deux mots ? Il t’écoute, toi !
— Il m’écoute quand il en a envie ! Je n’ai jamais pu le convaincre de faire quelque chose dont il n’avait pas envie.
— Tu veux essayer ?
— Je peux. Mais il va se braquer, et c’est tout ce que je vais obtenir.
Un quart d’heure après le forfait de Jérém, je m’éclipse à mon tour. Je monte l’escalier pour aller rejoindre P’tit Loup dans sa chambre d’enfant.
— Tu dors ?
— Oui !
— Oui, c’est ça ! je le charrie.
— Pourquoi t’es monté si tôt ? il me demande, la voix traversée par un certain agacement.
— Je pourrais te poser la même question !
— J’avais sommeil !
— Eh ben, moi aussi !
— C’est ça, oui…
— Je suis monté parce que je m’inquiète pour toi… tout le monde s’inquiète pour toi…
— Arrêtez de vous inquiéter, vous me cassez les burnes !
— Ok, ok, je suis monté parce que j’avais envie d’être avec toi, si tu préfères.
— Je peux dormir seul.
— Je sais. Mais moi j’ai envie de dormir avec toi. Et j’ai envie de te serrer contre moi. Je peux ?
— Viens…
Son corps musclé emplit mes bras de chaleur, mon esprit de bonheur.
— Je suis content que tu m’aies demandé de venir fêter Noël ici.
Un instant plus tard, mes lèvres se promènent doucement sur son cou, ma langue titille ses oreilles. Mes mains se baladent lentement sur son torse, mes doigts se laissent enchanter par le relief toujours aussi impressionnant de ses pecs, par la délicieuse douceur de sa peau, se perdent dans la contemplation tactile de ses poils, se laissent longuement happer par ses merveilleux tétons saillants. Puis, ils redescendent, parcourent à l’aveugle la gravure de ses abdos, s’amusent à les compter, à en mesurer les creux et les reliefs. Mon beau brun semble apprécier. Il me semble que sa respiration a changé, que son souffle est celui d’un garçon excité.
Je m’enhardis alors. Je laisse le bout de mes doigts se glisser entre l’élastique de son boxer et ses poils pubiens, je les laisse effleurer la naissance de sa queue. Et là, je constate qu’elle est bien chaude, bien tendue.
Je me glisse entre ses cuisses musclées et je pose mon nez et mes lèvres par-dessus le coton élastique, je cherche et je trouve le gland en tâtonnant avec ma langue, je titille le frein à travers le tissu fin. J’ai envie d’exciter mon beau brun, de le faire un brin s’impatienter, de le chauffer, j’ai envie de marquer le coup à l’occasion de nos retrouvailles sensuelles.
Mais ce soir, Jérém n’est pas d’humeur à faire durer les préliminaires.
— Suce-moi ! je l’entends me lancer sèchement.
Je m’exécute sur le champ, avec un bonheur infini. J’attrape l’élastique de chaque côté de son bassin, je fais glisser le boxer le long de ses cuisses. J’avale sa queue bien raide, à nouveau magnifiquement insolente. Je le pompe avec entrain, impatient de lui offrir enfin du plaisir. Quelques minutes plus tard, je suis si heureux de l’entendre me glisser :
— Je vais jouir…
Et je reçois aussitôt dans ma bouche la première d’une belle série de bonnes giclées chaudes, les premières dont il me fait cadeau depuis notre agression.
Entre Noël et le Jour de l’An.
Les jours suivants sont accaparés et quelque part égayés par le travail de la vigne. C’est l’époque de la taille, et tout le monde met la main à la pâte. M. Tommasi et Sylvie, Maxime et sa copine, mais aussi Jérém. Bien évidemment, je suis le mouvement. Au grand air, occupé par une activité physique, Jérém semble plus serein. Toujours aussi taciturne, mais serein. Et toujours aussi furieusement sexy, même avec une cotte de travail.
Le reste du temps, pendant les pauses, durant les repas, sa morosité est toujours aussi présente. Chaque soir, j’ai désormais droit de lui faire une pipe. Et ça, ça fait du bien. Mais ces petits moments de complicité sensuelle ne sont suivis d’aucune avancée de notre complicité affective. Jérém n’a pas envie de parler, et s’endort aussitôt après avoir joui.
Cette année encore, nous passons le réveillon du 31 à Campan. Cette année, Thibault est là aussi, accompagné de son adorable Arthur.
— Mais c’est pas possible, vous allez tous nous les piquer ! fait Satine, dépitée, en contemplant le joli couple de pompiers.
Les Cavaliers ont la délicatesse de croire, ou de faire semblant de croire, ce qu’ont raconté les journaux au sujet de l’agression de Jérém. De ne pas poser trop de questions sur ce qui s’est passé en cette horrible nuit parisienne. Et de ne pas faire de commentaires sur le petit changement de profil de Jérém.
L’ambiance est celle des soirées de fête, une folle ambiance faite de vannes potaches, de rires sonores, d’amitié. Mais même la bonne humeur et la bienveillance des cavaliers n’ont pas raison de la morosité de Jérém. Comme lors du réveillon de Noël, Jérém est taciturne, absent, et il ne se mélange pas à la fête. Il passe quasiment plus de temps à côté de la grande cheminée à griller des cigarettes qu’assis à table.
— Il ne va pas bien, hein ? me questionne discrètement Charlène lorsque Jérém part pisser dehors.
— Non, il ne va pas bien, j’admets, touché et attristé.
— C’est violent ce qu’il a vécu. Il voit quelqu’un ?
— Il ne veut pas. J’ai essayé de lui faire changer d’avis, mais il n’y a rien à faire. Il est têtu comme une mule.
— On dirait que quelque chose a cassé en lui, l’élan de sa jeunesse, son insouciance, sa joie de vivre, avance le sage Jean-Paul.
J’en ai les larmes aux yeux. Parce qu’en une seule phrase, JP a mis le doigt exactement là où le bât blesse.
De retour de sa pause pipi, Jérém est questionné par Martine au sujet de ses entraînements. Je l’entends lui mentir, lui dire que ça fait trois semaines qu’il a repris.
La nuit s’étire comme d’habitude sur les notes de la guitare de Daniel et sur le chœur à trop de voix toutes les unes plus fausses que les autres qui tentent de l’accompagner.
Cette nuit, ça fait cinq ans que Jérém m’a dit « Je t’aime » dans la petite maison. C’était après avoir fait l’amour et c’était la première fois qu’il me disait « je t’aime ».
Cette nuit, nous ne dormons pas à la petite maison, mais chez Charlène. Nous ne faisons pas l’amour. Et Jérém ne me dit pas « je t’aime » non plus. Je lui dis, moi.
— Je t’aime, P’tit Loup !
Pour toute réponse, il attrape mon bras, celui qui l’enlace et m’attire un peu plus contre son dos.
Depuis notre agression, Jérém ne m’a jamais encore pris dans ses bras. Mais il a souvent accepté que je le prenne dans les miens. Il fut un temps où dans ses bras puissants j’avais l’impression que rien ne pouvait m’arriver. Maintenant, c’est à mon tour d’offrir les miens pour le faire se sentir protégé. Je suis heureux qu’il se sente bien dans mes bras.
— Je suis désolé, Nico… je l’entends me glisser à mi-voix.
— Désolé de quoi ?
— De ne pouvoir te donner plus.
— Tu es là, tu es en bonne santé, et c’est tout ce qui compte.
— Je ne suis pas bien, Nico.
— Je sais. Mais je suis là. Tu entends ? Je suis là !
Lundi 1er janvier 2007.
C’est le lendemain que je gaffe. Au détour d’une conversation, j’évoque ma sortie de l’hôpital. Ce qui ne colle pas du tout avec la version officielle de l’accident de Jérém. Dès lors, Charlène nous oblige à lui dire la vérité sur l’agression.
— Cinq mecs pour en agresser deux ? Parce que vous êtes pédés ? Il y en a vraiment qui sont venus au monde juste parce que leurs parents ont oublié de mettre une capote !
— C’est clair ! je confirme.
— Pourquoi vous ne m’en avez pas parlé avant ?
— On ne voulait pas te faire de la peine. Tu n’aurais pas profité du réveillon, lui glisse Jérém.
— C’est pas faux. Mais quand-même !
— Maintenant, tu sais. Le sujet est clos.
— A te regarder, on dirait que ce n’est pas vraiment le cas.
— T’occupe ! Et surtout, tu n’en parles à personne.
— Tu sais que tu peux compter sur moi.
— Même pas à Martine, ok ?
Mardi 02 janvier 2007.
C’est ce matin que nous quittons la maison de Charlène, Campan et les Pyrénées. Cette nuit, Jérém n’a pas bien dormi. Il s’est levé toutes les heures pour fumer. Le fait que Charlène soir désormais au courant, le tracasse. Il a peur qu’elle s’inquiète. Au petit déjeuner, il porte sur lui les traces de la nuit presque blanche, le teint pâle, de beaux cernes.
— Ça n’a pas l’air d’aller, lui glisse la maîtresse de maison.
— Je n’ai pas bien dormi.
— Je ne te parle pas de ce matin, je te parle du fait que tu ne vas pas bien du tout en ce moment.
— Fiche-moi la paix de bon matin ! ! Je vais bien, ok ?
— Non, tu vas mal, tu vas même très mal. Et si tu continues comme ça, tu vas aller de plus en plus mal et tu n’arriveras pas à remonter la pente.
— Tu me casses les couilles à la fin !
— Je sais, j’imagine. Mais je m’en voudrais de te voir déraper sans t’avoir parlé franchement.
— J’ai pas besoin de leçons. Allez, on se casse, me lance Jérém en se levant de sa chaise d’un bond.
Charlène se lève d’un bond elle aussi.
— Assieds-toi ! Tu vas m’écouter cinq minutes, petit con !
— Qu’est-ce qu’il y a encore… fait Jérém, en changeant soudainement de ton.
— Tu t’es vu seulement ?
— Quoi ?!
— Tu as la gueule d’un déterré ! Tu as 25 ans, tu es dans la fleur de l’âge, bordel ! Tu es beau comme un Dieu, tu es en bonne santé, et tu as de l’or dans tes mains et tes pieds.
— Mais je n’ai plus envie de jouer !
— Tu as vécu quelque chose d’horrible et…
— Tu ne sais rien de ce que j’ai vécu !
— C’est vrai, mais je vais te dire les choses telles que je les vois.
— Je t’écoute ! lui lance Jérém sur un ton de défi.
— Oui, tu t’es fait tabasser parce que tu es pédé. Oui, c’est injuste. Et alors ? Tu crois que c’est pire que d’avoir un accident de voiture ? Il y en a qui ont été amochés bien pire que toi et qui se sont relevés et ont su remonter la pente. Il faut que tu t’accroches, il faut que tu te bouges le cul, sinon, tu vas rater le train de ta vie !
— Je n’y arrive pas ! J’ai pas envie de me lever le matin, j’ai même plus envie de baiser ! Je n’ai plus goût à rien.
Ça me fait de la peine de l’entendre exprimer enfin si clairement son mal-être, et ça me fait de la peine aussi de l’entendre l’exprimer de cette façon, parce que Charlène l’a acculé, parce qu’elle l’a obligé à le faire, alors qu’il n’a jamais voulu m’en parler. Mais l’important c’est que ça sorte enfin, d’une façon ou d’une autre.
— Si tu n’y arrives pas seul, va voir quelqu’un qui peut t’aider.
— Personne ne peut m’aider !
— Ne sois pas con, putain ! Je sais qu’au fond de toi tu as l’énergie pour rebondir, tu as juste besoin d’un petit coup de pouce.
— Non, je n’ai pas cette énergie, je ne l’ai plus !
— Il faut au moins que tu essaies, sinon tu finiras par le regretter toute ta vie. Ne te laisse pas couler, Jérém.
— J’ai l’impression de me noyer…
— Les bateaux ne coulent pas à cause de l’eau autour d’eux. Ils coulent à cause de l’eau qui rentre à l’intérieur. Ne laisse pas cette nuit pénétrer ton esprit et te faire couler.
L’année 2007.
En ce début d’année, je suis à Toulouse et Jérém à Paris. Je commence mon taf à Montaudran. Je commence par faire des photocopies et mettre à jour des listings. Pour l’instant, je suis loin de la Garonne. Il me tarde que la saison d’irrigation démarre pour pouvoir enfin être sur le terrain.
Quant à Jérém, il accepte enfin d’aller voir un psy. Les mots de Charlène ont fait leur effet. Sacrée Charlène.
Séance après séance, je sens au téléphone qu’il semble aller mieux. Ce n’est peut-être pas un hasard s’il reprend enfin les entraînements.
Je voudrais être avec lui pour l’encourager au quotidien, pour être le témoin de ses progrès. Au bout de trois longues semaines, l’occasion se présente enfin.
Samedi 27 janvier 2007.
C’est une fois de plus au Stade de France que se joue le choc des Titans, Stade Français contre Stade Toulousain. Hélas, les deux équipes sont privées de deux de leurs meilleurs joueurs. Jérém n’est toujours pas prêt pour revenir sur le terrain. Et Thibault a mis un terme à sa carrière.
Mais l’un et l’autre ne peuvent se priver de se rendre dans les tribunes pour assister au match. Et moi non plus. Je fais la route depuis Toulouse avec Thibault et Arthur. Mon impression au sujet de ce dernier se confirme pendant ce voyage de plusieurs heures. Le compagnon de Thibault est un sacré bonhomme, profondément gentil et attentionné. Et il est vraiment fou amoureux de l’ancien mécano. C’est tellement beau à voir ! Ils sont tellement beaux à voir !
Dans les tribunes, nous assistons à un match intense. Jérém et Thibault sont assis côte à côte et vivent le jeu à fond. C’est la première fois depuis l’agression que je vois Jérém aussi intéressé par quelque chose, aussi passionné. Et ça me fait tellement plaisir !
Le match se termine sur un score de 22 à 20 en faveur des Parisiens qui tiennent enfin une « revanche » face aux Toulousains après les déconvenues à répétition des derniers mois.
— Il a suffi que je me tire, et c’est la débâcle ! se marre l’ancien demi de mêlée.
— Il a suffi que je ne joue pas pour qu’ils gagnent, c’est tout aussi vexant ! fait Jérém.
— Ne dis pas de bêtises, Jé !
— Ça te fait pas quelque chose de voir tes coéquipiers jouer sans toi ?
— Bien sûr que ça me fait quelque chose. Mais je ne regrette rien. Je suis vraiment bien dans ma nouvelle vie, comme un poisson dans l’eau.
— Je suis heureux pour toi.
— Merci, Jé. Continue de te battre, et tu vas vite retrouver tes potes sur le terrain.
— J’espère…
Entendre Jérém « envisager » enfin un retour sur le terrain emplit mon cœur de joie.
Après le match, nous allons tous les quatre dîner en ville. Un peu plus tard dans la soirée, nous nous retrouvons tous à l’appart. Il est prévu que les deux beaux pompiers dorment dans la chambre d’amis cette nuit, avant de repartir demain pour la ville Rose. Je vais devoir repartir avec eux. Si j’étais encore étudiant, je pourrais sécher quelques cours et rester quelques jours. Mais désormais j’ai un travail, et mes obligations m’appellent. Que c’était beau d’être étudiant !
Je n’ai que cette nuit pour profiter de mon Jérém. Alors, je n’ai même pas envie de dormir. J’ai envie de profiter de sa présence, chaque instant.
La soirée s’étire tard dans la nuit, les discussions ponctuées de bières sont agréables. Les souvenirs communs des deux anciens coéquipiers font peu à peu surface dans la conversation. Le degré d’alcoolémie général augmente doucement.
A un moment, je vois le Lieutenant chercher les lèvres de l’ancien demi de mêlée et se lancer dans un baiser aussi doux que passionné. Un baiser qui dure, qui s’étire, et qui ne semble jamais devoir s’arrêter. Les bras enlacent, les mains caressent, cherchent le contact physique, insatiables.
Mais qu’est-ce qu’ils sont beaux ! Et comment je les envie ! J’aimerais tellement retrouver cette fougue avec Jérém. Je l’ai eue, et je l’ai perdue. Est-ce que je vais la retrouver, un jour ?
Lorsque ce long baiser prend fin, les deux pompiers ont l’air dans tous leurs états. Un instant plus tard, ils s’embrassent à nouveau. Lorsque les lèvres se séparent, les regards ne le peuvent toujours pas. Et le petit sourire qui illumine leurs visages donne la mesure du désir réciproque qui les consume. C’est beau, le désir, quand il est aussi brûlant, aussi manifeste.
Tous leurs mouvements sont harmonieux, fluides, animés par une complicité et une fébrilité qui crèvent les yeux. Ils ont envie l’un de l’autre, c’est flagrant.
— Si vous avez envie, ne vous gênez pas, j’entends Jérém lancer.
— On n’est pas des bêtes, on peut attendre, plaisante Arthur.
— Vous ne devriez pas… insiste Jérém.
Arthur sourit, un peu décontenancé par la proposition de Jérém. Mais Thibault saisit son bel Arthur par l’avant-bras, l’attire contre lui et l’embrasse à son tour. Un baiser fougueux, très sensuel.
Un instant plus tard, les deux beaux pompiers disparaissent dans la chambre. Ils vont faire l’amour.
J’ai envie d’en faire de même avec mon Jérém. Moi aussi j’ai envie de faire l’amour avec le gars que j’aime. Je l’embrasse, doucement. Longuement. Mais ses lèvres ne répondent que faiblement à mes sollicitations.
Je tente alors le tout pour tout, je l’embrasse avec plus de fougue. Mais il n’est pas d’humeur non plus.
C’est dur de réaliser à quel point, entre la parfaite fusion des corps et des esprits que partagent nos invités et ce qui est en train de se passer entre Jérém et moi, il y a un monde.
— Je ne sais même plus si j’ai envie de continuer, ou si seulement ça servirait à quelque chose de continuer. Suce-moi ! je l’entends me commander, alors que je suis sur le point de tout arrêter, et de pleurer.
Un instant plus tard, je me glisse entre ses cuisses, et je commence à le pomper. J’aimerais sentir son excitation monter, la vibration du plaisir traverser son corps et le faire exulter. J’ai tellement envie de lui faire plaisir !
Mais rien de tel ne se produit. J’ai l’impression que Jérém ne prend même pas vraiment son pied. Pas de soupirs, pas de ahanements, pas de frémissements de son corps qui traduiraient son excitation. Non, rien de tout ça.
Je l’ai senti lors des quelques pipes que j’ai pu lui faire depuis Noël. Si Jérém me laisse parfois lui offrir du plaisir, notre complicité n’est pas revenue pour autant. Et j’ai l’impression que là aussi quelque chose a cassé pour de bon.
J’essaie de faire bonne figure, mais mon esprit pleure à chaudes larmes.
— Ah, les deux pompiers sont en train de baiser ! je l’entends constater, alors que la cloison laisse passer et venir jusqu’à nous des petits bruits de l’amour.
— J’ai envie de toi, je lui glisse alors.
Une fois encore, je tente le tout pour tout. C’est quitte ou double. Je prends tous les risques. A ma grande surprise, Jérém est partant.
Un instant plus tard, après avoir craché dans sa main et sur ma rondelle, il se laisse glisser entre mes fesses. C’est la première fois que Jérém vient en moi depuis cette baise fougueuse dans le sous-sol de l’immeuble où habite Ulysse. Ça devrait être un moment magique.
Mais ça ne l’est pas. Ce n’est qu’une déception de plus dans une soirée où, décidemment, rien ne va plus.
Jérém me fait l’amour, mais son regard semble perdu dans le vide. Il semble ailleurs, il n’a pas l’air dans son assiette. Ses gestes sont brusques, précipités, presque maladroits. Tout semble forcé, dissonant. Comme si Jérém n’avait pas vraiment envie de me faire l’amour, et qu’il s’était juste laissé entraîner par l’envie de me faire plaisir. Pour faire semblant qu’il y a encore une complicité entre nous. Alors que ce n’est plus le cas. Peut-être qu’en acceptant ma proposition, il a voulu tenter de faire bonne figure, de s’éviter une longue discussion. Peut-être qu’il s’est laissé entraîner par la passion de nos invités. Comme s’il voulait les imiter. Comme s’il voulait se montrer, nous montrer, que c’était encore possible entre nous. Mais visiblement, ça ne l’est pas, ça ne l’est plus.
Car il y a un monde entre la fougue et la tendresse de toutes les fois où nous avons fait l’amour du temps où nous étions Ourson et P’tit Loup, ou même entre la bonne baise le soir de son anniversaire, et cet accouplement où tout paraît mécanique.
Nos corps sont emboîtés, mais nos esprits sont complètement déconnectés. Le plaisir que j’ai retiré de ses premiers coups de reins s’estompe peu à peu, laissant la place à une douleur grandissante. Je ne veux surtout pas priver Jérém de son orgasme, mais je me surprends à souhaiter qu’il ne tarde pas trop à venir. C’est triste.
Je repense à Thibault et Arthur, en train de faire l’amour dans la pièce d’à côté. Certainement en train de prendre leur pied comme des fous. Il n’y a rien de plus beau que deux êtres qui vibrent à l’unisson pour rendre l’autre heureux.
Leur bonheur me rend heureux. Thibault le mérite mille fois, et Arthur m’a l’air de le mériter tout autant.
Mais leur bonheur met aussi en évidence, par contraste, celui que Jérém et moi avons perdu.
Jérém continue de me pilonner, de plus en plus fort, en transpirant à grosses gouttes, comme si son orgasme lui échappait. Quand il arrive enfin à le rattraper, il jouit vite, il jouit seul.
Un instant plus tard, il se déboîte de moi, il repasse son boxer et file à la fenêtre s’allumer une clope, sans rien tenter pour me faire jouir à mon tour. De toute façon, je n’y suis plus, mon plaisir s’est évaporé, mon excitation aussi, et j’ai débandé.
Je repense aux fois où l’amour entre Jérém et moi était un pur feu d’artifice. Je me souviens de son regard excité et amoureux. Je me souviens de ses gestes, de son attitude, de cette envie, de ce besoin viscéral que nous partagions, ceux de s’offrir à l’autre, de nous affairer pour le plaisir de l’autre. Je me souviens de la dernière fois où nous avons fait l’amour, l’après-midi avant de fêter son anniversaire chez Ulysse.
Je me souviens qu’après l’amour, nous étions défaits, épuisés, et heureux. Si heureux.
A cet instant précis, après avoir joui, Jérém a l’air davantage perdu qu’heureux.
Quant à moi, je me sens envahi par une solitude immense, par une tristesse infinie. J’ai l’impression que mon cœur est un trou béant que rien ni personne ne saura plus jamais combler.
Cher lecteur, ton avis sur cet épisode sera le bienvenu.
Merci d'avanceFabien
 6 commentaires
6 commentaires
-
Par fab75du31 le 1 Mars 2023 à 21:07
Samedi 14 octobre 2006.
Hier, le vent d’Autan s’est levé sur Toulouse. Il a soufflé toute la nuit, il m’a même réveillé à deux reprises. Et ça continue aujourd’hui. Sur les allées, les branches des platanes se balancent au gré des caprices de la force éolienne. Les feuilles tombent par vagues, la chaussée et les trottoirs en sont couverts.
Ce matin, sur mon chemin vers la gare Matabiau, je remonte les souvenirs. Car c’est le même trajet que j’ai emprunté il y a un peu plus de cinq ans, le même trajet que j’ai emprunté tant de fois pour aller retrouver Jérém. Et je repense tout particulièrement à la première fois que j’ai fait ce trajet, pour aller retrouver Jérém pour notre première révision.
C'était le printemps, c’était la première année du nouveau millénaire. Mais c’était surtout et avant tout l’année de mes 18 ans.
Ce jour-là, le vent d’Autan soufflait très fort dans les rues de la ville Rose. Puissant, insistant, il caressait ma peau, chatouillait mes oreilles, me parlait du printemps, un printemps qui se manifestait partout, dans les arbres des allées au feuillage triomphant, dans les massifs fleuris du Grand Rond, dans les t-shirts qui mettaient en valeur la plastique des garçons.
J’ai le net souvenir de la sensation de ce vent dans le dos, accompagnant mes pas, encourageant ma démarche, comme pour faire taire mon hésitation.
Je me souviens de mon cœur qui battait la chamade en arrivant au Grand Rond, je me souviens de mes mains moites. Je me souviens d’avoir eu envie de faire demi-tour. J’avais trop peur du malaise de me retrouver seul avec un petit Dieu comme Jérém. Je m’apprêtais à revenir sur mes pas, cédant à la peur, prisonnier de mes craintes, fuyant la vie. Je m’apprêtais à faire demi-tour, lorsqu’une rafale de vent plus puissante et déterminée que les précédentes avait semblé me bousculer, me « mettre un coup de pied au cul», m’obligeant à avancer.
Quand j’y repense, j’ai presque l’impression que le vent d’Autan semblait ce jour-là souffler dans mon dos comme pour me pousser à la rencontre de mon destin.
Ce jour-là, le vent d’Autan me poussait à aller au bout de mon trajet, à franchir la distance entre la maison de mes parents, dans le quartier Saint-Michel, et l’appart de Jérém, rue de la Colombette. Il me poussait à marcher tout droit vers la première révision de maths avec mon camarade, vers la première révision de ma vie sentimentale, et de ma vie d’adulte.
C’était le début de cette histoire, de mon histoire.
Ce samedi, le vent d’Autan souffle toujours. Et j’ai l’impression qu’il me pousse à nouveau vers mon destin.
Le week-end de l’anniversaire de Jérém, le Stade Français retrouve Biarritz à Paris. Evidemment, je monte à la capitale pour assister au match. Là aussi le vent souffle à bloc. Ce n’est pas le vent d’Autan, mais ça décoiffe tout autant.
Jérém poursuit sur sa lancée, il semble inarrêtable. Les Parisiens s’imposent sur les Biarrots et remportent le match sur un score de 22 points à 16. La troisième mi-temps s’étire dans la nuit. A l’appart, je crève d’envie de faire l’amour avec Jérém. Mais je finis par m’endormir.
Il est deux heures du mat’ lorsque je suis réveillé par le bruit de la porte d’entrée. Jérém est enfin là, beau comme un Dieu. Il se penche sur moi, il m’embrasse. Au lit, nous nous endormons l’un dans les bras de l’autre.
Le dimanche, en revanche, nous ne quittons le lit que pour de très rares moments. Nous passons le plus clair de la journée à faire l’amour.
Lundi 16 octobre 2006.
Aujourd’hui, Jérém a 25 ans. Pour fêter son anniversaire, je le réveille avec une bonne pipe. Sous la couette, pendant que je le suce, j'adore glisser ma main entre sa peau douce et le coton doux de son t-shirt blanc, sentir la chaleur de son corps, et les délicieuses petites odeurs qui se dégagent de sa peau. La vibration de son orgasme est un instant de bonheur absolu. Ses giclées sont puissantes, chaudes, denses.
Pour fêter son anniversaire, Ulysse nous a invités chez lui le soir même. Le beau blond a une nouvelle passion, la cuisine. A bientôt 32 ans, il commence à penser à l’après de sa carrière sportive. Et il l’envisage en tant que chef cuisinier dans un établissement de standing qu’il projette de créer dans la capitale. D’ailleurs, son projet est déjà bien avancé, il en est d’ailleurs au stade de la recherche du site pour ouvrir son activité.
Rien ne m’appelle à Toulouse, mon taf ne commence que dans deux semaines. J’ai donc prévu de rester quelques jours de plus avec mon Jérém. Pendant que mon beau brun est aux entraînements, et en attendant son retour pour nous rendre à la soirée chez Ulysse, j’appelle Maman. Elle m’apprend que le vent d’Autan ne s’est pas calmé du week-end, et qu’il souffle toujours aussi fort.
A Paris aussi le vent souffle toujours. Je sors en début d’après-midi pour aller chercher le cadeau pour Jérém, un t-shirt et un boxer de sa marque préférée.
De retour de ses entraînements, Jérém m’embrasse fougueusement. Puis, sans un mot, il me plaque contre le mur, face au mur, il défait sa braguette, la mienne, il me pénètre, il me pilonne. Le baiser mis à part, j’ai l’impression de revivre le jour du bac philo, ce jour où il m’avait intimé de le suivre chez lui, après que je l’avais bien chauffé pendant l’épreuve. Je sens son corps contre le mien, je sens son corps dominer le mien, je sens ses mains saisir mes hanches, mes bras, je sens son souffle excité dans mon cou. Et au bout d’une poignée de minutes, j’entends le râle de plaisir contenu de justesse pendant que le beau brun me gicle dans le cul.
— Bon anniversaire, chéri ! je lui glisse, alors que je suis encore sonné par sa fougue.
Une minute plus tard, nous prenons la douche ensemble. Qu’est-ce que j’aime prendre ma douche avec Jérém, le regarder se savonner, voir l’eau ruisseler sur sa peau mate, nous embrasser longuement. Mais aussi le regarder s’essuyer, s’habiller, s’apprêter. A la fin de ce processus magique, mon beau brun est prêt à partir pour notre soirée chez Ulysse.
Blouson en daim sur t-shirt blanc col rond, chaînette posée négligemment sur le coton immaculé, jeans super bien coupé, baskets blanches. Le brushing bien fixé au gel, la barbe de quelques jours, aux contours bien nets, une note de parfum aux effluves capiteux qui flotte avec insistance autour de lui. Ce soir, Jérém est sur son trente et un. Ce soir, Jérém est beau comme un Dieu et il sent divinement bon. Ce soir, son sourire est à se damner. Ce soir, son regard amoureux est à pleurer.
Lorsque nous quittons l’immeuble, le vent souffle toujours. Il en est de même lorsque nous arrivons à la résidence d’Ulysse.
A l’appart, nous retrouvons le beau blond barbu dans la cuisine, derrière les fourneaux. Avec son tablier rouge posé sur t-shirt noir aux manchettes bien collées à ses biceps de fou, avec sa belle petite gueule au regard d’ange viril, il est sexy à mort.
Le demi de mêlée s’est donné la peine de préparer un super repas pour l’anniversaire de son co-équipier. De la préparation des mets, tous les uns plus raffinés que les autres, jusqu’au dressage de la table et des assiettes, tout est beau, tout est bon, tout est soigné. Ce repas est digne d’un grand restaurant.
Pendant le dîner, le futur chef nous parle de la formation de cuisine qu’il est en train de suivre en parallèle de sa carrière sportive. Il est passionné et passionnant.
Au dessert, c’est tiramisu. Ulysse nous explique que le secret du tiramisu, c’est le mascarpone.
— Ma grand-mère disait que le mascarpone, quand on le fait soi-même, a un goût tout particulier.
Ulysse est touchant. Jérém est Jérém, et il m’émeut. Les deux rugbymen accaparent tout mon champ de vision. T-shirt blanc ajusté sur torse de malade sur mec très brun à la peau mate et t-shirt noir tout aussi ajusté sur torse de fou mec très blond à la peau claire, qu’est-ce que c’est beau !
Les deux coéquipiers sont vraiment sexy à se damner. Et encore plus après quelques verres de vin qui rendent leurs regards sensuels et pétillants. Ça me donne le tournis. A moins que ce ne soient les verres que j’ai bus qui me donnent le tournis. Ou les deux.
Nous passons une très bonne soirée. La conversation finit par glisser vers le rugby. Il s’en suit une discussion animée entre les deux joueurs, un échange dans lequel une différence de point de vue sur certains aspects du jeu du dernier match semble crisper les esprits embrumés par l’alcool. Le beau blond finit par désamorcer les tensions en lançant une blague hilarante.
Après le dîner, nous nous posons sur le canapé du séjour, avec d’autres verres et d’autres boissons. Ulysse lance un DVD de match du Stade, justement l’objet du différend. Il passe en revue les actions de Jérém et fait des remarques sur son jeu. Ce sont des remarques constructives, bienveillantes. Images à l’appui, la discussion entre l’ailier et le demi de mêlée reprend de plus belle, mais sur un ton plus apaisé, plus complice.
Il est minuit passé lorsque le débrief prend fin, lorsque les points de vue de deux garçons semblent enfin reconciliés.
— Merci Uly, finit par glisser Jérém.
— Merci de quoi ?
— Pour cette soirée, et pour tout ce que tu m’apprends au rugby.
— Je ne t’apprends rien, j’essaie juste de te faire partager mon expérience.
— J’apprécie énormément, même si parfois je suis un peu buté. Alors, merci de me supporter !
— De rien, de rien, fait le beau blond, l’air gêné par les mots de Jérém.
Quelques minutes plus tard, dans l’ascenseur de l’immeuble, Jérém me sourit, l’air fripon, l’étincelle bien coquine dans le regard.
— Tu sais quoi ? J’ai envie de toi ! il me lance, à brûle pourpoint.
— Moi aussi j’ai très envie de toi.
— Oui, très envie…
— Tu vas me baiser à l’appart, oui !
— Je ne crois pas que je vais pouvoir attendre d’arriver à l’appart, il me glisse, tout en attrapant ma main et en la posant sur sa braguette à nouveau frémissante et bouillante.
— Et toi non plus, tu ne vas pas pouvoir attendre, il enchaîne, en posant sa main sur ma braguette, tout aussi frémissante que la sienne.
— C’est Ulysse qui t’a mis dans cet état ? je le questionne.
— Et toi ?
Le regard que nous nous échangeons est chargé d’un érotisme brûlant. Son sourire brun serait capable de faire fondre le soleil lui-même.
L’ascenseur termine sa course au rez-de-chaussée. Les portes s’ouvrent. Ça se passe très vite.
— Viens ! m’intime Jérém, en m’attrapant par l’avant-bras, en déviant ma trajectoire naturelle vers la grande porte d’entrée, en la détournant vers une petite porte située juste à côté de l’ascenseur sur laquelle une plaque stipule « Accès parking ».
Jérém connaît bien l’immeuble, car il y a passé quelques mois, en colocation avec Ulysse, après le non renouvellement de son contrat avec le Racing.
Dans le passage éclairé par une lumière terne, Jérém m’embrasse avec une fougue terrible. Je le sens chaud comme la braise. Pendant que sa langue galoche la mienne, et que son souffle excité me rend dingue, je l’entends se débraguetter en vitesse.
Oui, son excitation me rend dingue, mais pas au point de faire taire toutes mes peurs. Soudain, je repense à une fois dans l’entrée de l’immeuble de la rue de la Colombette, une nuit où j’avais commencé à le sucer et où nous avions failli nous faire surprendre par une voisine rentrée au mauvais moment. Je me souviens que Jérém avait été tellement échaudé qu’une fois à l’appart il avait eu une panne, panne qui l’avait bien mis en pétard, d’ailleurs.
— T’es sûr, Jérém ?
— Certain !
— On ne risque pas de se faire gauler ?
— C’est ça qui est bon !
— T’as pas peur qu’on te…
— Ferme-là, et baise-moi ! il me lance, sans détours, en défaisant ma braguette avec des gestes frénétiques.
Un instant plus tard, je me laisse glisser en lui. Dans ce couloir mal éclairé, Jérém se donne à moi. Je suis un peu mal à l’aise, mais il faut bien admettre que la situation est très excitante. Je sens mon orgasme arriver à grand pas, et je tente de le retenir en ralentissant mes coups de reins. Mais Jérém ne l’entend pas de la même façon.
— C'est bon, putain, défonce-moi ! Remplis-moi le cul, vas-y, beau mec !
Ses mots crus, son attitude débridée, son cul offert sans pudeur, son envie de se faire posséder entièrement assumée, son plaisir de passif tout aussi assumé. Et aussi, la vision de ses cheveux bruns, de son tatouage qui remonte le long de son cou, de sa chaînette posée sur le col de son t-shirt immaculé qui dépasse de son blouson, le parfum qui se dégage de lui. Tout cela me met dans un état second. Il y a de quoi précipiter mon orgasme. Et je ne tarde pas à gicler abondamment dans son beau et bon cul de rugbyman.
Je viens tout juste de jouir, lorsque le beau brun se déboîte de moi. Un instant plus tard, il me plaque contre le mur en béton, il se plaque contre moi. Je sens la fraîcheur sur mes fesses désormais dénudées. Puis, sa salive tiède sur mon trou. Puis, sa queue bien chaude entre mes fesses, son manche bien raide en train de me pilonner. Jérém me baise avec une précipitation certaine, ainsi qu’avec une certaine sauvagerie bien excitante.
Son excitation est telle qu’il gicle en moi à son tour au bout de quelques coups de reins à peine.
Jérém se déboîte à nouveau très vite de moi, il remonte son boxer, reboutonne sa braguette, agrafe sa ceinture. J’en fais de même. Je suis ivre de plaisir. J’ai le visage en feu, le cul en feu, le ventre en feu. J’ai l’impression d’être une torche qui vient de brûler. Avant de quitter les lieux, Jérém m'embrasse une dernière fois. C’est le baiser d’un amant qui vient de jouir comme un malade. C’est le baiser d’un gars à l’haleine bien alcoolisée mais au regard amoureux.
Il est environ une heure du matin lorsque nous quittons l’immeuble d’Ulysse. Le vent souffle toujours, et il me fait penser au vent d’Autan qui doit toujours souffler sur Toulouse à cet instant.
Dans le boulevard, nous cherchons un taxi. Il n'y en a pas. La nuit est agréable, il ne fait pas froid. Jérém n’aime pas le métro, alors nous décidons de marcher.
Je regarde Jérém, je décèle dans son allure l’ivresse du vin que nous avons bu pendant la soirée, des mille émotions que nous avons connues, et de l'amour que nous venons de faire. Et la douce fatigue qui s’empare du corps après le plaisir. Je les reconnais car ce sont les mêmes qui ralentissent mon corps et mon esprit. Notre complicité n’a jamais été aussi belle, notre bonheur aussi intense, notre amour aussi magique.
Dans la rue que notre manque de vigilance nous fait apparaître déserte, Jérém me plaque contre un mur et m’embrasse.
Après ce baiser d’amant amoureux, nous nous remettons à marcher. Nous n’avons fait que quelques dizaines de pas, lorsque j’entends quelqu’un venir dans notre dos avec un pas rapide. Je me retourne et je capte un type qui approche. Soudain, un frisson parcourt ma colonne vertébrale. Et s’il nous avait vus ? Et s’il avait reconnu Jérém ?
Alerté par mon geste, Jérém se retourne à son tour. Le type accélère encore le pas, visiblement dans l’intention de nous rejoindre. Il porte un pull à capuche, cette dernière remontée sur sa tête.
— Eh, les gars, il nous lance, vous avez une cigarette ?
Dans la pénombre du boulevard, le type me semble avoir une trentaine d’années. Instinctivement, quelque chose en lui me fait peur.
— J’ai arrêté de fumer, fait Jérém, lui aussi sur le qui-vive.
— Je ne fume pas, je lance à mon tour.
— Eh, dites, les gars, enchaîne le type sans transition, vous trouvez pas que ça sent mauvais par ici ?
— Quoi ? fait Jérém, décontenancé.
— Voyons… si, si, si, c’est bien ça, fait le type en faisant semblant de humer l’air… ça pue la tarlouze !
C’est à cet instant que la peur me glace. Une rafale de vent particulièrement violente semble annoncer la catastrophe qui arrive.
— Qu'est-ce que tu as dit, espèce de connard ?
— T’as bien entendu, espèce de fiotte. Je vous ai vus, les pédés, je vous ai vus vous embrasser ! Vous me dégoûtez !
— Tu veux que je te pète la gueule, espèce de grosse merde ? ! s’échauffe Jérém.
— Allez, Jérém, laisse tomber, on s’en va, on s’en va ! j’essaie de calmer le jeu, en retenant mon beau brun par l’avant-bras de toutes mes forces.
— Je ne crois pas, non, fait le type, avec un sourire effrayant.
Sans que nous les ayons vu arriver, distraits par l’altercation avec ce premier connard, quatre autres gars surgissent derrière nous, nous saisissent et nous entravent.
Je suis tétanisé de peur et je suis incapable d’opposer la moindre résistance. Mais Jérém se débat, leur crie de nous lâcher. Jusqu’à ce que le premier connard lui assène un coup sur la figure, d’une violence extrême.
— Ferme ta gueule, tarlouze !
Je ressens le bruit sourd du poing qui percute le nez de mon beau brun, jusqu’à dans mes tripes.
Soudain, un souvenir remonte à ma conscience. Celui d’une nuit en boîte de nuit à Toulouse où son t-shirt était éclaboussé de sang, mais pas le sien, celui d'un connard qui voulait s’en prendre à moi à cause d’un regard un peu insistant. Cette nuit-là, Jérém était arrivé au bon moment, et il avait mis une bonne raclée à ce connard.
Mais cette nuit, les forces du mal sont en nombre, et la bravoure de Jérém ne suffit pas. D’ailleurs, il a l’air bien sonné par ce premier coup de poing. Son t-shirt blanc est désormais parsemé de traînées écarlates, et c’est son sang qui continue à couler de son nez.
Nous sommes tous deux maîtrisés chacun par deux gars solides. Mais Jérém se débat comme un lion en cage et arrive à se dégager et même à rendre le poing dans la gueule au premier connard. Ce dernier, pris par surprise, est balayé par la violence du coup et fait un vol plané sur le goudron. Lorsqu’il se relève, il a le nez tout aussi en sang que Jérém.
Mais les deux autres ordures se jettent sur mon beau brun et arrivent à le maîtriser à nouveau.
— Espèce de sale pédé ! crie rageusement le premier connard en se tenant le nez en sang. Tu vas me le payer !
Puis, il se relève, s’approche de Jérém et commence à le frapper violemment.
Je voudrais trouver les mots pour me défendre, pour nous défendre, pour leur faire comprendre à quel point cette agression est injustifiée. Je voudrais trouver la force de leur dire que ce qui se passe entre Jérém et moi ne regarde personne d’autres que nous. Que le baiser auquel ils ont assisté, est un véritable baiser d’amour. Je voudrais leur parler de notre Amour. Je voudrais que notre amour arrive à les émouvoir.
Mais je sais instinctivement qu’aucun débat n’est possible avec ce genre d’énergumène. Que rien ne va les émouvoir. Alors, la peur, l’urgence, l’esprit de survie appellent des réactions épidermiques, suggèrent des mots que ce genre de cerveau malade est à mesure de recevoir. Et je crie de toutes mes forces :
— Lâche-le, espèce de fils de pute !
Je m’en fous de ce qui va arriver. Tout ce qui compte, c’est qu’il arrête de frapper Jérém.
Mes mots font leur effet. Le type, saisi par mes insultes, arrête de cogner Jérém.
— Qu’est-ce que t’as dit, espèce de sale tarlouze ? il me lance, dans un sifflement de serpent venimeux.
— Lâche-le, il ne t’a rien fait, je pleure. La peur me submerge. Mes nerfs lâchent.
— Elle fait la maline, la tafiole… et puis elle chiale de peur !
— Laisse-nous partir, espèce de connard !
— Nico arrête ! j’entends Jérém me crier.
— Si je comprends bien, lui c’est le mec et toi c'est la femme… dit-il en me regardant. Et tu es une pute prête à se sacrifier pour son homme… Toi, t’as bien l’air d’une chienne qui aime se la prendre bien profonde dans le cul… tu me dégoûtes encore plus que lui !
Le type me crache à la figure et me cogne en plein dans le nez. Une douleur atroce, insoutenable se diffuse sur mon visage. L’odeur et le goût de mon sang envahissent instantanément ma bouche.
— Laisse-le, espèce de merde ! j’entends Jérém crier.
— Attends un peu, je vais m’occuper un peu de ta copine, après il y en aura encore pour toi ! Tu ne perds rien pour attendre !
— Je vais enculer ta mère… et je vais enculer ton père ! j’entends alors Jérém hurler. Je suis sûr que ton père couine sa race quand il se prend une bonne queue dans le cul !
Je suis en état de choc, mais j’ai encore assez d’esprit pour comprendre ce que Jérém est en train de faire. Il essaie de détourner le sale type de moi. En provoquant le connard sur ce terrain particulièrement sensible, il prend tous les risques. J’ai peur, très peur.
— Non, Jérém, non ! je pleure.
— Toi, je vais te tuer !
Le sale connard se jette sur Jérém et recommence à le cogner avec une rage décuplée. Je crois qu’il va le tuer.
— Arrête, putain, on avait dit qu'on leur donnait juste une petite correction ! j’entends cracher l’un des types qui m’entravent. Arrête, tu vas le tuer !
Mais le premier connard continue de s'acharner sur Jérém, aveuglé par sa colère.
Soudain, je sens la prise sur mon bras gauche se dissiper. Le type qui vient de protester se jette sur le premier connard et essaie de le maîtriser.
— Lâche-moi, espèce de merde ! crie le sale type.
Un instant plus tard, j’entends d’autres cris. Quelqu’un arrive. Les cinq connards battent en retraite, ma deuxième entrave se dissipe, je m’effondre sur le goudron. Jérém, s’effondre lui aussi, complètement sonné.
Une petite foule accourt à notre secours. Certains s’arrêtent pour nous aider, d’autres coursent nos agresseurs. J’entends la voix d’Ulysse. J’entends la voix d’un autre gars qui dit :
— Je suis infirmier, je m’occupe d’eux, j’appelle les secours. Allez-y, chopez-les ! Ne les ratez pas !
Le jeune infirmier s’occupe très bien de nous. Le SAMU arrive assez rapidement. Du moins, c’est ce qu’on m’a dit. Car, lorsque le gars qu’on aime est à terre, en sang, après avoir été sauvagement agressé, chaque instant en attente des secours ressemble à une éternité.
Je ne sais pas comment j’ai tenu jusqu’ici. Mais là, tout mon corps lâche d’un coup. La douleur au visage me submerge. Mon esprit lâche lui aussi, terrassé par le choc, par la violence, par la peur de la mort qu’il vient de découvrir pendant l’agression. Et par la peur de connaître la gravité des blessures de Jérém. A vouloir me préserver, il a vraiment chargé, le pauvre.
Soudain, une image remonte à ma conscience. C’est une image d’il y a près de dix ans, l’image d’un petit con de 16 ans, un petit con à casquette à l’envers et au t-shirt noir, un petit con dans la cour du lycée, un petit con dont je suis instantanément tombé amoureux. Pas un seul instant ce jour-là j’aurais imaginé que cet adorable petit con sexy un jour me sauverait de cette façon si héroïque.
Un instant avant de perdre connaissance, je repense aux mots qu’Albert m’a dit un jour : « Être un homme, ce n’est pas avoir une femme, des gosses, un travail de mec et gagner de l’argent à la toque. Être un homme, c’est s’occuper des siens, avant toute chose ».
Je crois que cette nuit les évènements ont fait que nous avons été des Hommes.
Et puis, c’est le rideau noir.
Mardi 17 octobre 2006, 17h45, 16 heures après le désastre.
La première sensation qui vient à moi, c’est l’odeur des produits de nettoyage de l’hôpital. Puis, la douleur, à la tête, au visage. La bouche pâteuse. Les membres engourdis. Je suis dans le coltard.
Puis, des flash-backs comme des décharges électriques. Les souvenirs de l’agression me foudroient. Je revois Jérém en train de se faire tabasser, son t-shirt blanc désormais presque totalement rouge de son sang.
Jérém ! Où est-il ? Dans quel état est-il ? Il faut que je sache, là, sur le champ.
Je n’ai pas encore ouvert les yeux, mais j’entends des bruits, des voix, des échanges autour de moi.
Peu à peu, les voix deviennent familières, je reconnais celle de Maman, puis celle de Papa.
Et les images viennent en dernier. J’ouvre les paupières peu à peu, car la lumière est aveuglante, elle agresse mes rétines habituées au noir.
— Tu es réveillé, mon lapin ? s’exclame Maman, pleurant bruyamment sa joie de me voir revenir parmi les vivants.
J’essaie de parler, mais ma langue et ma mâchoire n’obéissent pas. Et pourtant, il le faut. Je dois arriver à parler, je dois demander des nouvelles de Jérém, je ne peux pas rester dans cette ignorance, dans cette angoisse qui ravage mon ventre. C’est au prix d’un effort considérable, presque surhumain, que j’arrive à articuler péniblement :
— Papa… Maman…
— Ça va mon lapin, tu as mal ?
— Je vais appeler une infirmière, j’entends Papa lancer.
— Ça va… je suis là, Maman…
— Tu nous as fait tellement peur !
— Maman…
— Oui, Nicolas…
— Jérém… est-ce qu’il est… vivant ?
— Oui, il est vivant, mais il est blessé.
— Il va tenir bon, hein ?
— Les médecins font tout ce qu’ils peuvent.
— Je veux le voir ! je lance, tout en essayant de me lever, alors que j’ai du mal à garder les paupières ouvertes et à articuler chaque mot, alors que ma tête tourne comme une toupie, alors qu’un marteau semble taper à l’intérieur sans relâche, alors que j’ai l’impression qu’elle va exploser.
— Non, Nicolas, ce n’est pas possible. Tu dois te reposer. De toute façon, ils ne laissent aller que la famille lui rendre visite.
— Je veux parler à son médecin !
— Je vais voir ce que je peux faire, mais c’est compliqué d’attraper les médecins ici, et puis ils ne parlent qu’à la famille.
— Son père et son frère sont là ?
— Oui.
— Va leur dire de venir me voir ! S’il te plaît, s’il te plaît !
— D’accord, d’accord Nicolas, mais reste calme, je t’en supplie.
Papa revient avec l’infirmière et un jeune et charmant médecin. Ce dernier me pose des questions, essaie d’évaluer mon degré de douleur pour doser les calmants. Il m’informe que mon nez n’est pas cassé, mais qu’il faut que je fasse attention.
— Je veux des nouvelles de Jérém ! je crie avec la faiblesse de mon souffle.
— Restez calme, Mr Sabathé, me glisse le jeune interne.
— Alain, tu peux aller voir le père de Jérémie et lui dire de passer voir Nicolas ? lance Maman à Papa.
— J’y vais ! s’empresse de répondre ce dernier, en quittant la chambre au pas de course.
Les deux soignants quittent la chambre à leur tour et je reste en tête à tête avec Maman.
— Qu’est-ce qu’ils t’ont fait mon lapin, elle pleure, laissant enfin s’exprimer toute sa peur, son angoisse retenue depuis des longues heures.
— Ça va, Maman, ça va, je tente de la rassurer d’une voix faible.
— Qu’est ce qui s’est passé ?
L’image du gars qui nous aborde, qui demande une cigarette, qui nous insulte, les quatre autres énergumènes qui débarquent et nous empoignent et nous traînent de force dans la petite rue, la peur, la douleur, les coups, l’odeur du sang. Et Jérém en train de se faire tabasser déchire mon esprit. Je n'ai rien pu faire pour l’aider. Je l'ai regardé se faire tabasser, c’était horrible, j’ai cru qu’ils allaient le tuer.
Il n’y a pas de mots pour décrire la peur que vous ressentez en voyant le gars de votre vie en train de se faire cogner, et ce pour la simple et bonne raison qu’il vous aime, que vous vous aimez. L’incompréhension qui vous envahit, et le sentiment d'impuissance aussi.
Les larmes montent à mes yeux, coulent sur mes joues. Si seulement on avait fait davantage gaffe…
— Ça va pas, mon lapin ?
Sur ce, Papa revient accompagné de M. Tommasi et de Maxime. Le petit brun vient m’embrasser, son papa me serre affectueusement la main. Les salutations se mélangent aux présentations. Ce n’est pas exactement de cette façon, dans une pareille occasion, que j’avais imaginé la rencontre de nos familles respectives. Mais l’urgence est ailleurs.
— Dites-moi comment va Jérém ! je m’impatiente au prix d’une recrudescence des coups de marteau piqueur dans la tête.
— Il a un paquet de côtes cassées, une épaule démise, et le nez cassé, m’explique M. Tommasi.
— Mais ça va aller, hein ?
— Bien sûr que ça va aller.
— Mon grand frère est un champion, un battant !
— Qu’est-ce qui s’est passé, Nico ? me lance M. Tommasi.
— On sortait de chez Ulysse après une soirée, et ces types nous sont tombés dessus.
— Parce que vous étiez ensemble ?
— On avait un peu bu, on rigolait et…
— Et ?
— Et… et… on… s’est… embrassés… je finis par admettre, dans les larmes.
— En pleine rue ? s’étonne M. Tommasi.
— On aurait dû faire davantage gaffe…
— Eh oh, c’est quoi ces raisonnements à la con ? me coupe Maxime. Alors, une fille qui porte une mini-jupe est un appel au viol et deux gars qui s’embrassent, c’est un appel au passage à tabac ? Mais on va où comme ça ? C’est plutôt ces sales types qui ont de la merde dans la tête ! Ils ont été bercés près du mur. Ou pas assez, en fait. Un coup un peu plus fort, et ils ne seraient pas là, et le monde se porterait d’autant mieux. Ce ne sont que de sales bâtards !
— Ces sales bâtards ont eu ce qu’ils méritaient, j’entends une nouvelle voix se glisser parmi celles de nos familles.
La vibration virile de sa voix a sonné comme une caresse pour mes oreilles et pour mon esprit. Cette voix de mâle, je la connais bien. Le beau blond Ulysse vient de pénétrer dans la chambre.
— On les a coursés et on a fini par en rattraper trois. Et je peux de dire qu’on n’y a pas été de main morte. J’en ai encore mal aux articulations de la main !
Je remarque que le demi de mêlée arbore un joli cocard à l’œil gauche.
— Comment tu as su…
— Après votre départ, je suis sorti pour aller rejoindre des potes. J’ai entendu les cris, et j’ai vu des gars qui couraient. J’ai compris qu’il se passait quelque chose, et j’ai suivi le mouvement. Et quand je vous ai vus par terre, en sang… putain… tu peux pas savoir comment je m’en suis voulu !
— Mais voulu de quoi ?
— Je ne sais pas, je ne sais pas, ça a été un tel choc…
— Ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont même pas des animaux ! rage Maxime.
— Ce sont des déchets, rien de plus, abonde Ulysse.
— Un coup de pelle sur la tête pour les achever, c’est tout ce qu’ils mériteraient, ajoute M. Tommasi.
— Ce qui me dégoûte aussi, c’est ce que racontent les journaux, continue Maxime. Jérém ne s’est pas fait agresser pour se faire voler, il s’est fait agresser parce qu’il aime Nico, et en plus il ne s’est pas fait agresser tout seul !
J’apprendrai plus tard que, coordonnée par l’agent de Jérém, la presse s’était donné le mot pour divulguer un narratif politiquement correct de l’agression. En gros, le récit officiel apprenait au grand public que Jérémie Tommasi, l’ailier vedette du Stade Français et du XV de France, avait été victime d’une agression à Paris. Que les malfrats s’en seraient pris à lui pour lui subtiliser sa carte bleue, sa montre de valeur et sa voiture sportive. Que le jeune rugbyman ne se serait pas laissé faire et il aurait été passé violemment à tabac. Et que, à la suite à ses blessures, il avait été hospitalisé dans un état sérieux.
Oui, j’apprendrai plus tard que la réalité est une matière fluide qu’on peut manipuler à sa guise. Les média, des alchimistes. Les directeurs de communication, des affabulateurs professionnels. Il n’est d’ailleurs fait aucune mention du fait que quelqu’un d’autre s’est fait tabasser avec lui. Moins on en dit, mieux la manipulation se porte.
— Hélas, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, confirme le beau blond. Il est plus important de garder les apparences que de faire évoluer les mentalités.
— Pour l’instant, ça c’est le cadet de nos soucis, fait M. Tommasi. L’important, maintenant, c’est que Jérém s’en sorte.
— Oui, l’important est que Jérém s’en sorte, considère Maxime. Mais faire évoluer les mentalités ne doit pas être le cadet de nos soucis. Si on ne parle pas de ce genre d’agression, on ne peut pas faire évoluer les choses. Et ça va arriver, encore et encore. J’espère que vous allez porter plainte ! il me lance.
Le lendemain matin, je suis autorisé à quitter l’hôpital. Et, grâce à l’intervention de M. Tommasi, je suis également autorisé à passer voir mon Jérém. C’est dur, c’est horrible de le voir allongé sur ce lit, immobile, le visage tuméfié, le nez caché par un gros pansement blanc. Si ce n’était pas grâce à ses cheveux bruns et ses tatouages, je ne le reconnaîtrais pas. Mon beau brun est conscient, mais assommé par les calmants. Je ne sais même pas s’il s’est rendu compte que je suis passé le voir.
— Je m’en veux tellement, tellement ! je pleure devant M. Tommasi.
— Tu n’as rien à te reprocher, Nico. Rien, du tout, tu m’entends ! Tu ne peux pas te reprocher d’aimer mon fils ! Maxime a raison, ce sont eux les coupables, eux et personne d’autre.
— S’il ne m’avait jamais croisé, il n’en serait pas là.
— Oui, c’est bien probable que s’il ne t’avait pas rencontré, il n’en serait pas là. Il est fort probable qu’il n’aurait pas appris à se connaître et à s’aimer, il est fort probable qu’il serait malheureux. Tu sais, Nico, avec les « si »…
Je culpabilise d’avoir qu’une blessure légère et que lui ait pris le gros des coups. Je culpabilise de ne pas avoir su le défendre comme il a su me défendre. L’idée que Jérém puisse endurer toutes ces conséquences de notre agression me donne le vertige. J’ai mal pour lui, j’ai mal d’avance. Son malheur à venir me hante déjà.
C’est horrible de penser que la gravité de ses blessures est en relation avec la puissance de son amour pour moi. Je sais que si ce gros bâtard s’est autant acharné sur lui, c’est parce que Jérém l’a cherché. Et je sais qu’il l’a cherché pour qu’il arrête de s’en prendre à moi. C’est une belle preuve d’amour. Dont je me serais franchement passé.
Un sentiment d’injustice, de haine, d’impuissance m’envahit devant ses blessures, encore plus que devant les miennes.
CINQ CONTRE DEUX, bande de sales lâches ! Visiblement en plus d'être intolérants, vous êtes aussi des lâches ! Mais vous savez quoi ? Vous pourrez frapper et encore frapper, vous ne nous empêcherez pas de nous aimer. Nous sommes peut-être des pédales, des tafioles comme vous dites, mais nous on n'attaque pas deux mecs à cinq.
J’aurais tellement voulu faire plus, épargner plus de coups à Jérém. Pourvu qu’il s’en sorte. Pourvu que sa carrière…
Maxime a raison. Pourquoi ce serait à nous de faire attention ? Est-ce qu’on a fait quelque chose de mal ? On essaie juste d’être heureux comme on l’entend. Est-ce que cela concerne quelqu’un d’autre que nous ? Il ne me semble pas. Alors, pourquoi tant de haine pour quelque chose qui ne concerne que nous ? Pourquoi tant de violence ? Quel est le délit qui justifierait cela ?
L’homosexualité n’est pas un choix, mais un état de choses. On naît homosexuel. C’est une caractéristique d’origine. C’est aussi naturel d’être homosexuel que d’être hétérosexuel.
L’homophobie, en revanche, ce n’est pas quelque chose de naturel. C’est culturel. En fait, non, même pas. L’homophobie est un ramassis de partis pris, d’ignorance, de manque d’empathie et, surtout, surtout, surtout, un manque absolu d’intelligence. La plupart des personnes ne savent même pas livrer les raisons pour lesquelles elles sont homophobes. Ou alors ce sont des raisons fallacieuses, sans fondement intellectuel. « C’est contre nature ». « Ça me dégoûte ». « Homosexuel = pédophile ». Voilà le top 3 des « arguments » des homophobes.
Ce ne sont pas les personnes homosexuelles qui ont un problème. Ce sont ceux qui pensent qu’ils peuvent décider de ce que les personnes homosexuelles ont le droit ou pas de faire.
En nous aimant, nous ne faisons de mal à personne, nous ne privons personne d’une quelconque liberté. Pourquoi notre liberté n’est pas respectée, n’est pas considérée comme étant légitime ?
Les homophobes n’agissent, ne luttent pas pour avoir plus de droits, mais pour que d’autres personnes n’en aient pas. C'est horrible de devoir se dire que juste parce qu'on est ce qu'on est, on se fait lyncher.
Papa et Maman sont évidemment déçus et inquiets que je ne rentre pas à Toulouse avec eux. Ça les aurait rassurés, ça leur aurait fait tellement plaisir de prendre soin de moi. Et ça m’aurait fait immensément plaisir aussi. Mais comment partir en laissant Jérém dans cet état ? C’est tout bonnement inenvisageable à mes yeux. Mais mes parents sont formidables, et ils comprennent mon choix.
Mon choix qui est celui d’accepter de bon cœur la proposition d’Ulysse de passer quelques jours chez lui en attendant de voir comment la situation de Jérém va évoluer. J’aurais pu m’installer dans l’appart de Jérém, mais il est déjà occupé par M. Tommasi et Maxime.
Pendant trois jours, Jérém est maintenu sous sédation. Pendant ces trois jours, je rumine, je broie du noir. J’ai peur. Peur que Jérém garde des séquelles. Peur de sa réaction si jamais ses blessures sont de nature à compromettre sa carrière. Il est presque certain que sa saison est foutue. Pourvu qu’il revienne à sa meilleure forme, pourvu qu’il revienne au rugby, à ses rêves, à son bonheur.
Quand je pense qu’il était le meilleur marqueur de points en ce début de saison et qu’il était populaire comme jamais. Qu’il était partout, dans les journaux, sportifs et de caniveau, et même à la télé. Quand je pense qu’on était heureux comme jamais.
C’est fou comme on peut tout perdre du jour au lendemain, en un instant. Pourvu que nous nous retrouvions après tout ça.
Le temps est très mauvais, il fait froid, et la pluie ne cesse de tomber, rendant Paris gris et austère. A moins que ce ne soit mon immense tristesse qui ait ôté toute couleur au présent. La présence de Maxime et de M. Tommasi, avec qui je déjeune chaque midi, me fait chaud au cœur. Tout comme celle d’Alice, la maman de Jérém, venue elle aussi au chevet de son aîné. Ou celle de Thibault, accouru lui aussi auprès de son pote de toujours.
Mais leur proximité n’enlève rien à la peur, à l’angoisse. Pendant trois jours, je vais voir Jérém à l’hôpital. Pendant trois jours, je me retiens de pleurer devant son visage méconnaissable, devant son manque de réactions, conséquence d’une lourde sédation, avant de fondre en larmes une fois dans le couloir du service.
Pendant trois jours, je lui parle. Je lui raconte notre histoire, depuis nos révisions dans l’appart de la rue de la Colombette, en passant par nos disputes, par notre accrochage dans la maison de mes parents, par les retrouvailles à Campan. Je lui dis à quel point il m’a manqué pendant les premiers mois de son aménagement à Paris, à quel point nos éloignements et nos ruptures ont été difficiles pour moi. Je lui parle de mon bonheur d’avoir pu être à ses côtés pendant l’épreuve qu’a été son accident au rugby. Et de celui, encore plus grand, des derniers mois, où plus rien semblait pouvoir atteindre notre amour. Je lui parle de nos voyages, en Italie, à l’Ile de Ré, en Islande, au Québec, dans le Gers, dans le Nord.
— Nous avons encore tant de choses à vivre ensemble. Tu as encore tant de matches à jouer, tant de boucliers de Brennus à soulever !
Au bout de trois jours, sa sédation est progressivement levée, et le beau brun revient enfin à lui. Il me faudra attendre le lendemain soir pour qu’il retrouve ses esprits.
Mais même une grosse journée après l’arrêt des calmants, Jérém demeure sonné, et il n’arrive presque pas à parler. Il a l’air vraiment fatigué. Et inquiet. J’essaie de l’apaiser, je glisse mes doigts dans ses cheveux, je pose un bisou léger sur son front. J’essaie de le câliner discrètement, mais je sens qu’il est mal à l’aise. Il est nerveux. L’infirmière qui vient vérifier sa perfusion finit par me prier de partir et de revenir le lendemain.
Ironie du sort, c’est ce même jour que le nouveau calendrier des Dieux du Stade débarque dans les librairies et autres kiosques à journaux. Ironie encore plus grande, le jeune ailier qui est depuis quelques jours dans la presse non pas à cause de ses exploits mais suite à son agression, fait carrément la couverture de cette nouvelle édition, chose que j’ignorais car il ne m’en avait pas parlé. J’imagine qu’il voulait me faire la surprise, et guetter ma réaction à chaud.
Le cliché, en noir et blanc avec un soupçon de chromatisme sépia, est tout bonnement à se damner.
Ironie presque absurde, cruelle, sur cette photo, Jérém y est magnifique comme sur aucune autre auparavant, et c’est pas peu dire. Il se dégage de cette photo une beauté, une puissance, une virilité, une jeunesse, une insolence, une attitude de jeune loup assuré, une sensualité, un regard brun illuminé d’un début de sourire qui feraient s’émoustiller un bloc de granit. Ce n’est pas un hasard si elle a été choisie pour paraître en couverture.
Sur cette couverture, Jérém y est somptueux, de beauté, de jeunesse, d’effronterie, d’assurance. Le torse, hélas rasé, et pourtant spectaculaire, les pecs, les tétons, les biceps, les abdos, les plis de l’aine, tout est saillant, à la fois délicieusement solide et parfaitement harmonieux, merveilleusement dessiné, divinement sculpté.
Mais c’est son attitude qui met le coup de grâce à la santé mentale de l’observateur. Le buste légèrement incliné et pivoté vers sa droite, la tête insolemment relevée, la mèche rebelle, un soupçon de barbe négligée et insupportablement sexy, les lèvres entrouvertes, le regard de b(r)aise bien planté dans l’axe de l’objectif. Et dans ses yeux, un sourire léger, pétillant d’une insistante étincelle lubrique. Toute son attitude dégage une sensualité torride.
Et encore, c’est sans compter avec le geste esquissé par sa main droite, par cet élastique de boxer blanc pincé entre le pouce et l’index, écarté de la hanche, une insoutenable invitation à glisser le regard et la main dedans, une pure incitation au délit. Un délit que la belle bosse dessinée par la poche du boxer rend carrément inéluctable.
Une attitude et une beauté d’une insolence rare, inégalable. Nous sommes là en présence d’un petit Dieu, un somptueux Dieu mâle à la sensualité radioactive.
Devant une telle image, il est impossible de ne pas avoir l’impression d’avoir un tambour de machine à laver en mode essorage dans le ventre. On ne peut pas regarder cette image sans avoir envie de se mettre à genoux. On ne peut regarder cette photo que d’une seule main.
C’est au mois de mars que je retrouve le boblond Ulysse. Je le retrouve en compagnie d’un « invité », non pas un rugbyman, mais un footballeur. Le demi de mêlée y apparaît dans toute sa splendeur, avec sa blondeur aveuglante, ses beaux cheveux, sa belle barbe virile, son regard clair, à la fois doux et furieusement viril. Quant au footballeur, il est brun, barbu lui aussi, le regard ténébreux dégageant quelque chose de sauvage, d’animal, de macho, de furieusement viril. Dans une certaine mesure, il me fait penser au magnifique bipède à casquette croisé dans le parc du Mont Riding.
Les deux sportifs sont torse nu, le beau blond, de profil par rapport à l’objectif, enlace le beau brun dans le dos, l’avant-bras du premier abandonné sur l’épaule de l’autre. Ils sont assis, ce qui fait que les épaules d’Ulysse partent un peu vers l’avant, et que son torse s’en trouve légèrement contracté. Et pourtant, malgré cette position peu propice à mettre en valeur la plastique masculine, ses pecs et ses abdos demeurent fabuleusement tendus.
Le bel invité est positionné de trois quarts, tous pecs et abdos tendus lui aussi. Le regard de glace du rugbyman et le regard de braise du footballeur pénétrant doublement l’objectif, et nourrissent et le fantasme du spectateur. Comment ne pas imaginer, en regardant cette photo, puisque c’est si bien suggéré par la mise en scène, les deux superbes mâles dans un pieu ? Comment ne pas ressentir ce petit vent, cette sensation d’apesanteur qui happe l'esprit, le vertige, le même qui nous vrille l'esprit en essayant d'imaginer l'infinité de l'Univers, quand on essaie d'imaginer qui prendrait possession de l'autre ?
Dans une autre photo, Ulysse est photographié seul, assis, les cuisses écartées, l’avant-bras et la main couvrant sa virilité, l’autre bras levé au-dessus de sa tête, appuyé contre un mur recouvert d’un drap blanc. Une position qui fait étirer son pec gauche, remonter son téton, découvrir la délicieuse pilosité de son aisselle. Le regard bien planté dans l’objectif, il est beau comme un Dieu Viking.
Inutile de chercher mon beau brun à travers les mois de l’année 2007. En effet, Jérém est l’Alpha et l’Omega de cette édition du Calendrier des Dieux du Stade.
Je retrouve mon bobrun dans la dernière de couverture, seul, dans une photo en noir et blanc magnifique. Le jeune ailier y figure allongé sur une serviette, positionné dans la diagonale du cadre, dans son plus simple appareil, le bras gauche relevé et replié pour que sa main puisse soutenir sa tête, l’aisselle poilue au premier plan, le visage tourné vers son biceps, le regard un brin lascif bien offert à l’objectif.
Et son torse – putain ! – avec ces pecs saillants recouverts de cette pilosité brune naturelle si furieusement sexy ! Visiblement, cette photo a été réalisée avant celle de couverture, avant que la lame d’un rasoir ne commette l’irréparable. La limite inférieure de la photo coupe juste en dessous de son pubis, de cette pilosité brune qui part de son nombril et se diffuse autour de sa queue et de ses couilles. Sa main droite est délicatement posée sur ses attributs, mais laisse apprécier une vaste portion de pilosité virile.
Entre les deux couvertures, on découvre ainsi deux facettes de la beauté insolente de mon Jérém. La beauté pure, et la beauté sensuelle.
Ironie du sort, oui, cruelle ironie. Quand je pense que le sujet de ces superbes clichés gît sur ce lit d’hôpital, avec sa belle petite gueule défigurée par de gros hématomes et cet immense pansement au nez, avec des fractures multiples et son avenir en suspens, j’ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps.
Le lendemain, Jérém est plus alerte. Il arrive à articuler davantage. Apparemment, il n’a pas gardé de séquelles mentales. Mais il n’a visiblement aucune envie de taper la discute. Car son moral est plus bas que terre. Il sait désormais que ses saisons en Top14 et en H Cup sont largement compromises. Il mesure également l’effort que va lui demander de revenir une nouvelle fois au top de sa forme après des semaines, des mois de convalescence.
Contrairement à mes craintes, il ne se montre pas particulièrement de mauvaise humeur. Il est juste absent, sans réaction, comme s’il retenait son souffle. Son regard brun se perd au-delà des vitres de la fenêtre, dans la grisaille peu engageante du ciel parisien de ce début d’automne. Ce qui me fait le plus mal, c’est que son regard brun est éteint. Je préférerais encore le voir fulminer, enrager.
Je me dis que ça doit être sa façon de gérer le traumatisme psychique. Je me sens moi-même comme vidé depuis l’agression. Je me sens anxieux, j’ai régulièrement des moments d’angoisse, et de soudaines chutes de moral. Parfois, j’ai du mal à retenir mes larmes. Le moindre bruit inconnu et un peu violent me fait sursauter. Des images de notre agression surgissent dans mon esprit sans prévenir, à toute heure. J’ai l’impression de sentir à nouveau la violence et le bruit des coups, l’odeur du sang, la peur qu’ils nous tuent. A part dans l’appart d’Ulysse, la porte d’entrée fermée à double tour, j’ai l’impression de n’être en sécurité nulle part.
Je trouve mon beau brun horriblement distant. Et même si je comprends son état d’esprit, l’ambiance que cela installe ajoute du malaise et de la tristesse à ma souffrance. J’aimerais tellement le prendre dans mes bras, partager nos angoisses, nos larmes, nos colères. Mais tout cela paraît tout simplement impossible.
Oui, je me dis que l’air absent et le mutisme de Jérém doivent être ses façons à lui de gérer son traumatisme. Mais tout ce silence m’angoisse. J’essaie alors de lui parler, mais j’ai l’impression de le déranger. L’agression est évidemment un sujet tabou. Le rugby en est un autre. L’avenir, le pire de tous. Evoquer le souvenir de nos jours heureux, j’ai essayé. Il ne réagit pas. Pas un mot, pas un regard. J’ai même l’impression de l’emmerder. Au bout d’un certain temps, il prétend être fatigué et me demande de le laisser tranquille.
— Je voudrais aller porter plainte contre ces types, je lui glisse avant de quitter sa chambre.
— Ne fais pas ça ! il me balance du tac-au-tac, en se sortant illico de son mutisme, sa voix oscillant entre peur et angoisse.
— Pourquoi tu ne veux pas porter plainte ?
— T’imagines si ça se sait ?
— Tu parles du fait qu’on a été agressés parce qu’on est homo ?
— C’est déjà assez dur comme ça, Nico, n’en rajoute pas s’il te plaît ! Si ça se sait, plus personne ne me respectera, personne. Je ne serai qu’une merde !
— C’est pas toi qui est une merde, c’est pas nous, ce sont eux, les merdes !
— Si tu portes plainte, tu vas être obligé de parler de moi, et ils vont vouloir m’entendre aussi. La presse va s’en mêler et ça va être un désastre. Je ne veux pas affronter ça ! Ne me fais pas ça, Nico, ne me fais pas ça !
— Mais Jérém…
— En plus, si tu portes plainte, tu risques de foutre Ulysse dans la merde. Si les mecs se font choper et qu’ils disent qu’ils se sont fait tabasser par un joueur connu, il va avoir de gros problèmes. Laisse-lui terminer sa carrière sans accrocs, s’il te plaît, il ne mérite pas d’avoir des ennuis. Il a fait ce qu’il fallait, il les a chopés et il leur a mis une bonne raclée, c’est tout ce que comprennent ces types. Et puis, mon agent a menti à la direction. C’est lui qui a inventé l’histoire du vol. S’ils apprennent qu’il a menti, il va passer pour qui ? Et moi, je vais passer pour quoi ?
— Et s’ils recommencent ? Et s’ils s’en prennent à d’autres gars comme nous, tu as pensé à ça ?
— Si c’est pas eux qui recommencent, ce seront d’autres…
— Alors quoi, on laisse faire ?
— Ils se sont fait défoncer la gueule, ils vont réfléchir deux fois avant de recommencer.
— Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Quand on est con à ce stade, on l’est pour la vie ! Tu sais, quand les secours sont arrivés, j’ai entendu un pompier dire que ce genre d’agression « ce sont malheureusement des choses qui arrivent ». Non, ce genre de choses ne doit pas être banalisé. Ces choses ne doivent plus arriver ! La haine ne doit pas être tolérée !
— Ecoute-moi, Nico, je vais déjà en prendre plein la gueule comme ça, alors, ça suffit !
C’est à contre-cœur que je consens à sa demande, je ne veux pas lui infliger ça en plus de ses angoisses. Non, je ne porterai pas plainte. Et ce crime restera impuni. La presse complice, aux yeux de la justice, il n’aura même pas existé.Hello toi qui viens de lire cet épisode !
Une remarque, un commentaire?
N'hésite pas à t'exprimer !
Fabien
 15 commentaires
15 commentaires
-
Par fab75du31 le 27 Janvier 2023 à 23:04
Lundi 26 juillet 2004.
C’est aujourd’hui que les vacances prennent fin pour Jérém. C’est là que nous allons nous séparer physiquement. L’ailier vedette du Stade Français reprend les entraînements dès demain. Il est également attendu en fin de semaine pour un rendez-vous très important. Quant à moi, je vais rester à Toulouse pour passer quelques jours chez mes parents, pour revoir Elodie, et peut être Julien et Thibault. Je sais déjà que ça va être dur d’être loin de Jérém après ces nouvelles vacances de bonheur.
Vendredi 30 juillet 2004.
[Le shooting photo que tu redoutais depuis des semaines se passe dans un studio en plein Paris. Tu n’es pas à l’aise avec ça, Jérémie.
Bien sûr, tu as l’habitude de la nudité, la tienne, celle de tes potes. Mais uniquement dans un contexte bien précis, celui des vestiaires et des douches. C’est une nudité que tu considères comme « naturelle ». Tu es tout aussi à l’aise avec la nudité sensuelle. Tu n’as jamais eu de mal à te foutre à poil quand tu te sentais désiré.
En revanche, sortir ta bite pour prendre la pose devant toute une équipe de production, ça c’est une tout autre chose. Rester des heures à poil devant des photographes, des éclairagistes, des étalonneurs, des directeurs de production, tu as vraiment du mal avec ça.
On te l’a proposé, tu n’as pas pu dire non. Car la plupart de tes coéquipiers a dit oui. Certains n’en sont pas à leur premier essai. A l’instar d’Ulysse. Tu te dis que refuser ce serait te faire remarquer, avouer que tu as quelque chose à cacher.
Mais le fait est que tu as quelque chose à cacher. Ton attirance pour les garçons. Tu as vu les photos des précédentes éditions, et ce que tu redoutes le plus c’est que l’on te demande de faire des clichés de promiscuité entre joueurs, sous les douches, dans les vestiaires. Tu as peur de bander.
Tu as peur de te trahir, tu as peur que ça se voit que tu es gay. Tu as peur d’être ridicule sur les photos. D’ailleurs, tu te sens déjà ridicule, tu as envie de tout planter et de te tirer de là. Ce n’est que grâce à la présence rassurante d’Ulysse et de celle de Thibault, lui aussi invité à rejoindre les Dieux du Stade pour cette nouvelle édition, que tu arrives à tenir jusqu’au bout.
A la fin de cette longue journée, tu es rincé. Tu n’as qu’une envie, celle de te doucher et de fumer un joint pour te détendre].
— Alors, c’était comment ? j’interroge mon beau brun le soir même.
— C’était interminable. J’étais pas à l’aise.
— T’as fait beaucoup de photos ?
— Des dizaines, des centaines ! Ça bombardait dans tous les sens !
— Mais c’est un calendrier Dieux du Stade ou un calendrier Tommasi ?
— Moque-toi ! J’aurais bien voulu te voir à ma place !
— T’as qu’à pas être si sex, ils ne t’auraient pas proposé de faire le calendrier !
— Ah ah, très drôle !
— Blagues à part, tu as eu ton mot à dire pour les photos ?
— Oh, putain, ça, ça a été le plus dur… remater toutes les planches et trier les photos une à une, me revoir à poil avec dix autres personnes qui faisaient des commentaires sur ma pose, ma gueule, ma bite, mon cul !
— Mais ils t’ont laissé participer au choix des photos ?
— Oui, j’ai validé chaque photo qui va paraître.
— Mais tu vas être sur combien de photos ?
— Trois, a priori.
— Ah, quand-même !
— Une, seul, une avec Ulysse, une avec Thibault.
J’ai hâte de découvrir les photos.
Août avance et je commence à penser à ma rentrée. Après avoir validé ma Licence en Sciences de la Terre et de l’Environnement en juin dernier, j’ai choisi de suivre un Master Environnement, toujours à Bordeaux. Ces deux années d’études supplémentaires me permettront d’aborder plus spécifiquement la question de l’eau, le sujet autour duquel je sens désormais vouloir orienter ma future carrière professionnelle. J’ai toujours été fasciné par la gestion de l'eau et sa préservation, l’une des plus importantes, si ce n’est la plus importante, de notre planète. J’ai un béguin tout particulier pour la Garonne, et je sens que j’ai envie de travailler avec elle, pour elle.
Avant de repartir à Bordeaux, je passe quelques jours chez mes parents. Je suis bien à la maison. Papa me questionne sur mes études et mes projets futurs, je lui parle de ma fascination pour l’eau et des premières idées d’avenir professionnel qui commencent à germer dans ma tête. Il a l’air fier de moi.
Je profite de mes journées pour revoir ma cousine Elodie et partager nos bonheurs. Moi, celui d’amoureux comblé, elle, celui de maman heureuse. La petite Lucie va bientôt fêter sa première année. Le temps passe si vite. Je lui parle de la préparation de mon voyage à Lisbonne en septembre pour aller assister au concert de Madonna, et je lui exprime mon regret de ne pas pouvoir partager ce nouveau spectacle avec elle.
— Si je pouvais, je viendrais avec plaisir ! Mais Lucie est encore trop petite, je ne peux pas la laisser, elle me répète.
— Je comprends, je comprends, t’en fais pas.
— Ce n’est que partie remise.
— J’espère bien !
— Tu penseras à moi quand tu te déchaîneras comme une folle à lier ?
— Bien sûr, je danserai pour toi aussi !
Je revois Thibault après son retour de Paris. Nous allons dîner en ville. Pendant le repas, le beau pompier me confirme le côté éprouvant du shooting pour le calendrier.
— Je crois que c’est la première et dernière fois que je me laisse embarquer là-dedans !
— A vrai dire, j’ai été étonné d’apprendre que tu avais accepté. J’ai toujours eu l’impression que tu es quelqu’un d’assez pudique…
— Je le suis. Mais je n’ai pas pu refuser. Les organisateurs voulaient un cliché de Jérém et de moi, les « Toulousains », comme ils nous appellent dans le milieu, et ma direction voulait à tout prix un joueur du Stade Toulousain sur le calendrier. Alors, ils ont fait pression jusqu’à ce que je cède. J’ai pas fini de me faire charrier par mes potes…
— Les « frères ennemis du rugby français », c’est comme ça que certains journaux ont titré au sujet de Jérém et de toi après la dernière rencontre entre les deux Stades…
— Ouais, ils aiment bien se gargariser de mots à la con !
Le jeune papa se languit du petit Lucas qui est avec sa maman pendant deux semaines.
— Je n’arrive pas à croire qu’il a déjà presque deux ans et demi !
— Il te rend heureux, ce gosse, je considère.
— Très heureux. Mais entre les entraînements, les matches du week-end et les pompiers, je ne le vois pas autant que je voudrais. Je n’arrive même pas à le prendre chaque jour de ma garde. Heureusement que Nathalie est arrangeante et que ses parents nous aident. On m’a proposé d’intégrer le XV de France, mais je crois que je vais dire non. J’aimerais bien, mais je ne peux pas être partout.
— Sérieux ? Tu vas dire non ? Il y en a qui ne rêvent que de ça.
— Tu sais, pour moi le rugby c’est avant tout une façon pour m’amuser et avoir des potes. La gloire, la carrière, la lumière, très peu pour moi. Quand ça devient trop sérieux, quand les enjeux sont trop grands, quand il y a trop de stress, quand il faut gagner à tout prix, je ne m’amuse plus. Déjà en championnat c’est dur. J’imagine en équipe nationale ! Et puis, si j’accepte, je vais devoir renoncer à mon engagement auprès des pompiers, ou bien voir Lucas encore moins. Et ça, c’est hors de question. On ne vit qu’une fois, et il ne faut jamais perdre de vue ses véritables priorités.
— Je comprends, et j’admire ta détermination.
— Je fais ce que je ressens là-dedans… fait le beau pompier en portant sa main sur le cœur.
— Là-dedans, il y a un grand cœur, je considère, et cela te rend un bon gars. Je t’admire beaucoup, Thibault.
— Arrête, tu vas me faire chialer !
— Et ton médecin ? je change de sujet pour évacuer l’émotion avant qu’elle ne se transforme en larmes.
— Lui aussi me rend heureux. Nous arrivons à nous voir un peu plus souvent. J’ai l’impression qu’il tient vraiment à moi.
— Comment pourrait-il en être autrement ? Tu es un garçon tellement attachant !
— Merci, Nico, tu l’es aussi.
Malheureusement, Julien n’étant pas en ville en ce moment, je n’ai pas le plaisir de le retrouver. Pour lui aussi, comme pour Elodie, ce n’est que partie remise.
Août 2004.
Août arrive, et le championnat de rugby reprend aussitôt. Lors de la 1ère journée du Top 16, le Stade Français remporte haut la main le match contre Bayonne.
Août se termine, septembre arrive. Et avec lui, les prémices de l’automne. Des journées qui raccourcissent, des soirées qui se rafraîchissent. Et des souvenirs qui remontent. Comme celui de nos retrouvailles à Campan. C’était il y a deux ans, sous la grande halle en pierre, sous une pluie battante. Il y a deux ans, Jérém m’embrassait pour la toute première fois. Je me souviens toujours de la tête de la dame qui avait traversé la halle pendant nos effusions, je me souviens de son regard accusateur, et je me souviens de la réaction de Jérém.
« Qu’est-ce qu’il y a, t’as jamais embrassé personne ? » il l’avait ramenée, railleur.
Oui, il y a deux ans je découvrais les randonnées à cheval dans la nature, je faisais la connaissance de Charlène, JP, Martine, Daniel et sa guitare, de la folle ambiance des soirées au relais avec les cavaliers.
Je faisais la connaissance d’un Jérém tellement différent du petit con de Toulouse, un Jérém « nature », dont je découvrais les racines, solidement ancrées dans ce petit village de montagne.
Septembre, c’est aussi le triste souvenir du 11 septembre. Et celui tout aussi triste du 21 septembre. La télé se charge de le rappeler dans de nombreuses émissions et reportages. Toulouse, New York et leurs habitants meurtris soignent toujours leurs stigmates.
Mardi 14 septembre 2004.
Ce soir, à 21h30, le Pavilhão Atlantico de Lisbonne frémit de l’impatience des 30.000 fans venus applaudir leur Star pour la toute dernière date du Reinvention Tour.
C’est bon de se retrouver entre gens qui partagent une même passion, une même admiration, pour qui Madonna représente une telle icone, un personnage qui porte un message de tolérance, d’ouverture, d’affirmation de soi, de progrès des droits pour tout un chacun.
Ça fait plus de six mois que j’ai acheté le ticket, six mois que j’attends cet instant, trois mois que mon impatience monte au gré des enregistrements audio, des très belles photos, et parfois même des vidéos – ces dernières en basse qualité, certes, mais néanmoins bien alléchantes – faisant surface sur le net après chaque date. Et maintenant que j’y suis, que le grand jour est arrivé, je me surprends à ressentir un petit pincement au cœur du fait que l’attente se termine déjà, et que cette tournée touche déjà à sa fin.
Un autre pincement au cœur me vient du fait que ma cousine n’est pas là pour partager ce moment avec moi. Jamais autant que ce soir je n’avais senti que le bon vieux temps entre Elodie et moi était définitivement révolu. Au fond de moi, je sais que ce n’est pas que partie remise. Je sais que celui de 2001 restera à tout jamais le seul concert de Madonna que j’ai partagé et que je partagerai avec elle.
Et ce, pour la simple et bonne raison que l’Elodie que j’ai toujours connue, la nana espiègle, cash et un tantinet fofolle n’existe plus. Elle a été remplacée par une épouse aimante et une maman comblée, qui n’a plus le temps pour les délires d’antan.
Le concert est à la hauteur de mes attentes, il les dépasse même. Madonna est dans une forme exceptionnelle, elle est resplendissante. Les écrans géants coiffent la totalité de l’immense scène, les moyens mis en œuvre sont du jamais vu. Les titres du dernier album sont mis à l’honneur à côté des nouvelles versions de ses titres phares. Les costumes, son look, les tableaux, les chorégraphies, tout est à tomber. Ce spectacle est de loin le plus grandiose de sa carrière. Et pourtant, cette débauche de moyens et de démesure sera encore largement dépassée deux ans plus tard.
Je sors de près de deux heures de spectacle comme abasourdi. J’en ai pris plein la tronche, et je sens que mon estime et mon amour pour cette immense artiste n’a jamais été si grand. C’était une formidable façon de fêter mon anniversaire en avance d’un jour. Merci Madonna !
Vraiment dommage de n’avoir pas pu partager ça avec Elodie. Ou Jérém.
Mercredi 15 septembre 2004.
Je suis tout juste rentré, et pas encore tout à fait remis de mon escapade lisboète, lorsque mon anniversaire tombe. Aujourd’hui, j’ai 22 ans. Au fond de moi, ça fait des semaines que je pense à ce jour et à comment j’aimerais le fêter. J’y ai tellement pensé, que je serais vraiment déçu que ça se passe autrement.
Et ça ne se passe pas autrement. A 17 heures je suis à l’appart, je finis le ménage, je me douche, je me mets sur mon 31. A 18h15 ma sonnette retentit. Je sais que c’est lui. J’ouvre le portail sans même demander qui c’est. J’ouvre ma porte et je vois Jérém avancer dans le passage qui sépare le grand portail et la petite cour au sol rouge.
— Bonjour M. Tommasi, j’entends Denis lancer de sa loge-tour de contrôle.
— Bonjour Monsieur !
Le beau brun avance vers moi, lui aussi sur son 31, belle chemise bleue ouverte juste ce qu’il faut sur ses pecs saillants et délicieusement poilus, belle crinière brune légèrement plus longue que d’ordinaire. Et un sourire, putain, un sourire qui ferait fondre le soleil lui-même, un sourire qui contient à mes yeux toute la beauté de l’Univers.
Je suis sur le seuil de ma porte et Jérém s’arrête juste devant moi, tout près de moi, son nez à dix centimètres du mien. Il me fixe pendant deux ou trois secondes, puis m’embrasse avec une fougue intense.
— Ah putain, qu’est-ce qu’ils sont chauds ces jeunots ! j’entends Albert lancer, alors que Jérém me pousse à l’intérieur et claque la porte derrière nous.
Le lendemain, jeudi, Jérém repart de bonne heure. Il est évident que je ne peux pas le laisser partir sans lui offrir une dernière pipe pour la route, sans m’offrir une dernière fois le goût de son jus, le goût du bonheur.
Ce jeudi est également le jour de ma rentrée. Le début d’une nouvelle phase de ma vie d’étudiant. Dans ce nouveau cursus, mon seul repère est Monica, la seule de mon groupe à avoir choisi le même Master que moi. Je suis un peu triste de ne pas retrouver mon pote Raphaël, parti terminer ses études dans une autre ville. Hélas, la vie c’est ça aussi. Après de belles rencontres, parfois les chemins se séparent.
Samedi 16 octobre 2004.
Aujourd’hui, Jérém a 23 ans. Et le jour de son anniversaire, il est amené à jouer l’un des matches les plus difficiles et éreintants de sa carrière. La rencontre Castres-Stade Français se solde par un score de 7-7 où chaque point a été arraché dans la transpiration, l’effort et le sang.
Après deux mi-temps épiques et une troisième pourtant sensiblement écourtée, mon beau brun rentre à l’appart complètement HS. Ce soir-là, il n’a même pas le courage de me faire l’amour. J’essaie de le sucer, mais sa queue ne répond pas. Tant pis, le câlin suffira pour cette nuit.
Après une bonne nuit de sommeil et une douche, avant de partir retrouver ses coéquipiers pour le débrief du match de la veille, le beau rugbyman au t-shirt blanc viendra prendre possession de mon cul et lui gicler dedans comme il se doit.
Fin octobre, le calendrier le plus attendu de l’année sort enfin. L’ouvrage fait son apparition dans les vitrines des libraires et dans les kiosques à journaux. Une apparition fracassante, c’est peu de le dire. Et ce, dès la couverture, Avec une entrée en matière très alléchante.
En effet, elle comporte le cliché d’un mâle bien connu, l’un des deux demis de mêlée les plus canons du Top16, le boblond au regard de glace, j’ai nommé le somptueux Ulysse.
Le coéquipier de Jérém y est photographié débout, avec un cadrage du buste, torse nu, tous pecs, tétons, biceps et abdos dehors, tenant un ballon ovale contre sa hanche. Le torse légèrement penché vers la gauche, la tête légèrement penchée vers la droite, le regard en plein dans l’axe de l’objectif. C’est un regard clair comme la glace, pénétrant. Un regard qui happe les regards, qui hypnotise. Une attitude assurée, mais sans excès, sans ajouts, tout ce qu’il y a de plus naturellement viril. Il y a à la fois une telle douceur et une telle puissance dans ce regard, que ça a de quoi rendre dingue.
Inutile à ce stade d’en rajouter en mentionnant ses cheveux un peu plus courts que d’habitude, sa belle barbe blonde toujours aussi fournie et soignée, le pli de l’aine qui part du ballon et se perd dans la limite inférieure de la photo, obligeant le spectateur à côtoyer la folie en imaginant la suite, maudit cadrage, tout comme celle de la délicieuse ligne de poils qui descend de son nombril, seule pilosité de ce corps parfait. Oui, inutile d’en mentionner plus, la raison s’est déjà fait la malle depuis belle lurette.
Le noir et blanc déchire, il permet de se concentrer encore plus sur les lignes, les reliefs, les formes. Pas étonnant que cette photo ait été choisie comme couverture. Avec un aperçu de ce type, cette édition du calendrier va se vendre comme des petits pains. Franchement, rien que la couverture, ça promet un grand cru.
Jérém m’a promis de m’en avoir une copie, mais je ne peux pas attendre pour découvrir ses clichés. Dans une librairie du centre, je feuillète le calendrier les mains tremblantes, le cœur en fibrillation, débordant d’excitation, d’impatience, mais aussi de malaise de le faire dans une grande allée où des gens circulent.
Janvier, février, l’année 2005 défile à toute vitesse sur le papier glacé. C’est en avril que le premier choc m’attend. Le premier d’une série.
Jérém est là. Le bobrun est lui aussi photographié débout. Le cadre est un peu plus élargi que celui d’Ulysse, car il descend jusqu’aux genoux. Jérém est également torse nu, tous pecs, poils bruns, tétons, biceps et abdos (et tatouages) dehors, comment pourrait-il en être autrement ?
Mais au-delà de sa beauté presque surnaturelle, c’est son attitude qui happe le regard et embrase l’esprit.
La tête penchée vers la droite et légèrement vers l’arrière, le regard charmeur, séducteur même, déjà ça suffirait pour que la raison abdique en faveur d’un désir incontrôlable. Mais la mise en scène va bien au-delà. Comment recevoir l’image de sa main droite posée sur sa cuisse, de la gauche cachant délicatement sa queue, et laissant pourtant entrevoir non seulement sa belle pilosité brune pubienne, mais aussi et surtout le côté droit du galbe de ses bourses ? Comment recevoir ces détails, cette pose, si ce n’est comme une provocation savamment étudiée, une attaque frontale à la santé mentale ?
Cette attitude me fait penser au Jérém le jour de notre première révision, quand il s’était levé et qu’il m’avait commandé de le sucer.
Son attitude dégage un érotisme brûlant, car c’est celle d’un garçon sulfureux. A l’évidence, la direction artistique du calendrier semble œuvrer pour lui coller cette image. Et il faut dire que le bobrun toulousain possède la belle petite gueule, le corps, la prestance et l’insolence de l’emploi.
Après ça, en sachant qu’il reste deux photos à découvrir de mon bobrun, continuer à feuilleter ce calendrier peut ressembler à une opération très risquée. Et pourtant, je m’y aventure, au péril de voir mes derniers neurones griller l’un après l’autre à cause d’une exposition trop prolongée à la bogossitude.
Jérém n’apparaît dans aucun autre mois. Il apparaît en revanche dans des pages bonus qui séparent chaque mois du suivant. Le deuxième choc est provoqué par la photo avec Thibault.
Thibault, à gauche de l’image, est pris de face, Jérém à droite, est pris de dos. Les deux potes sont photographiés dans l’eau. Le niveau de l’eau est malicieusement calculé pour permettre de voir les poils pubiens du demi de mêlée du Stade Toulousain, et le haut des belles fesses musclées de l’ailier du Stade Français. Jérém tourne sa tête, ainsi les deux potes regardent tous deux l’objectif. L’intense virilité des regards se combine à la proximité, à la promiscuité des torses, des pubis.
Là encore, le rendu du noir et blanc savamment contrasté appuie sur la beauté des corps, met en valeur les proportions, les reliefs.
Jérém m’a prévenu qu’il y aurait des poses et des attitudes suggestives, mais là, putain, ça dépasse l’entendement.
Et pourtant, même après ce deuxième KO technique, je ne me décourage pas, je continue à feuilleter.
Dans un autre intercalaire, je tombe sur le cliché de trois magnifiques rugbymen, les chemises ouvertes sur autant de torses de fous, les cravates défaites. Une image très suggestive, qui fait lourdement marcher la machine à fantasmes.
C’est coincée entre les mois de novembre et de décembre que la dernière image de Jérém me foudroie. On y voit trois jeunes mâles, dont mon beau brun, Ulysse et un autre gars complètement canon, les cheveux et les corps mouillés, à proximité des douches, jouant la surprise, l’air ébahis par l’objectif, comme s’ils avaient été interrompus dans quelque chose. Là encore, la camaraderie, la proximité, l’intimité, la promiscuité, et même la sensualité sont suggérées simultanément, créant un terreau formidable pour le fantasme.
Je sors de ce premier feuilletage comme assommé. Pour son premier shooting, mon beau brun fait fort, très fort. J’essaie d’imaginer combien de nanas et de mecs vont voir ces images, le trouver canon, sexy, combien vont avoir envie de lui, et ça me donne le tournis.
Oui, le mec que j’aime va se faire mater par la France tout entière, et il va faire bander ou mouiller la France tout entière.
J’essaie de me rassurer en me disant que personne ne saura comment je sais le faire jouir et comment il me fait l’amour. Et que, surtout, personne ne saura rien du lien profond qui unit Ourson et P’tit Loup.
Samedi 06 novembre 2004.
A l’occasion de la onzième journée du Top16, la première rencontre de la saison entre les deux Stades se joue une nouvelle fois au stade Ernest-Wallon à Toulouse. Évidemment, je suis de la partie. Évidemment, mon cœur balance. A la fin du match, j’aimerais tellement voir chacun des deux adorables Toulousains gagnants et heureux. Mais je sais que quel que soit le score final, le gagnant rendra hommage à l’adversaire et ce dernier sera heureux pour l’exploit du premier.
Le match se solde par un 32-16 en faveur des Parigots. Après le coup de sifflet de fin, la première personne que Jérém va saluer, c’est Thibault.
Mardi 16 novembre 2004.
Pour l’anniversaire de Monica, nous organisons des retrouvailles de l’ancienne petite bande des premières années de fac. En guise de cadeau, Raphaël a eu une idée assez originale.
Après avoir déchiré le papier cadeau, ma camarade de fac est sonnée par la nudité d’Ulysse, frappée par tant de beautés mâles, et carrément terrassée par la présence de mon Jérém.
— Ah, mais regarde-moi celui-là, qu’est-ce qu’il est beau ! s’exclame Monica justement au sujet de mon beau brun.
— Je suis sûr qu’il doit en avoir une petite ! se marre Fabien.
— Avec un corps et une gueule pareille, je prends le risque ! décrète Monica.
— Voyons, comment il s’appelle ? s’enquête Cécile. Jérémie Tommasi, sacré mec, celui-là ! Il doit en lever des nanas !
Personne n’a tiqué sur le fait que Jérém est mon Jérém. Alors, je ne rétablis ni la vérité sur la taille de ses attributs, ni sur la nature de sa vie sexuelle, pas plus que je ne dévoile la nature de notre relation, chose qui pourrait encore affecter Cécile. Je me contente de sourire intérieurement.
Les filles butent également sur la photo de Jérém et Thibault.
— Tu t’imagines coincée entre les deux, là ? lance Monica. Ça ferait du bien, non ?
Là non plus, je ne relève pas, bien que ça me brûle les lèvres de leur dire non seulement que ces deux torses et ces deux pubis se sont approchés bien plus que ça, et ce à plusieurs reprises, mais qu’il m’est bel et bien arrivé de me retrouver coincé entre ces deux-là et qu’effectivement, ça fait sacrement du bien.
— Je me demande comment les responsables du club ont réussi à vendre ça à ces mecs, s’interroge Cécile. Se foutre à poil sur un calendrier vu par des millions de personnes, ce n’est pas rien !
— Mais attendez… fait Monica, comme foudroyée par une soudaine illumination.
Elle revient en arrière, elle cherche le mois d’avril. Jérém est toujours là, beau comme un Dieu, un Dieu dégageant une sensualité torride.
— Tu le kiffes, celui-là, hein, Monica ? fait Raphaël qui, lui, n’a pas eu d’illumination.
— Oui, je le kiffe, et je connais… je connais une… une copine qui le kiffe encore plus que moi, bref je me comprends.
Oui, Monica, nous nous comprenons très bien.
— A mon avis, l’année prochaine ça va être « avril » pendant douze mois, abonde Fabien.
Décembre 2004.
Début décembre, je vais faire changer les pneus de ma voiture dans un petit garage. La nana à l’accueil, la cinquantaine rayonnante, est à la fois avenante, efficace, arrangeante, et fort sympathique. De plus, elle semble avoir un goût certain en matière de garçons.
Nous ne sommes qu’en décembre, et pour elle, c’est déjà le printemps. Je réalise que le calendrier des Dieux du Stade est tout sauf un outil de gestion du temps, mais plutôt un objet dispensateur de bonheur. Et je réalise également que le fait de voir mon beau brun ainsi exposé aux regards et aux désirs suscite en moi un sentiment mélangé de fierté et de jalousie. Ce qui me rassure, c’est le fait qu’avec Jérém tout se passe toujours très bien et que nos retrouvailles sont toujours aussi intenses, complices, tendres, passionnées, sensuelles, sexuelles.
Lors de l’une de ces rencontres, Jérém tient sa promesse et m’apporte une copie du calendrier. Des lors, je peux le consulter à ma guise. C’est là que je me rends compte du paradoxe de ce calendrier. Sur le papier, ce recueil d’images de corps taillés à la serpe et de belles petites gueules est une idée de génie.
Et pourtant, passé le premier choc des images étudiées pour en mettre plein la vue, je réalise qu’au-delà de l’admiration esthétique de cette débauche de muscles, de pecs, d’abdos, de belles gueules, on oscille en permanence entre la fascination, l’excitation et la frustration. Une frustration qui vient d’un certain défaut de naturel de tous ces clichés. Sous la direction des photographes, les garçons prennent trop la pose, la mise en scène est trop marquée. Or, la bogossitude est la plus belle quand son expression est la plus naturelle qui soit. Oui, il manque quelque chose à ces clichés, et ce quelque chose est le naturel.
Ce n’est pas un hasard si les seuls garçons qui me font vraiment de l’effet dans ce calendrier ce sont ceux avec lesquels j’ai partagé du plaisir et de la tendresse, Jérém en tête et Thibault juste après, ou du moins que je connais en vrai, comme Ulysse. L’image figée sur le papier glacée est complétée par les souvenirs et les ressentis qui insufflent la « vie » qui manque à ces photos.
En ça, le DVD du « making of » est la véritable réussite du projet des Dieux du Stade. On y voit les garçons rigoler, se charrier, on voit leur complicité, leur joie de vivre, leur insouciance. C’est beau à en pleurer.
En regardant les images, j’ai également une pensée émue pour les techniciens qui s’affolent autour des athlètes dans leur plus simple appareil et je me demande comment ils arrivent à se concentrer. Et parmi tous les corps de métier impliqués dans ce shooting célébrant la beauté masculine, il y en a un qui me fascine tout particulièrement. Dans l’un des plans, on voit une nana à genou devant un jeune Dieu mâle, un pinceau à la main, en train de maquiller je ne sais pas trop quoi autour de sa virilité. Oui, il existe des professions tout aussi étonnantes, fascinantes, que méconnues.
Noël 2004 et jour de l’An 2005.
Comme il est coutume depuis quelques années désormais, nous passons les fêtes de fin d’année à Campan. Entre Noël et le jour de l’An, le sujet de la reprise de la pension de Charlène revient sur la table, bilans des dernières années et budgets prévisionnels à l’appui. Charlène souhaite louer les prés et les installations à un prix symbolique pour s’assurer un complément de retraite sans trop peser dans l’équilibre financier du projet. Elle présente Camille, la fille qui est pressentie pour reprendre la gérance de l’affaire.
— Je te fais entièrement confiance, Charlène, fait Jérém. L’important, c’est que cet endroit perdure. Ici, il y a toute une partie de mon enfance.
Comme je l’aime, mon adorable Jérém !
La montagne et la neige sont des ambiances propices à la magie de Noël. Pour moi, la magie de Noël est associée depuis quelques années à la magie de Campan, cet endroit où Jérém et moi, malgré les amis qui nous entourent, sommes en quelque sorte seuls, loin de tout. Campan est l’endroit qui n’est qu’à nous. C’est le refuge de notre amour. Oui, c’est l’endroit où Jérém m’a embrassé pour la première fois, mais aussi l’endroit où il a fait son premier coming out, l’endroit où il m’a dit « je t’aime » pour la première fois.
C’est l’endroit où cette année encore, nous sommes heureux comme nulle part ailleurs.
2005.
L’année 2005, s’ouvre sous les meilleurs auspices. Je valide mon premier semestre, et c’est également le cas de Jérém qui a enfin retrouvé le chemin de la fac.
Aussi, les premières rumeurs d’un nouvel album de Madonna commencent à circuler, il se murmure même qu’elle aurait contacté ABBA, faut oser, pour sampler l’un de ses morceaux, « Gimme ! Gimme ! Gimme ! ». Le but serait de réaliser le premier single d’un album aux sonorités disco qui devrait sortir vers la fin de l’année. Voilà de quoi me réjouir.
La carrière sportive de mon beau brun est au beau fixe, et rien ne semble pouvoir l’arrêter. En ce début d’année, la belle petite gueule de Jérém est souvent dans la presse sportive. On l’annonce au plus haut niveau, on le dit assez gaillard pour aller jouer dans la cour des grands. Les grands, c’est le XV de France. Et la cour, c’est le Tournoi des Six Nations qui va bientôt débuter.
Jérém est euphorique à l’idée de jouer pour l’équipe de son pays.
— Le XV de France, tu imagines ? Moi, Tommasi, dans le XV de France !
Une euphorie relevée par un bon petit sentiment de revanche :
— Quand je pense qu’après mon accident j’ai vraiment cru que je ne rejouerais jamais au rugby !
Et encore de revanche :
— Ces cons de responsables toulousains vont se mordre les doigts de ne pas avoir voulu de moi !
Entre ses entraînements, au Stade et en Equipe de France, ses matches, ses cours, ses soirées et ses obligations mondaines, nous nous voyons peu. Pas assez, en tout cas, à mon goût.
Et pourtant, je suis heureux pour lui. Et je suis heureux tout court. Car rien, ni la distance, ni le temps passé loin l’un de l’autre, n’affaiblit notre amour. Bien au contraire.
Nous nous laissons libres de vivre ce que nous avons à vivre, mais finalement nous n’avons besoin de rien de plus. En tout cas pour moi. Je n’ai pas besoin d’aller voir ailleurs. Et même quand je suis à Bordeaux dans mon studio le soir, quand Jérém me manque horriblement, il me suffit de penser à lui, car je sais que quelque part dans ce monde, il existe un garçon pour qui je suis spécial. Je sais qu’il sera là pour moi si j’ai besoin de lui et il sait que je serai là s’il a besoin de moi.
Le Tournoi des Six Nations débute le 5 février 2005. La France joue contre l’Ecosse au Stade de France. Jérém ne fait pas partie de l’équipe sur le terrain, mais il est sur le banc des remplaçants.
Quant à moi, je suis en tribune avec Papa Tommasi, Maxime et Thibault.
Dès le début du match, je vois Jérém frémir, ronger son frein. Je sais qu’il crève d’envie d’être sur le terrain. La première mi-temps se termine sur un score assez équilibré. Au début de la deuxième, la France prend l’avantage. Vers le milieu de la mi-temps, l’ailier français se blesse. Et Jérém est appelé en remplacement.
Mon beau brun débarque sur le terrain l’air un peu intimidé, un peu perdu. Son attitude me rappelle celle qu’il avait lors du premier match télévisé de sa carrière, celle d’un petit mec dépassé par l’ambiance survoltée d’un stade rugissant.
Et pourtant, le petit mec se transforme vite en lion puissant. Il ne s’est pas écoulé cinq minutes depuis son entrée sur le terrain, lorsque, sur un passage de balle venant du magicien Ulysse, le jeune ailier prodige va au but. Le match se termine quelques minutes plus tard, sur un score de 9 à 16 en faveur des Français. Les trois points marqués par Jérém ne sont pas déterminants, certes. Mais ils ont au moins eu le mérite de montrer ce que le jeune Toulousain exilé à Paris a dans le ventre.
Une démonstration qui va lui valoir une place de titulaire dès le match suivant. Et le match suivant, ce n’est rien de moins que France-Angleterre. Il se joue le dimanche suivant, le 13 février, un an, jour pour jour, après nos retrouvailles à Biarritz.
La rencontre se tient au Stade de Twickenham à Londres. Le timing étant très court, je n’ai pas pu organiser mon déplacement. J’ai regardé le match à la télé avec Papa.
Les Français ont brillé pendant leur match, un match très musclé. Jérém a marqué quelques beaux points. Ulysse y a écopé du premier carton rouge de sa carrière. La deuxième mi-temps s’est achevée par un score de 18 à 17. Et la joie de Jérém à la fin du match, bien saisie par les caméras, donnait envie de pleurer tellement c'était beau.
Quinze jours plus tard, au Stade de France, le Pays de Galles a raison des Français qui s’inclinent sur un score de 24 à 18. Jérém est déçu. Je suis évidemment présent pour les deux mi-temps réglementaires, ainsi que pour la quatrième mi-temps sensuelle. Au cours de cette dernière, je me charge de lui remonter le moral au pieu, comme il se doit.
Il faudra attendre la quatrième journée du tournoi pour que les Français retrouvent le chemin de la victoire. Le 12 mars, c’est à Dublin que se joue France-Irlande, un match qui se termine avec un score triomphal de 29 à 16. Je suis là aussi présent pour les deux mi-temps réglementaires, ainsi que pour la quatrième mi-temps. Au cours de cette dernière, une fois encore, je me charge de fêter sa victoire au pieu, comme il se doit.
La dernière journée se joue la semaine suivante, au Stade Flaminio à Rome. Je m’y rends également pour assister à la victoire écrasante, presque un acharnement, du XV de France sur l'équipe d’Italie, la plus faible du tournoi, par 56 points à 13. Au final, la France est deuxième du classement du Tournoi des Six Nations, juste derrière le Pays de Galles.
Le lendemain, nous nous baladons dans la ville éternelle, tout en nous remémorant notre voyage deux ans plus tôt.
Avril 2005.
Au printemps, un dîner de retrouvailles de notre ancienne classe de lycée est organisé. Je ne me suis jamais vraiment senti à l’aise au lycée, et la perspective de retrouver mes anciens camarades ne me réjouit pas vraiment. Si j’y vais, c’est parce que Jérém y va. Et aussi pour retrouver ma copine Nadya.
Cette soirée est l’occasion de constater l’évolution des camarades d’antan. Certains sont partis dans de longues études, d’autres dans un emploi, ou dans un projet personnel. Certains sont bien rangés dans un couple, un mariage, certains ont même déjà des gosses, certains les ont même amenés à la soirée. D’autres ont une vie amoureuse plus chaotique.
Finalement, mes craintes de retrouver les angoisses du lycée se révèlent infondées. En quatre ans, nous avons tous grandi. Je me sens mieux, j’ai même l’impression qu’on s’intéresse à moi et à mes études, qu’on respecte mon parcours. Il reste un hic, évidemment, les questions autour de ma vie sentimentale. On ne manque pas de m’interroger à ce sujet, et je suis obligé de rester évasif, car je ne peux pas parler de mon bonheur avec Jérém. Il n’y a qu’une personne avec qui je vais arriver à m’exprimer librement.
— Je te trouve bien complice avec Tommasi, elle me glisse discrètement à un moment de la soirée, vous avez gardé une belle amitié.
Nadya s’est finalement mariée avec Malik, et ils sont les heureux parents d’un petit Sofiane. Finalement, ce fameux jour de notre retour du voyage d’Italie, cette pause dans la vigne, a été le moment fondateur de leur avenir commun.
— A toi, je peux dire la vérité, je me lance.
— Te fatigue pas, je la connais, la vérité !
— C’est vrai ?
— Tu as été fou de lui pendant tout le lycée.
— Oui, c’est ça !
— Et vous vous êtes trouvés depuis…
— Oui, c’était un peu avant le bac.
— Quand vous révisiez ensemble ?
— C’est ça.
— Et ça dure depuis ?
— Oui, oui, oui !
— Malgré la distance ?
— Oui.
— Malgré sa notoriété ?
— C’est pas toujours facile, mais on y arrive, en faisant quelques concessions.
— Tu es toujours aussi amoureux ?
— Plus que jamais !
— Et lui aussi ?
— Ce gars me rend heureux.
— Tu m’en vois ravie pour toi.
— Je sais. Je t’ai toujours considérée comme ma meilleure amie au lycée. D’ailleurs, ma seule amie.
— Je t’aime beaucoup Nico. Et j’aurais aimé que nous ayons cette discussion quand on était au lycée.
— Ça m’aurait fait du bien, je pense. Je me sentais tellement seul…
Évidemment, Jérém est plus que jamais la star de la soirée. On l’interroge sur sa carrière fulgurante, sur sa blessure, sur sa récente et spectaculaire intégration en Equipe de France à l’occasion du Tournoi des Six Nations, on le charrie au sujet des pouffes avec qui il s’affiche dans la presse à scandale et aussi au sujet du calendrier.
Je retrouve avec appréhension certains camarades, ceux qui étaient les plus insupportables avec moi, ceux qui m’insultaient, qui me traitaient de pédé. Au fond de moi, j’ai toujours peur qu’ils puissent recommencer à se payer ma tête. Mais très vite, je constate avec soulagement que les quelques années depuis le lycée semblent les avoir assagis. Si seulement ils avaient pu se calmer avant le bac ! Mais à l’époque on n’était encore que des gamins, surtout eux.
Le changement d’attitude de l’un d’entre eux, Sylvain, certainement le plus virulent à mon égard, notamment dans les vestiaires de sport, me frappe tout particulièrement. Le gars semble avoir perdu beaucoup de sa superbe, il me semble déjà marqué par la vie, j’ai l’impression qu’il n’est pas bien dans ses baskets. Son regard autrefois tour à tour sévère, ténébreux, insolent et moqueur, foncièrement charmeur, est désormais comme éteint. A l’époque du lycée, il me faisait peur, mais aussi très envie. Avec Jérém, c’était le gars le plus viril et sexy de notre classe. Il me fait toujours envie, malgré les quelques kilos en plus, et une allure pas vraiment soignée. Cependant, je dois admettre que le premier sentiment qu’il m’inspire est de la tendresse, suivi par une certaine peine, et pas mal de questionnements. J’aimerais pouvoir le faire parler. J’aimerais savoir ce qui l’a transformé à ce point.
Jadis toujours au centre de l’attention, Sylvain semble être devenu plutôt solitaire. Pendant la soirée, je le vois taciturne, et il ne semble pas vraiment se mélanger aux conversations avec ses anciens potes. Parfois, il est seul, l’air perdu. Il fume beaucoup, il boit encore plus. Je le trouve vulnérable, et je cherche l’occasion pour l’aborder et discuter un peu avec lui.
A ma grande surprise, c’est lui qui vient me parler. Il me questionne au sujet de mes études, il me parle vite fait de son travail d’ouvrier dans une usine. Il me parle de l’époque du lycée, il l’évoque comme d’une période heureuse de sa vie, période qu’il semble comparer avec l’actuelle, beaucoup moins heureuse. Il insiste tellement sur le bonheur du lycée, que je finis par lui balancer :
— Pour moi le lycée n’a pas vraiment été une période heureuse.
— Je me doute…
— Tu m’as rendu la vie assez difficile, je plaisante.
— Je sais, je suis désolé. J’étais vraiment un con à l’époque.
— T’en fais pas, c’est passé, je ne t’en veux pas. Enfin, je ne t’en veux plus.
— Je peux te poser une question ? il me lance de but en blanc.
— Ouais… dis toujours.
— Alors, c’est vrai ?
— C’est vrai, quoi ?
— Que tu es pédé ?
— Pédé ? je le reprends.
— Pardon, c’est pas ce que je voulais dire.
— On dit plutôt gay, ou homo…
— Désolé, je suis toujours aussi grossier.
Au lycée, Sylvain aurait été la dernière personne à qui je me serai confié. Mais ce soir, je ne sais pas pourquoi, je me sens à l’aise avec lui. Aussi, je me dis que pour faire parler les gens, il faut les mettre en confiance. Et se dévoiler est une bonne façon de mettre en confiance.
— Pour répondre à ta question, oui, c’est bien vrai. Ça me fait rire quand j’y repense, quand tu as commencé à me traiter de pédé au collège, je ne savais même pas encore ce que ça voulait dire.
— Je suis désolé de t’avoir fait autant chier.
— C’est passé, c’est oublié.
— Et c’est comment d’être P… enfin… homo ?
— Je ne sais pas, je le suis, je n’ai pas d’autre option pour essayer d’être heureux.
— Et tu as un mec ?
— Oui ! je réponds fièrement.
— Et il est comment ?
Ouf, il est moins perspicace que Nadya.
— C’est un beau garçon, nous sommes bien ensemble.
— C’est pas trop dur de supporter le regard des autres ?
— Si, mais on fait avec.
— Je ne pourrais jamais, jamais…
— Qu’est-ce que tu ne pourrais jamais ?
— Faire ce que tu fais…
— Quoi, coucher avec un mec ?
— Non, je parle d’assumer les regards…
— Pourquoi, coucher avec un mec tu pourrais ? je m’amuse.
— Non, non, non, non, non !
Beaucoup de « non » dans sa bouche, trop de « non » pour ne pas me demander qui il est en train d’essayer de convaincre, si c’est bien moi, ou bien lui.
— T’as pas cru que… il enchaîne, l’air effrayé.
— Non, non, je n’ai rien cru.
— Est-ce que j’ai l’air d’être…
— Non, non, non, pas du tout, je tente de le rassurer.
— Tu me kiffais au collège ? il me lance à brûle pourpoint.
— Ah, ça oui, je te kiffais au lycée !
— Tu avais envie de…
— Si au lieu de me harceler tu m’avais demandé une pipe, tu en aurais eu autant que tu voulais, si c’est ce que tu veux savoir !
— Je ne suis pas comme ça !
— Mais je te crois. Je dis juste ce qu’il en était, puisque tu me poses la question !
Sylvain demeure pensif, noyé dans les vapeurs de l’alcool. Il est très sexy, avec son regard toujours aussi sévère et ténébreux, mais aussi vulnérable. A cet instant précis, il me semble qu’il n’est vraiment pas bien dans sa peau, j’ai comme l’impression qu’il se retient de me balancer une réalité plus profonde, mais qu’il n’y arrive pas. J’ai l’impression qu’il est sur le point de craquer, et de pleurer.
Son attitude et ses questions m’intriguent, j’ai envie d’essayer d’en savoir plus.
— En tout cas, tu es toujours aussi sexy…
— J’ai grossi !
— Mais ça te va bien.
— Si tu le dis…
— Arrête, tu es un très beau gars, les nanas ça doit y aller ! Tu es maqué ?
— Non.
— Tu as des aventures, alors…
— Pas tant que ça…
— Tu cherches pas à en avoir ?
— Tu sais quoi, laisse tomber, il me balance, l’air agacé.
— Mais je ne fais que discuter… désolé si j’ai pu être indiscret, je tente de rattraper le coup.
— Va te faire baiser par ton pédé de mec et fiche-moi la paix !
— T’es toujours le même petit con qu’à 13 ans ! je me braque.
— Ta gueule !
Ce seront les derniers mots que nous échangerons de la soirée.
Mis à part ce petit accroc, ce dîner se révèle être une bonne soirée. C’est l’occasion de redécouvrir certaines personnalités, mais aussi de constater que le temps passe et ne s’arrête jamais.
Après la soirée, Jérém et moi dormons chez mes parents, qui sont fort heureux de nous avoir avec eux. Après l’amour, Jérém me glisse :
— Je t’ai vu discuter avec Sylvain…
— Il m’a demandé si j’étais pédé.
— Et tu lui as dit quoi ?
— Que c’était le cas.
— Tu ne lui as rien dit de plus, hein ?
— Non, t’inquiète.
— Merci.
— De rien. Tu sais, je ne l’ai pas trouvé très en forme.
— Bah, moi non plus. ai-je n’ai pas retrouvé le gars que je connaissais au lycée.
— Pareil pour moi. J’ai même eu l’impression qu’il voulait me dire quelque chose mais que ça ne sortait pas. Comme s’il avait du mal à assumer…
— Comme quoi ?
— Tu crois pas qu’il pourrait être comme nous ?
— Je ne sais pas… enfin… à vrai dire, j’ai toujours trouvé que dans les vestiaires il regardait beaucoup…
— C’est vrai ?
— On regarde tous dans les vestiaires, plus au moins. Mais parfois il m’a semblé qu’il regardait comme quelqu’un qui a envie…
— Il a l’air très malheureux. J’espère qu’il va trouver le moyen de remonter la pente.
Au cours du printemps, les matches s’enchaînent.
Le 30 avril, au Parc de Princes, c’est l’heure de l’un des plus gros matches de la saison, le Stade Français contre Stade Toulousain de fin de championnat. Ça se termine par un score de 40 à 19. Jérém, heureux de sa victoire, s’empresse d’aller saluer son Thib. Ce dernier a l’air déçu du résultat du match, et pourtant heureux pour son pote.
Trois semaines plus tard, le 22 mai, les deux potes se retrouvent à Édimbourg pour la finale de la coupe d’Europe. Avec un score de 18 à 12, le Stade Toulousain prend la revanche sur le Stade Français. Thibault, heureux de sa victoire, s’empresse à son tour d’aller saluer son Jé. Ce dernier a l’air déçu du résultat du match, et pourtant lui aussi heureux pour son pote.
Thibault est presque mal à l’aise vis-à-vis de Jérém, pour lui avoir ravi cette victoire prestigieuse. C’est ce qu’il nous avoue, après avoir laissé Jérém lui faire l’amour, et après avoir joui en moi à son tour.
— Quand on fait un beau match comme celui de cet après-midi, finit par trancher le jeune papa pour remonter le moral de Jérém, il n’y pas de perdant, mais un seul et unique gagnant, c’est le rugby.
Le 3 juin, les deux stades s’affrontent une nouvelle fois à l’occasion de la demi-finale du Top16. Ça se passe au Stade Jacques-Chaban-Delmas, à Bordeaux. Donc, pas de déplacement pour Nico ! Le Stade Français s’impose pour 23 à 18, et gagne sa place pour la finale.
Et c’est dans mon petit studio que lors de la quatrième mi-temps, je fais jouir mon beau brun pour célébrer sa victoire comme il se doit. Nous aurions bien ouvert les célébrations à Thibault aussi. Mais un impératif de progéniture malade l’appelait en urgence sur Toulouse.
La finale du Top16 se joue le 11 juin 2005 au Stade de France. Même après en avoir franchi plusieurs fois les portes, cette immense enceinte rugissante m’impression toujours autant. Aujourd’hui, le Stade Français rencontre le Biarritz Olympique. Le match est un choc des titans. Ça joue, ça marque des points à tout va. Aucune des deux équipes n’arrive vraiment à s’imposer, le score est de 31 à 31 à la fin du temps règlementaire. Il y a des prolongations, et ça se solde par un score de 34 à 37 en faveur des Basques. Jérém est hyper déçu, perdre en finale c’est rageant. Je tente de lui remonter le moral, mais sa morosité est tenace, au point d’anéantir sa libido. Et c’est pas peu dire. Il lui faut tout un weekend pour se remettre de sa contrariété, pour venir chercher un peu de tendresse dans mes bras.
En rentrant chez moi à Bordeaux, je repense au match, à l’équipe de Biarritz. Et, de fil en aiguille, aux retrouvailles avec Jérém à l’hôtel biarrot un an plus tôt, à Dorian et à M. Charles. Je suis saisi par l’envie de prendre des nouvelles, comme je l’avais promis à M. Charles en partant de l’hôtel. En fait, ça fait des mois que j’ai envie de le faire, mais je n’ai pas su trouver le bon moment.
— Hôtel Moderne Biarritz, bonjour !
C’est une voix inconnue qui répond au téléphone. Ce n’est ni celle de M. Charles, ni celle de Dorian. C’est peut-être celle de Lilian ?
— Bonjour, je m’appelle Nicolas, je souhaite m’entretenir avec M. Charles, s’il vous plaît.
— M. Charles ?
— Oui, le concierge.
— Mais M. Charles est parti.
— Il a pris sa retraite ?
— Non, il est parti, pour toujours. Il nous a quittés soudainement il y a environ deux mois.
Je suis abasourdi. Je reçois cette mauvaise nouvelle comme un coup de massue sur la tête.
— Et comment c’est arrivé ? je veux savoir, comme si ça changeait quelque chose, ou bien pour me donner le temps d’accuser le choc.
— Il semblerait qu’il ait fait un malaise dans son sommeil. C’est sa femme de ménage qui l’a retrouvé.
C’est la plus belle des façons de partir. Et la plus discrète. M. Charles est parti sur la pointe des pieds. C’est tout à son image. Fidèle à lui-même jusqu’au dernier souffle.
Je repense à ses derniers mots au moment de nous dire au revoir, l’année dernière. « Nous nous reverrons bientôt, Nicolas ». Hélas, le temps ne nous l’a pas permis. Ce n’est pas vrai. Le temps nous l’a permis. C’est moi qui n’ai pas su saisir l’occasion.
On pense toujours qu’on aura le temps de dire je t’aime aux personnes qui comptent et qu’on aura le temps de le leur montrer. Mais la vérité est que nous n’en savons rien, nous ignorons complètement le temps dont nous disposons et dont eux disposent. Il faut vivre chaque instant comme si c’était le dernier.
Après avoir raccroché, je repense à l’histoire de M. Charles, à sa philosophie de vie, à ses mots.
« Il ne faut pas se laisser happer par le quotidien, par la course du temps. Il faut savoir discerner les choses importantes de la vie, ce sont en général celles qui nous rendent heureux. Il faut vivre et aimer, sans attendre, sans se laisser envahir par ce qui est superflu. Il faut aussi un peu de chance. La chance, il faut parfois savoir la provoquer. Et il faut surtout la reconnaître et la saisir dès qu’elle pointe le bout de son nez ».
« Et rappelle-toi que le bonheur c’est surtout ne pas traverser cette vie tout seul. Le bonheur, c’est aimer. Le bonheur, c’est savoir qu’on est l’Elu du cœur de quelqu’un ».
Je repense à son Johan, les lettres d’amour, à son regret de ne pas avoir écouté son cœur. J’essaie d’imaginer ses jours heureux, ses souffrances, ses joies, ses bonheurs. Je lui suis très reconnaissant d’avoir partagé un peu de son histoire avec moi. Car dans mon souvenir, il continue à vivre.
Un homme s’éteint, un roman s’efface. Mais pas complètement, tant que quelqu’un se souvient de lui.
Un homme s’éteint et pourtant, la vie continue. La semaine suivante, je valide mon semestre. Jérém en fait de même.
Fin juin, nous partons en vacances tous les deux. Cette année, mon bobrun m’amène dans le Nord. Car, cette année, il a envie de rencontrer sa demi-fratrie.
Alice, la maman de Jérém, est super heureuse de nous accueillir. Jérém est très ému. Anaïs, sa demi-sœur, semble au premier abord une jeune fille timide. Mais une fois passé le cap du malaise de la rencontre avec ces inconnus, elle se révèle être une jeune fille qui aime être au centre de l’attention, et accaparer toutes les conversations. Elle est marrante, un peu envahissante, mais mignonne.
Mais la rencontre la plus touchante est celle avec Romain, le frère d’Anaïs, un adorable garçonnet âgé de 10 ans. Le petit mec reconnaît en Jérém le joueur de rugby.
— Et lui, c’est mon frère ? il s’étonne.
— Demi-frère, mais oui, c’est bien ton frère, lui explique Alice.
— Et toi, t’es qui ? il me lance, avec cette curiosité sans filtres propre aux enfants.
— Je suis un copain de ton frère, je reste neutre.
Nous restons trois jours chez Alice. Et pendant trois jours, Jérém et Romain sont inséparables. Jérém lui apprend les secrets du rugby professionnel, et le petit bout de chou lui pose plein de questions sur sa vie de rugbyman. Faute de maillot, Romain lui demande de lui dédicacer un t-shirt. Mais dès le lendemain, le grand frère amène le petit dans un magasin de sport et lui achète un maillot et un ballon de rugby.
« Pour mon petit frère. J.T. » griffonne-t-il sur les deux.
Pendant ces quelques jours chez Alice, nous dormons dans la même chambre, dans le même lit, mais nous ne faisons jamais l’amour. Nous faisons beaucoup de câlins.
— Je crois que j’ai fait la paix avec mon enfance, il me glisse, un soir. Et c’est grâce à toi, Nico.
Le dernier jour, au petit déj, Anaïs balance de but en blanc à Jérém :
— Pourquoi toi et Nico dormez dans le même lit ?
— Parce que nous sommes très amis, lui répond Jérém.
— Mais vous êtes deux garçons.
— Tu sais, fait Alice, rien n’interdit que deux garçons puissent dormir dans le même lit.
— Ah, d’accord…
— Mais ça, c’est un secret, et il ne faut pas le répéter, continue sa maman.
— Voilà, c’est notre secret, confirme Jérém.
— Et pourquoi, c’est un secret ?
— Parce qu’il y a des gens qui ne comprennent pas que deux garçons puissent dormir dans un même lit.
Après cette petite escale « famille », nous passons quelques jours à Deauville et à Etretat.
Mi-juillet, le nouveau shooting du calendrier des Dieux du Stade est programmé. Cette année, Jérém se prête au jeu avec plus d’enthousiasme, en tout cas avec moins d’appréhension. Dans sa bouche, ça a l’air d’une simple formalité.
Dans la foulée, les entraînements reprennent de plus belle, avec toujours la double casquette, Stade Français, XV de France. Le 20 août, c’est déjà la première journée du fraîchement renommé Top14. L’été, c’est déjà fini. Je profite des derniers jours avant la reprise des cours à la fac pour passer quelques jours à Gruissan.
D’autant plus que ma cousine Elodie y séjourne elle aussi, jusqu’à la fin du mois. Avec Philippe et Lucie, certes. Mais, en journée, Philippe peut s’occuper de Lucie. Et Elodie peut s’aménager quelques heures de plage, de balade et de discussions pour refaire le monde avec son cousin préféré, comme au bon vieux temps.
C’est tellement bon de la retrouver, de retrouver notre complicité, même si ce n’est que l’espace d’un après midi. Oui, c’est tellement bon de nous raconter en résumé nos trois dernières années, de nous balader sur la plage, de mater les mecs et nous dire ce qu’ils nous inspirent.
Septembre 2005.
Septembre arrive, avec ses dates anniversaire. Campan, la halle. J’entends encore le bruit de la pluie qui tombait drue sur le toit de la halle, je sens son odeur, je ressens le froid. Et je me souviens de tous ces papillons dans mon ventre, je me souviens de sa silhouette de dos, encapuchée, je me souviens de son premier regard, de son sourire. Et de son premier baiser.
Septembre arrive aussi avec d’autres anniversaires moins engageants, ceux du 11 et du 21 septembre. Et là, posé au beau milieu de ces deux anniversaires de catastrophes, le mien.
Le jeudi 15 septembre, j’ai 23 ans.
Cette année, Jérém est trop occupé pour pouvoir passer me faire un coucou. Mais nous nous voyons le week-end d’après, à Paris. J’ai alors droit à un beau cadeau, une belle montre de grande marque et hors de prix. Mais aussi à un très chic et très bon resto, où la tenue « correcte » est exigée. Je m’habille donc en costume, j’ai donc droit à Jérém en costume cravate, élégant et sexy à souhait. J’ai droit à un Jérém attentionné, heureux, épanoui, bien dans ses baskets, un Jérém à la conversation plaisante, à l’humour de plus en plus fin, à l’assurance de plus en plus marquée. J’ai aussi eu droit à ressentir une nouvelle fois la sensation que j’avais ressentie pour la première fois à Biarritz il y a un an et demi, quand je m’étais posé la question au sujet du fossé de maturité, d’avancement dans la vie qui était en train de se creuser entre lui et moi.
En attendant, j’ai également le droit de sucer Jérém en costard cravate, juste la queue sortie de sa braguette. J’ai le droit de le faire jouir dans cette tenue qui m’a toujours fait fantasmer. J’ai le droit de le voir se dessaper, de le sentir venir en moi, et de l’entendre souffler son nouvel orgasme tout près de ma nuque. Et j’ai le droit de m’endormir dans ses bras, bien au chaud dans ses bras.
Octobre 2005.
Septembre, c’est le mois des vendanges. Octobre, celui du Calendrier. Cette année encore, les Dieux du Stade s’illustrent dans un ouvrage décoiffant.
Déjà, la couverture porte un magnifique cliché d’un superbe mâle rugbymen Castrais. Le torse magnifiquement charpenté, parfaitement dessiné, bien symétrique, avec des épaules carrées, des pecs saillants, des abdos en bas-relief, des biceps rebondis à souhait, des plis de l’aine vertigineux, des cuisses d’enfer. Les mains du Jeune Dieux Mâle tiennent un ballon ovale juste devant sa virilité, mais à une hauteur savamment étudiée pour laisser dépasser le haut des poils pubiens. C’est la Splendeur Classique, le Faste Suprême de la Jeunesse, le Canon Ultime de la Perfection Masculine la plus pure. Une couverture qui annonce la couleur des « thématiques » abordées dans l’ouvrage dont elle est l’ambassadrice.
Car à l’intérieur, c’est une débauche de mâlitude, de jeunesse, de puissance, de muscles, de virilité. Tout cela manque comme toujours cruellement de sensualité, c’est le propre de l’image figée, du fait de prendre la pose, ce qui fait s’évaporer cet élan naturel qui est le plus grand charme d’un garçon. Mais, au-delà de ça, quel calendrier, ou plutôt, quel catalogue ! Un inventaire choisi de ce que le monde du rugby sait produire de plus magnifique.
Mon Jérém y apparaît dans deux clichés. Le premier, seul, et en noir et blanc, l’image saturée de lumière comme s’il était en plein soleil, ce qui doit être probablement le cas puisqu’il est appuyé contre une rambarde derrière laquelle on entrevoit des tribunes, probablement celles d'un stade de rugby. Le beau brun y apparaît de profil trois quart, la tête en arrière, les pecs bien saillants – et, oh sacrilège, la splendide toison brune de son torse réduite à néant, à tous les coups par le caprice d’une tête de con de directeur artistique qui a dû décréter que le poil mâle n’est pas vendeur – la main gauche juste à la limite du cadrage, laissant imaginer qu’elle pourrait tenir quelque chose, quelque chose qu’on ne voit pas. La photo est coupée à hauteur de ses premiers poils pubiens, l’image laisse la porte ouverte à toutes les spéculations. Les paupières baissées, les lèvres entrouvertes, la photo est chargée d’érotisme. On jurerait que c’est le portrait d’un garçon qui est en train de se faire sucer et qui prend bien son pied. Dans ce cas, ce quelque chose que sa main pourrait être en train de tenir, ça pourrait bien être…
Jérém apparaît dans un deuxième cliché, en compagnie de deux autre bomecs musclés. Le beau brun est au centre de l’image, de face, il couvre sa queue avec ses deux mains, et il fixe l’objectif de son regard très brun et aveuglant, avec tout ce qu’il peut dégager de charmeur, sensuel, insolent, allumeur. Quant aux deux autres petits mecs, ils sont tournés vers Jérém, mais de trois quarts, de façon qu’on peut en même temps apprécier leurs belles fesses rebondies bien offertes à la caméra, mais également leurs belles petites gueules. Ils saisissent chacun d’une main le biceps de Jérém le plus proche, l’air d’avoir été, une fois de plus, surpris par la caméra.
Il me semble que la symbolique sexuelle est assez flagrante. Jérém est le plus viril des trois mecs, le plus assumé aussi à l’évidence, car il semble le seul des trois à ne pas avoir été « effarouché » par l’arrivée de l’objectif. On imagine bien ces deux petits mâles sur le point de s’offrir à tour de rôle à sa virilité. Ou, alors, c’est moi qui ai les idées mal placées.
Les réalisateurs de ce calendrier doivent bien se rendre compte du caractère éminemment homoérotique de certaines images et attitudes. C’est peut-être un effet recherché.
Ulysse apparaît également dans cette édition, accoudé à une échelle en métal, la main droite abandonnée dans le vide, tous pecs et abdos et biceps et belle barbe blonde dehors, le ballon plaqué d’une main contre sa virilité, mais sans oublier de bien laisser dépasser le poil pubien (à l’évidence le seul poil male toléré dans cette édition), beau comme un Dieu, à craquer, à croquer.
Le grand absent de cette édition, est Thibault. L’adorable pompier m’a avoué un jour ne pas s’être senti à l’aise dans cet exercice. Et de ne pas avoir l’intention de renouveler l’expérience. Il ne reviendra jamais sur sa décision.
Samedi 15 octobre 2005.
La veille de son anniversaire, et à l’occasion de la 9ème journée du Top14, Jérém retrouve Thibault sur la pelouse du Stade de France. Le choc entre les deux poids lourds du rugby français fait trembler pendant 80 minutes l’immense anneau de la Plaine Saint Denis. Et il se termine par la victoire du Stade Français par 29 à 15.
Comme d’habitude, nous retrouvons avec bonheur notre pote Thibault lors de la quatrième mi-temps sensuelle entre garçons. Ce que nous ne savons pas encore, c’est que ce sera la dernière fois que Thibault partagera une nuit avec Jérém et moi.
Dimanche 16 octobre 2005.
Jérém a 24 ans. Pour l’après-midi, il a prévu quelque chose d’inattendu. A ma grande surprise, il me propose d’aller au cinéma. Une proposition déjà étonnante en soi, venant de mon beau brun, mais qui semble devenir surréaliste lorsqu’il m’annonce le titre du film qu’il a envie d’aller voir.
Ennis et Jack sont presque encore des enfants lorsqu’ils se rencontrent. Ils ont 19 ans, viennent d’une Amérique rurale où on ne parle pas de ses sentiments, et encore moins de ceux entre hommes.
Quelques semaines de bonheur durant l'été 1963 au cœur d’une nature grandiose, loin de la société des hommes et de ses convenances, suivies de deux décennies de solitude et de souffrance où leurs retrouvailles régulières et clandestines ne feront que souligner le manque de l’autre.
Le propos va bien au-delà du simple "western homo" comme certains média qualifient le film, ou de la boutade d’un animateur télé qui plaisantera, des années plus tard : « voir deux cowboys qui s’enculent dans un film, ça c’est pas banal ! ».
Dans ce film, il est question de la difficulté d’aimer, de la douleur qui résulte d’un amour impossible mais contre lequel on ne peut pas lutter. Il est par-dessus tout question du manque : « J'en crève de douleur, t'as pas idée à quel point j'en crève" dit Jack à Ennis peu avant le tragique dénouement de l’histoire.
Jake Gyllenhaal et Heath Ledger sont beaux comme des Dieux. Et ils livrent ici une immense interprétation. Je pense aux regards doux et amoureux de Jack, mais aussi, et surtout, aux mâchoires serrées d'Ennis, à son mutisme qui traduisent son insurmontable malaise. Les deux jeunes acteurs sont d’une justesse incroyable et transmettent les émotions de leurs personnages d’un simple regard, d’un mouvement de tête, d’un sourire à peine esquissé. La réalisation, les décors, la musique, tout est réuni pour bouleverser le spectateur. A un moment, j’aurais juré que Jérém avait cherché ma main dans le noir.
Je sors abasourdi de la projection. Je n’ai qu’une envie, c’est de revoir ce film. Je le reverrai plusieurs fois par la suite. Et à chaque fois je me dirai que je voudrais ne pas déjà connaître l’histoire et ses personnages pour retrouver l’émotion de la toute première découverte. Et à chaque fois je me dirais que je voudrais que Jérém soit là, avec moi, comme pendant cette toute première fois. Hélas, ce ne sera jamais le cas.
Lorsque les lumières s’allument, Jérém s’essuie vite le visage. Il a pleuré, lui aussi.
Le film est d’une beauté saisissante, mais il est également empreint d’une profonde tristesse.
Je me demande si notre histoire ne va pas se terminer comme celle de Jack et d’Ennis. Je ne pense pas à une fin tragique, non. Je ne pense pas non plus que Jérém veuille se marier un jour, ou avoir des enfants. Encore que, nous n’en avons jamais parlé, et je ne connais pas du tout ses attentes à ce sujet. Peut-être devrais-je aborder le sujet ?
— Tu voudras un jour avoir des enfants ? je m’entends lui demander, le soir même.
— Pourquoi, tu veux m’en faire ? il plaisante.
— Si seulement je pouvais…
Il sourit.
— Je parle sérieusement. Tu y as déjà pensé ?
— Je ne sais pas trop.
— Rassure-moi, tu vas pas me quitter pour marier une nana et l’engrosser ?
— Et toi, tu en veux des gosses ?
— Je ne crois pas, je m’entends lui répondre.
— Et ben, moi non plus, alors. L’affaire est réglée.
Oui, cette affaire semble réglée. Mais toutes ne le sont pas pour autant. Car c’est sur d’autres sujets que notre histoire me semble être placée sur la même trajectoire que celle de Jack et d’Ennis. Comme la perspective de ne jamais pouvoir vivre notre relation au grand jour, de devoir toujours faire attention, surveiller nos arrières, du moins tant qu’il sera rugbyman professionnel.
Certes, nous avons des familles qui nous soutiennent. Mais je pense que Jérém ne voudra jamais qu’on s’installe ensemble. Dans un an, je vais terminer mes études, et chercher du taf. Je voudrais me rapprocher de Paris, me rapprocher de lui. J’ai essayé de lui en parler, mais il a botté en touche à chaque fois, en disant que nous sommes bien ainsi, que ce qui importe n’est pas la quantité mais la qualité des moments que nous passons ensemble.
Il a certainement raison. Les moments que nous passons ensemble, ce sont des feux d’artifices. Mais qu’il est sombre, triste et mélancolique, le ciel, entre deux de ces feux d’artifice !
Ce soir encore, nous faisons l’amour. Ce soir encore j’oublie mes questionnements et j’apprécie ce bonheur avec le garçon, avec l’homme que j’aime.
Le lendemain de l’anniversaire de Jérém, le nouveau single de Madonna, « Hung Up », est sur les ondes. Porté par une rhythmique splendide et sublimé par le fameux sample d’Abba, la chanson marche dans les pas des Géants, elle se situe dans les pas de Holiday, Express Yourself, Vogue, Frozen et American Life. Le clip révèle une Madonna magnifique et triomphante à l’aune de ses cinquante ans.
Novembre 2005.
Les obligations sportives et mondaines de Jérém sont de plus en plus nombreuses. En ce mois de novembre, nous n’arrivons pas à trouver un moment pour nous voir.
Heureusement, Madonna vient à la rescousse pour rattraper ce mois où la météo maussade ajoute une couche épaisse à ma tristesse. Le nouvel album « Confessions on a dancefloor » sort le 14. Les douze chansons du CD sont enchaînées à la façon d’une mixtape de DJ. C’est dansant, gai, ça donne une pêche folle. Le son est à la fois délicieusement rétro et résolument futuriste. C’est frais et éphémère comme un verre de soda glacé en plein été.
« Confessions on a dance floor » demeurera probablement à tout jamais le dernier album avec lequel Madonna a mis tout le monde d’accord. Ses fans de toute époque et de toute sensibilité, ses fans avec les Moldus, les consommateurs de musique « qui passe en radio », les Moldus avec les Détraqueurs de la critique, les Détraqueurs avec les Gobelins de l’industrie musicale. Fin 2005, Madonna était à la télé, à la radio, dans les journaux – et sur Internet aussi – comme à la grande époque de ses débuts. Un véritable coup de maître, inégalé à ce jour.
Décembre 2005.
L’avion survole la Manche, puis le Royaume Uni transversalement du sud au nord. Il atteint la mer du Nord lorsque le jour commence à décliner. Le ciel est assez dégagé pour nous permettre de voir des morceaux de glace flottant dans la mer.
Nous atterrissons à Reykjavik vers 17h00, et il fait déjà nuit profonde. Il y a de la neige. Pas beaucoup, une dizaine de centimètres, et elle est glacée. Et pourtant, il ne fait pas aussi froid qu’on ne l’aurait imaginé. Merci le courant du Golfe.
Jérém sourit, il est tout excité, un peu perdu, j’aime le voir comme ça.
L’aéroport de Reykjavik est un tout petit terminal. Les écrans sont vides, notre avion est vraisemblablement le dernier de la journée. D’ailleurs, les quelques boutiques et bars sont en train de baisser le rideau. A part nos compagnons de voyage qui s’empressent de quitter les lieux, le site est presque désert.
Nous louons une voiture et un GPS, ce dernier étant l’indispensable compagnon dans un pays aux toponymes littéralement imprononçables et qui ne comporte qu’une seule véritable route, celle qui fait le tour de l’île. Le reste du réseau étant constitué de pistes souvent non goudronnées.
L’hôtel est situé dans le centre de Reykjavik. A l’accueil, nous nous renseignons sur les « northern lights ». Le réceptionniste nous explique que pour que les aurores boréales se produisent, il faut une émission de particules solaires associée à un vent du nord. Aussi, il faut un ciel dégagé pour les observer. Ce soir, hélas, aucune de ces conditions ne sont réunies.
Nous sortons dîner. Nous nous baladons dans une rue animée de la capitale, et nous choisissons un établissement qui a l’air d’être un resto gastronomique islandais. L’ambiance est feutrée, chaleureuse. Le repas comporte beaucoup de poisson, et c’est plutôt bon. Le serveur est charmant, et ça, ça ne se refuse pas.
Un vent glacial balaie les routes lorsque nous quittons le restaurant. Le retour à l’hôtel se fait au pas de course, le vent soufflant dans notre dos. La chambre nous accueille, et nous nous réchauffons en faisant l’amour. Rien ne sait réchauffer le corps comme le torse de mon beau brun sur mon dos, comme sa queue coulissant entre mes fesses, comme ses mains saisissant mes épaules, mes bras, mes hanches, comme son souffle haletant dans mon cou, comme l’intense vibration de son orgasme. Tout comme rien ne sait réchauffer mon esprit comme ses baisers et ses câlins après l’amour.
A cette saison, en Islande, il fait plein jour à 11 heures. Quant à la nuit, elle tombe vers 17 heures, ce qui laisse 5-6 heures de lumière naturelle par jour. Tout cela à condition que le ciel soit dégagé, ce qui ne semble pas être le cas aujourd’hui. Non, le mois de décembre ce n’est pas la meilleure saison pour visiter l’Islande. Quoique, cette contrainte de la longue nuit n’est pas dénuée d’un certain charme. Et puis, si on veut voir des aurores boréales, c’est précisément à cette saison qu’elles se produisent.
A 9h30, il fait encore nuit noire. Nous avons choisi de voyager la nuit pour profiter de notre destination dès le lever du jour. La route que nous empruntons une fois quitté Reykjavik est verglacée et enneigée. De plus, une tempête de neige nous accompagne sans défaillir. Nous croisons une voiture tous les quarts d’heure environ, on ne peut pas dire que la circulation soit chaotique. Je me demande s’il faut bien continuer.
Après une heure de route, le ciel nuageux commence à laisser passer quelques timides rayons de lumière. Nos yeux sont éblouis par le paysage qui commence à se dessiner autour d’eux. Nous recevons de plein fouet toute cette beauté. Jérém est fasciné, et il ne cesse de s'émerveiller. Et moi avec lui. J'adore le voir emballé.
Je suis tellement heureux d’être ici avec Jérém. Cet endroit, me rappelle Campan, l’hiver. Je sens que ça va être un autre voyage mémorable en compagnie de mon beau brun.
Nous traversons le parc de Pingevillir. Le soleil commence à se lever et nous apercevons de vastes prairies grillagées peuplées de troupeaux de petits chevaux amassés au bord des clôtures pour se protéger du vent déchaîné.
Les quelques fermes sont espacées de parfois plusieurs kilomètres. On ne peut pas vraiment dire que l’agriculteur islandais soit gêné par son voisin. Nous devinons facilement que tout ce charme verglacé doit quand même être rude à assumer au quotidien.
Au fil des kilomètres, les prairies laissent la place à des espaces à l’aspect lunaire, où l’eau ruisselante et le minéral se livrent bataille et ne permettent aucune végétation spontanée. Nous réalisons qu’il n’y a pas d’arbres sur cette île, nulle part.
A l’entrée du site de Geysir, les panneaux explicatifs nous racontent que le grand jet original qui faisait jusqu’à 80 mètres d’envergure est aujourd’hui éteint. Mais qu’un jet plus petit, appelé Strokkur, d’une vingtaine de mètres, se manifeste toutes les cinq minutes environ.
Le site est parsemé de petits bassins où l’eau chaude circule. Une forte odeur de soufre monte aux narines. Et au milieu de tout ça, le fameux jet, la star du site, se prépare à nous éblouir. Avec pas mal d’autres touristes, nous faisons le pied de grue pour l’apercevoir.
Au fond du petit cratère, nous observons l’eau bouillonner, monter, refluer. Jusqu’à ce qu’une cloche d'eau d'un bleu turquoise se forme, grandisse jusqu'à exploser et se transforme en un puissant jet d'eau bouillante qui jaillit des entrailles de la Terre.
Geysir
En fin de matinée, nous reprenons la route en direction des chutes d’eau de Gulfoss. Sur le site, la météo est épouvantable. Lorsque j’ouvre la porte du véhicule, une rafale de vent me la renvoie à la figure. Le blizzard est terrible. Nous prenons notre courage à deux mains, nous passons blouson, gants, écharpe, bonnet, lunettes.
Gullfoss est une cascade spectaculaire de par sa taille et sa configuration. Il s'agit en fait de deux cascades successives sur la rivière Hvítá, se jetant dans un canyon glacé. Le rugissement de l’eau est saisissant. Le paysage est somptueux. La nature révèle toute sa puissance.
Un long escalier envahi par la glace conduit au plus près de chutes. Nous avançons lentement, car chaque pas est dangereux. Nous arrivons en bas de l’escalier et c’est sur les dernières marches que je glisse. Je me cogne les fesses, la tête, le coude.
Jérém vient à mon secours. Je me relève rapidement, mais je suis quand même sonné.
Gulfoss
Devant l’écume qui nous gèle le visage, nous nous faisons prendre en photo par un touriste.
Nous reprenons la route avec l’intention de rejoindre la côte sud avant la nuit pour trouver un hébergement. Car, à part pour la première et la dernière nuit, je n’ai pas fait de réservation. En effet, d’après le guide touristique que j’ai acheté pour préparer ce voyage, en Islande on trouverait des hébergements partout et leur emplacement serait très bien signalé. Et j’y ai cru.
Le guide nous indique des hôtels dans le sud, le long de la Route n. 1. Nous n’avançons pas vite mais l’après-midi, lui, oui. A 16h30, la nuit islandaise commence à déployer son manteau de ténèbres sur le magnifique paysage qui nous entoure.
Nous essayons d’appeler deux hôtels conseillés pas le GPS, sans succès. Dans un village près de la côte, nous trouvons enfin une chambre d’hôte. Sigga, la propriétaire, une dame plutôt avenante, nous propose même de nous faire à dîner. Pendant qu’elle s’affaire en cuisine, je lui demande si cette nuit est propice pour les aurores boréales. Elle se connecte à un site de prévisions, mais hélas, les conditions ne sont à nouveau pas réunies.
Sigga et son mari mettent tous les plats sur la table et s’asseyent avec nous. C’est la bonne franquette, et c’est super comme ça. A table, nous sommes interrogés sur nos activités en France. Lorsque Jérém parle de sa carrière au rugby, le mari de Sigga s’illumine. Car il adore le rugby. Et ça met une super ambiance.
Le soir s’étire autour de conversations diverses, mais le fait de ne pas tout comprendre et d’avoir du mal à s’exprimer ça fatigue son homme. Nous allons au lit de bonne heure. La maison est plongée dans le silence, nos hôtes sont partis au lit aussi. Ce soir, nous sommes épuisés et nous nous contentons de câlins. Qu’est-ce que j’aime être en vacances avec Jérém, et particulièrement dans ce pays où il ne risque pas d’être reconnu, où nous sommes comme seuls au monde !
Ici, loin de tout, le beau brun est détendu, heureux, fougueux, passionné. Tout ce que j’aime chez lui.
Le lendemain, nous empruntons à nouveau la fameuse Route n. 1 vers l’est. A notre droite l’océan, à gauche, la montagne, des volcans, des glaciers, des chutes d’eau. L’île est située sur une faille géologique, elle a été façonnée par les volcans et elle est encore jeune, elle frémit de toute part comme tout être jeune et gaillard.
Il n’y a pas de mots pour décrire Jokusarlon, un site situé au sud-est où le plus grand glacier d’Islande glisse lentement dans la mer. Même les photos ont du mal à restituer l'immensité du site. Les morceaux de glace flottant dans l’eau glacée prennent une couleur bleu azur complètement surréaliste.
Youkusarlon
Nous avons la chance inouïe d’assister à l’instant où un grand pan de glace décide de se détacher du glacier et de tomber au beau milieu du canal. Le craquement produit par cette puissante scission nous prend aux tripes, telle une démonstration de force de la nature sauvage et indomptée de cette île.
La chute de cet énorme bloc de glace provoque un grand remous dans le canal. Les petits icebergs s’entrechoquent. Et dans leur voyage vers la mer, ils fondent lentement.
Sur le retour, nous nous arrêtons sur le site de Svartifoss. Il est déjà le milieu de l’après-midi, nous devons nous dépêcher car les indications au parking indiquent quarante minutes de marche pour atteindre la chute d’eau. Plus nous avançons, plus le chemin est étroit, escarpé et verglacé. Jérém marche devant moi. Puis, à un moment je le vois tomber, atterrir sur ses fesses, et glisser tout droit vers le ravin. Il arrive à se rattraper de justesse à un buisson et à se remettre debout. Je me demande si c’est bien prudent de continuer.
— Nous sommes presque arrivés, alors nous n’allons pas renoncer si près du but ! tranche mon beau brun.
Il a raison. N’empêche que nous risquons l’accident à tout moment, avec la nuit qui n’est pas loin et à plus de trente minutes du parking.
Et là, au détour d’un virage, la cascade apparaît enfin. Et en effet, ça valait le détour. Derrière la chute d’eau, une conformation rocheuse rappelle de près la forme d’un orgue d’église. Cette cascade est particulièrement spectaculaire.
Svartifoss
Mais déjà à nouveau la nuit islandaise nous guette. Nous nous empressons de revenir au parking, et cette fois ci nous arrivons à éviter la glissade.
De retour chez Sigga pour la nuit, une belle surprise nous attend. Nos hôtes ont mis en route le jacuzzi. Après le dîner, nous sommes invités à le tester.
Voici le tableau : un soir de décembre, en Islande, un manteau de neige étalé partout autour de nous, il fait -2 degrés. Et Jérém et moi, dans un jacuzzi posé sous un abri dans le jardin et chauffé avec la chaleur du sol !
Si on pouvait craindre d’avoir froid, nos inquiétudes sont rapidement dissipées. L’eau est super chaude. C’est super agréable, et très romantique. C’est un instant parfait. Nous sommes si bien, et nous sommes seuls, nos hôtes nous ayant annoncé leur intention d’aller au lit. Jérém vient m’embrasser, longuement.
Ce soir encore, c’est raté pour les « northern light ». Mais un Jérém amoureux et amant fougueux, capable, en l’espace de quelques minutes, de gicler dans ma bouche et de recommencer entre mes fesses, est un « lot de consolation » plutôt agréable.
Le lendemain matin, après avoir dit au revoir à Sigga et à son mari, nous partons en direction de la presqu'île de Dyrhólaey et des falaises Reynisfjall.
Dyrhólaey
Alors que l’océan est déchaîné, nous descendons jusqu’à la plage de sable noir. Pendant que je prends la pose devant l’objectif de Jérém, une grande vague s’abat sur la plage et arrive jusqu’à nous. Comme à l’Ile de Ré, nous sommes trempés, mais nous restons encore quelques minutes pour assister au lever de soleil sur ce site unique.
Quelques heures plus tard, sur la route de la capitale le soleil se pointe enfin, il se fait sentir sur la peau à travers les vitres du 4*4. Sa lumière puissante fait briller la neige omniprésente autour de nous.
A l’approche de Reykjavik, d’immenses colonnes de vapeur jalonnent le paysage. Plus prosaïques, d’énormes tuyaux collecteurs d’eau chaude zigzaguent sur le sol pour acheminer la chaleur de la terre jusqu’aux foyers de la capitale.
Ce soir, une certaine mélancolie envahit mon cœur. Dans quelques heures nous prendrons l’avion qui nous amènera loin de cette terre faite d’eau, de feu, de roche, de glace, un lieu en équilibre précaire entre le jour et la nuit, la chaleur et le froid. Cette ambiance de bout du monde va me manquer.
Ce soir, une petite déception s’ajoute à ma tristesse. A l’hôtel on nous informe que cette nuit non plus il n’y aura rien à voir côté aurores boréales. Le ciel est dégagé, mais il n’y a pas le vent du nord et le soleil n’envoie pas ce qu’il faut.
Cette nuit, il n’y a que la présence de mon beau brun pour rendre ces dernières heures plus supportables. Sa fougue et sa tendresse sont pour moi aussi belles que des aurores boréales.Il va de soi qu'il est ABSOLUMMENT interdit de laisser le moindre commentaire

 9 commentaires
9 commentaires
-
Par fab75du31 le 14 Janvier 2023 à 19:10
Mars 2004.
Après la parenthèse enchantée de nos retrouvailles à Biarritz, nous reprenons chacun notre vie. Moi, celle d’étudiant, et Jérém celle de rugbyman professionnel. Deux trajectoires qui nous amènent à être loin l’un de l’autre le plus clair du temps. Jour après jour, la distance me pèse.
— Tu ne devrais pas pester contre la distance, car elle entretient la passion, me rappelle le sage Albert.
Il a raison, la distance crée le manque, l’absence fait le bonheur des retrouvailles, l’abstinence, le désir. Se revoir est à chaque fois un aboutissement, la présence de l’autre un cadeau inestimable.
Certes, entre deux retrouvailles, le temps est long. A vingt ans, on est impatient, surtout avec l’amour.
Mais j’ai appris à prendre sur moi. Ou, plutôt, à vivre avec. J'ai cessé de demander à Jérém ce qu'il ne peut pas me donner, une vie de couple assumée et affichée. Je respecte son besoin de discrétion au sujet de sa vie privée. Jérém s’assume en tant qu’homo, et il assume ses sentiments vis-à-vis de moi, il me les a montrés de la plus belle des façons. Et c’est déjà énorme. J’accepte qu’on ne puisse se voir qu’à certaines occasions et sous certaines conditions, quand il peut, comme il peut. J’apprécie à sa juste valeur cette invitation à Biarritz, ce rendez-vous délicieusement clandestin, non dénué de certains risques pour lui.
J’ai même accepté qu’au vu de la distance qui nous sépare, de la rareté de nos rencontres, et de la fougue de nos vingt ans, la fidélité des corps ne soit pas une obligation. J’ai accepté son besoin d'avoir des aventures. J’ai accepté parce qu’il est sincère avec moi, parce qu’il se protège, parce que j’ai appris à lui faire confiance. Parce que je ne veux pas l’obliger à s’abstenir, lui qui est exposé à tant de sollicitations. Et, surtout, je ne veux pas l’obliger à me mentir.
Entre nous, les choses sont claires, posées. Nous avons embrassé ce mode de vie parce que nous sommes désormais certains que les aventures d’un soir n’entachent en rien nos sentiments.
Oui, cette année il est annoncé que Madonna va réinventer sa musique dans un spectacle grandiose. Jérém et moi réinventons aussi notre relation. Et, là aussi, c’est un spectacle grandiose.
Même si nous nous voyons peu, en moyenne une à deux fois par mois, le premier semestre de l’année 2004 s’écoule dans un bonheur ininterrompu. Parfois, lorsqu’il n’a pas match le week-end, Jérém vient me rejoindre à Bordeaux. Aussi, je vais parfois le rejoindre à Paris ou dans la ville où il dispute son match.
Moi qui ne ressens qu’un intérêt très limité pour le sport, et encore moins pour le rugby, un sport que je trouve brutal, dangereux, pour les risques de blessures que chaque action représente, je suis heureux d’assister à ses exploits, de le voir si épanoui sur le terrain. J’adore entendre les stades l’ovationner, vibrer à chacune de ses actions. Et lorsque je lis dans la presse, ou j’entends à la télé, que le jeune espoir est en train de devenir un joueur confirmé, et l’un des meilleurs ailiers du Top16, je suis très fier de lui. Certains commencent même à parler d’Equipe de France. Je réalise que le garçon que j’aime est en train de devenir une véritable star du ballon ovale. Je suis à la fois heureux pour lui, et un peu inquiet. Je ne veux pas qu’il se brûle les ailes, je ne veux pas qu’il se blesse à nouveau.
Tout cet engouement de la presse, sportive et gossip, autour de mon bobrun me fait aussi un peu peur. Une partie de moi craint qu’il soit aspiré par ce monde, et qu’il s’éloigne de moi. Jérém est de plus en plus souvent invité à des soirées, à des réceptions, les sponsors se bousculent pour s’associer à sa notoriété. Les cadeaux s’empilent, l’argent rentre à flots. Pourvu que tout cela ne lui monte pas à la tête, pourvu qu’il ne fasse pas de bêtises, qu’il ne se laisse pas entraîner dans de mauvaises fréquentations. Pourvu qu’il ne touche jamais à la drogue.
Quand je suis présent au match, je ne le quitte pas un seul instant des yeux. C’est idiot, j’en conviens, mais j’ai l’impression que tant que mes yeux ne le lâchent pas, il ne peut rien lui arriver, il ne peut pas se blesser, il ne peut pas faire de conneries. Ma présence n’empêche rien, mais ça me rassure.
Il y a d’autres raisons qui me motivent pour aller le rejoindre dans la ville où il dispute son match du week-end. J’aime tout particulièrement les retrouvailles sexuelles après la compétition.
Quand le match s’est bien passé, quand son équipe a gagné, Jérém est euphorique. Son ego de mâle, galvanisé par la victoire et flottant sur les vapeurs de l’alcool ayant coulé lors de la troisième mi-temps, déborde d’envie de transformer l’essai de son triomphe sportif sur un autre terrain, dans un pieu, dans ma bouche, dans mon cul.
Quand le match ne s’est pas bien passé, quand l’équipe a perdu, Jérém est déçu, le moral dans les chaussettes. Son ego de mâle, malmené par la défaite et flottant là aussi sur les vapeurs de l’alcool ayant coulé lors de la troisième mi-temps, a besoin d’un dérivatif, a besoin de défouler sa frustration sur un autre terrain, au pieu, dans ma bouche, dans mon cul.
Dans tous les cas, la victoire comme la défaite rendent sa virilité bouillonnante.
Dans tous les cas, je suis là pour ça, pour permettre à sa virilité et à ses besoins de jeune mâle fringuant de s’exprimer.
Dans tous les cas, je prends cher, je prends dans la bouche, je prends entre mes fesses, plusieurs fois pendant la nuit après le match.
Jérém me possède d’une façon dont lui seul a le secret.
— J’adore ton cul… j’adore baiser ton cul ! il me glisse parfois, lorsqu’il approche de l’orgasme.
— J’adore ta queue !
— Tu la sens bien là ?
— Oh oui, je la sens bien, très bien…
— Elle est bonne ?
— Oh putain, que oui, elle est très bonne !
— Je te baise bien, hein ?
— Tu fais ça tellement bien !
— Je vais jouir…
— Fais-toi plaisir !
Satisfaire mon homme est le bonheur ultime. Le voir, l’entendre, le sentir prendre son pied, avoir son goût dans ma bouche, savoir qu’il a joui entre mes fesses, sentir son odeur sur moi, en moi, voilà autant d’occasions de bonheur sensuel.
J’adore aussi le regarder dormir après le plaisir, j’aime le savoir satisfait de son match, de son jeu, de sa baise et de sa queue.
L’écho du bonheur sensuel de ces week-ends, de ces quatrièmes mi-temps, retentit en moi pendant les jours qui suivent. Lorsque plusieurs centaines de bornes me séparent à nouveau de Jérém, mes lèvres, ma langue, mon palais et mon cul gardent le souvenir de la présence, du gabarit, du passage de son manche raide, de sa puissance, de son insolence.
Oui, le sexe avec Jérém est à chaque fois un feu d’artifice. Et il l’est d’autant plus depuis que je réalise qu’avant de faire plaisir à un très beau garçon, j’aime faire plaisir au garçon que j’aime.
Samedi 24 avril 2004.
Ce week-end-là, Jérém n’a pas match. Et il me propose de passer le week-end à l’Île de Ré. Nous nous rejoignons à la Rochelle, je gare ma voiture et je prends place à côté de mon beau brun. Je suis heureux de le revoir, et je le suis d’autant plus que c’est lui qui a eu l’initiative de cette escapade.
La première chose qui me saisit en arrivant à l’Île de Ré, c’est cet ouvrage de malade qu’est le pont qui relie l’île au continent. Pendant la traversée, je suis happé par le dégradé vert gris de l’océan, par une intense sensation de dépaysement, d’ailleurs. Le ciel gris, maussade se confond avec l’eau.
Il n’y a pas encore grand monde à cette saison sur l’Île, ce n’est pas encore l’heure de la grande invasion estivale.
Nous nous baladons longuement sur la plage, nous marchons lentement sur le sable fin tassé par l’océan, nos pas rythmés par le bruit du ressac. Le reflet inattendu d’un soleil provisoire arrive à se frayer un chemin parmi les nuages et à poser sur l’océan une robe d’une couleur qui oscille entre le marron et l’orange.
Je suis fasciné par le vol des mouettes, par le mouvement lent de quelques petits bateaux blancs posés sur l’eau, autour de ce pont comme suspendu entre ciel et mer.
Pendant le week-end que nous passons sur l’Île de Ré, il ne cesse jamais de pleuvoir pendant plus d’une demi-heure. C’est une pluie fine, insistante, morose, une pluie qui minerait le moral, si la beauté de cette île, certes mélancolique mais époustouflante, n’était pas là pour en mettre plein la vue. Et puis, quand on est amoureux comme je le suis à cet instant, on a le soleil dans le cœur, et ses rayons jaillissent à tout instant projetant sa lumière et sa chaleur partout autour. Il fait toujours beau, tout est beau à l’Île de Ré quand l’homme que vous aimez se balade à côté de vous, quand vous voyez le désir et l’amour dans ses yeux.
Demain ce sera lundi et chacun partira de son côté. Je sais déjà qu’il va me manquer. Mais j’ai appris à profiter et à jouir de ces moments d’éternité sans les gâcher avec les questions et les peurs que demain peut susciter. Jérém aura été dans ma vie une incroyable leçon de lâcher prise.
Nous montons au phare des baleines. Après une longue ascension, nous pouvons apprécier pleinement la puissance de l’océan déchaîné. A Biarritz, Cap Breton, Bordeaux, l’océan est toujours impressionnant. Mais le côté sauvage de l’Île de Ré, ce côté hors du temps et de l’espace, cette sensation de bout du monde, ajoutent de la magie à cette puissance.
Nous redescendons sur la plage. Le vent souffle très fort, les vagues sont de plus en plus violentes Nous nous faisons surprendre comme des gamins par une vague plus forte, nous nous faisons éclabousser, nous nous retrouvons avec les chaussures et les jeans mouillés. Ça nous amuse, et ça nous fait rire aux éclats, je ris comme quand j’étais enfant, je crois que sur cette plage nous redevenons enfants.
Jérém se pose, s’allonge carrément sur le sable. Nous sommes seuls sur la plage, je me glisse sur lui, je l’embrasse, nous nous embrassons longuement.
A la Flotte-en-Ré, nous faisons un tour sur le petit port, avec ses quelques bateaux à quai, ses mouettes posées sur la rambarde en pierre, alignées face à la mer dans l’attente d’un vent favorable pour prendre l’envol. Avec sa bande son si particulière dans laquelle se mélangent les clapotis de l’eau, le souffle du vent, le cliquetis métallique produit par une corde de voilure que le vent fait taper contre un mat, celui plus sourd d’une passerelle qui se frotte à un ponton. C’est la voix de l’Île de Ré. Une île qui sommeille encore après le départ des touristes à la fin de l’été et qui ne se réveillera vraiment qu’à l’arrivée de la belle saison.
Au fond du cheminement du port, je sens sa main se poser sur mon épaule. Le petit phare comporte un petit creux dans le mur qui nous met à l’abri de tout regard. Sa main saisit mon blouson, Jérém me pousse contre le mur en pierre. Il se tient là devant moi, beau comme un Dieu, ses mains posées fermement sur mes épaules, dans ses yeux ce regard de garçon amoureux qui me rend fou, avec cette tendresse qui vaut mieux que mille paroles. Et puis il approche son visage du mien, ses lèvres des miennes, et il m’embrasse. Nous sommes là, en train de nous bécoter comme deux ados pendant que la mer se déchaîne autour de nous, pendant que les mouettes s’envolent avec leurs cris perçants.
Entre deux retrouvailles avec Jérém, je continue mes études. Après presque une année loin de la fac, je retrouve la vie étudiante, et cela me plaît bien. Je retrouve Monica, Cécile, Fabien, Raphaël. Je me laisse parfois entraîner par ce dernier à des fêtes étudiantes où je bois un peu, où je m’amuse enfin.
Aussi, il m’arrive de croiser des garçons dans la rue, à la fac, dans des soirées, d’accrocher leur regard, d’y voir, ou d’imaginer, des désirs, des promesses.
Il semblerait que lorsque nous sommes bien dans notre peau cela rayonne à l’extérieur de nous et attire les regards et les désirs. Je dois avoir l’air vraiment bien dans ma peau, car j’ai parfois l’impression de me faire mater, chose qui ne m’arrivait que très rarement auparavant. Ou dont je n’avais pas conscience auparavant. Oui, il est possible que j’aie appris à mieux regarder.
Il m’arrive de sortir dans des boîtes pour garçons et de m’amuser avec des regards « moins risqués ». Je laisse parfois ces regards devenir des rencontres, du sexe, mais jamais de l’attachement. Je prends du plaisir, tout en pensant à chaque fois à ce que je n’ai pas avec un inconnu, ce que seul Jérém sait me donner. A savoir, le bonheur des sens couplé à celui de la tendresse, à celui de l’amour.
Jérém est l’unique, il est l’Elu de mon cœur. Je réalise enfin la nature et la portée de ce changement qui s’opère en moi depuis l’accident de Jérém, j’arrive à identifier cette sensation qui m’avait saisi à Biarritz.
Jusqu’à il n’y a encore pas longtemps, à chaque fois que je croisais un beau garçon, je me sentais ravagé par le désir, j’avais à minima envie de l’avoir en bouche, je ressentais une irrépressible envie de le faire jouir d’urgence.
Mais cette année a bousculé tant de choses. Désormais, lorsque je croise un beau garçon, si mon regard est toujours irrépressiblement attiré, voilà que mon désir, pourtant toujours présent, semble plus apaisé. Avant, croiser un beau garçon inaccessible provoquait en moi comme une douloureuse blessure. Désormais, le bonheur que m’apporte la présence d’un beau garçon est plus un fait de tendresse et de bienveillance. C’est comme si dans mon esprit il n’y avait plus la place pour désirer de façon ravageuse. Je ne m’enflamme plus comme avant. Désormais, l’amour de Jérém comble mon cœur. A moins que ce ne soir l’amour que je porte à Jérém qui fait cela.
Si j’ai des aventures, c’est parce qu’à vingt ans, le corps demande à exulter. Mais à chaque fois, je me dis qu’en réalité cela ne m’apporte pas ce dont j’ai besoin. Car, ce dont j’ai besoin, un seul garçon sait me l’apporter.
Ainsi, après l’excitation des sens, après le plaisir, la frustration du cœur revient à chaque fois, et elle est dure à affronter. Alors, les aventures perdent peu à peu d’intérêt à mes yeux. Au fond, je commence à comprendre que je peux plaire. Et cela me suffit pour me sentir bien. Désormais, concrétiser est accessoire.
Un jour, j’ai envie d’appeler Ruben pour savoir comment il va. Nous nous revoyons dans un bar, autour d’un café qui se prolonge pendant tout un après-midi. Le petit Poitevin semble aller plutôt bien, il a l’air serein. Il est toujours célibataire, mais ça ne lui pèse pas. Il n’a pas du tout l’air de m’en vouloir pour notre rupture. Au contraire, il me questionne sur ma relation avec Jérém. Je lui en parle en essayant de ne pas trop étaler mon bonheur, mais il comprend que je suis amoureux et il semble sincèrement ravi pour moi. Ravi et bienveillant comme le serait un ami. Je crois que nous sommes devenus amis. De notre ancienne relation demeure une certaine complicité, pourtant dénuée de toute ambiguïté. D’ailleurs, il me propose de refaire du vélo, si je le souhaite. Je ne refuse pas, mais je ne m’engage pas non plus. Je préfère en parler à Jérém avant, et sonder sa réaction.
— Tu fais ce que tu veux, Nico, tant que tu ne fais pas de bêtises… voilà sa sentence.
Là où, par bêtises, je comprends « tant que tu ne tombes pas amoureux de lui ».
Je recommence alors à faire du vélo. Les sorties nature avec Ruben et son assos sont amusantes et enrichissantes. Je me sens bien avec ces gens passionnés et bienveillants. Comme toujours, ils me rappellent la bande de cavaliers de Campan. J’ai tellement envie de retourner à Campan avec Jérém.
Un jour, sur un panneau d’affichage de la fac je tombe sur une annonce à propos du recrutement d’un rédacteur pour le journal étudiant de la fac. Cela m’a intéressé. J’ai appelé le contact indiqué sur l’affiche, et la nana qui m’a répondu a été très accueillante. Dès le lendemain, je rencontre Sophie, ainsi que ses quelques collègues au journal. Deux jours après, je commence à écrire. Je parle d’événements en lien avec la vie étudiante, des assos présentes sur le campus. Ce ne sont que des articles de service, mais cela occupe mon temps et mon esprit. L’écriture devient un petit refuge où je me sens bien.
Peu à peu, le goût de l'écriture me gagne. Je recommence à écrire sur Jérém, sur notre histoire. J’avais commencé il y a un an, puis l’accident de Jérém avait complètement bousculé les priorités de ma vie. Mais les souvenirs des trois dernières années me sont si précieux que j’ai envie de les fixer noir sur blanc.
La saison de rugby touche à sa fin, le Stade Français remporte haut la main les matches des deux dernières journées de qualification contre Clermont Ferrand et Colomiers.
Jérém est revenu au meilleur de sa forme et match après match ses exploits se succèdent avec une régularité exceptionnelle. En phase finale du Top 16, les deux Stades se retrouvent dans la même poule, la B. Pour la première fois, les anciens coéquipiers, les deux meilleurs potes, Jérém et Thib vont pouvoir jouer l’un contre l’autre dans un grand match de championnat.
Quand je pense qu’il y a un an Jérém était au plus mal, je mesure le chemin parcouru depuis et ça me donne le vertige.
Début mai, Jérém me propose d’aller voir le match à Toulouse. Quand je pense qu’il y a trois ans Jérém n’admettait même pas qu’il prenait son pied à coucher avec moi, je mesure le chemin parcouru depuis, et ça me donne aussi le vertige.
Je repense à la première fois où j’ai vu Jérém, le premier jour du lycée, à ce premier regard qui m’a foudroyé. Ma vie a commencé ce jour-là, à cet instant-là. Je plains ceux qui n'ont jamais ressenti cela, l'intensité d'un regard, le déchirement d'un désir qui tente de faire son chemin sur un terreau de timidité et de crainte, tel une graine qui tente de germer sur un terrain hostile.
Ce désir, tout comme cette graine, est tenace. Dans les deux cas, cette ténacité est un instinct de vie, une aspiration au bonheur.
Samedi 15 mai 2004.
Le match se joue au Stade Ernest Wallon, le haut lieu du rugby toulousain. C’est un retour aux sources pour mon beau brun, un retour dans sa ville natale, comme un retour d’exil, dans le stade de l’équipe dont il rêvait de faire partie mais qui n’a pas voulu de lui.
Evidemment, j’ai fait le déplacement, je ne pourrais rater pour rien au monde un match où Jérém et Thibault s’affrontent. Je sais que Jérém tient à ma présence dans les gradins. D’ailleurs, il a réussi à m’obtenir un placement au bord du terrain juste à côté de l’entrée des équipes.
Ce samedi sur la pelouse du stade des Sept Deniers, c’est le choc des Titans. Deux équipes, probablement les plus fortes du Top16 s’affrontent, à un pas des demi-finales. Des joueurs, et parmi eux des fleurons du rugby français, vont se mesurer sans rien lâcher. Le choc est tel que le stade vibre, tremble, tangue à chaque action, à chaque passe. L’effervescence de l’assistance est palpable, les ovations des supporters font trembler les gradins.
C’est beau de voir les deux potes sur le terrain, eux qui ont longtemps joué dans la même équipe, les voir jouer l’un contre l’autre. J’ai l’impression qu’ils jouent merveilleusement bien.
Je sais que Jérém se met la pression comme jamais, je sais qu’il a envie de gagner comme jamais, qu’il a envie de prouver à ceux qu’ils n’ont pas voulu de lui, et dans leur propre fief qui plus est, qu’ils ont fait une belle connerie. Jérém a besoin d’une revanche.
Pendant deux mi-temps intenses et riches en rebondissements les points sont marqués, arrachés, emportés dans l’effort et la transpiration. Et à la fin du temps réglementaire, le tableau affiche un score de 18-24 en faveur des Parisiens.
Ça y est, Jérém tient sa revanche. Une victoire que lui et ses coéquipiers sont allés chercher au prix d’un match sans répit, une victoire que les Toulousains n’ont laissé filer qu’après de vaillants efforts.
A la fin du match, l’image de Jérém et de Thibault qui se prennent longuement dans les bras l’un de l’autre est très émouvante. Thibault sourit, il a l’air ému et heureux pour la victoire de son pote. Une victoire aussi importante que si c’était la sienne, ou peut-être un peu plus encore.
Un journaliste attaque Jérém et Thibault à la sortie du terrain. Les deux belles gueules viriles des deux potes s’affichent sur les écrans du stade.
— Alors, Tommasi et Pujol, ça fait quoi de jouer l’un contre l’autre, alors que vous avez grandi ensemble, que vous avez été formés ensemble au rugby ?
— Un pur bonheur ! fait Thibault sans hésiter.
— Même si le match a été remporté par l’équipe adverse ?
— Le match a été beau, dur et prenant, on s’est battu jusqu’à la dernière minute… c’est un plaisir d’affronter des adversaires de cette envergure, commente le jeune papa.
— On a gagné, mais ils n’ont pas perdu, fait Jérém.
— Maintenant, l’objectif est de viser le haut du classement de votre poule…
— Bien sûr ! font les deux potes en chœur.
— Et remporter les demi-finales contre les équipes les mieux classées de la poule A…
— Et nous retrouver en finale ! fait Jérém, euphorique.
— Et on va vous mettre une bonne raclée ! plaisante Thibault.
— Rêve toujours ! fait mon beau brun.
— En tout cas, on vous souhaite à tous les deux le meilleur pour la suite…
Les deux potes se serrent la main, puis se prennent dans les bras l’un de l’autre. C’est beau, et bien plus que ça. Je trouve grisant de savoir que ces deux garçons ont un secret que toute cette foule ignore et dont je suis l’un des rares détenteurs. Je veux bien évidemment parler du fait qu’en dépit des apparences, des histoires d’amourettes sur les journaux pour l’un, d’un enfant pour l’autre, en dépit d’allures on ne peut plus viriles, l’un comme l’autre aiment les garçons, qu’ils ont déjà couché avec des garçons, dont moi, et même qu’ils ont déjà couché ensemble.
Aujourd’hui, ce samedi 15 mai 2004, après 80 minutes d’effort sportif et de jeu tout aussi spectaculaire que respectueux, ces deux garçons sont élevés au statut des « héros » par leurs co-équipiers, par leurs supporters, par leurs managements respectifs, ils sont même tenus en grand respect par les joueurs et les supporters de l’équipe adverse. Je ne peux m’empêcher de me demander s’il en serait de même si leur secret s’ébruitait.
Et alors que leur accolade prend fin, je suis happé par l’image de leurs maillots tendus sur leurs pecs se soulevant au rythme d’une respiration encore accélérée par l’effort sportif, de leurs brushings un peu malmenés par les exploits, de leurs fronts, de leurs cous, de la naissance de leurs pecs perlant de transpiration, par la sensualité qui se dégage de l’un comme de l’autre à cet instant précis.
Cette respiration après l’effort, ces brushing un peu défaits après l’exploit, cette transpiration perlant de leur peau, cette sensualité inouïe du corps qui a tout donné, je la retrouverai quelques heures plus tard, après la quatrième mi-temps, dans l’appart de Thibault, après que les deux potes se soient joui dans le cul à tour de rôle, après qu’ils aient joui dans le mien l’un après l’autre. Une fois de plus, nous fêtons une grande occasion en passant la nuit à nous offrir du plaisir.
Début juin, je valide mes semestres sans trop de difficulté. Entre un match et l’autre, Jérém a lui aussi retrouvé le chemin des cours. Certes, son statut de sportif étudiant lui simplifie pas mal la tâche, mais je vois bien qu’il y met du sien aussi. Ça passe de justesse, mais ça passe, et c’est le plus important.
Les deux Stades se classent bien en tête de leur poule. Le 19 juin, à Lyon, le Stade Français s’impose face à Bourgoin. Ça semble bien engagé pour une finale de Top 16 entre les deux Stades. Jérém et moi nous rendons le lendemain à Montpellier pour assister au match Stade Toulousain-Perpignan. Hélas, la rencontre ne se passe pas comme prévu, en tout cas pas comme nous l’avions souhaité. Après deux mi-temps difficiles, les Haut-Garonnais s’inclinent face aux Frontaliers.
Samedi 26 juin 2004.
La finale du championnat de rugby se joue au Stade de France, rien de moins.
Une fois de plus, Jérém a réussi à obtenir des places de premier choix, en tribune Est, catégorie basse. Je dis bien « des places », car il a invité Papa à venir aussi. Evidemment, Papa était aux anges, et il ne s’est pas fait prier pour faire le déplacement dans la capitale. Je suis heureux de partager ce moment avec lui. Et évidemment, pour cette occasion spéciale, Jérém a également prévu des places pour son père et son jeune frère Maxime. Et Thibault, Thierry et Thomas, bien entendu, ses meilleurs potes de Toulouse. Nous sommes tous là, réunis pour cette occasion spéciale, alignés en brochette sur le même rang.
Habitué à voir jouer Jérém dans des stades de 20-30000 places, je suis scotché par la démesure de l’immense enceinte aux 80000 places. Des places qui se remplissent jusqu’à la dernière. Le brouhaha et l’effervescence de ce genre d’endroit, d’une foule aussi immense sont étourdissants.
Je repense à la première fois où je suis allé voir jouer Jérém à Toulouse, peu après notre première révision. Je me souviens y être allé avec ma cousine, et avoir profité de l’occasion pour faire auprès d’elle mon tout premier coming out. Je me souviens de sa tête quand je lui avais annoncé que je couchais avec cette bombasse de Jérém, je me souviens de son air dépité, puis de sa bienveillance à mon égard. De sa mise en garde, de sa recommandation de ne pas tomber amoureux d’un gars « comme lui », un gars qui ne s’assumait pas et qui me ferait souffrir à coup sûr. Que de chemin parcouru depuis, du petit stade de quartier à Toulouse au Stade de France, des baises de l’appart de la rue de la Colombette à l’amour intense à chacune de nos retrouvailles, depuis le garçon qui ne s’assumait pas au Jérém d’aujourd’hui qui admet pleinement ses sentiments pour moi.
Le début du match est imminent. Le stade gronde, son impatience et son excitation montent de plus en plus. Les tribunes vibrent. Je vibre avec, ça provoque en moi des montées d’adrénaline, ça me donne la chair de poule. L'ambiance de fête me fait perdre pied.
Lorsque les joueurs rentrent enfin sur la pelouse, ils sont accueillis par une ovation qui a la puissance d’une déflagration. Jérém n’a pas du tout l’air intimidé par l’immense enceinte et par la foule surexcitée.
Le match démarre et mon beau brun semble au meilleur de sa forme. Il est rapide comme le vent, il est adroit, rusé, malin, habile, stratège. Sa connexion avec les autres joueurs est parfaite, avec Ulysse en particulier, et ça fait des miracles. Il ne rate aucune action, il marque des points en nombre, et les essais sont quasi systématiquement transformés.
Le match se termine avec une victoire nette pour le Stade Français, 38-20. Dans une longue, assourdissante, interminable ovation, le Stade de France fête les champions de tout un pays.
Quelques minutes après la fin du match, les joueurs de l’équipe gagnante s’alignent au milieu du terrain.
L’année dernière au Stade de France, Jérém rongeait son frein en costard cravate, et il soulevait le Brennus juste pour l’honneur, soutenu par les bras puissants d’Ulysse. Cette année il soulève son véritable premier bouclier de Brennus, bien assuré sur ses pattes, après avoir bien mouillé le maillot, devant une foule en délire.
Son regard à cet instant est émouvant au possible. Il y a de l’incrédulité, de l’éblouissement, de l’émerveillement. C’est le regard d’un gosse à Noël. Il y a une joie immense, mais aussi des larmes d’émotion que les écrans géants montrent impudiquement à de milliers de spectateurs.
J’ai l’impression que le stade tout entier applaudit et félicite le champion qui revient de loin. Et parmi les 80000 paires de mains qui claquent avec ferveur, celles de la petite délégation toulousaine tapent avec encore plus d’énergie que les autres, avec plus de bienveillance et d’affection. Même Thibault, qui rêvait lui aussi de soulever ce bouclier, est visiblement ému par le triomphe de son Jé.
— J’aurais tellement aimé jouer ce match contre le Stade Français, il me glisse.
— Tu aurais aimé soulever le Brennus à sa place ! lui lance Thierry qui a entendu ses mots.
— Peu importe qui aurait soulevé le Brennus. J’aurais surtout aimé jouer cette finale avec Jé.
— L’année prochaine, ce sera la bonne ! Je vois bien une finale Stade Toulousain contre Stade Parigot, et le Brennus qui revient à Toulouse, sa place de droit ! s’avance Thierry.
Hélas, ses prévisions se révéleront largement inexactes. Jamais les deux potes ne se retrouveront en finale du Top16. Déjà, parce que, pendant des décennies, les deux Stades n’accéderont pas en même temps à la finale de ce championnat qui sera bientôt rebaptisé le Top14. Aussi, parce que la carrière de l’un des deux potes s’arrêtera brusquement deux ans plus tard, au terme de la saison 2005-2006.
Nous attendons Jérém à la sortie du stade. Lorsque le champion apparaît enfin, sa première accolade est pour son père. Un père qui est comme jamais ému, comme jamais fier de son fils.
[Ton père ne t’a pas quitté des yeux depuis le coup de sifflet final. Tu le prends dans tes bras et l'étreins de toutes tes forces. Tu lui cries à l'oreille : « On est champions, Papa ! On est champions ! ». Aujourd’hui, ton père a un sourire d'enfant. C’est la première fois qu’il a ce sourire. Et c’est la première fois que tu vois dans son regard cette fierté, cette reconnaissance, ce respect. Aujourd’hui, ton père, tu l’as impressionné. Tu as réalisé tes espoirs et tes rêves les plus fous, et aussi les siens, par la même occasion. A cet instant précis, tu te sens sur un pied d'égalité avec lui. A cet instant précis, tu te sens aimé comme jamais auparavant].
L’étreinte entre les deux Tommasi s’étire, comme si l’un et l’autre avaient besoin de faire retomber la pression, de faire cesser les larmes avant de s’éloigner. La mère de Jérém nous a rejoints, et l’accolade suivante lui est destinée. Vient ensuite le tour de Maxime, puis de Thibault, et de ses autres potes. Chacun a droit à une accolade, à quelques mots. Jérém vient serrer la main de Papa, il est en larmes, Papa aussi. L’image de Papa qui serre Jérém dans ses bras m’émeut encore plus que tout ce qui a précédé.
La dernière accolade m’est destinée. Jérém me prend dans ses bras et il me serre très fort et très longuement contre lui. Sa joue et ses lèvres se posent dans le creux de mon épaule, dans un abandon total, comme s’il s’en foutait qu’on ne soit pas seuls, mais devant ses potes, devant sa famille, un stade tout entier, des caméras.
— Merci Nico, merci, je t’aime Nico, il me chuchote dans le creux de l’oreille.
Juillet 2004.
Après, c’est l’été. Un autre été que je passe avec Jérém. La première étape de nos vacances est Campan. Je retrouve avec bonheur la petite maison, la bonhomie des cavaliers. Jérém est fêté pour sa victoire en Top 16.
— Je te l’avais dit que tu reviendrais au top ! lui lance JP, en le prenant dans ses bras.
— Au top et au-delà de tout espoir ! Un bouclier de Brennus à ta première saison ! Ça c’est un exploit ! le félicite Daniel à son tour.
— C’était pas ma première saison… se défend mon beau brun.
— Avec le Racing, c’était une saison de rodage. La saison dernière, tu ne l’as jouée qu’à moitié. D’ailleurs, cette dernière aussi tu ne l’as jouée qu’à moitié. Donc, ça fait bien une année, ta première année ! insiste Daniel.
— Tu as une curieuse façon de voir les choses… ça doit être le troisième pastis sans eau qui parle à ta place… le casse Lola.
— Ça doit être ça, ma belle…
Le lendemain, nous partons en balade à cheval avec Charlène. Je retrouve avec plaisir ma monture tout terrain et tout confort, la Tequila internationale. Je retrouve le dépaysement de la forêt, de la position en hauteur, l’odeur du cuir, de la transpiration du cheval, l’ivresse de la vitesse, les sensations du contact avec l’animal, le ressenti de ses mouvements. Le bonheur de voir Jérém sur Unico, d’évoluer dans un environnement naturel, sauvage, de retrouver un Jérém nature, pur, en lien avec son enfance. Je passe un magnifique après-midi. Nous passons un magnifique après-midi.
Mais au retour de notre balade, Charlène nous livre une nouvelle qui est de nature à saper notre bonheur. Elle nous annonce que, faute de repreneur, elle compte faire valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année et fermer le centre équestre.
Jérém est décontenancé, il a l’air perdu et attristé.
— Ne fais pas cette tête, je ne vais pas t’obliger à replacer tes chevaux, ils peuvent rester. Mais je vais arrêter les balades, et je ne renouvellerai plus les chevaux qui partent. Je vais garder une dizaine de chevaux, histoire de compléter ma retraite.
— Mais tu vas continuer à monter ?
— Oui, tant que mon genou me le permet.
— Ça va plus être pareil…
— Qu’est-ce qui ne va plus être pareil ?
— Cet endroit. S’il n’y a plus de balade, plus d’animation, plus de jeunes chevaux, plus de jeunes cavaliers…
— Il y a un temps pour tout. Je suis fatiguée, je ne vais pas continuer et m’user jusqu’à la corde !
— Oui, je sais.
— Je sais tout ce que ce centre a représenté pour toi…
— Ce qu’il représente toujours…
— Je sais, mon Jérémie. C’est pas faute d’avoir cherché un repreneur. Mais il faut se rendre à l’évidence.
— Stéphanie n’est toujours pas intéressée ?
— Ma fille n’est pas faite pour ça…
— Et ton ouvrier non plus ?
— Marc est doué avec les chevaux, mais il est trop jeune pour chapeauter tout ça.
— Et si je le reprenais moi, ton centre équestre ?
— Tu n’as pas le temps de t’occuper de ça, t’as bien d’autres chats à fouetter !
— Je reprends à mon compte, et tu gères.
— Ça ne changerait rien, je n’ai plus l’âge de me taper tout le taf.
— Embauche quelqu’un d’autre. Forme-le. Transmets-lui ton savoir-faire des chevaux, de la gestion du centre. Je reprends l’affaire. Etudie une solution, je te suivrai.
— Il faudrait déjà que ce soit viable, il ne faut pas que ce soit une charge pour toi.
— Ça l’a été pour toi, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour moi.
— Ça demanderait une réorganisation de fond en comble…
— Je te fais entière confiance, Charlène.
— Tu es sûr de toi, mon garçon ?
— Très sûr.
— Ecoute, je ne te promets rien, mais je vais y réfléchir.
— Moi, c’est tout réfléchi !
— L’idée me séduit aussi…
— Alors réfléchis bien. Il faut que cet endroit continue de vivre.
Jérém m’émeut. A Campan, il est tellement touchant. Son âme de gosse refait surface et c’est son cœur qui guide ses actes. Et ça, ça me fait fondre. Ça, ça m’accroche à lui au-delà de tout, de l’attirance, du sexe. C’est ce qui se tapit dans l’ombre de sa virilité qui me plaît outre mesure. Ça a toujours été le cas, au final. Sauf qu’avant, j’en étais moins conscient.
Pendant que nous prenons la route pour La Mongie, la radio passe une chanson que j’ai découverte en partant de Biarritz quelques mois plus tôt et qui me vrille les tripes à chaque écoute depuis :
So why don't we go
Alors pourquoi n'allons-nous pas
Somewhere only we know ?
A un endroit qui n'appartient qu'à nous ?
Aujourd’hui notre relation n’est plus autant semée d’embûches qu’elle ne l’était il y a encore un peu plus d’un an. Aujourd’hui, tout va bien entre nous, je n’ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et pourtant, Campan est toujours ce lieu qui n’appartient qu’à nous, notre petit Paradis à nous. Campan a été l’endroit où Jérém m’a embrassé pour la première fois, où il s’est excusé pour la première fois de m’avoir fait du mal, où il s’est assumé et où il a assumé notre amour en public, la première fois où il m’a dit « je t’aime ». C’est un endroit qui dégage une sorte de magie qui met à nu l’âme de Jérém et qui me rend encore plus follement amoureux de lui que je le suis d’ordinaire. Et c’est pas peu dire. Oui, Campan est un endroit qui a été spécial, qui l’est toujours, et qui le sera toujours.
La montée en voiture jusqu’à La Mongie est du genre bucolique, avec ces vaches errantes en bord ou même sur la route. L’arrivée au village l’est aussi, avec des lamas qui divaguent en toute liberté autour des guichets du téléphérique.
Le voyage en télécabine est à couper le souffle. On s’envole vers la cime, et on a l’impression de s’envoler vers le ciel. Le village s’éloigne, le vide que nous laissons derrière nous est impressionnant.
Et puis, il y a l’arrivée, là-haut. Là-Haut, on a l’impression d’être suspendus dans le ciel, en apesanteur, de flotter sur l’air frais des sommets.
Le site autorise une vue à 360 degrés sur la chaîne des Pyrénées, les balcons suspendus sur le vide permettent d’admirer un paysage de pierre et d’eau où le travail de l’homme est à la fois impressionnant et discret. Les coupoles géantes abritant les instruments d’observation se fondent à merveille dans cette scénographie majestueuse.

Oui, tout est à la fois beau et impressionnant là-haut. La vue, le charme brut et puissant des éléments, la table d’orientation indiquant les noms des pics, où je retrouve de nombreux noms associés aux étapes les plus redoutables du Tour de France, le petit lac en contrebas dons les eaux sont d’un bleu profond.
Mais aussi, la prouesse que représente cette construction à cette altitude, sur ce pic rocheux, à une époque où les moyens n’étaient pas ceux d’aujourd’hui. C’est la même sensation empreinte d’ébahissement et d’admiration que je ressens devant les grandes constructions du passé, celle que j’ai ressentie à Rome, à Florence, à Notre Dame, à Versailles, au Louvre.
J’essaie de m’imaginer la détermination et la bravoure des pionniers qui sont venus ici et qui ont bâti cette merveille avec leurs bras, leur sueur, leur jeunesse, et ça me donne le vertige.

Le paysage change sans arrêt, des nuages apparaissent et cachent des pans entiers de montagne, puis se dispersent quelques minutes plus tard laissant découvrir des moutons autour d’un lac, ou un vol de vautours.
Je suis fasciné par cet horizon dégagé et immense, par la beauté des Pyrénées sublimée par cette belle journée ensoleillée et limpide. Mais il n’y a pas que la beauté des Pyrénées qui est sublimée par la lumière intense et cristalline de cette journée.
Avec son t-shirt noir bien ajusté, sa peau mate, ses lunettes de soleil de kéké, ses cheveux très bruns et son brushing de bogoss, mon Jérém est à craquer. D’ailleurs, ça ne loupe pas, il se fait mater par un gars. Pendant un instant, j’ai cru que le mec, accompagné de sa copine, avait juste reconnu l’ailier Tommasi et qu’il était ému par cette « rencontre » fortuite. Pourtant, très vite, je remarque que dans son regard il n’y a pas que de l’admiration. Dans son regard qui traîne plutôt sur le bogoss Jérém que sur l’ailier Tommasi, dans ces mouvements imperceptibles de sa langue qui se glisse furtivement entre ses lèvres, dans cette petite agitation de sa pomme d’Adam, il me semble qu’il y pourrait y avoir autre chose, quelque chose que sa copine ne voit pas, ou qu’elle ne veut pas voir, mais qui est bien là.
Oui, même à 3000 mètres d’altitude, mon beau Jérém se fait mater. Ça me fait sourire, et ça m’excite.
Sur la grande terrasse ensoleillée, nous prenons un café. Je regarde nos baskets en éventail sur fond de chaîne pyrénéenne, je contemple mon bonheur. J’ai envie de l’embrasser. C’est fou à quel point j’ai envie de lui à cet instant.
— On n’est pas bien, là ? je m’entends lancer, ne pouvant pas garder mon bonheur pour moi tout seul.
— Trop bien !
Et là, je sens le dos de sa main frôler le dos de la mienne. Au départ, je crois que c’est un hasard. Mais le contact se prolonge, se répète. Jérém est en train de me faire un câlin discrétos, sur cette terrasse où il y a pas mal de monde !
Le bobrun a tourné légèrement son visage vers moi. Même si je ne vois pas ses yeux, je sais que derrière ses lunettes noires, Jérém me regarde, guette ma réaction.
— Tu me rends tellement heureux, Tommasi ! je lâche, terriblement ému, me faisant violence pour ne pas me jeter sur lui et l’embrasser de toutes mes forces.
— Quand tu es avec moi, la vie me semble plus simple, et plus douce.
A 4000 mètres d’altitude, je crois que nous nous sommes dit tout l’amour que nous ressentons l’un pour l’autre.
En fin d’après-midi, nous prenons la route pour la région de Toulouse. Jérém est accueilli en héros du rugby par Papa et en beau-fils exemplaire par Maman.
Papa ne tarit pas d’éloges sur sa magnifique saison et sur cette victoire du Top16 qu’il qualifie d’historique. Jérém a une telle cote auprès de Papa, c’est beau à voir. C’était inespéré. Les deux reviennent de loin. Papa d’une réaction épidermique lorsque je lui ai annoncé que Jérém et moi étions ensemble, et Jérém d’un grave accident sportif. Et maintenant que tout est arrangé, maintenant que Papa admire chez Jérém le grand sportif qui a contribué à offrir un Brennus à son équipe de cœur tout autant qu’il respecte le garçon qui rend son fils heureux, la complicité entre les deux hommes est saisissante et me fait chaud au cœur.
Auprès de Maman aussi, Jérém a une cote d’enfer. Maman ne s’intéresse pas au rugby, mais elle s’intéresse à tout ce qui fait mon bonheur. Jérém fait mon bonheur, par conséquent, elle adore son beau-fils. Quand je pense que la première fois qu’elle avait croisé Jérém, nous venions de nous disputer et j’avais le nez en sang. Mon coming out ne s’est pas fait dans la sérénité. Mais ça a bien changé depuis.
Le lendemain, nous changeons de département. Nous passons de la ville à la campagne, des plaines de Garonne aux côteaux du Gers, des étendues de maïs à celles de tournesol. Quelques dizaines de bornes encore, en partant vers le nord du département, la vigne commence à se montrer. Au fur et à mesure que nous nous approchons de notre destination, je ressens une certaine fébrilité. Je sais que je n’ai plus rien à craindre, mais quand-même. Ce n’est pas tous les jours qu’on saute ce pas avec le gars qu’on aime.
Le domaine de M. Tommasi est situé dans la région de Cologne, sur une pente douce orientée plein sud. Au sommet de la colline, la belle maison de maître et ses dépendances trônent au milieu des rangs de vigne aux grappes abondantes.
Après un accueil chaleureux, M. Tommasi m’invite aussitôt à faire le tour du domaine. Nous nous baladons dans les vignes en cette belle fin de matinée. C’est la première fois que je visite un domaine viticole, et je suis immédiatement sous le charme. Ce qui me frappe et m’impressionne c’est que tout est rangé au cordeau et rien ne dépasse. Les rangs de vigne, les abords des parcelles, les corps de fermes, les dépendances. Le vignoble, ça transpire la passion de celui qui le cultive.
Je ne m’y trompe pas. M. Tommasi me parle longuement de cépages, d’hectolitres, de palissage, de taille « noble » faite à la main, et de celle moins noble faite à la machine. Je n’y comprends pas grand-chose, mais son amour et sa passion pour la vigne sont débordants, sa façon de parler de son métier est captivante.
Après la vigne, la visite se poursuit naturellement dans le chai. Au milieu des immenses cuves, dans cette grande salle qui sent le moût, M. Tommasi me parle de fermentation des sucres, d’assemblages, de dates de vendange, d’arômes plus ou moins fruités.
M. Tommasi est passionné et passionnant. On sent que son vignoble fait sa fierté. Mais il s’agit d’une fierté légitime, sans forfanterie, la fierté que pourrait avoir un père pour la réussite de son enfant.
Après la plantation et le chai, la trilogie autour de la vigne s’achève avec la dégustation. D’abord le rouge. Le rouge, ce n’est pas pour moi.
Mais alors, quand M. Tommasi me sert une bonne rasade d’un vin blanc issu d’un cépage nommé Colombard, là, je suis sous le charme. Je fais des infidélités au vin blanc de ma vie, le Jurançon, et je les fais sans complexes, je les réitère même. Putain, qu’est-ce que c’est bon !
— Vous avez un très beau vignoble, ce que vous faites est remarquable, vous devez être content de cette belle réussite, je lance à M. Tommasi en quittant le chai.
— Je le suis. J’aurais aimé qu’au moins l’un de mes enfants s’installe sur le domaine.
— Papa ! fait Maxime.
— Je ne reproche rien à personne, si ce n’est qu’à moi. Je me rends compte que j’ai été trop dur avec eux par le passé, et j’ai fini par les dégoûter. Je les ai fait fuir. Mais je suis fier de leurs réussites, il continue. Jérémie est un joueur exceptionnel et Maxime va devenir un médecin tout aussi exceptionnel. Ils trouveront leur bonheur ailleurs que dans ce domaine.
M. Tommasi, que j’ai toujours entendu décrit comme un homme distant, dur, s’avère être quelqu’un de bienveillant et très ouvert d’esprit. J’imagine qu’il a dû mettre pas mal d’eau dans son vin, un exercice des plus périlleux pour un vigneron, soit dit en passant, pour en arriver là, pour arriver à se mettre à la place de ses enfants, et pour accepter que le bonheur qu’il avait imaginé pour eux et celui qu’eux-mêmes ont imaginé pour leurs vies ne coïncident pas.
— L’important, c’est qu’ils soient heureux, il conclut.
Et dans le regard qu’il me lance en prononçant ces quelques mots, je comprends qu’il parle de tous les bonheurs de ses enfants. Jérém, qui a dû recevoir les mots de son père de la même façon que je les ai reçus, a l’air tout ému.
— Qu’est-ce que tu as changé, Papa ! lui lance Maxime.
— C’était pas trop tôt ! se défend M. Tommasi.
— T’aurais dû changer de copine plus tôt, lui lance le petit con.
Ça m’a toujours impressionné, en particulier les deux fois que j’ai vu père et fils cadet au chevet de Jérém après un accident et une blessure, cette façon de Maxime de balancer des trucs à son père sans y aller par quatre chemins, sans colère, mais tout en justesse et fermeté. Et aussi la réaction de son père, qui ne l’a jamais envoyé paître, même quand, du haut de ses vingt ans, il le recadrait parfois âprement. M. Tommasi doit tenir son fils cadet en grande estime pour accepter de se laisser ainsi parler d’égal à égal. Et aujourd’hui encore, cela se confirme.
— Mais tais-toi ! Allez, on va manger ! réagit M. Tommasi, une façon de botter en touche sans pour autant nier la justesse du propos de son fils cadet.
— Il a raison, me glisse M. Tommasi, tout bas.
Oui, j’ai toujours eu l’impression que Maxime savait tenir tête à son père, alors que Jérém souffrait de se sentir rejeté. Que Maxime osait parler à son père et que Jérém ne l’osait pas. Mais cela aussi, semble avoir changé.
— Ou il aurait fallu que je me blesse plus tôt ! plaisante Jérém.
— J’aimerais dire que tu as tort, mais ce serait mentir. Il a fallu en arriver là pour que je comprenne que je ne pouvais pas continuer à te faire la guerre parce tu étais différent de celui que j’avais imaginé. Pour que je comprenne que le rôle d’un père c’est d’être là pour son enfant, pour ses enfants. J’ai assez perdu de temps avec mes garçons, je ne veux plus perdre une seule seconde.
— Tu t’en sors pas mal, Papa, fait Maxime.
— Pas mal, pas mal, fait Jérém. Pas avec les mots, mais avec ce regard qu’il échange avec son père, un regard empli d’émotion.
Sophie, celle qui a été annoncée par Maxime comme la nouvelle copine de son père, est une femme avenante et accueillante. Si je me fie à l’allusion du petit frère de Jérém, elle aurait sur M. Tommasi une meilleure influence que celle qui l’a précédée, cette dernière étant sans doute celle qui avait pris la place de sa mère après son départ. Et alors que l’ancienne copine aurait provoqué un éloignement entre M. Tommasi et ses deux garçons, la présence de Sophie jouerait positivement sur les relations familiales.
Delphine, la nouvelle copine de Maxime, est du genre réservé. Elle a même l’air un peu mal à l’aise au milieu de cette réunion familiale. Mais l’adorable étudiant en médecine est là pour l’aider à s’intégrer, il est aux petits soins, il est vraiment mignon.
Le repas à six convives et trois couples est une réussite. Le fait d’être accepté dans la famille de Jérém m’émeut profondément. Je n’aurais jamais imaginé il y a trois ans qu’on en arriverait là, un jour, Jérém et moi.
Et ce qui m’émeut aussi, c’est de découvrir les lieux de son enfance. D’autres lieux, après Campan. Le domaine, le chai, la maison. Mais aussi, au gré d’un petit tour en voiture dans l’après-midi, le village, son école primaire, le premier terrain de rugby où il a joué. Et, le soir, sa chambre d’enfant qui est restée dans son jus depuis près de dix ans, depuis son départ à Toulouse.
Je découvre d’anciens ballons de rugby usés, des maillots de l’enfant qu’il a été, des albums de photos de joueurs de rugby.
— Avec Thibault on échangeait les photos en double. Il avait toujours plus de chance que moi, je n’ai jamais réussi à compléter un seul album, alors qu’il y arrivait régulièrement. Tiens, le voilà, lui ! il s’exclame.
— Lui qui ?
— Ce demi de mêlée, il a fait la plus grande partie de sa carrière à Castres, il précise, en me montrant un super beau brun dans l’une des photos en haut de la page.
— C’était un bon joueur ?
— Aussi. Mais il était surtout super bogoss ! Quand j’avais 13 ou 14 ans, je me suis branlé quelques fois en matant cette photo.
— Mais tu savais déjà que tu étais gay ?
— Au fond de moi, je le sais depuis toujours. Et pourtant, quand je me branlais en matant ce type, je me disais tout simplement que je voulais lui ressembler. Qu’est-ce qu’on peut se raconter comme connerie pour ne pas affronter la réalité ! il considère.
Dans sa chambre d’enfant, je découvre également ses cassettes, ses CD. Il y a un peu de rock français, et beaucoup de rock international, Guns And Roses, Aerosmith, Metallica.
— Je ne savais pas que tu aimais le rock !
— Tu ne sais pas tout de moi !
— A croire que non, j’admets.
— Je ne connais pas trop le rock, je glisse en me saisissant d’un CD.
— Evidemment, tu n’écoutes que de la musique de pédé, Madonna et compagnie !
— Madonna et compagnie t’emmerdent !
— Ferme-là et écoute ça ! m’intime le bobrun en glissant un CD dans le lecteur.
— Ah, ça je connais, j’ai tout juste le temps de répliquer, avant que Jérém ne se glisse sur moi, et m’embrasse fougueusement.
Dans sa chambre d’enfant, sur les notes de « November Rain », ce soir Jérém et moi faisons l’amour. J’adore faire l’amour avec Jérém. Et ce que j’aime tout autant c’est que depuis qu’il ne fume plus, les instants après le plaisir se passent le plus souvent dans ses bras.
Nous passons le reste de l’été à sillonner la France en voiture. Cordes sur Ciel, Sarlat, Rocamadour, Futuroscope. Pour le 14 juillet nous allons voir Ulysse à Dunkerque.
Nous sommes ensemble, nous sommes un vrai petit couple. Qui ne peut pas se tenir la main ou se galocher en public, certes, mais qui s’aime vraiment, un couple qui baise probablement bien plus que la plupart des couples hétéro parfois « trop affichés » que nous croisons. Nous partageons notre bonheur avec les quelques personnes qui méritent notre confiance, dont font partie les amis les plus importants, ainsi que nos familles. Et c’est l’essentiel.
Le dernier week-end des vacances de Jérém, celui du 24 et 25 juillet, nous revenons dans le Gers, dans le domaine de Papa Tommasi. Jérém en a envie, il en a besoin. Il a besoin de passer un peu plus de temps avec ce père qu’il vient de retrouver après tant d’années d’incompréhensions. Il a besoin de retrouver ce lieu où il a été heureux enfant, avant de s’en sentir rejeté après le départ de sa mère. Il a besoin de revenir au pays, après tant d’années d’exil.
C’est la deuxième fois que je reviens dans cet endroit en quelques semaines, mais je ressens toujours la même émotion et la même tendresse au contact des lieux de l’enfance de mon bobrun. J’avais déjà ressenti cette sensation à Campan, au contact des gens et des lieux qui ont connu mon bobrun à une saison de sa vie où j’ignorais tout de lui, y compris son existence. Mais dans sa maison d’enfant, dans sa chambre d’enfant, dans sa famille, là, je suis admis à un degré d’intimité encore supérieur. Et ça m’émeut profondément.
Dans sa chambre d’enfant, Jérém sort une boîte à chaussures. A l’intérieur, des photos de lui, à trois ans, avec un bonnet rouge et un manteau tout aussi rouge, le regard noir, contrarié, le même que je lui ai connu plus tard, lorsque je l’ai vu en pétard. Les traits, sont ceux d’un enfant. Mais le regard très brun est déjà là.
Au fil des photos, Jérém me raconte son enfance, sa relation plutôt fusionnelle avec sa mère, avant. Et puis, le drame que ça a été pour lui le jour où, vers ses neuf ans, cette dernière n’a plus voulu lui faire le bisou avant d’aller au lit, « parce que tu dois devenir un grand garçon ». Il me dit avoir toujours été persuadé que c’était son père qui était à l’origine de ce déchirement, qui avait imposé à sa mère de ne plus le traiter en enfant et de commencer à le traiter comme un grand garçon.
Il me reparle du traumatisme qu’a été la séparation de ses parents, et celui encore plus grand qu’a été pour lui l’abandon de sa mère. Il me remercie encore de l’avoir convaincu de l’écouter à Capbreton, de lui avoir obligé à affronter ce traumatisme, et de commencer à le surmonter.
— Ça ne me rendra jamais une enfance heureuse, mais ça m’a au moins permis d’évacuer la colère qui me suivait comme un boulet depuis plus de dix ans.
Oh que ça fait du bien d’entendre ces mots !
La boîte à chaussures nous livre une photo sur laquelle figure Maxime, sur un petit vélo bleu ciel, l’air pas assuré du tout. Il doit avoir 3 ou 4 ans, et Jérém se tient à côté de lui, une main sur le guidon, l’autre sur son épaule. A l’évidence, Jérém est en train d’apprendre à son petit frère à faire du vélo, ou du moins en train de l’empêcher de tomber. Sur une autre photo, à la neige, toute la famille y figure. Entre les parents, Jérém tient Maxime dans ses bras, c’est mignon comme tout. Ça m’émeut jusqu’aux larmes.
— Tu as dû bien t’occuper de ton petit frère quand vous étiez gamins.
— Je ne sais pas. Ça a peut-être été un peu vrai jusqu’au divorce. Depuis, il faut bien l’admettre, c’est plutôt lui qui s’est occupé de moi. Quand je lui en ai laissé l’occasion, bien évidemment.
Au fil de ces photos, mais aussi des souvenirs qui remontent à table au détour d’une conversation, des mots qui surgissent parfois au détour d’une phrase, je parcours toutes les jeunes années de mon Jérém. Et lorsque je regarde ces lieux, il me semble de le voir gambader en culottes courtes.
Quand je suis dans le jardin, je me dis que derrière ce grand chêne, il a dû se cacher, enfant, en jouant avec Maxime. Je me dis que plus tard, Thibault a dû se joindre à eux pour ces jeux d’insouciance.
Une insouciance qui a été balayée nette par le départ de sa mère. Du jour au lendemain, sans y être préparé, Jérém a réalisé et a dû accepter qu’elle ne serait plus jamais là. Mais ça n’a rien changé au manque, à sa tristesse d’enfant.
Je me dis qu’à cette époque, il s’est peut-être réfugié dans la grange pour être seul. C’est peut-être là qu’il a grillé ses premières clopes. Peut-être que Maxime s’y est réfugié aussi, et que Jérém l’y a rejoint pour le réconforter. Ou bien, c’est Maxime qui l’y a rejoint pour le réconforter.
Je me dis qu’adolescent, il a dû monter le grand escalier de la maison en boudant. Qu’il a dû s’enfermer dans cette chambre et faire exploser sa colère, ou pleurer à l’abri des regards.
Je me dis que dans cette grande maison, il a été heureux, il a été triste, il s’est senti protégé, puis rejeté, il a eu envie de partir.
Je me prends à imaginer ses états d’esprits pendant ses toutes jeunes années. Je voudrais l’avoir connu à cette époque, je voudrais avoir partagé tous ces moments avec lui.
L’image de Jérém enfant que je reconstruis au fil des récits, des objets, des souvenirs, des photos, se superpose à celle du Jérém de bientôt 23 ans, jeune adulte, mon compagnon, qui s’assume, qui assume notre relation, qui affronte et panse peu à peu ses anciennes blessures. Et cette superposition, ce mélange, m’émeut au plus haut point.
Dans ce vignoble, je regarde, pendant des heures, le ciel bleu, les nuages qui passent, j’écoute le vent qui souffle. Je vois de la vigne, je vois cette maison, je vois des fleurs, je te vois toi, Jérémie Tommasi, et je t'aime comme un fou.
Dans ce vignoble, au cœur de tous les Jérémie, j’ai envie de pleurer de bonheur. 5 commentaires
5 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Jérém&Nico - Saison 1