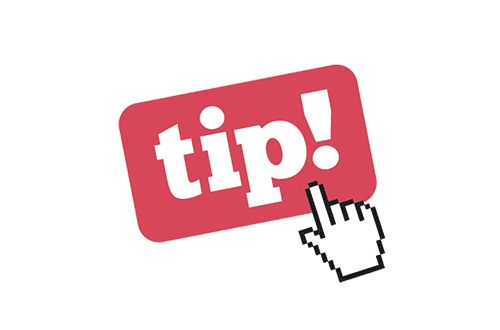-
Le sucer est le bonheur suprême. Lui faire plaisir, le plus exquis des plaisirs. Et sentir, en plus, ses doigts sur mes tétons, c’est juste inouï ; ses doigts qui caressent, pincent légèrement, tout en variant sans cesse les mouvements, la pression, tout en m’offrant d’infinies nuances d’excitation, d’innombrables frissons.
Jusqu’à ce qu’un feu d’artifice dément n’explose dans ma tête : lorsque, à force de tâter et de tâtonner, le bogoss finit par trouver LE toucher et la cadence qui m’apportent LE frisson absolu : position des doigts, pression, toucher, coordination, cadence, tout est parfait…
Vendredi 17 août 2001, au réveil.
Oui, tout est parfait… à part le fait qu’un réveil en sursaut vient interrompre cette magnifique séquence à la saveur de déjà-vu. Enroulé dans mes draps, je suis en nage.
Il me faut un petit moment pour réaliser que je suis à Gruissan, et que j’y suis depuis une semaine. Putain, une semaine !!! Une semaine déjà.
Une poigné de secondes et tout me revient : notre dispute, mon coup, son coup, le bruit de la chair qui morfle ; des mots et des bruits qui me hantent ; maman qui débarque ; son nez en sang, son dernier regard plein de tristesse et de tourment, juste avant son départ.
Oui, son départ. La porte qui claque derrière lui : la dernière note, dure, sèche et dissonante de notre histoire. La sensation d’un gâchis sans nom qui m’arrache le cœur.
Alors, oui, le mien est un réveil en nage ; mais, aussi, un réveil en larmes.
J’attrape mon téléphone sur la table de nuit : toujours aucun message, de personne.
A chaque fois que je regarde l’écran vide de mon portable, c’est une nouvelle, cuisante déception ; une nouvelle confirmation du fait qu’il est passé à autre chose, qu’il m’a oublié, qu’il ne reviendra jamais vers moi ; que sa vie est ailleurs, sans moi. A chaque fois que je regarde l’écran vide, c’est comme si je me faisais quitter un peu plus encore.
Oui, il s’est déjà écoulé une semaine depuis ce vendredi noir, depuis cette triste date du 10 août, cette date qui me hante. Putain d’« anniversaires », si rapprochés, si douloureux juste après une rupture.
Même à Gruissan, mon sommeil est irrégulier, insuffisant, je passe des longues heures nocturnes à ruminer des images, des mots, des souvenirs ; même à Gruissan, je traîne une fatigue dont je n’arrive pas à me débarrasser. Et la migraine me guette à chaque fin de journée.
Depuis une semaine, je suis tellement sonné que je n’ai même pas ressenti le besoin de me branler.
Ce matin, à l’issue de ce maudit rêve, je ne suis pas plus en forme ; pourtant, malgré la tristesse et la désolation qui agissent en moi comme un poison, mon corps semble réclamer ces caresses et ces sensations qu’il a boudées depuis assez longtemps.
Alors, je me branle. Je me branle et je ressens instantanément l’envie violente, déchirante d’avoir sa queue entre mes lèvres, de sentir son gland contre ma langue, de tenir son plaisir dans ma bouche ; je me branle et je pense à ses giclées puissantes, à son goût de petit mec, si doux et si fort à la fois ; je me branle et je frémis dans mon entrejambe, dans mon ventre ; je me branle en écartant mes cuisses, en appelant ses coups de reins de toutes mes forces ; je me branle en pensant à sa petite gueule déformée par l’orgasme.
Et je jouis… je jouis en pensant à son plaisir, ce plaisir que je peux plus, que je ne pourrai plus jamais lui offrir ; ce plaisir, celui de le faire jouir, que je pourrai plus jamais m’offrir.
Lorsque je reviens à moi, je récupéré, étalé sur le matelas, épuisé. Je récupéré en me demandant avec qui il couche désormais, qui a la chance de le faire jouir aujourd’hui… c’est une nana ? Des nanas ? Un autre mec ? Qui fait-il couiner ? Est-ce qu’il a joui, hier soir ? Combien de fois a-t-il joui depuis vendredi dernier ? Comment prend-il son plaisir ? Est-ce qu’il fait des choses qu’il faisait avec moi ? En découvre-t-il d’autres ? Est-ce qu’il couche toujours avec capote, ou bien il a déjà franchi le pas de s’en passer ? A-t-il finalement trouvé ailleurs un plaisir plus grand que celui que j’étais capable de lui offrir ? Est-ce qu’elle – ou lui – se rend compte de la chance d’avoir ce petit Dieu, ce bogoss absolu, cette machine à sexe, dans son lit, dans sa bouche, dans son ventre ?
Ainsi, au sentiment de vide et de désolation, s’ajoute l’immense manque provoqué par l’absence de son corps. Chacune de mes cellules pleure ce manque : la douceur, l’odeur, la chaleur de sa peau ; l’harmonie et la puissance de ses muscles, l’étreinte de ses bras ; et, aussi, la nostalgie de ses regards doux et joueurs, de l’amour pendant la semaine magique ; notre merveilleuse entente sensuelle, notre parfaite complémentarité sexuelle ; son kif, mon kif, mon envie de lui faire plaisir, son envie de me faire plaisir ; nos plaisirs, de plus en plus incroyables ; notre complicité, de plus en plus détonante, avec pour point d’orgue cette pipe fabuleuse dans l’arrière-boutique de la brasserie.
J’ai envie de lui à en crever, et pourtant je sais que je ne l’aurai plus, plus jamais ; je vais devoir supporter l’horrible privation de ne plus l’avoir dans ma bouche, de ne plus le sentir frissonner sous ma langue, de ne plus connaître la puissance de ses giclées, et le goût de son jus ; mes mains, ma peau, ma bouche, mon nez, vont devoir renoncer au contact avec son corps ; je ne l’aurai plus jamais en moi, je ne le sentirai plus jamais coulisser en moi, je ne le verrai plus jamais jouir en moi, je n’aurais plus jamais sa semence en moi. C’est fini. Fini.
J’ai tout perdu : le mec dont j’étais fou amoureux et un mâle fabuleux au lit.
Quand je pense au plaisir sexuel que j’ai connu pendant des mois, j’ai envie de pleurer et de crier ; je me dis que plus jamais je ne retrouverai quelqu’un capable de me faire autant vibrer, de me baiser, de me faire l’amour de cette façon ; c’était trop bon avec lui, parce que c’était si libre, sans soucis.
J’ai pris un risque important avec lui, un risque que je n’aurais jamais dû prendre : coucher avec sans capote, depuis la toute première fois, ça n’a pas été très prudent. Non seulement je me suis laissé faire par ses envies, je me suis laissé porter par mes propres envies, par le désir déraisonnable que ce mec m’inspirait ; mais je lui faisais confiance, je croyais qu’il en valait la peine ; je croyais que tôt ou tard il ne serait qu’à moi.
Je lui ai offert mon corps comme il le voulait, parce que c’était lui. Je lui ai donné tout ce qu’il voulait, et plus encore. Je me sens trahi, humilié. Je regrette de m’être autant donné à lui.
Et maintenant, l’idée que quelqu’un d’autre va en profiter à ma place me rend fou de jalousie. J’ai l’impression qu’on me déchire de l’intérieur ; je me sens doublement humilié, trahi, meurtri. Quand je pense qu’il m’a baisé alors qu’il venait de coucher ailleurs, dans l’heure… le goût de sa queue qui a déjà joui remonte à mes narines et j’ai envie de vomir.
Certes, c’est moi qui a forcé la galipette… à la base, il ne venait que pour récupérer sa chaînette…
Mais comment il a osé me faire ça ? Coucher ailleurs… pourquoi ? Pourquoi ?
Et puisqu’il l’avait fait, il aurait dû être plus ferme, partir malgré mon insistance, ne pas me laisser le prendre en bouche : il pouvait se douter que j’allais comprendre, et que ça allait me faire horriblement mal ! Connard ! Sale connard ! J’ai tellement envie, tellement besoin de le haïr.
Pourtant, je pleure en m’avouant que je donnerais tout ce que je possède, et peut-être même le restant de mes jours, pour goûter une fois encore, une seule, à son corps, à sa queue, à son jus.
Pourtant, lorsque je repense aux trois mois qu’a duré notre relation, je me rends compte que ce qui fait le plus mal, ce que je regrette le plus, c’est de ne pas avoir pu partager grand-chose d’autre avec lui que des bonnes parties de sexe.
J’ai toujours cru que, malgré ses résistances, ses barrières, un jour nos envies profondes, nos attirances, nos besoins d’affection, de tendresse, d’amour, finiraient par se dévoiler l’un à l’autre, par se rencontrer : je me suis trompé : j’ai cru à un moment que je pourrais compter davantage à ses yeux que comme un simple cul à baiser : je me trompais là aussi.
J’aurais tant aimé qu’on ait pu apprendre à se découvrir, à se connaître. Je regrette de ne pas avoir su le mettre en confiance, de ne pas avoir eu les épaules nécessaires pour lui montrer que je pouvais être là pour lui, qu’il pouvait compter sur moi.
Il n’y a que Thibault qui a ce pouvoir vis-à-vis de lui.
Thibault qui m’avait pourtant donné des clés à ce sujet ; le bomécano m’avait appris que, derrière la façade de mec bien dans ses baskets, son pote était un garçon qui doutait de lui-même et qui avait besoin d’être rassuré.
Je regrette de ne pas avoir su utiliser ces éléments pourtant cruciaux.
À distance, facile de refaire le monde. Mais, concrètement, qu’est-ce que j’aurais pu faire pour m’approcher davantage de son cœur, ce cœur qui ne veut pas se laisser approcher ?
Il aurait fallu que je sois capable de me montrer prêt à le soutenir, sans qu’il ait l’impression d’être faible ; car c’est sans doute ce qu’il aurait aimé ressentir, la présence de quelqu’un qui l’aide à être en accord avec lui-même, à être lui tout simplement ; quelqu’un qui le rassure et qui l’aide à s’accepter.
J’ai essayé de lui faire comprendre à quel point je l’aime, à quel point j’ai besoin de lui ; j’ai même fini par le lui crier, en ce triste vendredi, alors qu’il venait de me dire qu’il voulait qu’on arrête tout ; j’ai aussi essayé de lui faire comprendre que je voulais être là pour lui, avec lui, et que je ne laisserais jamais tomber.
Il n’a jamais voulu de l’amour que j’avais à lui offrir, et encore moins du soutien que j’aurais voulu lui apporter : mes difficiles tentatives de lui faire comprendre que je tenais à lui et que je voulais partager avec lui autre chose que du sexe, n’ont fait que le braquer et le faire fuir.
D’ailleurs, même si parfois ses attitudes ont semblé dire le contraire, il a toujours affirmé qu’il n’y avait que du sexe entre nous.
Comment aurais-je pu le toucher davantage, alors ?
Soudainement, je repense au maillot que j’ai ramène de Londres. J’avais fondé de grands espoirs sur ce cadeau. J’avais voulu lui faire plaisir, j’avais imaginé mon plaisir de voir son regard s’illuminer lorsqu’il le recevrait.
J’avais imaginé ce maillot comme le départ d’une nouvelle complicité entre nous, en dehors du sexe ; une complicité qui aurait dû faire écho à cette nuit fantastique, l’une des rares que j’ai passées avec lui, la nuit après le départ de ce Romain levé au On Off ; cette nuit où, troublé par ce plan et par ce mec qui avaient violemment révélé sa jalousie vis-à-vis de moi, il m’avait demandé de rester dormir ; cette nuit où il s’était un peu ouvert à moi, sur le rugby, sur ce qui comptait dans sa vie, cette nuit magique où j’ai essayé de lui dire à quel point je tenais à lui.
Cette nuit-là, moment si rare, si unique, si précieux, une occasion en or pour lui parler : j’ai essayé, j’ai foiré ; je n’ai pas su le toucher, je n’ai pas su trouver les bons mots ; en tout cas, pas avant que son sommeil ne ferme définitivement la petite brèche qui s’était offerte à moi.
Alors, ce maillot, c’était la bonne façon de lui dire qu’il était bien plus pour moi qu’un magnifique étalon baiseur ; ce maillot aurait dû être la première chose que nous aurions « partagée » en dehors du sexe.
Lui offrir ce maillot, c’était lui offrir quelque chose qui était attaché à ce qui compte le plus dans sa vie, le rugby : je ne connaissais rien au rugby, je ne connaissais même pas Wilkinson avant d’entendre ce nom dans sa bouche, entouré de mots admiratifs ; ce maillot ne représentait rien, pour moi, à part un moyen de faire plaisir au garçon que j’aimais.
Et malgré tout, j’en suis certain, il a été qu’il a été touché par ce geste : je l’ai vu à ce regard enfantin et plein de passion qui a illuminé son visage pendant une fraction de seconde ; avant de se « ressaisir », et de refuser ce cadeau, comme pour refuser de créer un lien supplémentaire entre nous, au moment où justement il voulait couper tous les autres.
Mais bien sûr !!! Pourquoi je n’y ai pas pensé ??? Lui donner le maillot plus tôt, pendant la semaine magique, c’est ça que j’aurais dû faire ! Voilà une évidence qui éclate dans mon esprit avec la violence d’un douloureux regret.
Ça aurait été le moyen de créer un lien, à un moment où tout était peut-être possible… lui donner le maillot quand tout allait si bien entre nous… à ce moment-là, il l’aurait accepté avec joie… il aurait été heureux de le recevoir, sans réticences… il m’aurait remercié… j’aurais été heureux de le voir heureux comme un gamin… et le lien aurait été créé… et il aurait peut-être pu peser plus tard dans la balance de ses sentiments.
A plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion de lui donner le maillot ; ce qui m’a retenu, à chaque fois, c’est sans doute la peur stupide que ce cadeau, en tant que démonstration trop tangible de l’amour qui était le mien, ne l’« effraye » ; j’ai eu peur que ce cadeau, que cet amour ne le fassent fuir, qu’ils ne coupent la magnifique progression sur laquelle nous étions lancés.
Ce maillot, c’était quitte ou double. Il fallait juste oser prendre le risque. Je n’ai pas osé. Ou j’ai osé trop tard. Tant d’occasions ratées, comme autant d’actes manqués.
J’avais un atout dans mon jeu, je l’ai gaspillé.
Sur le coup, laisser le maillot à la brasserie me paraissait une bonne idée ; maintenant, à distance, j’ai l’impression d’avoir fait du forcing, de lui avoir mis un peu plus la pression en l’« obligeant » à accepter mon cadeau ; tout en rendant son patron « témoin » de tout cela.
Il est même probable que le fait de se voir remettre le paquet, « de la part de Nico », l’ait mis mal à l’aise, en rendant encore plus forte sa détermination à s’éloigner de moi.
Qu’est-ce que j’ai pu être idiot de m’imaginer qu’il enverrait un message pour me remercier, ou du moins pour me dire qu’il avait bien eu le maillot !
Samedi 18 août 2001
Ce matin je me réveille une fois de plus avec le moral dans les chaussettes.
J’attrape mon portable et je constate que l’écran est toujours vide.
Je comprends son silence. Il m’a oublié. Ou bien, il veut m’oublier. Il veut que je l’oublie.
Et maintenant ? Est-ce qu’il n’y a que la solitude devant moi ? Comment reprendre goût à la vie, après le déluge qui a tout détruit sur son passage ?
Sortir, rencontrer d’autres gars, réapprendre à faire confiance, tenter de deviner et de comprendre les sentiments de l’autre, faite gaffe de ne pas me faire avoir une autre fois, éviter à tout prix de souffrir encore ; coucher à nouveau, devoir me protéger, devoir me préoccuper des risques, avant de découvrir le plaisir d’autres corps : je n’arrive à envisager rien de tout ça. De toute façon, je ne sais même pas si je vais réussir à plaire. Mon corps peut-être, va plaire, pour une baise « à la Mourad ». Mais qui voudra d’une relation avec moi ? Qu’est-ce que j’ai réellement à offrir à un mec ?
Et qu’est-ce que les mecs ont à m’offrir ? Qui sont les gays ? Que recherchent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Est-ce qu’ils ne pensent tous qu’à tirer leur coup vite fait ? Comment être sûr de bien me protéger, de ne pas choper une saloperie ?
Soudainement, je repense à Stéphane. Un mec bien. Gentil, adorable, très respectueux, et à cheval sur la protection. Ça me ferait tellement de bien qu’il soit là à cet instant précis. Mais pourquoi il a fallu qu’il parte en Suisse ? Peut-être que s’il était resté sur Toulouse, à l’heure qu’il est je connaitrai le bonheur avec lui, au lieu de connaître ce malheur, ce désespoir.
Un autre Stéphane, ça existe ?
Ce matin, je repense également au silence de Thibault. Un silence que je trouve de plus en plus étrange.
Pendant des jours, j’ai cru que dans son silence il y avait de la discrétion, le respect de ma souffrance, et la conviction que si j’avais besoin de lui, je savais où le trouver.
Mais plus le temps passe, plus je commence à me dire qu’il y a peut-être autre chose derrière sa distance : je me dis que le bomécano est peut-être dépité de mon comportement ; il a dû être déçu de moi lorsqu’il a appris que j’ai frappé son pote en premier. Et il a raison d’être déçu de moi. Moi-même, je le suis.
J’ai frappé en premier, je n’ai aucune excuse. J’ai été violent, et son silence est la pire des sanctions : j’ai été violent et je ne mérite plus son estime, ni son amitié.
L’absence de Thibault ajoute encore de la souffrance à ma détresse. J’ai mal à l’idée de le perdre, lui aussi. Thibault est avant tout le meilleur pote du garçon qui me rend si malheureux ; mais c’est aussi un très bon pote, peut-être même, certainement même, mon meilleur pote.
Je voudrais lui envoyer un message mais je n’ose pas.
Et puis, une partie de moi est convaincue que le mieux à faire, c’est peut-être de couper les ponts avec le passé.
Dimanche 19 août 2001
C’est aujourd’hui que Philippe débarque enfin à l’appart ; il est toujours aussi charmant, dans son petit look étudiant à dévergonder, avec ses lunettes carrées plutôt classe, ses cheveux ondulés dans lesquels on a envie d’enfoncer les doigts et de caresser sans modération, sa barbe d’une semaine bien fournie et bien taillée ; vraiment un beau gars, et super gentil en plus.
Elodie est heureuse, et ça me fait vraiment plaisir pour elle. Le revers de la médaille, c’est que, du coup, elle est très accaparée par son homme, ce qui la rend automatiquement moins présente pour moi.
Nous avons passé une semaine collés serrés ; je crois que, à part les nuits, nous n’avons pas passé dix minutes l’un hors de la vue de l’autre. Et là, sans transition, je me retrouve à tenir la chandelle sous un parasol soudainement devenu trop petit.
Et même si j’adore ma cousine et j’apprécie bien son charmant Philippe, très vite je me rends compte que « je hais les couples qui me rappellent que je suis seul ». Je pense qu’on est nombreux à avoir un jour ressenti cette sensation, avant que, quelques années plus tard, une chanteuse n’ait l’inspiration de la chanter à haute voix et d’en faire un tube, ô combien bien vu.
Oui, j’adore Elodie, j’adore Philippe, je suis content pour eux ; pourtant, au bout d’un moment j’ai besoin d’air.
Me voilà en train de marcher seul sur la plage, loin, longtemps ; j’ai l’impression de redécouvrir le monde, de refaire mes premiers pas ; je suis comme un convalescent à qui on a retiré trop tôt et trop brutalement ses béquilles : je ne suis pas encore complètement guéri, j’ai encore besoin d’Elodie, sa présence rassurante me manque ; le sevrage est brutal ; je sens que la rechute me guette.
Il suffit d’un bobrun à la peau mate et au torse musclé qui se balade sur la plage avec sa copine et me voilà reparti dans les souvenirs, les regrets, les remords, la souffrance.
Heureusement, j’ai mes lunettes pour cacher mes larmes, et le vent pour les essuyer au fur et à mesure.
Soudaine, violente envie de l’appeler, ou de lui envoyer un sms. Où est-ce qu’il est à cet instant précis ? Est-ce qu’il bosse toujours à la brasserie ? Est-ce qu’il est déjà sur Paris ? Est-ce qu’il est en train de s’envoyer en l’air avec sa pouffe ? C’est qui cette pouffe ?
Depuis une semaine, j’ai été dix, cent, mille fois sur le point de lui envoyer un message, un message écrit, effacé, réécrit et ré-effacé un nombre incalculable de fois sur mon portable ; à chaque fois, l’envie de prendre de ses nouvelles a été anéantie par un salutaire sursaut de dignité, d’auto-préservation. Un jour, sur un coup de colère, j’ai effacé l’intégralité de nos échanges d’sms depuis nos premières révisions ; j’ai parcouru l’historique des appels, et effacé chaque trace de son contact.
Au bout de quelques jours, j’ai même effacé son numéro de mon portable. Geste purement symbolique, car je connais son 06 par cœur. Ça peut paraître con, mais le fait de ne plus avoir son prénom dans mon téléphone, m’aide à avancer.
La présence constante de ma cousine m’aidait aussi à avancer. Et elle me préservait de la tentation de faire des bêtises.
Mais aujourd’hui, alors que je me balade seul sur la place, je me sens prêt à commettre l’irréparable : lui demander des nouvelles par sms. Lui demander des nouvelles et me préparer à souffrir un peu plus encore, quelle que ce soit sa réponse, y compris la plus probable et insoutenable de toutes : son silence.
Je sais que le fait de chercher le contact avec lui équivaut à compromettre mon processus de guérison ; et, aussi, à faire ressurgir des attentes absurdes, à recommencer à espérer un changement de sa part, à espérer son retour.
Je sais que je n’ai rien à espérer, car il m’a fait trop mal ; pourtant, au fond de moi, il y a toujours un petit espoir, tapi sous les gravats de ma souffrance, l’espoir qu’il comprenne et qu’il revienne.
Je sais que je ne devrais pas le laisser revenir, même si lui il le voulait. Mais est-ce que j’en serais capable ?
De toute façon, le problème ne se pose pas, car il ne reviendra pas.
Heureusement, j’ai laissé mon portable à l’appart. Alors, pas de sms.
Fatigué par tant de marche, je m’arrête à un kiosque sur la plage pour prendre une boisson fraîche ; ainsi que pour chercher du réconfort en regardant une bande de potes en train de jouer au volley.
Mater du bogoss torse nu, les muscles bandés au gré des actions de jeu, les shorts de bain ondulant sur les cuisses, moulant les fesses, glissant parfois un peu sur les hanches ; m’abreuver de leur présence, de leur bonne humeur de potes en vacances qui m’apaise, me réconforte, m’amène loin, très loin ; tout en sirotant un soda bien frais assis à l’ombre d’un parasol en bord de plage : ça ressemble à un aperçu de l’entrée du Paradis. La vue d’une meute de bogoss sur la plage devient alors une sorte d’oasis passagère mais ô combien bienvenue, dans le désert infini de ma détresse.
Des grosses enceintes accrochées au toit en bambou du kiosque diffusent à toute puissance l’une des rengaines insipides de l’été. Lorsque le supplice sonore se termine, une rythmique inédite et puissante le remplace sans transition. Le son est intéressant, la mélodie me plaît d’entrée : la voix du DJ profite de l’intro instrumentale pour annoncer que le King est de retour. Ça, ça sonne à mon oreille comme une bonne nouvelle. Une nouvelle chanson, une nouvelle séquence dans une carrière musicale hors pairs ; comme une préfiguration du nouveau chapitre de ma vie qui n’attend qu’à être écrit.
Lorsque l’intro se termine, cette voix si connue sort enfin des enceintes et apporte à mon oreille des mots qui me parlent, qui me touchent, qui m’émeuvent :
My life… will never be the same/Ma vie… ne sera plus jamais la même
'Cause girl, you came and changed/Parce que chérie, tu es arrivée et tu as changé
The way I walk/Ma façon de marcher/The way I talk/Ma façon de parler
I cannot explain the things I feel for you/Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens pour toi
But girl, you know it's true/Mais chérie, tu sais que c'est la vérité
Stay with me, fulfill my dreams/Reste avec moi, réalise mes rêves
And I'll be all you'll need/Et je serai tout ce dont tu as besoin
Oui, le King est de retour ; un retour qui n’en sera finalement pas un, mais plutôt le début de la fin.
Mais, en attendant, j’ai envie de croire que cet immense artiste qui a marqué mon enfance, mais qui, depuis quelques années, est en perte de vitesse, peut encore surprendre et revenir au top.
En attendant, ses mots parlent à ma détresse. Et sa voix, sa musique, tout comme les bogoss en train de jouer au volley de plage et mon soda bien frais, sont les ingrédients d’un petit bonheur capable de retarder pendant un instant ma rechute dans la détresse.
Je retrouve Elodie et Philippe en toute fin d’après-midi et nous rentrons à l’appart pour dîner.
Nous ressortons après, pour aller prendre un verre. On rigole bien, tous les trois ; enfin, surtout Elodie et Philippe ; moi, je me contente de faire bonne mine ; en réalité, je suis en train de rechuter. Tous les signes cliniques sont là : j’ai envie d’être seul ; j’ai envie de ruminer ma peine.
Alors, quand aux alentours de minuit ils ont annoncé leur envie de rentrer, j’ai prétexté une forme pétante et une envie soudaine de me balader un peu, beaucoup, pour mieux préparer mon sommeil.
C’est ce que je vais faire, marcher ; marcher sur le port, dans le village, jusqu’à la plage, m’imprégner de la douceur du soir, du son apaisant de la mer, du chant insouciant des cigales, de la présence de quelques bogoss ici et là.
Je marche pour tenter d’échapper à mes démons. Tentative vaine, ils me collent de près. Je n’arrête de penser à lui, ça vire à l’obsession. Ce soir, il me manque horriblement.
La nuit avance, la chaleur disparaît et une brise fraîche vient caresser ma peau ; l’heure tardive est propice aux réflexions, aux angoisses.
Je repense à mon bleu qui disparaît de jour en jour : bientôt, il n’en restera plus aucune trace. Tout comme il ne reste plus de traces, depuis plusieurs jours déjà, de son dernier passage en moi. Quelques jours encore, et ma chair ne gardera plus aucun souvenir de lui.
Alors, ça peut paraître idiot, mais désormais j’y tiens à ce bleu : ce qui est tout bonnement paradoxal.
J’ai envie de tout oublier de cette histoire, jusqu’à même oublier d’avoir été amoureux ; pourtant, je m’accroche à ce bleu, jusqu’à souhaiter qu’il ne disparaisse pas : ce bleu est le dernier contact que j’ai eu avec lui ; j’ai l’impression que du moment où il ne sera plus visible sur mon visage, mon dernier espoir qu’il vienne s’en excuser n’aura plus raison d’être.
Vraiment, ce soir il me manque horriblement. Les images de nos étreintes se bousculent dans ma tête… sa langue qui vient à l’assaut de la mienne… ses mots « Putain, je n’ai jamais joui aussi… »… sa main sur ma queue… le sentir revenir en moi, puis me branler juste pour me faire jouir ; ses doigts sur mes tétons, le toucher magique ; son beau sourire pendant toute cette semaine merveilleuse ; le bonheur de le regarder dormir ; le bonheur le prendre dans mes bras ; et lui faire des bisous…
Déchirante envie d’avoir le pouvoir de remonter le temps pour être avec lui encore, pour revenir à cette semaine magique ou tout était si beau, ou tout semblait possible ; remonter le temps pour tout changer, pour éviter les erreurs qui m’ont conduit là où je suis aujourd’hui, loin de lui ; remonter le temps pour faire l’amour avec lui, pour le voir me sourire et me taquiner comme il y a deux semaines. Remonter le temps pour trouver le moyen de le retenir.
Est-ce qu’il est encore sur Toulouse ou est-ce qu’il est déjà parti à Paris ?
Oui, ce soir il me manque horriblement. Ce soir, j’ai envie d’entendre sa voix ; je sais que ça va me faire plus de mal que de bien, mais j’en ai trop envie. J’ai besoin d’entendre sa voix pour tenter de comprendre s’il va bien ; et pour tenter de déceler un espoir ; j’ai besoin d’un espoir.
Heureusement, mon portable est resté à l’appart ; malheureusement, ma carte bleue est avec moi ; son 06 est gravé dans ma tête ; et je connais l’emplacement des cabines téléphoniques ; cabines qui ont en plus un avantage certain, celui de garantir l’anonymat de l’appelant.
Me voilà devant le petit clavier métallique. J’hésite longuement avant de me lancer. Je finis par taper les dix chiffres, les doigts tremblants, le cœur dans ma gorge ; les voir s’afficher sur le petit écran me donne le tournis.
Ça sonne. Je ne sens plus mes jambes, je suis obligé de m’appuyer contre la paroi vitrée. À chaque sonnerie, mon cœur a des ratés. Troisième sonnerie : je me dis que finalement je préférerais tomber sur son répondeur, juste entendre sa voix enregistrée, et raccrocher juste avant le bip.
Cinquième sonnerie, mon vœu semble en passe de se réaliser.
Pourtant, ça finit par décrocher.
« Oui ? ».
Et le timbre de sa voix de mec, au ton ferme, viril, un brin autoritaire, vient faire vibrer mon oreille ; et, avec elle, tant de cordes sensibles en moi.
Je ne veux pas lui parler. De toute façon, je ne peux pas, ma langue est nouée, mon cerveau paralysé.
Le secondes s’enchaînent, mon silence devient suspect.
« Allo ? » fait le bogoss, agacé.
Je sais que c’est le moment de raccrocher, avant de me faire envoyer chier. Pourtant, je n’arrive pas à m’y résoudre ; une partie de moi voudrait parler, lui dire que c’est moi, lui dire à quel point il me manque, à quel point je crève d’envie d’être avec lui. En attendant, mon silence finit par l’indisposer carrément.
« Alloooooo ? » il relance, déjà emporté.
Putain, qu’est-ce qu’il me manque… tout remonte en moi… une immense, douloureuse nostalgie pour ce Paradis Perdu… je vais encore chialer… je dois me retenir… je dois mettre fin à cette « conversation »… mais je n’en ai pas la force…
Mais lui, si. Une seconde plus tard, j’entends le clic du téléphone lointain qui vient de raccrocher, suivi par le son de la ligne coupée.
Je raccroche à mon tour, en larmes ; et je marche, je marche, je marche pour tenter de me calmer ; je marche jusqu’à l’épuisement.
Je rentre à l’appart vers 3 heures, je suis en miettes, le moral sous les semelles. Tout le monde est couché, le silence règne en maître : si les amoureux avaient envie de faire l’amour, c’est fait ; ils ont pu le faire sans avoir à se soucier de faire attention à ma présence dans la chambre d’à côté, et moi je n’ai pas eu à endurer ça, je n’ai pas eu à détester un peu plus ce couple qui me rappelle que je suis seul.
Lundi 20 août 2001
Le lendemain, j’évite de raconter l’écart « téléphonique » à ma cousine ; d’une part, je n’en suis pas vraiment fier, car ça n’a fait que raviver ma blessure ; d’autre part, je sais qu’elle me pourrirait, et à raison, et je n’ai franchement pas envie de me faire disputer ; de plus, elle a d’autres chats à fouetter que de s’occuper des comportements ridicules de son cousin : elle est très occupée à être heureuse.
Tellement occupée que je ressens de plus en plus fortement le besoin de faire équipe à part.
Je vais à la plage seul, avant qu’ils ne soient levés ; je me balade seul, alors qu’ils vont à la plage en amoureux.
J’ai besoin d’être seul, de ruminer seul, de pleurer seul.
C’est insupportable de penser que je ne le reverrai plus jamais. Que c’est fini pour de bon. Ma migraine est revenue de plus belle. Ma vie n’a plus de sens. La souffrance envahit chaque cellule de mon corps, chaque instant de mes journées, chaque neurone de mon cerveau… ma vie n’est plus que noirceur et détresse. Je n’en peux plus : il faut que cette douleur cesse, coûte que coûte.
Dans l’après-midi, je me décide à aller visiter le château de Gruissan ; et là, sur les ruines majestueuses de l’ancienne bâtisse, au-delà d’une fine barrière métallique bordant la falaise, mes idées se font soudainement très noires.
Une douce brise remonte et caresse ma peau : le vide a l’air si tentant.
Un pas, un seul pas Nico : tu enjambes la barrière, et tu fermes les yeux ; un pas encore, un tout dernier, et toute cette souffrance qui te déchire de l’intérieur et qui t’étouffe va cesser tout de suite et à tout jamais.
Il n’y a rien qui te retient, aucun bonheur ne te parait possible désormais… alors qu’il te suffit d’un petit saut pour ne plus rien ressentir, pour être en paix…
En réalité, oui, quelque chose me retient, non pas vis-à-vis de ma propre vie, mais vis-à-vis de celle des autres : c’est la peur de faire souffrir les gens qui m’aiment : maman, papa, Élodie, Thibault.
Je ne veux pas faire souffrir, je ne veux pas leur infliger ça ; même pas à celui qui m’a rendu si malheureux, je ne veux pas qu’il se sente coupable.
Je voudrais juste disparaître de cette terre d’un coup de baguette magique, sans laisser de trace, disparaître de la mémoire des gens qui m’ont connu, comme si je n’avais jamais existé.
Disparaître pour ne plus souffrir. Rêve impossible.
Alors, l’appel du vide est de plus en plus fort, sa promesse de plus en plus séduisante…
Si je fais ce pas, je vais occasionner une très grande peine à ceux qui restent, certes ; mais, au fond, une fois que je serai parti, leur souffrance ne sera plus mon problème : la souffrance peut rendre terriblement égoïste.
Mais est-ce que tu vas avoir les couilles de faire ça, Nico ?
Soudainement, un souvenir remonte à mon esprit, un souvenir qui revient du fin fond de mon enfance. J’avais genre 9-10 ans, lorsque j’ai vu une scène à la télé qui m’a marqué comme peu d’autres. Je n’ai jamais repensé à cette scène depuis, mais elle refait surface dans ma mémoire aujourd’hui, devant la falaise du château de Gruissan.
Les détails sont flous, il me semble que c’était un film d’animation réalisé dans un style naïf et épuré, en noir et blanc.
Dans la séquence, on voit un bonhomme à l’air complètement désespéré (sans que l’on connaisse les raisons de sa détresse) monter au dernier étage d’un building. Lorsqu’il arrive au sommet, le bonhomme regarde vers le bas et, après un instant d’hésitation, il se jette dans le vide.
L’immeuble est haut, et sa chute dure longtemps ; d’autant plus que, pas la magie de l’animation, sa vitesse de chute n’augmente pas de façon exponentielle, mais elle reste constante ; et, surtout, bien en déca des exigences de la gravité terrestre.
Alors, pendant sa chute « aménagée », le bonhomme voit défiler, fenêtre après fenêtre, étage après étage, des vies qui lui sont inconnues : à travers une fenêtre, il voit une belle femme qu’il a soudainement le regret de ne plus pouvoir connaître ; derrière une autre fenêtre, il voit des gens qui font la fête, et qui lui paraissent très sympathiques ; derrière une troisième, il voit un couple qui s’embrasse et qui a l’air heureux. Etage après étage, le bonhomme se surprend à envier les vies de toutes ces gens.
C’est ainsi que, d’abord déterminé dans son geste, à fur et à mesure que le sol approche, le bonhomme se sent de plus en plus assaillir par le doute et le regret.
Le sol approche inexorablement et en cet instant ultime, le bonhomme n’a plus du tout envie de mourir.
Ainsi, sa dernière pensée avant de se fracasser au sol, c’est le regret de quitter cette vie qui lui semble à nouveau belle, le regret d’avoir commis un geste qu’il considère finalement stupide.
Au final, le bonhomme termine sa vie en se trouvant stupide.
D’un geste brusque, je fais un pas en arrière.
Non, je ne dois pas céder aux sirènes de la falaise ; il faut des couilles, oui, pour se laisser tomber dans le vide ; mais il faut des couilles dix fois plus fortes pour tenir bon et continuer à avancer.
La falaise, c’est égoïste, la falaise c’est stupide. La falaise, c’est me priver de ce cadeau qu’est la vie.
Alors, si je fais un pas en arrière, ce n’est pas pour ne pas faire de la peine aux gens qui m’aiment ou parce que je n’ai pas les couilles ; si je fais un pas en arrière, c’est avant tout et par-dessus tout pour moi, pour moi, pour moi. Je mérite de vivre.
Et puis, peut-être qu’au fond de moi je sais déjà qu’un jour j’aurai envie de raconter cette histoire : si je pars, personne ne saura jamais ce que j’ai vécu avec mon horrible beau ténébreux. « Live to tell ».
If I ran away, I'd never have the strength/Si je fuis, c'est que je n'aurais jamais eu la force
To go very far/D'avancer vraiment
How would they hear the beating of my heart/Comment entendraient-ils le battement de mon cœur
(…) How will they hear/Comment entendront-ils
When will they learn/Quand apprendront-ils
How will they know/Comment sauront ils
Je viens tout juste de faire un pas en arrière, alors que j’entends le son de notification d’un sms.
La surprise qui m’attend est immense et elle m’émeut aux larmes.
Voilà un premier cadeau de la vie que je n’aurais pas pu recevoir si, une minute plus tôt, j’avais cédé à l’appel de la falaise.
« Hello, comment ça va le toulousain ? ».
Le bon message au bon moment. Ça, c’est du Stéphane tout craché.
Nous échangeons quelques messages, et il finit par m’appeler.
Le son de sa voix me fait du bien. Je me souviens de sa gentillesse, de sa maturité, de sa bienveillance, de sa sagesse ; je me souviens de l’amour avec lui, de sa douceur, de sa tendresse. J’ai tellement envie de le revoir.
« Comment va Gabin ? ».
Stéphane veut avoir de mes nouvelles. En quelques mots, je lui raconte les deux derniers mois de ma relation, depuis son départ, jusqu’au clash du 10 août, ce triste vendredi noir.
« Ça va aller, Nico ? ».
« C’est dur… ».
« Je pourrais te dire que je sais combien tu souffres, mais je mentirais… chaque souffrance, comme chaque amour, est unique… ».
« Je ne veux plus être amoureux de lui… ».
« Ça ne se commande pas ça… tu ne peux pas décider de ne plus aimer, même quelqu’un qui t’a blessé… Mais crois-moi, même si aujourd’hui cela te semble impossible, un jour tu oublieras ta rage et ta tristesse, et la vie te semblera à nouveau belle et pleine de promesses…
Tu dois regarder loin, au but que tu dois viser, celui d’être à nouveau heureux… chaque jour, fixe-toi des petites étapes, et veille à les atteindre… ce sont ces petits pas qui vont t’aider à avancer, sans te décourager devant l’énormité du chemin encore à parcourir pour atteindre ton objectif…
Aujourd’hui, tu as peut-être envie de ne rien ressentir… de ne plus jamais rien ressentir… mais te forcer à ne rien ressentir, pour ne plus souffrir... quel gâchis !
Si tu oublies la souffrance, tu oublieras aussi la joie que tu as éprouvée auparavant… et si tu oublies cette joie, ton cœur s’asséchera et tu n’auras rien à offrir aux rencontres que l’avenir t’offrira…
Lorsqu’on accepte de vivre sa vie, il faut l’accepter toute entière, et ne pas en retenir que ce qui est beau ou agréable. Ce qui est difficile, triste et dur fait aussi partie de la vie, les joies comme les peines : les unes sont indissociables des autres, elles sont même parfois les conséquences l’une de l’autre. On ne peut pas espérer l’amour sans avoir peur de souffrir et, surtout, sans accepter de souffrir. La vie est un tout, et il faut faire avec… ».
J’ai pleuré au téléphone, j’ai pleuré après avoir raccroché ; mais pour la première fois, ce ne sont pas que des larmes de souffrance, mais des larmes provoquées par le soulagement d’entrevoir enfin une petite lueur d’espoir au fond du tunnel sans fin de ma détresse.
Je suis tellement bouleversé par les mots de Stéphane que la nuit suivante je n’arrive pas à trouver le sommeil.
J’allume la télé et je tombe sur une émission d’Arte : en général, les émissions de la nuit d’Arte c’est bien pour aider à trouver le sommeil.
Mais pas cette nuit : car, une fois n’est pas coutume, non seulement une émission de la nuit d’Arte n’appelle pas le sommeil et/ou la consternation, mais elle arrive à capter mon attention toute entière.
Il s’agit de la rediffusion d’un documentaire consacré à une chanteuse vénitienne très populaire en Italie mais pratiquement inconnue en France. Son nom, est Patty Pravo.
Sur des images d’archive des années 70, la voix off la décrit comme une artiste atypique et inclassable dans le paysage de la variété musicale italienne. En raison d’un répertoire dont les thèmes récurrents sont la fin de l’amour, l’abandon, le manque, et la solitude, la star italienne est définie comme « la chanteuse du chagrin d’amour » ; une artiste libre, dans ses choix artistiques et dans sa vie, qui est devenue, au fil des années, l’icône de toute une génération, et en particulier dans le milieu gay.
L’émission, intégralement sous-titrée, alterne des interviews de l’artiste avec des extraits de ses chansons.
Ragazzo Triste/Garçon triste
Ragazzo triste come me (…)/Garçon triste comme moi (…)
che sogni sempre come me (…)/qui rêve toujours comme moi (…)
(…) Nessuno può star solo/Personne ne peut rester seul,
Non deve stare solo, quando si e' giovani così/Ne devrait pas être seul quand on est si jeune
La Bambola/La Poupée
Tu mi fai girar, tu mi fai girar/Tu me fais tourner, tu me fais tourner
Come fossi una bambola/Comme si j'étais une poupée
Poi mi butti giu, poi mi butti giu/Puis tu me jettes, puis tu me jettes
Come fossi una bambola/Comme si j'étais une poupée
Non ti accorgi quando piango/Tu ne t'en rends pas compte quand je pleure
Quando sono triste e stanca/Quand je suis triste et fatiguée
Tu, pensi solo per te/Toi, tu ne penses qu'à toi
Se perdo te/Si je te perds
Se perdo te cosa farò/Si je te perds, qu’est-ce que je vais faire ?
Io non so più restare sola/Je ne sais plus rester seule
Ti cercherò e piangerò/Je te chercherai et je pleurerai
Come un bambino che ha paura/Comme un enfant qui a peur
(…) Se perdo te, se perdo te/Si je te perds, si je te perds
Cosa farò di questo amore/Qu’est-ce que je vais faire de cet amour
Ti resterà, e crescerà/Il restera, il grandira
Anche se tu non ci sarai/Même si tu n'es pas là
Tutt'al Più/Tout au plus
Parfois, je pense revenir te voir /Et si je ne l'ai pas encore fait
Ce n’est pas parce que l'amour est terminée/Je t’aime encore
Je ne l'ai fait parce que/Parce que j’ai peur de te trouver changé
Pazza idea/Idée folle
https://www.youtube.com/watch?v=OYttugD31rI
Se immagino che tu sei qui con me/J'imagine que tu es ici avec moi
sto male, lo sai!/Je me sens mal, tu sais!
Voglio illudermi di riaverti ancora/Je veux me donner l’illusion de t’avoir à nouveau
com'era un anno fa/comme c’était il y a un an.
Pazza idea di far l'amore con lui/Idée folle de faire l'amour avec lui
pensando di stare ancora insieme a te!/pensant que je suis encore avec toi!
Folle, folle, folle idea di averti qui/Folle, folle, folle idée de t’avoir ici
mentre chiudo gli occhi e sono tua/Pendant que je ferme les yeux, je suis à toi.
Et aussi,
Non andare via/Ne me quitte pas
Une reprise qui n’a pas besoin de présentations.
Cette nuit, j’ai découvert une artiste, une femme dont les chansons m’ont frappé droit au cœur. Cette nuit, je sais que moi et Patty, ce sera pour la vie. Cette nuit, je me dis que je veux apprendre l’italien.
Il est trois heures du mat, je viens enfin de me coucher, lorsque mon téléphone émet un petit son de réception de message ; réflexe pavlovien, et mon cœur est à nouveau prêt à casser ma poitrine : au fond de moi, j’espère toujours que ce sera un message de lui ; une fois de plus, ce n’est pas le cas.
« Hey, tu bronzes, le veinard ? Mate pas trop les mâles sur la plage ! ».
C’est un message de Julien, l’adorable jeune loup blond.
Jeudi 23 août 2001, la veille du départ.
C’est décidé, demain nous allons quitter Gruissan et rentrer à Toulouse.
Ça va faire deux semaines que nous sommes partis : deux semaines depuis notre dispute, deux semaines que je ne l’ai pas vu. Deux semaines que j’attends un sms qui n’est jamais venu. Il m’a déjà oublié. Il est passé à autre chose : une nouvelle copine, une nouvelle vie. Je me demande s’il est toujours sur Toulouse ou s’il est déjà à Paris.
Quoi qu’il en soit, il n’y a plus de place pour moi dans sa nouvelle vie.
Alors, c’est peut-être que c’est lui qui a raison finalement : peut-être qu’il fallait tout casser, faire table rase du passé et repartir chacun vers son avenir propre. Oui, peut-être que finalement c’est mieux ainsi.
Deux semaines, rien que deux semaines ; pourtant, j’ai l’impression que ça fait un siècle que j’ai quitté Toulouse, comme si j’avais été carrément sur une autre planète. L’idée de rentrer au bercail me parait bizarre. Et angoissante.
Je réalise que je viens sans doute d’affronter la quinzaine la plus dure, la plus difficile, la plus éprouvante de ma vie : c’est aussi l’occasion de constater que, malgré tout, je suis toujours vivant ; mon bleu a pratiquement disparu de mon visage, ma migraine me laisse enfin du répit ; et mes larmes, aussi.
Je suis conscient que si j’ai pu passer ce cap sans faire des conneries, c’est parce que j’ai eu la chance d’être très bien entouré : la chance d’avoir une maman adorable, une cousine fantastique, des potes formidables comme Stéphane ou Julien… ou encore Thibault, si jamais j’arrive à le « retrouver ».
La chance d’être si bien écouté, compris, accepté, entouré, aimé.
La présence de toutes ces personnes bienveillantes autour de moi me rend plus fort. Grâce à elles, je ne suis pas seul.
C’est important, les amis : ce sont les seuls qui peuvent nous soutenir lorsque tout s’effondre autour de nous. C’est important d’être bien entouré. Sans mes amis, je ne sais pas où j’en serai aujourd’hui.
Elodie a été vraiment géniale : grâce à sa présence bienveillante, je e suis senti pris en charge, accompagné, soutenu, secoué ; et même si, sur la fin, la présence de Philippe a un peu changé la donne, je ne peux pas me plaindre.
Le fait de m’être retrouvé un peu plus seul, dans un deuxième temps, ça a été un mal pour un bien ; finalement, j’avais peut-être besoin d’être seul, pour me retrouver, pour entamer un travail de deuil qui ne peut être fait que par moi-même.
Je repense à ce moment de faiblesse devant la falaise et je me trouve vraiment idiot.
Combien de jeunes gays de 18 ans, découvrant leur sexualité, ont cette « chance » ? Combien de jeunes mettent fin à leurs jours, non pas parce qu’ils se sont faits largués, mais parce qu’ils sont harcelés, battus agressés dans la rue, rejetés, exclus par leur famille, au point que leur vie n’est en effet plus supportable, parce qu’ils ne peuvent compter sur personne ?
Mettre fin à ses jours ce n’est pas la bonne solution, même si ça peut le sembler dans un moment de désarroi : rien ne vaut ce geste, même pas face au chagrin le plus insupportable ; quant aux cons qui s’emploient à rendre insupportable la vie d’autrui, jamais, jamais, jamais, ô grand jamais, ils ne doivent gagner.
La fin d’un amour c’est un gâchis épouvantable ; mais il n’est pas plus grand gâchis que celui de ne pas découvrir ce que l’avenir nous réserve.
Malgré tout, je redoute le retour sur Toulouse et tout ce que cela implique en termes de choc émotionnel : je sais que je ne suis pas encore complètement guéri, loin de là ; je redoute les souvenirs qui vont venir à moi à l’instant où je vais retrouver les lieux familiers, cette ville, ses rues, cette maison, la chambre qui ont servi de décor à ce premier amour fini.
Une seule chose est capable de rendre l’idée de ce retour moins insupportable : c’est la perspective de retrouver ma maman, cette maman que j’adore et qui est désormais au courant.
Pendant le séjour à Gruissan, je l’ai eue régulièrement au téléphone : mais nous n’avons jamais reparlé de ce qui s’est passé ce jour-là. En, fait, je n’ai pas vraiment envie d’en reparler avec elle, j’ai surtout besoin de sentir sa présence, cet amour, cette bienveillance qui chauffe et soigne mes blessures.
Quand j’y pense, j’ai encore du mal à me dire que maman est désormais au courant. C’est une bonne chose qu’elle le soit, je ne regrette pas une seule seconde ; ce que je regrette, c’est le fait que mon coming out ne se soit pas du tout passé comme je l’avais imaginé ; qu’elle ait pu entendre les échos de notre dispute, qu’elle ait été confrontée à l’image du sang, des coups, de la violence ; je regrette les circonstances dans lesquelles elle a eu la confirmation de mon attirance pour les garçons.
Sur le moment, j’ai été triste pour elle, j’ai été inquiet qu’elle s’inquiète pour moi. Mais ma maman a des ressources incroyables, et elle très bien su gérer : c’est grâce à ses mots et ses gestes adorables et pleins d’amour qu’elle a su balayer mes inquiétudes, porter les tout premiers soins d’urgence à mon cœur blessé.
Oui, c’est une bonne chose que maman soit au courant.
Pourtant, et c’est quand même bizarre, je me sens presque nostalgique de ma vie d’avant, quand personne ne savait encore, ou du moins quand je pouvais penser que personne ne savait ; une vie qui me rendait malheureux, certes, mais qui recelait un « jardin secret » qui faisait partie de ma spécificité.
Je me suis construit dans la dissimulation, dans la peur que les parents, les amis ou les connaissances, apprennent qui j’étais vraiment ; mon secret, et la crainte qu’il soit découvert, sont devenus au fil du temps presque des raisons d’être.
Etre gay n’est pas ce qui me définit uniquement en tant que personne, mais ça en fait partie.
Pendant longtemps, j’ai attendu le moment du coming out comme une sorte de délivrance : et quand enfin ce moment arrive, je ressens un vide en moi.
Mon coming out est fait, et c’est comme si une partie de moi était portée en plein jour, comme si elle m’échappait, comme si elle ne m’appartenait plus totalement. Alors qu’au contraire, le fait de partager ce secret, qui du coup cesse d’en être un, c’est plutôt le signe que je suis en train de m’affirmer et de m’approprier de ma propre vie.
Mais, au-delà de cette nostalgie plutôt absurde, mon plus grand regret est d’avoir attendu tant de temps pour sortir du placard.
Le fait que mes coming out successifs avec Elodie, Thibault, maman, se passent bien, me fait prendre conscience du fait que mon « secret » n’avait finalement pas tant d’importance que ça ; que j’aurai pu m’épargner tant d’angoisses, de questionnement, et la peur panique d’être démasqué : si seulement j’avais pu réaliser plus tôt qu’être gay n’est pas si terrible, que je n’avais pas à me cacher.
Et aussi, le fait que maman soit au courant, me donne l’impression d’avoir franchi un cap au-delà duquel je ne pourrais plus faire marche arrière, comme si ma vie allait prendre une direction en quelque sorte inéluctable ; comme si quelque chose arrive à son terme, a sa conclusion logique ; et, comme toute conclusion, elle me fait peur. Et elle me fait me poser des tas de questions.
Est-ce que je suis vraiment être homo ? Est-ce que, avant de donner une direction définitive à ma vie, je ne devrais pas d’abord essayer avec une fille ? Peut-être que je pourrais y arriver… être comme tout le monde… certainement, ma vie serait plus simple… non seulement je n’aurais pas à assumer le fait d’aimer le garçons, chose à laquelle je travaille justement au fil de mes coming out successifs… mais aussi et surtout je n’aurais pas à affronter la difficulté de trouver un gars qui veuille bien partager ma vie et s’assumer comme moi, avec moi…
Mais une fille… non, quand même pas… je ne pourrais pas… je serais malheureux, je rendrais malheureux…
Vendredi 24 août 2001
Comme prévu c’est ce vendredi en début d’après-midi que nous quittons Gruissan et nous reprenons la route vers Toulouse.
Depuis deux semaines, après le déluge, j’ai pleuré jusqu’à en perdre toute énergie ; j’ai pleuré pour me délester de ma souffrance, j’ai pleuré pour oublier ; je repense à mon bleu sur le visage dont il ne reste presque plus rien : la distance et le temps m’ont fait du bien.
J’ai eu la chance de commencer ma vie sentimentale, et aussi de connaître mon premier grand chagrin d’amour, à une époque où la distance physique autorisait une véritable absence de l’autre, cette dernière étant un préalable nécessaire au deuil affectif.
C’était une époque où Facebook et Instagram n’existaient pas ; et puisqu’ils n’existaient pas, ils ne pouvaient pas se transformer, dans le cas d’une rupture, en funestes témoins de mondes perdus ; en vitrines, indécentes et impudiques, de nouvelles vies dont nous ne faisons plus partie ; en couteaux remuant sans cesse dans une plaie affective béante qui aura d’autant plus de mal à guérir ; en machines à alimenter la jalousie, à maintenir la souffrance, à annuler la distance mentale, rendant encore plus insupportable la distance physique et affective de l’autre ; en instruments interdisant au passé de devenir le passé, nous privant tout bonnement du salutaire et indispensable droit à oublier.
Alors, loin de lui, loin de tout, j’ai essayé de l’oublier. Je réalise soudainement que ça fait pile deux semaines aujourd’hui ; deux semaines depuis ce vendredi noir, depuis cette triste date du 10 août. Je me rends compte que, depuis deux semaines, je n’ai jamais prononcé son prénom. Elodie non plus, d’ailleurs.
Le seul écart commis, c’est ce maudit coup de fil que je n’ai pas pu m’empêcher de passer un soir de détresse aigue. Si seulement je pouvais oublier aussi les 10 chiffres de son portable. Hélas, j’ai trop la mémoire des chiffres. Mais je suis bien déterminé à ne plus jamais m’en servir. Et, avec un peu de chance, quand il sera à Paris, il en changera.
Au bout de ces deux semaines loin de tout, j’ai l’impression de retrouver un semblant de sérénité et d’équilibre ; enfin, de la résignation du moins.
La cité de Carcassonne fait son apparition sur notre gauche, embrasée par la couleur vive du soleil de l’après-midi. Le poste diffuse la chanson de cette fin d’été :
My life… will never be the same/Ma vie… ne sera plus jamais la même
'Cause girl, you came and changed/Parce que chérie, tu es arrivée et tu as changé
The way I walk/Ma façon de marcher
The way I talk/Ma façon de parler
I cannot explain the things I feel for you/Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens pour toi
Nous ne sommes plus qu’à 100 bornes de Toulouse.
Il me manque horriblement… est-il encore sur Toulouse ou est-il déjà parti à Paris ?
Un constat déchirant et un questionnement tout aussi angoissant : voilà ce qui tourne en boucle dans ma tête au réveil de la première nuit passée dans ma chambre.
Sentir en moi le besoin irrépressible d’aller le voir, coûte qui coûte : à Toulouse, ou à Paris…
Voir soudainement, violemment prendre forme en moi l’espoir désespéré de pouvoir rattraper ce qui s’est passé, l’espoir d’aller le voir et de trouver enfin le passage secret qui donne accès à son cœur, les mots qui sauront le toucher ; me dire que, peut-être, depuis deux semaines il a eu le temps et l’occasion de réfléchir, la distance aidant, de se rendre compte du gâchis qu’on est en train de commettre ; me dire que, peut-être il m’attend…
Mais non, il ne m’attend pas ; non, je ne peux pas aller à sa rencontre.
Il est en revanche une autre rencontre que je dois provoquer au plus vite : celle avec mon pote Thibault.
Car, plus j’y pense, plus je me dis que ce silence ne lui ressemble vraiment pas.
D’abord, parce que Thibault est un véritable ami, qui m’a toujours soutenu : s’il avait des choses à me reprocher, il ne se contenterait pas de me faire la gueule, mais il chercherait à savoir ce qui s’est vraiment passé.
Car Thibault n’est pas un mouton, ce n’est pas parce qu’il est fidèle en amitié, qu’il approuve toujours les comportements de son pote ; je ne pense pas qu’il l’aurait cru aveuglement si ce dernier avait essayé de m’adosser toute la faute de notre bagarre.
Non, ce silence, ce n’est vraiment pas son genre. Alors, de plus en plus, je me demande si vraiment le bomécano est au courant de ce qui s’est passé.
Demain je vais le voir, c’est décidé. S’il y a malaise, je tenterai de le dissiper ; et s’il y a autre chose derrière son silence, je serai fixé.
Nous venons de passer la sortie de Villefranche de Lauragais, la dernière avant le périf ; dans une demi-heure, je serai à la maison.
En passant le péage, l’angoisse m’envahit.
Philippe, à la place du passager, roupille paisiblement. J’ai envie de dire à Elodie de s’arrêter, de me laisser un peu de temps pour me préparer à ce retour.
Mon regard croise le sien dans le rétroviseur. L’inquiétude doit se lire en lettres de feu sur mon visage.
« Ca va aller, mon cousin ? ».
« Oui, ça va aller… ».
Sauf que non, ça ne va pas aller du tout.
Le périph’ défile trop vite ; de la même façon, trop vite, je retrouve les allées, les façades, le profil familier de la ville rose, la maison.
Malgré le grand sourire et les mots adorables avec lesquels maman vient m’accueillir, la vitesse à laquelle tout s’enchaîne m’est insupportable.
Elodie vient de partir, je monte dans ma chambre ; je m’assois sur le lit et d’un seul coup, un coup extrêmement violent, tout remonte en moi : les souvenirs, tant de souvenirs.
Je croyais avoir épuisé la source de mes larmes : je me trompais. Je croyais aussi être guéri de mon chagrin : je suis seul dans ma chambre et j’ai envie de crever.
Samedi 25 août 2001
Le t-shirt noir dépassant du zip largement ouvert de son bleu de travail, la tête sous le capot d’une jolie voiture de sport, Thibault a l’air très appliqué à sa tache. C’est touchant de voir ce p’tit mec soigner toujours autant son travail.
Il est 17 heures et je sais qu’il ne va pas tarder à débaucher. J’attends qu’il capte ma présence pour lui adresser un petit coucou. Un petit coucou qu’il me retourne, certes ; pourtant, le beau sourire chaleureux et bienveillant auquel il m’a habitué, n’est pas de la partie aujourd’hui.
Thibault referme le capot de la voiture, raccroche les outils au tableau, se nettoie les mains dans un bout d’essuietout. Un instant plus tard, il marche droit dans ma direction.
Ses mains et les avant-bras sont noirs de cambouis, il en porte même des traces sur le visage : et même dans cet « état », le bomécano est beau, vraiment beau.
Hélas, au fur et à mesure qu’il approche, force est de constater que ses magnifiques yeux noisette tendant au vert ont l’air si tristes, si inquiets aujourd’hui.
« Salut Nico » fait-il, sans tenter la bise.
« Salut Thibault… ».
« Tu vas bien ? ».
« Oui… oui… et toi… ? ».
« Ça peut aller… » fait-il ; avant d’enchaîner, sur un ton empressé, impatient, presque fiévreux : « dis-moi, Nico… tu as des nouvelles de Jéjé ? ».
Je sens les larmes monter à mes yeux en entendant le diminutif amical de ce prénom que je n’ai pas prononcé depuis deux semaines ; et, en même temps, je suis abasourdi de l’entendre dégainer pile la même question que j’ai moi-même envie de lui poser.
« Non… ça fait deux semaines que je n’en ai pas… ».
« Il fait chier… » fait Thibault, soucieux.
« Mais il n’est pas chez toi ? » je m’inquiète à mon tour.
« Ça fait plus d’une semaine que je ne l’ai pas vu… ».
« Et tu n’as aucune nouvelle depuis… une semaine ??? » j’angoisse.
« Tu m’attends deux minutes, Nico ? Je vais me laver et on va prendre un truc ensemble… ».
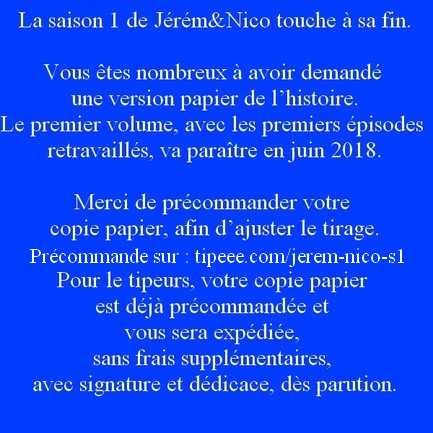
Format livre, au prix de 30 euros, cliquez ICI
Le livre existe également en format pdf + epub (format liseuses), au prix de 15 euros, cliquez ICI
 5 commentaires
5 commentaires
-
Le bogoss me toise. Illuminé par ce sourire coquin, son regard est une pure promesse de baise torride. Il sait à quel point j’ai envie de lui ; et moi aussi je sais qu’il a envie de moi. Je le sais. Je le vois. C’est grisant.
La gifle olfactive de son déo de mec embrume un peu plus mon cerveau.
« Tu veux boire quelque chose ? » je lui demande, alors que je n’ai qu’une envie, ou plutôt deux, celle de le voir à poil et de l’avoir dans ma bouche.
« Non… c’est toi qui va boire un truc… » fait-il en se retournant vers moi et en me lançant un regard chaud comme la lave qui sort du volcan. C’est un petit sourire canaille, amusé, c’est quelque chose qui ressemble à de la complicité. Dans ma tête, ça ressemble au Paradis.
« Ah, tu crois ? » je m’amuse à mon tour.
« J’en suis même certain… » fait il en appuyant le dos contre le mur, tout en ouvrant lentement sa braguette et en dévoilant un joli boxer rouge feu avec élastique blanc ; très bien rempli, qui plus est.
Petit con, va… à gifler, mais bandant à souhait.
Je ne vois que son boxer, je vois rouge, rouge feu : je me précipite sur lui, non, je me jette sur lui ; j’ai envie de le voir torse nu, j’ai envie de lui arracher le t-shirt ; fou de désir, j’attrape ce bout de coton scandaleusement sexy, je le retourne sur son torse ; le bogoss lève les bras, le mouvement est parfaitement coordonné et tout aussi pressé et précipité que le mien ; je le fais glisser, je libère l’odeur de sa peau, je libère ce torse que j’ai envie de lécher jusqu’à en perdre la raison.
Emporté par la tempête des sens, je me penche, je lèche ses pecs : c’est un désir brûlant, une envie irrépressible, un besoin presque vital. Je lèche, je mordille doucement ses tétons, l’un après l’autre ; mes mains se précipitent vers sa braguette, rencontrent les siennes, les dégagent d’un geste déterminé, presque brusque.
Je crève d’envie de me mettre à genoux et de le prendre en bouche ; pourtant, ce corps à corps est d’une sensualité et d’un érotisme qui dépasse l’entendement ; mes lèvres son insatiables, mes mains infatigables ; sous le déluge de mes caresses, l’excitation du bogoss s’emballe, devient délirante.
Ma langue descend à ses abdos, se délecte de son nombril ; et lorsque j’arrive à la ligne verticale de petits poils, je ne peux résister à la tentation d’y plonger mon nez ;je pars en quête des odeurs masculines de sa peau, dans cette région si proche de son sexe ; bonheur olfactif, tactile, sensuel : petites odeurs de jeune mâle, peau tiède, petits poils tout doux, délicieux avant-goût de sa puissance de mec.
Je suis à genoux entre ses cuisses. Je le prends en bouche et je me sens bien.
Le sucer est juste le bonheur suprême. Lui faire plaisir, le plus exquis des plaisirs. Et sentir, en plus, ses doigts sur mes tétons, c’est juste inouï ; ses doigts qui caressent, pincent légèrement, tout en variant sans cesse les mouvements, la pression, tout en m’offrant d’infinies nuances d’excitation, d’innombrables frissons.
Jusqu’à ce qu’un feu d’artifice dément explose dans ma tête : lorsque, à force de tâter et de tâtonner, le bogoss finit par trouver LE toucher et la cadence qui m’apportent LE frisson absolu : position des doigts, pression, toucher, coordination, cadence, tout est parfait…
Oui, tout est parfait… à part le fait qu’un réveil en sursaut vient interrompre cette magnifique séquence à la saveur de déjà-vu. Enroulé dans mes draps, je suis en nage.
Pendant quelques instants, je suis perdu : mon rêve était si réel, que j’ai du mal à croire que ça en était un.
Pourtant, je suis seul dans le lit ; un lit qui n’est pas le mien, dans une chambre qui n’est pas la mienne. Il est quelle heure ? On est quel jour ? Où est-ce que je suis ?
Il me faut un petit moment pour réaliser que je suis à Gruissan, et que j’y suis depuis une semaine. Putain, une semaine !!! Une semaine déjà.
Une poigné de secondes et tout me revient. La semaine sans ses nouvelles ; mon escapade à la brasserie pour lui dire de venir chercher sa chaînette ; sa chemisette couleur pétrole, le lendemain, lorsqu’il se pointe chez moi ; les cinq dernières notes du Casse-Noisette ; le sexe froid, sans âme ; sa détermination à partir vite ; ma demande d’explications au sujet de son brusque changement d’attitude ; son agacement ; le bruit de la capote qui tombe par terre ; ses mots durs, méchants, blessants comme des lames ; mon coup, son coup, le bruit de la chair qui morfle, le sang ; des mots et des bruits qui me hantent ; maman qui débarque ; le regard de maman ; son dernier regard plein de tristesse et de tourment, juste avant son départ.
Oui, son départ. La porte qui claque derrière lui : la dernière note, dure, sèche et dissonante de notre histoire. La sensation d’un gâchis sans nom qui m’arrache le cœur.
Alors, oui, le mien est un réveil en nage ; mais, aussi, un réveil en larmes.
Samedi 11 août 2001, une semaine plus tôt, dans ma chambre à Toulouse.
Ce matin, je me réveille de très bonne heure. Il n’est que 5h15. La maison dort encore.
Cette nuit, je n’ai pas beaucoup dormi. Je m’y attendais. Mais pas à ce point. J’ai sommeillé plutôt que dormir. J’ai survolé les heures en faisant de l’équilibrisme sur mes nerfs épuisés. J’ai pensé, pleuré, regretté ; j’ai essayé d’imaginer une, cent, mille façons de rattraper les choses, je me suis posé un million de questions sans pouvoir me donner une seule réponse qui enlèverait ne serait-ce qu’un ton de noirceur au tableau.
Mais comment essayer de m’extirper du désespoir le plus total, alors que tout converge à un seul, unique et triste constat : la fin de cette histoire, la fin de mon amour.
Quand tout est perdu, la douleur est immense, le deuil impossible.
Je suis KO. La nuit est passée sur moi comme un rouleau compresseur. J’ai les yeux enflés de larmes, le visage douloureux à cause du coup reçu, la tête alourdie par une grande fatigue, assommé par une migraine terrible. C’est comme un rhume carabiné, sauf qu’il n’y a pas de remède contre le mal qui m’assomme.
Je n’ai presque pas dormi de la nuit, mais je sais que je ne vais pas retrouver le sommeil pour autant. Je comate. Je sais déjà que la migraine va m’assiéger tout au long de la journée.
Je ne dors plus, mais je n’ai pas du tout envie de me lever. Il faut avoir une raison pour se lever. Un but, une obligation, une envie, un rêve, l’espoir d’un bonheur : quelque chose qui fait courir. Je n’ai rien de tout ça dans mon horizon.
Je me sens tellement fatigué que j’ai l’impression que mes yeux, mon cerveau, mon corps sont comme paralysés. En fait, je ne ressens rien, comme si je n’avais plus de corps, ni de cerveau : rien, à part cette intense sensation d’étouffement, de mort intérieure.
J’ai l’impression d’être tombé du dixième étage d’un immeuble et de m’être écrasé sur le bitume ; la sensation d’être fracassé de partout, jusqu’au dernier os, et de demeurer pourtant conscient.
Mon cerveau est tellement envahi et paralysé par la souffrance qu’il n’a même pas la ressource pour remonter à la cause de cette souffrance ; je n’arrive à penser à rien, à me focaliser sur rien ; chaque pensée, chaque souvenir, chaque image me semble au-dessus de mes forces : ressource de système insuffisante, le bug est important. Ne penser à rien, juste ne penser à rien ; et tenter de supporter cette migraine atroce.
Le vent d’Autan, toujours aussi fort, toujours aussi insistant, tape contre les volets, les fait vibrer, résonner ; petit à petit, le soleil vient lui aussi tenter de donner l’assaut à ma chambre ; déterminé, insistant, il profite du moindre interstice pour venir me parler de cet été qui s’est définitivement envolé pour moi ; dans mon cœur, cet été s’est désormais muté en hiver de Sibérie.
J’ai l’impression que le déluge s’est abattu sur ma vie ; que tout est chamboulé, que rien ne sera plus comme avant. Ma vie, c’est le vide. J’ai tout perdu, mon plus grand bonheur.
Alors, je veux juste tout oublier, ne plus rien ressentir. Je sais que je ne tomberai plus jamais amoureux. Je ne veux plus jamais tomber amoureux. Ça fait trop mal quand ça s’arrête.
J’ai juste envie de couper les ponts avec ma vie d’avant. Si la rentrée était demain, ce serait un véritable soulagement pour moi. Il faut que je voie avec maman si je ne peux pas m’installer à Bordeaux avant la rentrée. Mais je ne connais personne à Bordeaux ; et l’idée de me retrouver seul dans un petit studio m’angoisse.
Je n’ai même pas envie de voir Elodie ; je n’ai pas envie de parler de ce qui s’est passé, même pas avec elle. Juste oublier, le plus vite possible.
La seule chose dans laquelle j’arrive à trouver un semblant de soulagement, c’est la réaction de maman. Bien évidemment, j’avais imaginé mon coming out d’une façon complètement différente : j’aurais voulu attendre, pour le faire, de pouvoir la rassurer quant à mon bonheur ; loin de là, elle a assisté à mon malheur. Mais elle a été formidable, vraiment formidable : ses mots et ses caresses, m’ont fait un bien fou. Son amour m’a fait un bien fou.
Quand je pense qu’il y a des jeunes qui se font mettre à la porte par des parents qui n’acceptent pas leur homosexualité, je me dis que j’ai quand-même une chance inouïe.
Je n’ai pas pour autant envie de reparler de tout ça, avec elle, dans l’immédiat ; mais rien que le fait de savoir qu’elle sait et qu’elle me soutient, c’est en soi une aide morale précieuse.
La radio a tourné toute la nuit dans le noir, et elle tourne toujours ce matin, à volume tout bas ; j’avais besoin d’une présence, besoin de me donner l’illusion de ne pas être seul sur Terre ; j’avais besoin de me donner l’impression d’une vie qui continue, celle de la radio, une vie à laquelle pouvoir en quelque sorte raccrocher la mienne, cette vie qui s’est arrêtée la veille, comme une horloge cassée.
Je me sens comme vidé de toute énergie ; j’ai envie de rester là, dans ce lit, pour le restant de ma vie. Je m’accroche aux infos, aux chansons, aux pubs, comme un moyen d’empêcher mon cerveau de s’éteindre, à mon cœur de cesser de battre.
Je comate toujours, alors qu’une barre de fatigue et de douleur transperce mon crâne de tempe à tempe ; j’ai la tête aussi lourde qu’une pastèque ; j’ai les membres, les muscles, les articulations, les os rendus douloureux par la fatigue extrême ; j’en ai mal au ventre, tellement je ne suis pas bien.
Peu à peu, j’entends la maison se réveiller ; papa se lève, il prend sa douche, son petit déjeuner ; papa part travailler. J’écoute la ville se réveiller à son tour, la circulation reprendre, les voix des passants dans la rue revenir doucement.
Il est 9 h, lorsque maman vient taper à la porte de ma chambre.
« Tu es réveillé, mon loulou ? ».
« Oui maman, bonjour… ».
« Ça va, Nico ? ».
« Oui… » je lâche, tout en me laissant submerger par un bâillement silencieux mais si profond que j’ai l’impression qu’il va ouvrir mon thorax en deux.
« Tu te lèves, Nico ? ».
« Pas tout de suite, s’il te plait… ».
« Ne tarde pas trop, tu vas être en retard… ».
« En retard… pour… ? »
« T’as oublié, Nico ? Tu as ton dernier cours de conduite ce matin… ».
« Ah… merde ! ».
« Tu veux reporter ? ».
Oui, j’ai envie de reporter ; du moins, mon corps a envie de reporter ; l’idée de m’arracher du lit, de sortir de la maison, d’affronter le monde, cette journée d’été, le soleil, le Vent d’Autan, de marcher jusqu’à l’autoécole et de devoir me concentrer sur la conduite me semble bien au-dessus de mes forces.
Pourtant, et c’est là que je me rends compte que je suis finalement peut-être toujours vivant, je vois pointer au fond de moi une raison de me lever ; même si je n’ai aucune envie de parler de ce qui s’est passé hier, je me dis que de passer un moment avec Julien le clown sexy ça me fera du bien, ça me changera les idées.
« Non, ne reporte pas… je me lève, j’arrive… ».
Je ramasse mes membres en vrac, je prends mon visage entre mes mains, comme pour aider mon buste à soulever ce fardeau qu’est mon crâne ; je me fais violence, j’ouvre les volets, je me laisse percuter par la lumière vive du jour, par la caresse musclée du vent d’Autan, par les bruits dissonants de la ville.
Je passe dans la salle de bain et je me retrouve face au miroir, nez à nez avec l’image de ma gueule en vrac ; ah, putain, je suis vraiment bien amoché ; j’avais eu l’impression d’avoir reçu le coup en plein sur le nez, mais c’est plutôt sur le côté que j’ai chargé ; le bleu commence sous l’œil droit et descend le long du nez.
Je l’ai tapé, il m’a tapé, quel immense, horrible gâchis ! Et maintenant, tout est fini pour de bon. J’ai envie de pleurer, car ma vie n’a plus de sens.
Dégoûté, je m’arrache à cette image de malheur et j’ouvre le robinet de la douche ; l’eau tombe de la pomme, comme les larmes sur mon visage.
L’eau qui glisse sur mon corps est comme une caresse apaisante ; voilà une douche que je fais durer longtemps, tout en me demandant comment je vais pouvoir justifier ma gueule en vrac auprès de Julien, pour éviter qu’il pose trop de questions.
Primo, je vais mettre des lunettes de soleil ; deuxio, je vais lui servir la même explication que maman à papa : la porte de la salle de bain sur le nez. Il ne va jamais gober ça, mais il va devoir s’en contenter.
Lorsque je descends, un bol de café au lait fumant est posé sur la table à coté de quelques tranches de pain grillé ; ma confiture préférée, celle d’abricots, ainsi qu’un verre de jus de fruit à la poire complètent ce délicieux tableau matinal. L’odeur du pain grillé, ainsi que la présence de maman remplissent la pièce d’un bonheur simple qui m’émeut aux larmes ; caresse pour mes narines, l’une ; caresse pour mon cœur, l’autre.
« Merci maman… pour le petit dej… ».
Elle sourit. Elle est belle.
« Ça va mon Nico ? T’as réussi à dormir un peu ? ».
« Pas trop… ».
« C’est le chagrin… ».
« T’as pas un truc pour la migraine, maman ? J’ai la tête qui va exploser… ».
« Si tiens, mon loulou… » réagit elle du tac au tac en m’envoyant une boite d’aspirine.
« Merci maman… ».
Je bois une gorgée de café au lait, la boisson chaude descend en moi comme un doux câlin ; et soudainement, je me sens prêt à lâcher ce que j’ai sur le cœur depuis la veille :
« Je suis désolé que t’aies appris ça comme ça, hier… ».
« Je n’ai rien appris, hier… rien que je ne savais déjà… à part mettre un visage sur un garçon dont je soupçonnais bien l’existence… ».
« Mais comment tu savais ? »
« Ce sont des choses qu’une maman ressent… ».
« Ça se voit autant ? ».
« Mais pas du tout, mon Nico… quand on te regarde, on ne voit qu’un beau garçon… et on ne peut pas deviner ce qui fait battre ton cœur, pas du tout, je t’assure… ».
« Tu me rassures… n’empêche que tu savais… ».
« Bon d’accord » elle rigole « il n’y a pas que de l’intuition féminine dans l’histoire… il y a eu aussi un peu de chance… si on peut dire ça comme ça… il faut que je te dise, Nico… il y a quelques temps, j’ai croisé la maman de Dimitri au centre commercial et elle m’a demandé de tes nouvelles… elle a précisé que ça faisait depuis l’été dernier qu’elle ne t’avait pas vu… je n’ai pas eu besoin de lui poser la question, mais il m’a semblé évident que tu n’as jamais dormi chez Dimitri ces derniers mois... ».
« Et t’as pensé direct à un mec… tu t’es pas dit que j’aurais pu être chez une fille… »
« C’est ce que j’ai pensé la première fois que tu as découché… après, je me suis dit que tu n’aurais pas fait tant de cachotteries si ça avait été le cas… et aussi, depuis la semaine dernière… il y avait cette odeur de cigarette qui trainait dans la maison… et aussi un parfum de garçon… ».
« Désolé d’avoir menti… ».
« Je ne t’en veux pas, Nico… tu as menti parce que tu avais peur… mais tu n’as pas à avoir peur de moi… et je suis sûr que même papa va bien le prendre… quand tu seras prêt, tu lui expliqueras calmement, et ça va passer comme une lettre à la poste… ».
« Elodie est au courant… ».
« Je m’en doutais… »
Ça faisait combien de temps que tu étais avec ce garçon… au fait, il s’appelle comment ? ».
« Je n’ai jamais été avec lui… ».
« Comment ça… ».
Maman, s’il te plait, je peux pas… » je la coupe, au bord des larmes.
« D’accord mon Nico, d’accord… » fait elle en me caressant doucement les cheveux.
Comme je l’avais imaginé, le contact avec la ville bruyante, avec sa lumière aveuglante, avec les passants pressés, avec le vent violent et insistant, m’agresse sans pitié. Lorsqu’on est au fond du trou, il faut une énergie mentale insoupçonnée rien que pour exister ; car, dans ces moments-là, exister c’est être en opposition à un monde qui apparaît étranger et hostile.
Je tente de me cacher derrière mes lunettes de soleil, mais j’ai l’impression que tout le monde me regarde quand même, que mon cocard clignote sur mon visage comme un gyrophare violet.
Me voilà lancé sur les rails de cette nouvelle journée que je vais devoir affronter lesté de cette fatigue insupportable ; me voilà parti pour puiser dans mes dernières ressources pour accomplir chaque mouvement, chaque pas, la moindre pensée (je me sens comme un portable dont l’icône de charge clignote en permanence, annonçant un arrêt imminent).
Cette belle et chaude journée d’été n’a pas de sens pour moi, car ce sera une journée sans lui ; la première, d’une longue série, une série infinie ; je sais que je ne le reverrai plus jamais ; à part, peut-être, à la télé ou sur un journal sportif ; je n’aurai même pas le droit à l’oublier pour me reconstruire : son absence me hantera à travers le rugby.
Il faut que je parte de cette ville au plus vite : quand je serai à Bordeaux, je pourrai peut-être échapper au rugby. Et aux souvenirs.
Ma souffrance plane au-dessus de moi comme une immense chape de plomb ; tous mes sens sont enlisés dans une sorte d’état comateux, mon cerveau marche au ralenti, tout me parvient comme avec un léger différé ; je réagis un coup sur deux, en vrac, mes mouvements sont empâtés : je me prends les pieds dans la marche d’un trottoir, je trébuche, je manque de m’étaler à plat ventre.
Je me sens incapable d’accomplir quoi que ce soit de bon aujourd’hui. Je me demande si ça a vraiment été une bonne idée de ne pas annuler le cours : finalement, je n’ai pas du tout envie de conduire, j’ai peur de faire des conneries ; et puis, je redoute le regard de Julien, je redoute les questions qu’il ne va pas se gêner de poser.
Je suis peut-être à cinquante pas de l’autoécole, lorsque la voiture se gare sur le petit parking.
Deux filles en sortent ; et avec elles, le petit coq blond, toujours aussi taquin, toujours aussi charmeur, toujours aussi sexy.
Sa tenue du jour comporte un t-shirt gris chiné, les bords des manchettes et du col mis en évidence par une fine lisière sombre : un petit bout de coton tendu sur sa plastique, qui met bien en valeur ses épaules bâties et ses biceps ; un jeans marron et des baskets blanches, un brushing à cheveux longs plaqués vers l’arrière ; et, pour compléter sa tenue de bogoss, il arbore un immense sourire, un sourire tellement lumineux qu’il déborde et irradie même à travers de ses grandes lunettes noires.
Définitivement, ce mec est à hurler. En plus, il respire la jeunesse insolente, la joie de vivre, la vie brûlée par les deux bouts. Rien qu’en le regardant, j’ai l’impression de mieux respirer, d’aller carrément mieux. Définitivement, la beauté est à la fois un puissant analgésique et un antidépresseur plutôt efficace.
J’approche et le bogoss me serre la main, puissante prise de mec.
« Salut ! ».
« Salut… je lui rétorque, alors que je sens qu’il a capté direct mon cocard. Non, les lunettes de soleil ça ne cache pas tout.
Les filles s’attardent à taper la discute au bogoss : elles me gonflent. C’est lui qui met fin à leurs piaillements, en leur coupant l’herbe sous les pieds :
« C’est bien sympa, les filles… mais je ne suis pas sûr que ma copine apprécierait que je sorte en boite avec vous ce soir… il faut y aller maintenant, j’ai un autre cours… ».
Les filles se tirent enfin.
« Hey, Nico ! » il m’accueille alors très chaleureusement ; et là, je le vois plisser les yeux, amorcer le mouvement si sexy de mettre ses sourcils en chapeau, et me balancer direct, en singeant avec sa voix le ton avec lequel on s’adresserait à un enfant : « qu’est-ce que t’as fait ? Tu t’es battu ?!?! ».
Nico touché.
« Non, je me suis pris la porte de la salle de bain sur le nez… ».
« A d’autres… ».
Nico touché 2 fois.
« C’est vrai… je te jure… ».
« Tu me la fais pas… je sais à quoi ressemble un cocard… j’en ai fait quelques-uns, j’en ai reçus aussi… ».
Nico touché 3 fois.
« Je suis maladroit… ».
« Tu vais pas apprendre à un singe à faire la grimace… ».
Je vois la fille de la dernière fois se pointer au loin, je la regarde approcher.
« Ne pose pas de questions, Julien… s’il te plaît, fais comme si de rien n’était… ».
« C’est lui qui t’a fait ça ? ».
« Julien, s’il te plaît… ».
« Il a osé te frapper, ce con ? » fait-il en levant mes lunettes.
Nico coulé.
« J’ai frappé en premier… ».
« Toi, tu as frappé ? » fait-il l’air perplexe et surpris, presque impressionné.
« Ecoute, Julien, ne te mêle pas de ça… ».
« Ça me fait mal au cœur de te voir dans cet état… je voudrais pouvoir t’aider… ».
Le jeune loup blond a l’air vraiment touché par ma détresse.
« Tu peux pas m’aider… enfin, si… fais ton pitre avec la fille comme d’hab… fais-moi rire, Julien, j’ai besoin de rire… ».
« Ça, c’est dans mes cordes… ».
La fille arrive, Julien l’installe devant le volant. Pendant tout le cours, le beau moniteur s’illustre dans son rôle de charmeur impénitent, taquin, moqueur, drôle et beau parleur. Comme d’habitude, plus que d’habitude.
« Qu’est-ce qui t’arrive aujourd’hui ? T’as bouffé un clown ? » finit par remarquer la fille.
Mais rien n’arrête le jeune loup blond, il s’applique à mettre l’ambiance et il arrive même à m’arracher quelques sourires.
Aujourd’hui, je ne cherche pas forcement son regard dans le rétro, je n’en ai pas la force ; en revanche, c’est son regard qui cherche le mien, et qui l’accroche, il lit dedans, même à travers nos deux lunettes de soleil.
Je redoute un peu le moment d’être seul avec lui, car je sais qu’il va tenter de me cuisiner.
« Ca va, Nico ? » il me demande, dès que nous sommes que tous les deux.
« Oui, ça va, allons-y ! » je tente de me dérober. Peine perdue.
« Ça n’a vraiment pas l’air… » fait-il sans même écouter ma réponse « raconte… qu’est-ce qui s’est passé ? ».
« Laisse tomber, s’il te plait… j’ai pas envie d’en parler… ».
« Ça te ferait pourtant du bien… ».
Je sais qu’il a raison ; je sais que la seule façon d’aller mieux, ça passe par les mots : mais je sais aussi que si je commence à lui raconter ce qui s’est passé la veille, je vais pleurer direct.
Et même si j’ai le sentiment que la sienne n’est pas une curiosité mal placée, mais une véritable inquiétude, je n’ai pas la force de prononcer des mots, de revivre et de livrer des choses qui vont rendre ma défaite encore un peu plus réelle, ma douleur encore plus vive.
Je n’ai plus envie de pleurer, j’ai les yeux qui me font mal et chialer ravive à chaque fois ma migraine.
« S’il te plait, Julien… vraiment… ».
« Tu vas pouvoir conduire ? ».
« Je vais essayer… ».
Je m’engage dans la circulation. Très vite, je me rends compte que j’ai un mal fou à me concentrer. Je suis tellement naze que j’ai du mal à capter et à retenir ses mots, pourtant limités aux stricts besoins de la conduite ; je suis obligé de le faire répéter, souvent ; pour, au final, ne retenir que la moitié de ses instructions, n’en exécuter qu’un quart, en réussir encore moins.
J’ai du mal avec les vitesses, je me mélange les pinceaux, je roule en deuxième jusqu'à faire bramer le moteur ; en redémarrant d’un feu rouge, je démarre en quatrième, je cale, je me fais klaxonner, je stresse, je transpire ; mon mal de tête devient un supplice ; Julien me dit « cligno à gauche », je mets cligno à droite ; je manque de frôler une voiture dans une file parallèle ; Julien freine à ma place, il est même obligé de toucher le volant pour éviter l’accrochage.
« Nico, fais attention ! » je l’entends me lancer. Le ton de sa voix est raccord avec le regard que je sens sur moi depuis le début du cours : bienveillant et inquiet. Son attitude me rappelle soudainement celle de mon pote Thibault.
Assez vite, ses instructions me font sortir du centre-ville : nous longeons la Garonne, en direction du périphérique. Je suis stressé, fatigué, en nage, le mal de crâne me tenaille ; je sais que j’ai foiré mon cours et que j’ai déçu Julien ; peut-être même qu’il va annuler mon inscription pour l’examen de septembre, car finalement je vais avoir besoin d’autres cours avant. Tant pis, je m’en fous. Rien n’a d’importance. Je n’ai qu’une envie, c’est d’être seul, et de pleurer, pleurer, pleurer.
« Arrête toi, là, Nico » fait Julien, en m’indiquant l’embranchement conduisant au terrain vague au bord de la Garonne ; ce terrain où nous avons parfois fait des exercices de manœuvre et parfois discuté de choses qui n’ont rien à voir avec la conduite.
Je n’ai pas envie de lui donner l’occasion de me tirer les vers du nez, mais je n’ai pas la force de m’opposer à sa demande ; je crois que s’il m’avait dit de me jeter dans la Garonne, je l’aurais fait aussi : je me laisse faire, en panne totale de volonté.
« Coupe le moteur, Nico… ».
Et je coupe le moteur.
« Parle-moi, Nico… qu’est ce qui se passé ? »
Et là, la tension qui j’ai laissé s’accumuler en moi en voulant retenir ma souffrance et mes larmes, explose d’un coup ; et je pleure, je pleure, je pleure.
Julien décroche sa ceinture, puis la mienne et il me prend dans ses bras. Il me laisse pleurer, le visage enfoui dans le creux de son épaule, il me laisse pleurer sans poser des questions.
« Je suis désolé… ».
« Tu n’as pas à l’être… » fait-il, en posant sa main sur mes cheveux.
Le contact avec son corps chaud, les caresses de sa main, l’odeur de sa peau au parfum léger du déo ; sa présence et sa bienveillance ont le pouvoir de me réconforter et de me faire sentir bien. Vraiment, j’ai l’impression d’être avec Thibault. Je me sens en confiance.
« C’est fini… fini… je ne le reverrai plus… ».
« Qu’est-ce qu’il s’est passé ? ».
« On s’est disputés, hier… ».
« Pourquoi vous vous êtes disputés ? ».
« Parce qu’il n’assume toujours pas ce qui se passe entre nous… ».
« Au lit ? ».
« Au lit et en dehors du lit… il préfère tout foutre en l’air que d’assumer… il n’a jamais rien assumé… et encore moins maintenant… ».
« Pourquoi maintenant ? ».
« Bientôt il va partir à Paris… ».
« A Paris ? ».
« Oui, il a été repéré par une équipe de rugby pro… ».
« Naaaaan… il va jouer au Stade ? Dans mon équipe… à moi ? ».
« Non, au Racing… ».
« Ah oui ? Et alors il a voulu te larguer avant de se tirer… il a voulu arracher votre relation comme on arrache un sparadrap… ».
« Je lui ai dit que je l’aimais… et lui il m’a dit que je ne suis rien pour lui… juste un mec pour s’amuser… je me suis énervé et je lui ai balancé tout ce que j’avais sur le cœur… je voulais lui faire mal mais il m’a fait encore plus mal… il m’a dit de dégager de sa vie… ».
« S’il n’assume pas ce qu’il fait avec toi, c’est qu’il n’a pas de couilles pour être un bonhomme… ».
« Il a été horrible… ».
« Et vous en êtes venus aux mains… montre ça… » fait-il, tout en enlevant à nouveau mes lunettes « eh beh… il ne t’a pas raté… comme quoi, vous les pd, vous pouvez être tout aussi con que les hétéros quand vous vous appliquez… ».
« Si tu savais comment je m’en veux de l’avoir frappé… ».
« Il l’a bien cherché, non ? ».
« Oui, mais… ».
« Tu l’aimes vraiment ce mec… ».
« Comme un fou… ».
« S’il ne sait pas apprécier ça, il n’en vaut pas la peine ! ».
« Peut-être qu’il a raison de faire ça… de toute façon, je n’ai rien à lui offrir… à la rentrée, je vais partir à Bordeaux pour mes études ; et lui, il va partir à Paris… pendant des années, je vais être étudiant, je n’aurai pas de salaire ; lui, il va être connu, il va avoir du fric… il va évoluer dans un monde où il n’y a pas de place pour un pd qui aime un joueur vedette… c’est un autre monde, et puis c’est loin… il va avoir son appart, il va avoir des nanas à plus en finir… et s’il veut des mecs, il pourra toujours en trouver sur place, des vrais bomecs… qu’est-ce que tu veux qu’il s’emmerde avec un type comme moi qui, en plus, lui met la pression ? ».
« Mais tu rigoles, Nico ? Tu as tant de choses à offrir à un mec ! Tu es un petit gars adorable, gentil, amoureux… ».
« Je n’aurais pas dû lui dire que je l’aimais… ».
« Tu n’as pas à regretter de lui avoir dit, car c’est ce que tu ressens, et ça devait sortir, tu avais besoin de lui dire… il serait sorti de toute façon, tôt ou tard… tu l’as dit et tu as bien fait… et lui, il l’a au moins entendu… même s’il l’a piétiné… ».
La sonnerie de son portable retentit soudainement. Le boblond décroche aussitôt. Une voix féminine grésille dans l’appareil :
« Tu reviens bientôt ? Tes prochains cours t’attendent… »
« Oh, putain » fait Julien en regardant la montre à son poignet « je n’avais pas vu l’heure… ».
« T’es pas encore en train de t’envoyer en l’air, j’espère ? »
« Non, pas du tout… tu me prends pour qui… » il rigole.
« Pour un mec à qui, s’il était le mien, j’aurais déjà coupé tout ce qui dépasse… ».
« Moi aussi je t’aime, Carine… ».
« Grouille, abruti ! ».
Le bogoss raccroche en rigolant. Son sourire canaille est beau à pleurer.
« T’as vu… je me fais engueuler… elle est jalouse… » fait-il, en dégainant son plus bel air de clown coquin.
Je tente de lui sourire à mon tour.
« Il faut qu’on y aille… » il me lance.
Le fait est que je ne me sens pas prêt à reprendre le volant ; ces dernières larmes m’ont vidé de toute énergie ; j’ai chaud et du mal à respirer, la barre qui transperce mon crane de tempe à tempe me fait de plus en plus souffrir ; je suis HS dans le siège de la voiture.
« Tu veux que je conduise ? » fait le beau moniteur, en anticipant ma demande.
« Je veux bien… ».
Je regarde le beau Julien au volant de sa voiture ; il conduit avec assurance, et le trouve beau et viril dans le rôle de chauffeur ; sa conduite est à la fois sportive et apaisante, ça me fait un bien fou de me sentir pris en charge. Il me regarde, me sourit, me parle de ses galipettes avec Sandrine entre deux cours.
Je le regarde et l’image d’un autre chauffeur, brun, la peau mate, à bord d’une 205 rouge, roulant vers l’appartement de la rue de la Colombette, promesse d’une nuit d’amour, surgit dans mon esprit comme un éclair aveuglant. J’ai encore envie de pleurer…
Je profite d’un blanc dans la conversation pour me secouer de ce souvenir avant de me laisser emporter par l’émotion ; j’en profite pour m’excuser :
« Désole pour mes conneries de tout à l’heure… peut-être que finalement je ne suis pas prêt pour l’examen de septembre… ».
« Mais tu plaisantes, Nico ? Je sais que tu sais conduire… et je sais aussi que tu n’es pas bien aujourd’hui… alors, je ne vais pas tenir compte de ce dernier cours… tu passeras ton examen à la première session de septembre, comme prévu… d’ici là, essaie de te reposer et de ne pas trop penser à tout ça… dis-toi que ce mec n’est pas un mec pour toi… pense à Bordeaux, à tes études, à ta nouvelle vie… tu dois aller de l’avant… je suis sûr que tu vas trouver un bon gars qui va se rendre compte à quel point tu es un mec génial… c’est avec ce gars-là que tu seras bien… ».
« C’est gentil de tenter de me remonter le moral… ».
« C’est normal, t’es mon pote… ».
« Je n’aurais jamais cru qu’on deviendrait potes… ».
« Moi non plus, mais n’empêche que je te trouve sympa… ».
Le jeune loup blond me sourit. Et, ce coup-ci son sourire est à la fois charmant et touchant.
Nous arrivons au parking de l’autoécole. Julien coupe le moteur, se tourne vers moi ; il me regarde droit dans les yeux et il me lance :
« Tu devrais partir quelques temps pour te changer les idées… ».
« C’est plus ou moins prévu avec ma cousine, mais je ne sais pas encore quand… ».
« Le plus tôt sera le mieux… pars et amuse-toi, Nico… profite de tes 18 ans… ne passe pas le reste de l’été à broyer du noir… c’est l’été, putain ! File à la mer, nage, balade-toi sur la plage, sors, rencontre des mecs… baise avec… mais si tu baises avec, n’oublie pas de te protéger… n’oublie jamais ! Pas de bêtises sous prétexte que tu ne vas pas bien… un jour tu iras mieux et il ne faut pas qu’à ce moment-là t’ailles à regretter les conneries que t’as faites dans un moment de faiblesse… ».
« Promis… Julien… merci… pour tout… » j’arrive à lui répondre, en lui tendant la main et en retenant de justesse de nouvelles larmes.
Et là, devant tout le monde qui attend devant l’autoécole, le boblond me prend une dernière fois dans ses bras et me serre très fort contre lui.
« Merci à toi Nico, surtout n’oublie jamais que tu es un gars génial ! ».
« Toi aussi tu es un gars génial… à bientôt, Julien… ».
Je sors de la voiture et je m’éloigne sans tarder : les larmes se pressent à mes yeux, je veux être tout seul pour chialer à nouveau.
Je n’ai pas fait dix pas que j’entends la voix du beau moniteur m’appeler :
« Nico, attend ! ».
Je me retourne ; Julien me fait signe de revenir, son portable à la main. Je reviens sur mes pas.
« C’est quoi ton numéro ? ».
Je lui donne machinalement sans vraiment savoir pourquoi il le demande et pourquoi je le lui donne, vu que les cours de conduite c’est fini.
Je le vois enregistrer le contact, puis tapoter un message ; le signal sonore du message envoyé retentit ; le jeune loup blond relevé alors la tête et plante une dernière fois son regard transperçant et charmeur dans le mien.
« Je t’ai envoyé un sms, comme ça tu vas avoir le mien… ».
« Merci… » je lâche machinalement.
« De rien… si je te donne mon tel, c’est pour que tu t’en serves… si ça ne va pas, tu m’appelles, ok ? ».
« Ok… promis… ».
« Allez, vas-y maintenant, bonnes vacances, petit veinard ! ».
Je m’éloigne, le cœur envahi et saturé par un mélange de sensations inédit, un trop plein d’émotions plus que jamais prêt à déborder de mes yeux rougis.
Les mots, l’attitude chargée de bienveillance de Julien, me touchent profondément ; l’amitié qu’il me témoigne a l’air vraiment sincère. Oui, qui aurait cru qu’on en arriverait là : notre complicité est partie d’un petit jeu du chat et de la souris, sur fond de mon attirance pour lui, cette attirance qui flattait son ego ; une complicité faite de regards complices et d’allusions sans conséquences.
Au départ, j’ai été gêné qu’il capte mes regards, mon attirance ; j’ai été aussi gêné qu’il découvre l’existence du « bobrun qui fait la gueule » ; mais tout ça nous a rapprochés, et ça m’a fait gagner un confident. Et aujourd’hui, je suis ému par ses témoignages d’empathie, d’estime, d’amitié.
Je ne me serais jamais attendu tout ça de lui. C’est un bon gars ce Julien ; un coquin, un charmeur et un coureur impénitent, mais un bon gars quand-même.
Le chemin pour rentrer à la maison se révèle bientôt être une épreuve. La fatigue me gagne, la chaleur m’assomme, la barre qui transperce de tempe à tempe m’achève : j’ai du mal à mettre un pied devant l’autre.
J’ai besoin d’un lit, j’ai besoin de dormir, dormir pendant des jours et des semaines, dormir pour ne plus souffrir, dormir assez longtemps pour en oublier même les raisons de ma souffrance. Dormir jusqu’à l’oublier. Jusqu’à oublier même son nom.
Soudainement, la perspective de m’éloigner de Toulouse avec ma cousine semble dégager un peu l’horizon devant moi. Accalmie précaire, illusion d’un instant, fragile, chancelante.
Le retour de la tempête me guette au prochain carrefour : lorsque sa présence transperce ma rétine, vrille mon cerveau, déchire mon cœur, mes tripes.
Je le vois débouler à la toute dernière minute et je manque de le percuter. Je l’évite de justesse et je me rattrape à une voiture garée contre le trottoir pour ne pas tomber.
« Désolé ! » il me lance, en plantant son regard de b(r)aise dans le mien, tout en attrapant ma main pour m’aider à me relever.
« Ce n’est rien, ce n’est rien… » je répète, complètement désorienté, happé par la fragrance, par le bouquet frais et boisé qui se dégage de lui.
C’est un bobrun, un très bobrun, du genre bad boy, petite frappe, charmant au possible, sexy à se taper la tête contre le mur ; il est habillé d’un simple t-shirt blanc col rond, pas spécialement ajusté, avec un jeans déchiré ; la cigarette au bout des lèvres, il plisse les yeux en tirant dessus.
« Ça va aller ? » il se renseigne en attrapant sa cigarette du bout des doigts, entre le pouce et l’index, la grimace typique du fumeur sur le visage lorsque la nicotine brûle ses bronches.
« Oui ça va aller » je réponds mécaniquement, alors que je suis happé par son regard, désorienté par un trop plein d’émotions nouvelles.
« Salut ! Et encore désolé… » fait-il, avant de repartir.
« Salut ! » je lâche tout bas, en le regardant s’éloigner.
Oui, salut, bel inconnu. Salut et adieu. Dans une seconde, tu m’auras oublié. Pas moi. Je te regarde marcher devant moi, le pas rapide, assuré, très mec ; je te regarde marcher vers ta vie, laissant derrière toi une intense trainée de parfum de mec : c’est une fragrance qui m’est bien familière, car elle a souvent hanté mon nez et mon cerveau pendant de nombreux moments sensuels.
Si tu savais, bobrun inconnu, comment tu me rappelles des tas de souvenirs, à quel point tu me fais penser à lui…
Tu as le même regard brun, intense, ténébreux, chaud comme la braise ; tu t’habilles comme lui, simplement mec, t-shirt blanc et jeans ; et même si je devine que, sous ton t-shirt, tu es certainement moins bâti que lui, tu portes le même parfum ; tu as les mêmes attitudes de mec, très mec, lorsque tu fumes ta cigarette. Te voir, c’est comme une claque dans la figure : car, te voir, c’est comme le voir, lui.
Une claque qui, en une fraction de seconde, fait tout remonter en moi… tout ce que je veux oublier…
C’est pas possible, je n’arriverai jamais à l’oublier…
La migraine ne me lâche pas d’une semelle, elle transforme ma tête en grosse caisse.
J’ai le sentiment qu’on m’a arraché le cœur, que plus jamais je ne tomberai amoureux ; et que je ne serai plus jamais heureux.
Je viens de rentrer à la maison, lorsque mon tel émet enfin un petit son. Le message de Julien vient d’arriver.
« N’abandonne jamais.. tu es un vrai bonhomme. Crois en toi. Jul ».
J’ai perdu mon amour, mais j’ai trouvé un pote.
Après mangé, après le départ de maman, je vais à la sieste.
Je me réveille au bout d’une heure, pas plus : non pas que je n’aurais pas voulu dormir davantage, mais il fait tellement chaud que je me réveille en nage.
Je n’ai pas envie de lire, ni de regarder la télé. Je vais courir sur le canal. Je vais courir pour me défouler, pour tenter d’évacuer cette rage souffrance qui m’étouffe ; je vais courir pour m’épuiser.
Je cours, longtemps, je cours comme un fou, je cours loin de la ville ; je cours en pleurant, je cours jusqu’à ce que la douleur de mes muscles soit si intense qu’elle me fasse oublier la douleur qui me ravage de l’intérieur.
Je cours en écoutant la BO de Moulin Rouge que j’ai acheté quelques jours plus tôt. Je pleure devant la douceur de la version orchestrale de « Your song » ; je m’effondre sur la beauté mélancolique de « One day I’ll fly away » et de « Come what may » ; je me calme un peu en écoutant la version loufoque et décalée de « Like a Virgin » ; mais je me suis à nouveau submergé par ma souffrance au contact de la vibrante version de « The show must go on »… comment mon propre show va bien pouvoir continuer, maintenant ?
La mélancolie profonde de « Nature boy » vient appuyer un peu plus sur ma tristesse ; c’est une version instrumentale, mais les mots de Bowie résonnent dans ma tête :
There was a boy/Il y avait un garçon
A very strange/Un garçon très étrange
Enchanted boy/Et enchanté
They say he wandered/On dit qu'il errait
Very far, very far/Très loin, très loin
Over land and sea/Au-delà de la terre et de la mer
A little shy and sad of eye/Un peu timide et à l'oeil triste (…)
And then one day/Et puis un jour
One magic day/Un jour magique
He passed my way/Il a croisé mon chemin (…)
This he said to me/Voici ce qu'il me dit
The greatest thing/La plus grande chose
You'll ever learn/Que tu apprendras jamais
Is just to love and/Est seulement d'aimer et
Be loved in return/D'être aimé en retour
Si seulement, si seulement c’était possible. Si seulement aimer suffisait à être aimé en retour.
Puis, vient le « Boléro ».
Ça démarre avec des notes de piano, elles perlent des écouteurs légères et lentes comme des larmes ; des notes qui viennent parler direct à ma tristesse, l’interpeller, la mettre à nu.
Mais ça ne dure qu’un temps : les percussions déboulent avec la puissance et la violence d’une rivière en crue, avec la violence de la vie qui continue impitoyable malgré ma détresse ; le premier violon surgit avec un son lancinant et déchirant, comme le cri désespéré de ma souffrance qui veut juste qu’on la laisse tranquille, qui veut échapper au bruit, à la lumière, à la violence de l’existence ; alors que les percussions, implacables, de plus en plus rapides, semblent marteler que l’univers se fiche royalement de cette souffrance, et qu’il n’y aura aucun répit, qu’il faudra juste vivre avec, ou mourir.
Le « Boléro », scandé par ses percussions au rythme presque obsessionnel, mené par ses violons et ses claviers rutilants, instille dans mon esprit une sorte de fatalité du temps qui passe et qui emporte le bonheur à tout jamais, une impression qui fait écho au sentiment de désolation qui m’habite depuis bientôt 24 heures.
Mais il y a, à mon sens, autre chose qui se dégage du « Boléro », au-delà de cette impression de fatalité : c’est une énergie positive qui semble suggérer la nécessité de l’effort, pourtant inhumain, d’aller de l’avant.
Le rythme s’accélère encore, s’envole, va de l’avant, prend de la hauteur ; il semble vouloir me dire que non, le monde ne va pas s’arrêter de tourner parce que je suis au plus mal ; que je n’ai pas le choix, qu’il va falloir me remettre debout, aller de l’avant avec mes propres forces, même si je n’en ai pas du tout envie ; qu’il va falloir que j’accepte le fait que c’est fini et qu’il ne reviendra pas ; qu’il faut que je recommence à vivre, sans lui.
Mais comment ?
Comment supporter ce message, celui d’aller de l’avant ; où trouver assez d’énergie pour aller de l’avant, alors que toutes les fibres de mon cœur voudraient remonter le temps au dernier moment heureux avec lui ?
Pourtant, si je veux cesser de souffrir, il faut que j’arrive à mettre ce coup de collier pour m’arracher de ce passé douloureux et aller vers l’avenir qui m’attend.
Je serre les dents pour écouter le « Boléro » jusqu’au bout, je le passe une deuxième fois, une troisième, comme un mantra ; je monte le son à fond la caisse, je me défonce les tympans sur le rythme percutant ; j’essaie de m’imprégner du message d’espoir que j’ai envie d’y voir, en essayant de le faire mien.
Le « Boléro » devient ainsi la BO de ma rupture.
Hélas, c’est encore bien trop tôt pour pouvoir espérer surmonter la blessure récente, vive et brûlante : je ne peux me débarrasser si facilement du sentiment d’injustice, de gâchis, de désolation qui me déchire ; le sentiment de m’être trompé à ce point sur ce mec, le sentiment de m’être fait avoir comme un idiot, de m’être donné à lui avec trop d’imprudence, de m’être fait baiser au sens propre comme au sens figuré ; le sentiment de m’être mis à nu devant lui avec une naïveté ridicule, pour voir mon amour piétiné.
J’ai envie de crier à men déchirer les poumons tellement j’ai mal.
Je rentre à la maison en fin d’après-midi ; je suis tellement épuisé que j’ai envie de gerber ; je suis malade et je n’ai même pas envie de diner.
« T’es sûr mon Nico ? Tu ne veux vraiment rien manger ? ».
« T’en fais pas, maman, je vais dormir, demain ça ira mieux… ».
« Tu es pâle comme un linge… ».
« Je suis fatigué… ».
Seul dans ma chambre, je m’effondre.
24 heures déjà : les « anniversaires » comptent parmi ce qu’il y a de plus dur à encaisser dans une rupture.
Avec les exhortations à ne pas s’apitoyer sur soi-même, à aller de l’avant, à ne pas se faire pourrir la vie par « celui qui n’en vaut pas la peine ».
Les mots de Julien, le « Boléro », un seul message bombardé dans ma tête : accepter l’inéluctable et passer à autre chose.
Je ne peux pas accepter, je ne veux pas accepter. Comment accepter qu'on vous arrache le cœur ?
Seul dans ma chambre, dans mon lit, dans le noir, je revois son visage, le nez en sang ; je revois son regard juste avant de quitter la maison, ce regard perdu dans lequel je suis sûr d’avoir vu du regret, un déchirement, une profonde tristesse : comme s’il se faisait violence pour être aussi mauvais ; et ce, dans le seul but de laisser cette histoire impossible derrière lui, avant de s’envoler pour Paris ; dans le but de me dégouter de lui, de me priver de tout faux espoirs.
Mais si ça lui coûte autant de piétiner notre belle histoire, pourquoi il s’inflige ça, pourquoi ?
Je me dis qu’il ne peut pas aller au bout de sa bêtise, non ; qu’à un moment ou à un autre, il va bien se rendre compte qu’il est en train de détruire quelque chose de beau et d’unique, quelque chose qui apporte du bonheur dans sa vie ; cet amour, cette complicité, cette tendresse qu’il y a entre nous.
Je me dis que je dois tenir bon, qu’il va avoir un sursaut de lucidité et réaliser à quel point il a été horrible et injuste… ce n’est pas possible autrement ; je me dis qu’avant de partir pour Paris, il va m’envoyer un sms, des excuses ; je me dis qu’il va revenir vers moi, me demander de nous revoir une dernière fois, me serrer dans ses bras, me dire qu’il regrette, qu’il s’est rendu compte que je lui manque ; me demander de tout lui pardonner. Et je lui pardonnerais ; cent fois, je lui pardonnerais.
Stupide et vaine attente. Espoir éphémère, dont la déception d’heure en heure, n’a de résultat que d’exacerber encore un peu plus ma souffrance.
Soudainement, je ressens le besoin de me séparer de ses affaires ; c’est un besoin violent, auquel je tente de m’accrocher en espérant au plus vite me débarrasser de cette souffrance.
En repensant au dédain avec lequel il a refusé le maillot que je lui ai offert, je me sens insulté et offensé ; je me suis fait une telle joie de lui acheter, j’ai mille fois imaginé le moment de lui offrir, le bonheur de lui faire plaisir ; jamais je ne me serai imaginé que ça se passerait de cette façon.
Quoi faire désormais de ce maillot ? Je ne peux pas le garder. Le jeter ? C’est dommage. Je vais le filer à Emmaüs. Il reste sa chemise, son t-shirt, son boxer, les trois photos dont Thibault m’a fait cadeau : je les mets dans une poche que je ferme ; demain, je vais les jeter. Il faut juste que je trouve le cran de le faire. Je vais le trouver. Je ne veux rien garder de lui. Rien qui me rappelle nos moments ensemble. Il y a assez de souvenirs dans cette maison, dans ma tête, pour que je laisse des objets m’en rappeler davantage.
La migraine m’assiège, me persécute, implacable tortionnaire ; mes nerfs sont en boule : j’ai l’impression d’être tellement fatigué, que mon épuisement m’empêche paradoxalement de trouver le sommeil ; j’ai l’impression que mon cerveau, mes hormones, sont complètement détraqués, que plus rien ne marche dans mon corps.
Vivement la rentrée, que je me tire à Bordeaux ; loin de cette chambre, loin de cette maison, de cette ville, des souvenirs, de cette souffrance insupportable.
Samedi 12 août 2001.
La nuit a été longue : la nuit est interminable lorsque les sommeils sont courts. Je me réveille encore plus fatigué et mal en point que la veille. J’ai tout juste le courage de me trainer jusqu’à la salle de bain pour faire pipi, jusqu’au frigo pour boire un verre de jus de fruits et de m’éclipser avant que la maison ne se réveille. Je monte les marches de l’escalier avec une allure de zombie, ces mêmes marches que j’ai tant de fois grimpées quatre à quatre pour aller à sa rencontre.
Je me recouche. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver le sommeil. Pourtant, c’est décidé, ce matin je ne vais pas me lever. Je n’ai aucune raison de me lever. Je me recroqueville dans ma tanière, la radio toujours en bruit de fond.
Contre toute attente, je me rendors. Et pendant très très très très très longtemps.
Mon réveil, en milieu de l’après-midi, sera un brin brutal : c’est la voix d’Elodie qui me tire de ma léthargie, Elodie en mode surjeu à fond, telle un guest déboulant au beau milieu d’un épisode de série comique.
« Allez, cousin, t’as assez dormi… secoue toi, prends une douche, on se tire… ».
« De quoi ??? » je m’insurge, émergeant en sursaut.
« Ah putain… ça sent le phoque ici ! » fait elle, se précipitant à la fenêtre pour ouvrir les volets.
La lumière vive et la caresse musclée du vent d’Autan ajoutent de la violence à ce réveil sauvage.
« Laisse-moi dormir ! » je fais, mauvais, en enfouissant ma tête sous la couette.
« Allez, cousin, ne fais pas l’autruche… file te doucher… on part à Gruissan ! ».
« Quand ? ».
« Tout de suite ! Ce soir je veux manger un plateau de fruits de mer ! ».
L’idée de bouger de mon lit me parait inconcevable.
« Je dors… ».
« Bouge ton cul ! » fait elle en m’arrachant la couette.
Je fais un rapide check-up de mon état physique. Verdict : je me sens toujours très fatigué, mais la migraine semble me donner un répit.
« Allez, on y va ! » fait elle en attrapant l’une de mes chevilles et en tirant vers le fond du lit.
« Tu me casses les… ».
« Je sais, mais t’as encore rien vu… je te laisse une demi-heure… le temps de prendre un café avec tata… après je remonte avec un seau d’eau et de glaçons ! ».
Je l’écoute redescendre les escaliers. Je l’entends discuter avec maman. Je n’arrive pas à capter leur conversation, mais quelque chose me dit que maman n’est pas étrangère à la venue d’Elodie.
En tout cas, passé le premier moment de ce réveil un peu brutal, la présence de ma cousine commence vite à me faire du bien. L’idée de partir loin de Toulouse, de me retrouver seul avec elle, de déconner comme des fous, commence à me plaire.
Je me levé, je passe à la douche ; l’eau tiède aussi me fait du bien. Je m’habille, je jette quelques affaires dans ma valise et je descends.
« T’es prêt, cousin ? ».
« Pas tout à fait… j’ai un truc à faire, avant de partir… je te demande une petite demi-heure de plus… ».
« C’est quoi que tu dois faire ? » me demande Elodie, sans détour.
« Juste me débarrasser d’un truc… ».
« Et ça ne peut pas attendre ? ».
« Non, je dois le faire maintenant, c’est important… ».
« Ok, à toute mon cousin ! ».
Pendant ma douche, j’ai repensé au maillot. Je ne peux pas le garder, mais je ne vais pas le jeter, ni le donner à Emmaüs. Ce maillot est un cadeau et il appartient désormais à son destinataire ; s’il n’en veut pas, il le jettera à la poubelle par lui-même. Je ne sais pas combien de temps nous allons rester à Gruissan ; et il y a de fortes chances que quand je reviendrai sur Toulouse, il sera déjà parti à Paris. Alors, c’est maintenant ou jamais.
Certes, je pourrais le filer à Thibault : mais, d’une part, le temps me manque ; et d’autre part, je n’ai pas envie de le voir : voir Thibault, c’est comme voir le garçon qui est à l’origine de mon malheur ; sa présence ne ferait que me rappeler le bonheur que j’ai perdu, et je n’ai pas vraiment besoin de ça.
De plus, à l’heure qu’il est, il doit être au courant de ce qui s’est passé entre son pote et moi, et je n’ai pas du tout envie d’en parler.
Bientôt 48 heures… 48 heures déjà… qu’est-ce que c’est dur ces putain d’« anniversaires ».
Oui, Thibault doit être au courant de ce qui s’est passé entre son pote et moi. Ça me parait difficile qu’il ne le soit pas. Un petit message de sa part m’aurait fait du bien, malgré tout. A moins qu’il se dise que j’ai besoin de rester seul et que je sais où le trouver en cas de besoin.
De toute façon, je n’ai pas envie de le voir ; je vais partir avec Elodie, et j’ai besoin de faire le vide, de me couper de Toulouse et ses habitants, tous ses habitants.
J’ai mis le maillot dans un sac en papier, j’ai marqué son nom dessus. Le milieu de l’après-midi c’est l’heure idéale pour aller à la brasserie sans craindre de le croiser ; à cette heure-ci, il va être en pause : je vais laisser le maillot à son patron ou à un collègue. Au pire, si je le croise, je le laisserai sur une table et je partirai. Mais j’espère vraiment ne pas le croiser.
Oui, ce maillot a un seul destinataire possible ; m’en débarrasser, c’est un geste qui a une grande signification pour moi, un geste que je voudrais purement cathartique.
Pourtant, à regarder de plus près, sous l’envie de me délester de ce symbole d’un passé si lourd à porter, dans mon geste il y a quand même l’envie sous-jacente de le retenir, ce passé ; ce geste, c’est comme une bouteille jetée à la mer ; dans mon geste, je nourris quand même l’infime espoir d’arriver à toucher son cœur. Je repense à ce regard de gosse qu’il a eu lorsqu’il l’a déplié et je me dis que ce maillot est vraiment ma toute dernière carte à jouer.
Je suis parti de la maison très déterminé, mais je sens ma volonté flancher un peu plus à chaque pas ; je redoute de le croiser, car même le voir de loin me parait un effort insoutenable.
Le cœur tape si fort dans la poitrine qu’il semble devoir l’exploser à chaque battement.
Je me fais violence pour avancer ; les percussions implacables du « Boléro » résonnent dans ma tête et je presse le pas, droit devant moi, j’y vais comme un train lancé à toute allure vers le terminus, ignorant tout sur son passage.
Lorsque j’arrive à Esquirol je suis hors d’haleine, j’ai les jambes en coton et une crampe à la main à force de serrer le sachet.
Une silhouette noire et blanche déboule en terrasse avec un plateau à la main et je suis au bord du back out.
Fausse alerte, ce n’est pas lui. C’est son patron.
Comme je m’y attendais, il n’y a pas grand monde en terrasse à cette heure.
J’attends que le type soit revenu dans la salle pour rentrer à mon tour. Une fois à l’intérieur, mon regard est immédiatement happé par la porte qui mène aux toilettes, et bien au-delà des toilettes ; mon cœur est aspiré par le souvenir désormais nostalgique et douloureux de cette pipe dans la remise, même pas une semaine plus tôt.
Comment ma vie a changé depuis : il y a six jours, j’étais le mec le plus heureux de la terre ; six jours plus tard, je suis aussi malheureux que les pierres. Ces putains d’« anniversaires », putain !
« Bonjour… » je me lance.
« Bonjour, c’est pour une commande ? ».
« Euh… non, je voudrais laisser ça… ».
« Il n’est pas là ! » fait le patron en lisant le nom du destinataire.
« Je peux vous le laisser quand même ? ».
« C’est quoi ? ».
« Un maillot de rugby… ».
« C’est de la part de qui ? ».
« Un pote… euh… Nico… ».
« T’es son pote ? » »
« Ouaiss… ».
« Mais dis-moi, ce ne serait pas avec toi qu’il s’est battu ? » fait il en regardant fixement le bleu sous mon œil. Je viens de me rendre compte que j’ai oublié de passer les lunettes de soleil.
« On a eu un petit différend… ».
« C’est encore à cause d’une nana, c’est ça ? ».
« On va dire ça comme ça… » je coupe court « vous lui donnerez ? ».
« Oui, je lui donnerai tout à l’heure… ».
En repartant après avoir déposé le maillot, je ressens un mélange de détachement, de soulagement et de tristesse. A vrai dire, je ne sais pas lequel des trois sentiments était le plus fort. Peut-être le détachement.
La cité de Carcassonne fait son apparition sur notre gauche, embrasée par la couleur orange du soleil couchant. Je regarde ma cousine en train de conduire et je repense à Julien en train de conduire ; je repense à mon état la veille et à celui de cet instant ; tant d’heures de sommeil m’ont un peu remis sur pattes. La bonne humeur de ma cousine a un effet positif sur mon moral : depuis que nous avons quitté St Michel, nous n’avons pas cessé de rigoler, de chanter ; elle m’a raconté plein d’histoires drôles sur ses collègues de travail ; elle m’a parlé de Philippe et de ses soucis de voiture.
Nous avons abordé tout un tas de sujets, mais elle ne m’a pas posé une seule question sur ma gueule en vrac ; elle doit pourtant être au courant de ce qui s’est passé, ou du moins se poser des questions.
Je connais ma cousine ; elle va attendre un peu que je fasse le premier pas. Mais très vite, elle va me lancer des perches tellement immenses, que je vais être obligé de mordre.
Je sais que tout viendra en son temps, quand je serai prêt.
Ou bien quand elle en aura marre d’attendre.
« Ah, bah, dis-donc, tu t’es fait bien refaire le portrait… » elle finit par me lancer de but en blanc dès que nous nous retrouvons dans l’appart.
« Conasse ! » je rigole.
« Oui, c’est moi… et maintenant, tu vas tout me raconter depuis le début… ».
« Et alors, tu l’as frappé en premier… » fait semblant de s’étonner Elodie à la fin de mon récit… jamais je ne t’aurai cru capable de frapper qui que ce soit… ».
« Parce que je suis pd ? » je m’insurge face à celui qui me semble être un cliché insupportable.
« Non, parce que tu es un mec bien, espèce d’idiot ! ».
« Oui, je n’arrive pas à le croire moi-même… ».
« En réalité, ton geste ne m’étonne qu’à moitié… ».
« C'est-à-dire ? ».
« Le coup que tu lui as porté, ce n’est pas de la violence gratuite… ce coup, c’est juste l’expression de la souffrance que tu as ressenti à ce moment-là… il a été trop loin ce petit con… je veux bien que toute cette histoire soit difficile à vivre pour lui aussi, mais il n’a pas à te charger de cette façon… ».
« J’avais tellement mal à ce moment-là… ».
« J’imagine bien, mon cousin… à vrai dire, je pense que dans cette beigne il y avait toute la souffrance et la frustration qui se sont accumulées en toi au fil de cette relation… et elles sont ressorties d’un seul coup… ».
« Mais je n’aurais pas dû le frapper pour autant… en le frappant, c’est moi qui ai mis le mot fin à notre relation… ».
« Mais qui sait, Nico ? Peut-être que dans sa tête de petit con, ce coup dans la gueule lui a fait découvrir une nouvelle facette de Nico… un Nico qui en a marre de tout accepter sans broncher… va savoir, peut-être que ton coup de poing dans la gueule, ça l’a impressionné… ».
« Je ne pense pas pouvoir impressionner un gars comme lui… je n’ai pas assez de caractère… ».
« Tu as un caractère bien plus trempé que tu ne l'imagines ! Bien sûr, tu es moins virulent que lui… t’as peut-être moins de tchatche, et surtout tu te laisses dominer par ton attirance… mais au moins, tu sais qui tu es et tu l’assumes… alors que lui, c’est tout le contraire : il fort à l'extérieur, physiquement, verbalement ; il est fort en apparence, mais fragile à l'intérieur… et sa virulence, ses changements d’humeur, d’attitude, ce sont des aveux de faiblesse… son comportement, c’est un comportement puéril…
C’est pas étonnant qu’il se comporte de cette façon pile au moment où s’offre à lui la possibilité de partir à Paris… je crois que cette nouvelle lui a fait soudainement réaliser qu’il tenait véritablement à toi et qu’il risquait de souffrir en partant… alors, il choisit la solution radicale, chercher à t’oublier en se persuadant qu’il te méprise, chercher à se montrer impitoyable et froid avec toi pour que tu l’oublies aussi…
A mon avis, il doit être cruellement partagé entre deux sentiments : la joie de voir son rêve se réaliser, et la frustration, la tristesse de se rendre compte que ce rêve est a priori incompatible avec ce qu’il était sur le point d’accepter… ».
« Accepter quoi ? ».
« Mais d’être amoureux, banane ! C’est un peu comme s’il s’en voulait et s’il t’en voulait de cet amour qui vient compliquer ce moment qui aurait dû être un beau moment pour lui… ».
Aller à la plage, me baigner, rester des heures sous le parasol à mater les bogoss avec Elodie, faire des classements, délivrer des notations, disserter à l’infini sur la beauté masculine ; et passer d’autres heures en silence, côté à côté, à lire de bons bouquins ; puis, vers le soir, marcher longuement sur la plage, rigoler et refaire le monde ; s’acheter une pizza et rester tard face à la mer, regarder le coucher de soleil jusqu’à la dernière image, comme le générique de fin d’un film qui nous a émus et qui nous scotche à notre fauteuil ; puis, la nuit tombée, écouter la mer calme, la peau caressée par la brise du soir, les pieds dans le sable ; parler, rigoler, parler, pleurer.
Sortir le soir, chaque soir ; pour boire un verre, pour mater encore du bogoss. Pour rigoler. Pour tenter de réapprendre à vivre. 5 commentaires
5 commentaires Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Jérém&Nico - Saison 1