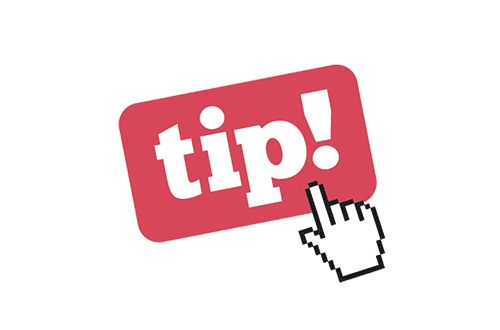-
0321 Sous les vents redoutables, le Roseau plie…
Chers lecteurs, chères lectrices,
suite à la demande d’un lecteur concernant la possibilité de participer de façon discrète au financement de l'écriture de Jérém&Nico, je précise qu'il est possible de faire ça la plus discrètement du monde en cliquant sur le bouton "PAYPAL Ajouter au panier" dans la colonne à droite de ce site (il faut remonter en haut de la page pour le voir).Ou en cliquant ici même :
 financer Jérém&Nico sans inscription, en toute discrétion, en cliquant sur ce bouton :
financer Jérém&Nico sans inscription, en toute discrétion, en cliquant sur ce bouton :Ceux qui ont un compte PAYPAL seront alors redirigés vers la page de connexion PAYPAL. Le montant du don est libre, et c'est un don unique. Sur le révélé de banque, ce don apparaîtra simplement comme PAYPAL, sans aucune mention de Jérém&Nico.
Merci d'avance pour votre aide.Et bien sûr, les commentaires, même courts, sont toujours les bienvenus.
Fabien0321 Sous les vents redoutables, le Roseau plie…
Mars 2003.
[Tu étais sur une lancée magique, Jérémie Tommasi, et tout te réussissait. Pendant les matches, tu marquais des points à tour de bras. Tes coéquipiers t’admiraient, tes adversaires te redoutaient, le public du stade vibrait à chacun de tes essais. Et ça te donnait comme une sorte de délicieuse ivresse qui te portait, qui te donnait des ailes, qui te poussait à te surpasser, à aller toujours plus loin.
Sur le terrain, tu te sentais bien. Parce que tu te sentais à ta place. Parce que pendant deux fois quarante minutes, tu étais Tommasi12, un gars avec qui la moitié de la France voudrait jouer au rugby et être pote, et l’autre moitié coucher avec.
Sur le terrain, tu n’étais que puissance, aisance, talent insolent. Tu étais l’incarnation de l’image que tu voulais donner de toi. Tu construisais ta légende personnelle match après match. On t’annonçait une carrière fulgurante. Certains te prédisaient même des matches en équipe nationale dès l’année prochaine.
Chaque samedi, l’espace de deux ou trois mi-temps, tu oubliais tes doutes, tes interrogations, tes blessures. La peur qu’on découvre ton secret. Tu te sentais tout puissant, tu te sentais invincible, inarrêtable. Tu te sentais immortel. Et cette sensation était la plus grisante de toutes.
Mais ton bel élan et tes faux sentiments de toute puissance ont été stoppés net, un samedi de mars, à quelques minutes de la fin de la mi-temps. Tu t’étais envolé, tu étais monté très haut. Et soudain, tu es redescendu sur terre, brutalement, au sens propre comme au sens figuré. Et ça a fait un mal de chien. La douleur physique et morale a été insoutenable.
Aujourd’hui, tu es fracassé, dans ta chair et dans ton esprit. On t’annonce de longs mois de rééducation, loin du rugby. Huit mois, dans le meilleur des cas, loin de tout ce qui fait le sel de ta vie.
Huit mois, ça te paraît une éternité. Hier encore tu étais une star sportive montante, dans huit mois tu ne seras plus personne. Tu vas te démuscler, et beaucoup plus vite que tu t’es musclé. Tu vas perdre tous tes atouts. En huit mois, l’équipe va apprendre à se passer de toi. En huit mois, tout le monde va t’oublier. Tes coéquipiers, tes supporters, la direction de l’équipe. Ton contrat de joueur va-t-il seulement être renouvelé à la fin de la saison, alors que tu ne seras toujours pas revenu sur le terrain ?
A quoi bon, au fond, puisque tu te dis que tu ne reviendras jamais au niveau d’avant ! Tu te dis que tes blessures sont trop graves. Et que même si tout se passe bien, tes tendons ne seront plus jamais aussi résistants qu’avant l’accident. Et même s’ils l’étaient, le souvenir de la douleur que tu as ressentie te tétanise. Tu ne veux plus jamais ressentir cette douleur atroce. Tu ne sais même plus si tu vas oser courir à nouveau un jour.
Et encore moins jouer au rugby. Car depuis cet accident quelque chose a cassé dans ta tête. Jusqu’à ce jour, le contact avec les adversaires ne t’a jamais fait peur. Tu y allais avec insouciance, avec inconscience.
Aujourd’hui, tu réalises que ton corps est fait lui aussi de chair, d’os et de sang. Tu réalises qu’il est précieux, car il est fragile. Ce n’est que maintenant, trop tard, après cet accident qui remet tout en question, qui bouche ton horizon, que tu réalises le danger que tu courais à chaque action de match, à chaque entraînement.
Certes, tu avais entendu parler de joueurs blessés, de convalescences qui s’étirent, de joueurs qui ne reviennent jamais au niveau d’avant, tu as entendu parler de carrières brisées. Mais l’inconscience de ta jeunesse t’a toujours amené à penser que cela n’arriverait qu’aux autres.
Et puis, sans crier gare, c’est arrivé à toi. Et ça t’a conduit là où tu es maintenant, immobilisé dans ton canapé, en train de déprimer à fond. Tu sais que tu ne reviendras pas au rugby si tu es diminué, tu ne veux pas finir à jouer dans une petite équipe.
Alors, tu te dis que le sport professionnel c’est fini pour toi. Et cela te plonge dans une immense détresse. Car, après avoir goûté pendant un an et demi au monde étincelant du rugby, la perspective d’une vie ordinaire avec un petit boulot ça te fiche les boules.
Oui, si le rugby c’est fini pour toi, qu’est-ce qu’il te reste dans ta vie ? A quel rêve, à quelle ivresse tu vas pouvoir t’accrocher désormais pour faire taire tes démons intérieurs ?]
Jeudi 27 mars 2003, au soir.
C’est dur de voir Jérémie pleurer. Ses larmes passent de ses joues aux miennes, et elles me transmettent toute sa souffrance. Une souffrance refoulée, pleine de colère, une colère pleine de désespoir.
— Va-t’en, Nico, pars loin d’ici. Tu vois pas que je suis en train de couler ? Ne coule pas avec moi !
— Je ne partirai que quand tu iras mieux. Et personne ne coulera. Je te promets que tu iras mieux. Je te promets qu’un jour tu joueras à nouveau au rugby et encore mieux qu’avant l’accident. Je te promets qu’un jour tu gagneras le Top16 avec le Stade. Mais pour ça, il faut y croire. Pour cela, il faut continuer à croire en tes rêves.
Oui, je sais que je distribue de l’espoir à crédit, à découvert, sans prendre aucune garantie, en encourant un risque fou. Mais en voyant Jérémie dans cet état je ne peux faire autrement que lui donner quelque chose à quoi s’accrocher, coûte que coûte. J'ai besoin d'y croire et je veux qu'il commence à l'envisager.
Je pense aux mots du chirurgien du train :
« Et surtout, il faut s’arranger pour qu’il n’arrête jamais d’y croire, même s’il prétend le contraire. Car l’espoir est l’élément clé de la guérison. Il n’est bien évidemment pas suffisant, mais il est terriblement nécessaire. »
— Tout est possible, pourvu qu’on continue à rêver, je lui glisse, alors que mes sanglots se mélangent aux siens.
Les joues de Jérém sont encore humides lorsque Thibault et Maxime rentrent à l’appart. Le petit brun s’en rend compte. Il prétend avoir oublié de prendre le courrier, tout en faisant disparaître en catastrophe les enveloppes qu’il tenait à la main dans la poche arrière de son jeans. Quant à Thibault, il avance avoir oublié de faire des courses. Les deux adorables petits mecs quittent fissa l’appart, pour me laisser un peu plus de temps pour sécher les larmes de Jérém.
Ce soir-là, Thibault et moi prenons une chambre dans un hôtel. Elle comporte deux lits jumeaux, mais très vite nous les rapprochons pour nous câliner.
— Ça me fend le cœur de le voir dans cet état, me glisse Thibault, alors que ses gros bras me pressent contre son torse puissant et chaud.
— A moi aussi ça me fend le cœur, il est tellement abîmé !
— C’est vrai que tu peux passer du temps avec lui ? il me questionne.
— Oui, je peux, et j’en ai envie.
— Tu t’en sens le courage ?
— Je ne sais pas, mais j’ai envie d’essayer.
— Il faut être très fort, Nico…
— Je sais.
— Tu es sûr que ça ne va pas interférer avec tes études ?
— Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Je pense que mes camarades peuvent m’aider.
— Tu es vraiment un chouette gars, Nico.
— Toi aussi Thibault, tu es un gars en or.
— Ce qui me fait peur, c’est quand il va se retrouver seul à Capbreton. J’ai peur qu’il n’y mette pas tout son cœur, et qu’il ne fasse pas tout ce qu’il faut pour récupérer.
— J’aimerais pouvoir être à ses côtés quand il sera là-bas, mais je n’ai aucune idée de comment faire, j’avance.
— Si tu es vraiment sûr que tu peux passer du temps avec lui, je te propose quelque chose.
— Dis-moi…
— Je te paie le séjour à Capbreton. Tu prends une chambre ou un appart là-bas, et je règle tous les frais pendant tout le temps que tu seras à côté de Jé.
— Mais Thibault ! je m’exclame, touché pas sa générosité, ému par sa bonté.
— Il n’y a pas de « mais ». Si tu es prêt à t’occuper de lui, je peux te faciliter la tâche, et je veux te faciliter la tâche. Mais je te préviens que ça ne va pas être facile, il ajoute aussitôt. Les jours qui t’attendent ne vont pas être de tout repos. Il est démoli à l’intérieur, et il voit tout en noir. Il va te rendre malade, parce qu’il va très mal. Mais il a besoin de toi, même s’il va toujours prétendre le contraire.
L’admiration et l’immense tendresse inspirées par la grandeur d’esprit que Thibault vient de me montrer une fois de plus, n’ont jamais été si débordantes, si fortes à m’en donner des larmes. J’ai envie de lui, j’ai envie de faire l’amour avec lui. J’ai envie de lui offrir tout le plaisir qu’il mérite. J’ai envie de le câliner, j’ai envie d’offrir à cet adorable garçon toute la douceur qu’il mérite. Et putain je sais, à quel point il la mérite !
Thibault un véritable puits à câlins, un véritable aimant à bisous. Cette nuit, je lui donne toute la tendresse dont il a besoin, qui n’est sans doute qu’une fraction de celle qu’il m’inspire.
Nous savons le désir que nous partageons. Mais cette nuit la présence de l’autre nous suffit pour nous faire nous sentir bien.
Samedi 29 mars 2003.
Thibault et Maxime restent un jour de plus et rentrent à Toulouse dans le week-end. Quant à moi, je reste avec Jérém. Je reste malgré le fait qu’après notre rapprochement du premier soir, malgré qu’il ait accepté que je m’installe chez lui pour quelques jours pour permettre à Maxime de rentrer à Toulouse, Jérém s’est montré assez distant et froid. La cohabitation ne s’annonce pas vraiment sous les meilleurs auspices. Mais je prends sur moi, et j’essaie de garder un peu d’optimisme quant au fait que ça va s’arranger.
— J’attends ton RIB, me glisse discrètement Thibault, en me prenant dans ses bras, avant de partir. Et si c’est trop dur, tu m’appelles. Je viendrai vous voir, s’il le faut je ferai l’aller-retour dans la nuit.
Ce garçon est vraiment, vraiment adorable.
Début avril 2003.
Entendre raconter la détresse de Jérém par Maxime et la vivre en première ligne, au quotidien, ce sont deux choses complètement différentes. La tâche est ardue, et ça demande beaucoup d’énergie. De l’énergie mentale, morale en particulier.
En plus de son inquiétude pour son avenir au rugby qui se traduit par une mauvaise humeur constante et indécrottable, Jérém semble toujours essuyer les conséquences de son traumatisme crânien. Comme me l’avait annoncé Maxime au téléphone, mon beau brun souffre d’insomnies. Le peu qu’il dort, il dort mal, et il ne récupère jamais de sa fatigue qui commence à devenir chronique. Il sommeille toutes ses journées affalé sur le canapé, assommé par les médocs, l’air vidé de toute énergie. Il boit des bières, il fume. Le mal de tête ne le lâche jamais, il prend cachets sur cachets, il a toujours aussi mal. Il est très sensible à la lumière. Aussi, nous vivons dans la pénombre, et c’est lugubre. Le manque de lumière ne joue pas en faveur du moral. Son ouïe est hypersensible, et il m’engueule à chaque bruit un peu brusque dont je suis l’auteur.
Il est très irritable, et le peu que nous échangeons, je le trouve perdu, nerveux, parfois confus. Il a du mal à penser et réfléchir, et cela semble lui demander un effort immense. Aussi, il semble avoir du mal à se souvenir de certaines choses.
Et les innombrables cigarettes, joints, calmants et bières qu’il siffle chaque jour n’arrangent rien. L’accès permanent à ces Paradis Artificiels contribue à le maintenir dans le coltard, à étourdir ses capacités intellectuelles, à empêcher son esprit d’affronter la réalité, de reprendre sa vie en main, de puiser au plus profond de lui l’énergie pour rebondir.
J’ai beau lui dire que tout ce mélange peut être dangereux pour sa santé et que ça peut compromettre son rétablissement. Il m’envoie bouler en disant qu’il n’y aura pas de rétablissement.
Lorsque je le regarde, lorsque je l’entends parler, déprimer, je vois un garçon brisé. Quand je pense à la fierté qui brillait dans ses yeux lorsqu’il jouait et qu'il marquait un but, je ne reconnais plus le garçon renfermé et éteint qui est là sous mes yeux.
Je sens que quelque chose s’est brisé au fond de lui, quelque chose d’important, d’essentiel, de vital, même. Je crois que c’est le rêve de sa vie qui s’est brisé. Et il n’y a pas de douleur plus insoutenable que celle provoquée par un rêve qui se brise.
Je voudrais trouver les mots pour l’aider à aller mieux, mais je ne sais pas par où commencer. D’autant plus que dès que j’ose aborder le sujet « accident » ou « blessures » ou essayer de l’encourager, je me fais remballer comme un malpropre.
La dernière chose que je veux en ce moment c’est m’engueuler avec lui. Il n’a pas besoin de ça, et moi non plus. J’ai besoin de mettre toutes les chances de mon côté pour tenir le coup, et surtout ne pas me faire mettre à la porte. Mais à quoi bon rester avec lui si je ne peux l’aider à aller mieux ?
J’ai du mal à tenir le coup. Je tiens en prenant sur moi, je prends sur moi en repensant aux mots du chirurgien dans le train à propos de la souffrance du sportif blessé.
« J’ai vu passer pas mal de jeunes sportifs sur mon billard, rugbymen, footballeurs, handballeurs, avec des blessures graves. Et je peux vous dire que ceux qui s’en sont sortis, ce sont ceux qui ont eu du soutien pendant toute la durée de la rééducation. Il ne faut pas le lâcher, même s’il devient odieux. S’ils deviennent invivables, c’est parce qu’ils souffrent, et ils souffrent parce qu’ils ont peur d’avoir tout perdu. Il faut être forts. Il faut l’être pour vous, et pour lui. »
Je repense aussi aux mots d’Ulysse.
« Sous le vent contraire, le Chêne tente de résister et se fait déraciner. Alors que le Roseau plie, mais il tient bon, il récite par cœur. Sois Roseau, Nico ! La tempête va arriver, mais elle repartira. Et tu seras toujours debout après son passage. »
J’essaie, mais c’est tout sauf évident.
En attendant, je fais tout ce que je peux pour lui faciliter la vie. Je l’aide à se lever, même s’il ne voulait pas au début, à s’habiller. Je vais faire ses courses, y compris le shit (très beau garçon que son dealer, j’ai tellement envie de lui dire de changer de métier !), je lui fais à manger, je fais le ménage. J’œuvre discrètement. J’essaie d’être là pour lui, tout en me protégeant.
Malgré cela, ces quelques premiers jours de cohabitation se révèlent particulièrement difficiles. Jérém est sacrement amoché, meurtri par la vie. Il est en permanence sur les nerfs, et un rien suffit pour le faire exploser. Il peut être très blessant. Il peut aussi pleurer, parfois. Et là, inutile de penser à le prendre dans mes bras pour essayer de l’apaiser, sous peine de me faire encore jeter méchamment. Il vaut mieux que je parte dans la pièce d’à côté en attendant que ça passe. Ça me fend le cœur de ne rien pouvoir faire pour lui. Et je pleure de mon côté à chaudes larmes.
C’est dur, vraiment dur. Mais c’est décidé, je resterai à ses côtés malgré son humeur de chien rageur, à essayer de l’aimer malgré lui.
Le fait est que la mauvaise humeur, la morosité et le pessimisme sont des bêtes salement contagieuses. Je regarde Jérém se noyer jour après jour et j’ai l’impression qu’il m’entraîne vers le fond avec lui. Je réalise qu’il avait raison le soir où il m’avait dit qu’il était en train de couler. Et je réalise que quelque part, le fait de me dire de partir pour ne pas couler avec lui ressemblait à s’y méprendre à une preuve d’amour.
Alors je reste, bien qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'il me gueule dessus et qu'il m'ordonne de me casser et de lui foutre la paix.
Je sors tous les jours faire les courses, pour prendre l’air quand celui de l’appart devient trop irrespirable. Mais je pars la peur au ventre, et je rentre vite. Je ne peux me résoudre à le laisser seul plus qu’une demi-heure. Je n’arrive pas à me débarrasser de la peur qu’il puisse faire une connerie. Ma peur est peut-être infondée. Mais il est si mal que je préfère ne pas prendre le moindre risque.
Une infirmière vient chaque jour lui renouveler les pansements et l’aider à prendre soin de lui. Mathilde est une nana qui assume parfaitement ses rondeurs et qui a l’air on ne peut mieux dans ses baskets. Elle est dynamique et avenante. Elle est drôle et pétillante et sa venue est comme un rayon de soleil dans la triste monotonie de ces journées, de ce huis-clos qui devient de plus en plus pénible.
Chaque jour, elle fait ses observations positives sur la cicatrisation des blessures. Jérém fait mine de ne pas en faire cas. Ou balaie ses mots d’un revers de main. Pourtant, quelque chose me dit que le récit de cette évolution positive ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd.
Jour après jour, Mathilde garde son sourire malgré les réflexions chargées de pessimisme avec lesquelles Jérém réagit à ses encouragements.
En dehors de cette visite quotidienne, de ce rendez-vous à la fois amusant et rassurant, les seuls moments sereins ce sont ceux que nous passons en silence à jouer à la PS. C’est le seul moyen que j’ai trouvé pour partager du temps avec mon beau brun, sans le mettre en pétard, sans me faire jeter, le seul moyen pour l’obliger à faire un break cigarette-pétard-boisson.
Franchement, les jeux vidéo, et a fortiori des jeux vidéo de sports, ça m’intéresse autant que la sexualité des nanas. Mais je prends sur moi, je fais l’effort, je m’accoutume à cette activité que je perçois comme étant « contre nature ». J’apprends à jouer à FIFA pour le distraire. Je finis même par me défendre et même par lui mettre des raclées, lui qui jouait à FIFA déjà bien avant notre première révision.
Parfois j’y pense, pendant que nous jouons. Je pense à ce jour de mai d’il y a bientôt deux ans, où j’ai traversé une partie de la ville afin de réviser avec lui pour le bac. J’ai des frissons en repensant à son regard lubrique, à sa main qui attrape la mienne et qui la pose sur la bosse de son jeans. D’autres fois, en le revoyant debout, contre le mur, le t-shirt blanc taillant son torse comme un gant, la casquette à l’envers, la braguette ouverte, la bosse saillante, m’invitant à aller le sucer. Je vibre de nostalgie en repensant à la première fois où j’ai eu accès à sa virilité, la première fois où je l’ai pris en bouche. Et à ses mots : « Je vais jouir et tu vas tout avaler ». Et au bonheur avec lequel je m’étais exécuté.
Ce jour-là, il était aussi venu en moi, il m’avait possédé pour la toute première fois. Je découvrais un monde nouveau, fait d’un plaisir sensuel inouï.
Mais aussi de frustration. A la fin de cet après-midi de bonheur, alors que j’espérais un peu de tendresse, Jérém m’avait dit de partir et de fermer ma gueule au sujet de ce qui venait de se passer.
Je l’avais regardé, planté devant sa PS, en train de jouer à FIFA, la casquette à l’envers et torse nu, beau comme un Dieu. Un petit Dieu auquel j’avais offert tout le plaisir qu’il avait demandé.
Quand j’y pense, Jérém était un sacré petit con à l’époque, un petit macho imbu de sa queue et pour qui seul son plaisir comptait. Une sacrée tête à claques qui ne doutait de rien. Du moins en surface. En tout cas, à ce moment son effronterie était intacte, car une certaine insouciance l’était aussi.
Depuis qu’il est à Paris, j’ai l’impression que cette insouciance a été mise à rude épreuve par la pression liée à son statut, à son métier, à sa notoriété croissante. J’ai l’impression que la disparition progressive de l’insouciance est le lot que certains considèrent comme indissociable du package « Devenir adulte ». Ce qui est certain, c’est qu’elle a totalement disparu depuis son accident.
Je me sens nostalgique et ému par le souvenir de cette insouciance révolue, par le souvenir des révisions dans l’appart de la rue de la Colombette. A cette époque Jérém était certes un insupportable petit con. Mais il était serein, confiant en lui et en l’avenir. Tout ce qu’il n’est plus aujourd’hui. Je donnerais cher pour remonter le temps.
C’est pour cela que j’aime ces moments FIFA, car ils me ramènent au souvenir d’une époque somme toute heureuse (elle ne l’était pas totalement, mais le temps a dû commencer à faire le tri, je pense), et révolue.
Hélas, ces moments de partage ne durent jamais très longtemps, car la migraine finit toujours par revenir. Jérém est obligé parfois d’abandonner en pleine partie. Je le vois alors balancer sa manette, planter la partie, et s’affaler sur le canapé, l’air épuisé et souffrant.
En dehors de ces moments de détente, Jérém fume cigarette sur cigarette, pétard sur pétard, boit bière sur bière. Il mange peu, il dort beaucoup. Surtout le jour.
La nuit, Jérém dort dans son lit, et moi sur le canapé. J’ai trop peur de lui faire mal dans le sommeil.
Nous ne partageons plus aucun moment de tendresse. Et ça me manque terriblement. Je ne demande pas grand-chose. Une caresse, un baiser, une accolade me suffiraient pour me sentir moins seul, moins rejeté. Mais Jérém est très distant. Ça me rend malade. J’ai besoin de le toucher, de sentir sa présence avec mon corps, avec ma peau. J’essaie d’aller vers lui. Parfois, je passe ma main dans ses cheveux, je l’embrasse dans le cou furtivement. Mais il ne réagit pas. Je finis par avoir l’impression que ça le dérange plus qu’autre chose.
Le sexe me manque aussi. Je n’ose même pas aborder la question, de peur de me faire rembarrer méchamment. Bien sûr, il est convalescent, et j’attendrai autant qu’il faudra. J’en ai envie, et je me dis qu’il pourrait en avoir envie aussi, et que ça pourrait nous faire du bien. Je suis bien placé pour savoir à quel point un bon orgasme est capable d’apaiser un garçon.
Si je savais qu’il en a envie, je serais bien évidemment partant. Mais il ne manifeste aucun désir en ce sens. Alors, j’essaie de tâter le terrain sur le ton de l’humour. L’occasion se présente un soir, alors qu’il vient de passer de longues minutes à se faire sermonner au téléphone par son petit frère.
— Tu veux une glace ? je lui propose.
— Non !
— Une boisson ?
— Non !
— Un café ?
— Non !
— Une pipe ?
— Non plus.
— Une pipe, ça ne se refuse pas ! je tente de rigoler.
— Ça, tu oublies !
— Pourquoi tu dis ça ?
— Pour rien, laisse-moi tranquille.
— Je disais ça juste au cas tu en aies envie…
— J’ai pas envie !
— C’est pas grave, pas grave du tout, vraiment. Je rigolais !
Un long moment de silence suit ces derniers mots, un silence ponctué par plusieurs taffes de cigarette. Puis, après avoir écrasé son mégot, je l’entends me glisser, le regard ailleurs :
— Je n’ai pas bandé une seule fois depuis l’accident. Ça fait plus d’un mois, il précise.
Je n’avais pas soupçonné l’existence de ce point de frustration dans le corps et dans la tête de mon beau brun, un point qui doit se mélanger aux autres et les amplifier encore.
Jeudi 3 avril 2003.
Ça ne fait même pas une semaine que je cohabite avec Jérém, et j’étouffe. L’envie de partir est de plus en plus forte. Mais je ne peux pas le laisser tout seul. Dans trois jours il va partir à Capbreton, et je n’ai toujours pas trouvé l’occasion pour lui annoncer que j’envisage de l’accompagner.
Soudain, une idée traverse mon esprit. Je la peaufine au fil des heures.
Vendredi 4 avril 2003.
Et je la mets en pratique dès le lendemain.
— Ça te dit d’aller faire un tour en bagnole ? je lui balance en début de matinée, après le départ de Mathilde.
— Un tour où ?
— Il fait beau aujourd’hui, on pourrait faire une virée hors de Paris.
— T’as qu’à y aller seul.
— Je voudrais que tu viennes avec moi. Je pense que ça te ferait du bien de prendre l’air et de voir le soleil.
— Très peu pour moi.
— S’il te plaît, s’il te plaît, un tout petit tour. On sort de Paris, on se fait un resto, et on rentre pour la sieste. Je meurs d’envie de tester ta nouvelle bagnole, j’appuie mon propos pour le motiver.
— Tu me casses les couilles !
— Je t’aime moi aussi, je lui lance à contre-pied.
Quelques minutes plus tard, je m’installe au poste de conduite de sa belle allemande bleu métal.
— Elle est magnifique, on dirait une fusée !
— Vas-y mollo, c’est un petit bijou, et elle m’a coûté une petite fortune. Et si je ne joue plus, il y a de fortes chances que je doive la revendre.
— Tu ne la revendras pas, car tu n’en auras pas besoin.
— Roule et ferme-la ! il me balance, en s’allumant une clope.
Je démarre le petit bolide et je m’insère dans la circulation dense de la capitale. Le périphérique est saturé.
— Quelle connerie de prendre la route à cette heure-ci ! il râle dans son coin.
Je prends mon mal en patience et je finis par sortir de Paris. Le volant se laisse happer par la direction d’Orléans.
— Tu veux aller où, au juste ?
— Je ne sais pas encore. J’ai envie de rouler, cette bagnole est une pure merveille !
La belle allemande roule, roule, roule. A Orléans, elle réclame son dû. Nous nous arrêtons à une station-service pour faire le plein et boire un café. Je regarde mon téléphone et j’ai envie de pleureur de bonheur. Le SMS que j’attendais vient d’arriver. Tout est bon, la virée est bouclée. Pendant que nous buvons notre café, une bande de cinq mecs d’environ notre âge s’approche de nous, le regard rivé sur Jérém et sur ses béquilles.
— Tommasi ? C’est toi, tu es Tommasi ? l’interpelle l’un des mecs, un beau brun appartenant à la team « casquette à l’envers ».
— Non, c’est pas moi, fait Jérém, sur un ton vexé et peu engageant.
— Si c’est toi ! insiste le petit mec. Tu me signes ma casquette, s’il te plaît ?
— Je ne suis plus personne, je ne jouerai plus. Ma signature ne vaut plus rien, parce que c’est la signature d’un raté.
— Quand on a vu ce qui t’es arrivé à la télé, on était grave vener… ce type qui t’a dégommé, il l’a fait exprès, il mériterait qu’on lui casse la gueule !
— Ce qui est fait est fait, glisse Jérém, le regard fuyant et désabusé.
— Tu t’es fait opérer, mec ?
— Oui, j’ai du rafistolage partout.
— Tu reviens quand sur le terrain ?
— Jamais !
— Comment ça, jamais ?
— Les médecins tablent sur six mois de rééducation, j’avance.
— Les médecins ne savent rien !
— Tu vas revenir, et comment ! Tu es un magicien sur le terrain et tu nous emmènes avec toi quand tu marques un but. Tu n’as pas le droit de nous laisser en plan !
— La vie m’a laissé en plan…
— Toi t’es son pote ? s’adresse à moi le mec.
— Oui…
— Alors, tu le surveilles pour qu’il fasse tout comme il faut, pour qu’il revienne au plus vite et que tout se passe bien. Je te nomme responsable de son avenir au rugby. T’as intérêt à ce que tout se passe sans accrocs. Si ça foire, on te trouve et on te pète la gueule ! Eh, les gars, on lui pète la gueule s’il y a un problème ?
Ses potes acquiescent en rigolant.
Je sais que le gars plaisante. Mais en même temps, je ressens toute l’admiration qu’il éprouve pour Jérém et son souhait sincère de le voir revenir sur le terrain.
— C’est noté, je plaisante, à moitié amusé et à moitié ému par la spontanéité et la bienveillance de ce garçon.
— Tiens, signe la casquette, il insiste.
Jérém s’exécute en râlant. Il signe également un bout de papier, un ticket de métro, une boîte en carton contenant des chocolats.
— Ils étaient sympas ces gars, je lui lance, en reprenant l’autoroute.
— Surtout casse-couilles.
— Ça t’a pas fait plaisir d’être reconnu ?
— En ce moment, je m’en passe bien.
— Tu donnes de la joie à ces gars, et ils ont voulu te le montrer. J’ai trouvé ça très mignon.
Jérém ne répond pas. Mais quelque chose me dit que même s’il prétend le contraire, cette petite rencontre lui a mis du baume au cœur. Je le vois au fond de ses yeux, je le vois à cette étincelle, petite, faible, émoussée, mais bien présente, qui vient de s’allumer au fond de son regard.
La belle allemande semble désormais happée par la direction de Châteauroux.
— Tu vas me dire à la fin où tu veux aller ?
— J’ai envie de rouler, je reste vague. On va bientôt s’arrêter manger, puis on verra.
Nous prenons notre repas à proximité de Châteauroux. Jérém est taciturne et peu réactif aux efforts de conversation que j’essaie de faire. Pourvu que cette virée ne me pète pas à la figure. Il est 14h30 lorsque nous reprenons la route. La belle allemande semble toujours happée par le Sud.
— Il faut faire demi-tour, sinon on ne sera pas à Paris avant la nuit, me lance Jérém sur un ton agacé.
— Et pourquoi tu veux rentrer à Paris ?
— Parce que c’est chez moi !
— On pourrait dormir ailleurs…
— Mais où ?
— On va trouver !
— N’importe quoi ! Demain matin j’ai besoin de changer mes pansements, Mathilde va venir.
— Non, elle ne va pas venir.
— Comment ça ?
— Je lui ai dit que nous ne serions pas là.
— Et mes pansements ?
— J’en ai pris. Je l’ai regardé faire chaque jour et je peux me débrouiller.
— Ça me dit pas où tu veux aller dormir et à quoi ça rime toute cette route !
— Ça rime au plaisir de conduire cette merveilleuse bagnole, et à celui de t’entendre râler ailleurs que dans ton appart, et pour de nouvelles raisons !
— T’es con ! il me balance, un petit air amusé sur son visage.
— C’est la première fois…
— Quoi la première fois ?
— La première fois que je te vois sourire depuis l’accident.
— Je n’ai pas ri !
— Si tu as ri !
— Non, je te dis !
— Tu dis ce que tu veux. Moi, il m’a semblé te voir sourire. Et tu peux pas savoir combien ça me fait plaisir. J’aime tellement quand tu souris. Je t’aime, Jérémie Tommasi !
Nous faisons une nouvelle pause pipi café à proximité de Limoges. Le volant tient toujours le cap vers le Sud. Les panneaux TOULOUSE se font plus réguliers.
— Tu m’amènes à Toulouse ? me demande Jérém.
— Je t’amène quelque part.
Je ne peux pas encore lui dire qu’il chauffe, un peu.
Brives, Rocamadour, Cahors, Montauban, je laisse une à une ces villes derrière nous. TOULOUSE nous accueille. A l’approche de ma ville de naissance, le berceau de l’amour de ma vie, l’émotion me submerge. Toulouse, Papa, Maman, Elodie, vous me manquez, mais nos retrouvailles ne seront pas pour ce soir. Car la virée n’est pas terminée.
— Dis-moi où tu m’amènes, me glisse Jérém, alors que les sorties du périphérique défilent sous nos yeux.
— Tu vas vite comprendre.
La belle allemande quitte le périphérique et s’engage dans la direction Tarbes-Lourdes. Entre la sortie de Toulouse et le péage de Lestelle, Jérém demeure silencieux.
Ce n’est que lorsque nous avons passé la barrière que je l’entends me glisser :
— Tu sais que la maison va être froide et sale…
Ça me fait plaisir qu’il le prenne de cette façon. J’avais tellement peur qu’il me fasse un scandale !
— Qui t’a dit qu’on va à la maison ?
— Ah, voilà autre chose…
— Mais tu lui as dit au moins qu’on se pointait ? il enchaîne quelques instants plus tard.
— Oui, hier soir.
— Petit cachottier !
— Si je t’avais mis au courant, tu aurais dit non.
— C’est sûr.
— J’ai bien fait de ne rien dire alors !
— Il faut croire…
— Elle était tellement heureuse quand je lui ai annoncé que je t’amenais !
— Quel petit con tu es !
— Et toi non !
L’approche de Campan est elle aussi chargée d’émotion. Car ce petit village dans la montagne est l’endroit où j’ai depuis toujours été le plus heureux avec Jérém. Campan est notre refuge. C’est Jérém qui l’a dit un jour.
Il est près de 21 heures lorsque nous débarquons chez Charlène. Martine est là aussi. Les retrouvailles sont émouvantes. Les deux mamans de cœur de Jérém le serrent longtemps dans leurs bras, et elles pleurent de joie. Jérém pleure aussi. Mais cette fois-ci, j’ai l’impression que ses larmes le soulagent d’un grand poids.
Un bon petit dîner nous attend au coin du feu.
— Nico m’a prévenu un peu short, alors ce soir je n’ai pu rameuter que Martine, plaisante Charlène.
— Qu’un deuxième couteau, quoi, se marre l’adorable commerçante.
— Désolé, je glisse instinctivement.
— Ne le sois surtout pas ! Je suis tellement heureuse que tu aies eu cette idée ! J’imagine que vous êtes fatigués par la route et que vous avez envie de vous coucher de bonne heure. Mais demain soir, tu ne vas pas échapper à un bon gros repas au relais !
Évidemment, la conversation tourne longuement autour de l’accident de Jérém et sur l’avancement de sa guérison. Lorsque le jeune rugbyman évoque son départ prochain pour le Centre de rééducation de Capbreton, Charlène lui balance du tac-au-tac :
— Mais tu as quelqu’un qui t’accompagne là-bas ?
— Non, j’y vais seul.
Je ne lui ai toujours pas dit que j’ai prévu de le suivre à Capbreton. Charlène m’en offre l’occasion avec en prime un soutien prévisible qui ne sera pas de luxe. Un soutien dans lequel j’avais espéré en préparant ce voyage.
— Je pourrais t’accompagner, moi.
— Quoi ?
— Je peux rester quelques jours là-bas, le temps que tu prennes tes marques.
— Et tu vas crécher où ?
— Je prendrai une chambre.
— Et tu vas la payer comment ?
— J’ai un peu d’argent de côté…
— Voilà une riche idée ! s’exclame Martine. Au moins les premiers jours, le temps que tu t’habitues à ta nouvelle routine.
— Je me débrouillerai.
— Quand tu vas arriver là-bas, tu ne vas connaître personne, et tu ne vas voir que des gars accidentés comme toi, ou pire. Ça va te saper le moral. Tu n’auras pas de trop d’un visage connu, et de celui de ton petit copain qui plus est !
Jérém ne relève pas les derniers mots de Martine. Il ne les confirme pas. Mais il ne les infirme pas non plus. J’ai eu peur qu’il le fasse. Mais il ne l’a pas fait.
— D’ailleurs, si tu as besoin d’un peu de cash, je peux t’en filer, me lance Charlène.
— Je n’ai pas besoin de votre aumône ! s’exclame Jérém.
— Mais qui te parle d’aumône, espèce de petit con ! On veut seulement mettre toutes les chances de ton côté pour que ta rééducation se passe au mieux !
— J’ai assez d’argent pour rester quelques jours, je coupe court.
— Je ne t’ai jamais demandé de venir à Capbreton.
— Je sais. Je ne vais pas rester longtemps. De toute façon, tu vas finir par me rendre chèvre. Je vais rester quelques jours, une semaine au plus, je m’arrange avec la vérité. Et puis, si je ne viens pas, avec qui tu vas jouer à FIFA ?
Samedi 5 avril 2003.
Le lendemain soir, le relais accueille la foule des grandes occasions.
Une grande bannière composée d’autant de feuilles A4 que de lettres nécessaires pour composer le mot « Bienvenu, champion ! » est affichée sur le plus grand mur de la salle.
Tout le monde est là. Arielle avec sa spécialité, la quiche pas assez cuite. Martine avec sa bonne humeur contagieuse. Nadine avec son rire sonore et communicatif. Satine avec sa grande gueule. Les adorables aînés de l’asso, Ginette et Edmond, sont là aussi. Marie-Line et Bernard, collectionneurs de cas soc’ équins ont répondu également à l’invitation de Charlène. Daniel est là aussi, avec ses deux maîtresses, sa Lola et sa guitare. Loïc et Sylvain sont présents, et visiblement toujours ensemble. Je suis étonné de voir également Florian et son copain Victor. Vu l’animosité que nourrissait Florian vis-à-vis de son ex, je n’aurais jamais imaginé voir les deux couples dans une seule et unique pièce sans qu’il y ait du sang sur le dancefloor. Mais ainsi soit-il, tout est bien qui finit bien.
Jérém avance en s’aidant avec ses béquilles. Je me tiens derrière lui, au cas où il y aurait un souci, à cause des vertiges qu’il a parfois suite à son traumatisme crânien.
Jean-Paul, l’être le plus sage et bienveillant que je connaisse se tient devant la porte avec sa femme Carine, la nana la plus curieuse que je connaisse. Il a les yeux humides.
Dès que Jérém franchit le seuil, il le prend dans ses bras et le serre très fort contre lui.
— Salut, toi ! il lui glisse.
— Salut…
— Comment tu te sens ?
— Bien, maintenant que je suis ici, avec vous.
Je ne peux exprimer à quel point ces quelques mots me touchent.
— Et moi je suis heureux de te voir parmi nous. Bienvenu, Mr Tommasi !
— Putain, tu ne fais jamais les choses à moitié, lui balance Daniel en le prenant à son tour dans ses bras. Tu nous as fichu une trouille bleue encore une fois.
Chaque cavalier vient saluer le champion blessé à tour de rôle, et les « Comment ça va ? » pleuvent de toute part.
— Vous m’écoutez, s’il vous plaît une minute ? j’entends Jérém lever la voix à un moment pour attirer l’attention.
— Chut, chut, il va annoncer sa candidature à la présidentielle, plaisante Daniel.
— Ta gueule !
— Oui, merci ! Jé-ré-mie pré-si-dent ! Jé-ré-mie pré-si-dent ! Jé-ré-mie pré-si-dent !
— Mais tu la fermes un peu et le laisses parler, oui ? intervient Lola.
— Tu as oublié de prendre sa laisse, ce soir, non ? plaisante Satine.
— Je ne le dis qu’une fois et je ne le répéterai pas, reprend Jérém en donnant de la voix. J’ai été blessé et opéré aux ligaments croisés du genou et au tendon d’Achille. Apparemment, ça cicatrise bien. Je me suis cogné la tête sur le sol, et ça déconne encore un peu, mais ça a l’air de s’arranger aussi. Dans quelques jours, je vais en rééducation à Capbreton pendant quelques mois. Est-ce que je vais rejouer au rugby ? Je n’en sais foutrement rien. Inutile de me le demander ou de faire des pronostics. Je vous dirai quand je le saurai. En attendant, parlons de choses plus marrantes. J’en ai marre de parler bobos. Des tamalous, il y en a assez dans cette assos !
— Bien dit, fait Jean-Paul ! Jé-ré-mie pré-si-dent !
Toute l’assistance reprend le slogan lancé par Daniel et ça fait un joyeux bordel.
— Qu’est-ce qui se passe ici ? j’entends demander par une voix familière.
Maxime est là, et il n’est pas seul. Thibault a fait le déplacement avec lui.
Je n’oublierai jamais cette soirée. Cette première fois où, à la faveur de cette ambiance bienveillante et bon enfant dont cette assos a le secret, j’ai retrouvé un peu du Jérém d’avant l’accident. Un Jérém capable de sourire, de voir du positif, un Jérém plus apaisé. Un Jérém que je désespérais de pouvoir retrouver un jour. Je n’oublierai jamais les sourires que JP et Daniel ont pu lui tirer, les encouragements qu’ils ont pu lui apporter, et le regard ému et touché de Jérém.
Et ce que je n’oublierai jamais par-dessus tout, c’est le regard qu’il m’a lancé lorsque je l’ai rejoint à la cheminée, pendant qu’il fumait sa cigarette. Je n’oublierai jamais le « Merci » qu’il m’a glissé discrètement, les yeux humides, et sa main qui se pose sur ma nuque, ses doigts qui se glissent brièvement dans mes cheveux. Non, je n’oublierai jamais le premier geste de tendresse non seulement depuis l’accident, mais depuis notre séparation en décembre dernier.
Cette nuit, Jérém me manque beaucoup. Charlène nous a préparé deux chambres séparées pour laisser plus de place à Jérém. Quand la maison s’est tue, j’aurais voulu aller le rejoindre. Mais j’ai préféré le laisser se reposer. Il avait l’air si claqué, après toutes les émotions de la soirée ! Heureux, mais claqué.
Dimanche 6 avril 2003.
Demain, lundi, c’est je jour du départ de Jérém pour Capbreton. Avant de prendre la route ce dimanche, nous passons dire bonjour à Unico, Tequila et Bille. Charlène est très émue de voir Jérém répartir aussi vite.
— Vous auriez dû venir plus tôt ! elle nous gronde.
— Je n’avais pas le moral.
— Et ça va mieux maintenant ?
— On dirait…
— Prends bien soin de toi, mon grand. Et si ça ne va pas, appelle ta vieille copine ! Merci, Nico, de prendre si bien soin de lui.
Jérém demeure silencieux pratiquement jusqu’à Toulouse. Mais je suis heureux de voir qu’il a l’air bien plus dans son assiette que pendant le voyage aller. Ce bain d’affection, de tendresse, de bienveillance qu’ont su lui offrir ses amis cavaliers a l’air de lui avoir vraiment fait du bien.
— Tu es sûr de vouloir venir à Capbreton ? il me questionne de but en blanc.
— Sûr et certain.
— Tu vas louper tes cours.
— Je m’en fous.
— Mais pas moi !
— Tu loupes bien tes cours, toi !
— Moi je suis nul en cours, je suis un touriste à la fac. Mais toi, c’est du sérieux.
— Ma priorité, c’est toi, ta guérison.
— La fac devrait l’être aussi !
— J’ai pris des dispositions pour me faire aider par des camarades de cours. Et puis, Capbreton est à moins de deux heures de Bordeaux !
— Si ça se passe bien, tu pourras repartir.
Ah putain, qu’est ce que je suis heureux de l’entendre enfin envisager que ça pourrait bien se passer !
Je n’ai pas pu trouver, seul, le moyen pour rallumer cette flamme en lui, pour lui redonner l’espoir. Mais j’ai su trouver ceux qui ont su le faire à ma place. Et rien que ça, ça me donne une joie immense.
— C’était pas une idée idiote cette virée ! je m’entends réfléchir à haute voix.
— Pas idiote du tout. Merci encore. Ça m’a fait un bien fou.
Ses mots m’émeuvent aux larmes, sa main chaude qui se pose sur ma cuisse me donne des frissons. J’ai l’impression de retrouver peu à peu notre complicité perdue, et je suis aux anges.
— Je te rembourserai les frais que tu auras à Capbreton.
— T’en fais pas pour ça. Vraiment pas.
Évidemment, je me garde bien de lui dire que ce sont les sous de Thibault et d’Ulysse (ce dernier a voulu partager les frais de mon séjour à Bordeaux avec le premier) qui vont me permettre de m’installer à Capbreton et d’y rester le temps qu’il le faudra. Les deux rugbymen m’ont demandé de ne rien dire à Jérém pour ne pas qu’il se sente gêné par leur geste.
— L’important c’est que ça se passe bien. Je t’aime, Jérémie Tommasi !
Nous arrivons à Paris dans la soirée et nous dînons au restaurant. Pour la première fois depuis des mois, je dors avec Jérém. Pour la première fois depuis des mois, il me laisse le prendre dans mes bras. Pour la première fois depuis l’accident, je sens que la boule de rage qui était dans son ventre semble s’être dissipée. Cette nuit, Jérém dort du sommeil du juste.
Moi, en revanche, je dors très peu. Malgré le fait que Jérém m’ait dit que je ne risque pas de lui faire mal, je n’arrive pas à me détendre. Mais le fait de le tenir dans mes bras, et les quelques baisers que nous nous sommes échangés avant de nous souhaiter une bonne nuit, me mettent du baume au cœur.
Lundi 7 avril 2003.
Jérém est attendu pour son admission au Centre dans l’après-midi. Après avoir ramassé mes affaires et aidé Jérém à réunir les siennes, nous reprenons la route. Jérém semble soucieux. Dans sa tête, mille questions doivent fuser. C’est le début du moment de vérité. Il va faire un check up, avant l’étude du plan de rééducation. C’est là qu’il va savoir si tout se passe bien ou pas. Il doit appréhender les résultats des tests qui l’attendent. J’appréhende aussi. Il doit appréhender la réponse de son corps à la rééducation. Il doit avoir peur que les résultats se fassent attendre plus que prévu. Ou, pire, qu’ils ne soient jamais au rendez-vous. Les semaines, les mois à venir vont être déterminants pour la suite de sa carrière sportive. C’est là que tout se joue.
— Ça me rassure que tu sois là, je l’entends me glisser à un moment.
Je croise son regard et j’y vois une peur panique immense.
— Je suis là, et je serai là autant qu’il le faudra.
En passant à côté de Poitiers, j’ai un petit pincement au cœur en pensant à Ruben, à cette famille dont il m’a souvent parlé et que je ne connaîtrai jamais. Je ne regrette pas d’avoir volé au secours de Jérém, la seule chose que je regrette est de n’avoir pas été honnête plus tôt avec le petit Poitevin. Je l’ai été, dans une certaine mesure. Mais ça ne l’a pas empêché de tomber amoureux de moi et de croire en des rêves dans lesquels je n’ai jamais cru, des rêves que j’ai fini par briser, et par deux fois.
Sur la route vers Capbreton, nous faisons une halte à Bordeaux pour que je puisse récupérer d’autres affaires. Mes deux propriétaires viennent nous saluer. A nouveau, Jérém est accueilli avec une chaleur et une affection qui font vraiment du bien.
Lorsque je leur annonce que je vais m’installer à Capbreton pendant quelque temps pour rester aux côtés de Jérém pendant le début de sa rééducation, Albert n’hésite pas un instant.
— Pendant tout le temps que tu seras là-bas, tu n’auras pas à nous payer le loyer de l’appart. On te le garde jusqu’à l’automne, sans problème.
— On te le gardera le temps qu’il faudra, abonde Denis.
— Oui, le temps qu’il faudra, lui fait écho Albert.
— Merci beaucoup, merci de tout cœur ! je leur lance.
— On va dire que c’est notre contribution à la bonne cause de faire retrouver le meilleur de sa forme à ce beau et bon joueur, ainsi que le chemin du terrain de rugby.
— Merci, fait Jérém, l’air tout aussi ému que moi.
— C’est beau, ce que tu fais, Nico, avance Albert. Tout lâcher pour aider le garçon que tu aimes. Là, tu me plais, Nico. Certains avancent que nous, les pédés, ne sommes pas de hommes parce que nous ne sommes pas attirés par les femmes, il continue. Mais rappelle-toi ce que te dit un vieux croulant. Être un homme ne veut pas dire épouser une femme, aimer le foot ou le rugby, comme on veut nous faire croire dans le monde. Être un homme, c’est avant toute chose être droit et responsable, c’est protéger les siens, ceux qu’on aime, et qui nous aiment. Et là, Nico, tu n’as rien à envier à aucun soi-disant « homme ». Au contraire, il y a tant de guignols hétéros qui devraient prendre exemple sur toi.
— Le papi a raison, me lance Jérém, lorsque nous reprenons la route.
— Lequel ?
— Le plus âgé…
— Il a raison au sujet de quoi ?
— Un homme, c’est ce qu’il a dit.
Ulysse avait bien raison. Le roseau est toujours débout après le passage de la tempête.
Lundi 7 avril 2003, 17h12.
Le Centre de rééducation est situé juste derrière la plage. Depuis le parking, on entend le vrombissement des vagues, et on sent à plein nez les effluves d’eau salée.
Au check in, je suis touché que Jérém écrive mon nom et prénom et qu’il me demande mon numéro pour garnir la rubrique « Personne à appeler en cas d’urgence ».
Par ce simple geste, il acte le fait qu’il accepte ma présence, aussi longtemps que nécessaire, qu’il me fait confiance, qu’il apprécie que je sois là. Et ça me touche énormément.
La chambre de Jérém a vue sur l’Océan, sur le sable, sur le ciel. C’est magnifique. La chambre et le lit sont assez grands pour deux. Ça m’arrache le cœur de passer la nuit ailleurs. Mais pour l’aisance de Jérém, il est préférable que je m’en tienne aux plans, et que je trouve un hébergement dès ce soir.
Je demande à l’accueil, et la réceptionniste me donne les coordonnées d’un bailleur qui loue des meublés pour les accompagnants, à la semaine. Le prix n’est pas donné, mais j’ai pour consigne de ne pas m’arrêter sur ce genre de détail. C’est confortable de pouvoir compter sur la générosité désintéressée de mes deux jeunes et adorables sponsors. C’est dans le besoin, qu’on voit qui sont les vrais amis.
Le bailleur dispose de plusieurs studios à quelques centaines de mètres du Centre. J’en réserve un et je paie cash la première semaine de loyer.
Puis, Jérém et moi allons dîner au resto. C’est le dernier resto que nous allons partager pendant un bout de temps, parce qu’on nous a bien précisé à l’admission qu’à partir du début de la rééducation, l’alimentation de Jérém sera pilotée et surveillée afin d’optimiser ses chances de récupération. Alors je choisis un bon restaurant, et j’invite mon homme.
— Mais t’as vu les prix ? T’as gagné au loto, ou quoi ?
— T’inquiète, ça va aller.
Je passe une bonne soirée. Nous passons une bonne soirée. Jérém est favorablement impressionné par l’endroit et par l’accueil qui lui a été réservé. Tout dans ce Centre, la déco, les chambres, les tenues du personnel, dégage un côté professionnel et performant qui est très rassurant. Et la proximité de l’Océan, la puissance des éléments est un plus non négligeable.
Après le repas, je raccompagne mon beau au Centre. Je l’accompagne jusqu’à sa chambre, pour pouvoir lui faire un câlin et un bisou avant de lui souhaiter une bonne nuit.
Au moment de nous quitter, Jérém a l’air fébrile.
— Et si ça marche pas ? il me questionne, l’air complètement perdu et inquiet.
— Ça va marcher !
— Tu viens quand demain ?
— Je viendrai dans la matinée, j’attendrai que tu aies fini tes visites.
M’arracher de son étreinte, m’éloigner de ce garçon qui a besoin de moi et qui accepte enfin mon aide est une déchirure. C’est dur de le quitter. Mais il le faut. Je pleure pendant tout le trajet entre le Centre et le meublé.
Quelques minutes plus tard, je me retrouve seul dans cet appartement encore étranger. Je me sens perdu, et je ressens une boule au ventre à l’idée d’avoir laissé Jérém seul, lui aussi, seul avec ses angoisses. Il est 23 heures passées, mais j’ai besoin d’entendre une voix familière.
Je sais que Papa et Maman ne se couchent jamais avant minuit. J’appelle à la maison. Je tombe sur Papa.
— Tu as eu raison de l’accompagner, Nico, il va avoir besoin de toi, m’encourage Papa.
— J’espère arriver à suivre quand même mes cours, mes camarades m’ont promis de me passer leurs notes.
— Tu es assez doué pour y arriver.
Cette confiance et cette estime que Papa me témoigne depuis notre réconciliation me touchent toujours autant.
— J’espère.
— Des cours, ça peut se rattraper plus tard. Des blessures comme les siennes, il faut les panser maintenant.
— Hélas, je ne suis pas chirurgien, ni kiné…
— Je parlais des blessures intérieures, celles qui ne se voient pas, mais qui font le plus de dégâts.
— Je sais, Papa.
— Tu l’aimes, et il t’aime. Ta place est à ses côtés. Il a besoin de toi. Aide-le.
— J’espère qu’il va m’en laisser l’occasion…
— Dis-lui que c’est ton père qui t’envoie ! il plaisante.
Papa arrive à me tirer un sourire ému. Il me touche vraiment.
— Je suis fier de toi, Nico
— Merci Papa !
Ses encouragements me vont droit au cœur. Les mots de Maman vont dans le même sens, et je me sens compris et soutenu. Et ça fait un bien fou.
-
Commentaires
1Tds31Mercredi 31 Août 2022 à 18:30Quel épisode magnifique et émouvant. Et toujours et encore hâte de lire la suite. Bon courage pour l écritureRépondre2FredJeudi 1er Septembre 2022 à 14:02J'ai les larmes aux yeux.un magnifique épisode3SophieVendredi 2 Septembre 2022 à 00:00Super chapitre ! Tellement d'amour ! Je préfère ça aux scènes du début de l'histoire, un peu trop violentes et trop humiliantes à mon goût. Hâte d'avoir la suite...4YannLundi 5 Septembre 2022 à 10:04Cet épisode m'a vraiment cueilli aux tripes. D'abord par la tournure inattendue de l'histoire que je n'avais pas imaginée. Et puis aussi par l'amour, l'amitié, la bienveillance qui font surgir plein d'émotions. Même si, lors de l'accident avec le scooter Nico avait su prendre les choses en main. Là, on le découvre avec du caractère et beaucoup de détermination pour soutenir le garçon qu'il aime tout en sachant comment le prendre pour ne pas le braquer. Il faut dire qu'il a eu un soutien total : Ulysse, Thibault, Maxime, ses parents et toute la bande de Campan. Le plus beau compliment que lui fait Jérém c'est quand il lui dit qu'Albert avait raison sur ce qui fait un homme. C'était sa façon de se rattraper pour ce qu'il lui avait dit quelques mois plus tôt.
Pour aller mieux mentalement, je pense qu'il ne lui manque plus qu'une chose à Jérém, le soutien de ses coéquipiers et du staff. Pour son père …
5AlainLundi 5 Septembre 2022 à 18:50Comme d’habitude j’ai adoré . Cet épisode a même réussi à m’arracher des larmes .Bravo et vivement le prochain
6geblMardi 6 Septembre 2022 à 16:16J aime toujours les commentaires de Yann, mais tu as oublié le soutient très très fort du père de Nico

-
YannMercredi 7 Septembre 2022 à 07:13
Merci gebl. J'aime beaucoup cette histoire par tout ce qu'elle a d'authentique. Non, je n'ai pas oublié le père de Nico, je l'ai juste associé à sa mère en parlant du du soutien de ses parents.
-
 Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
 Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Jérém&Nico - Saison 1